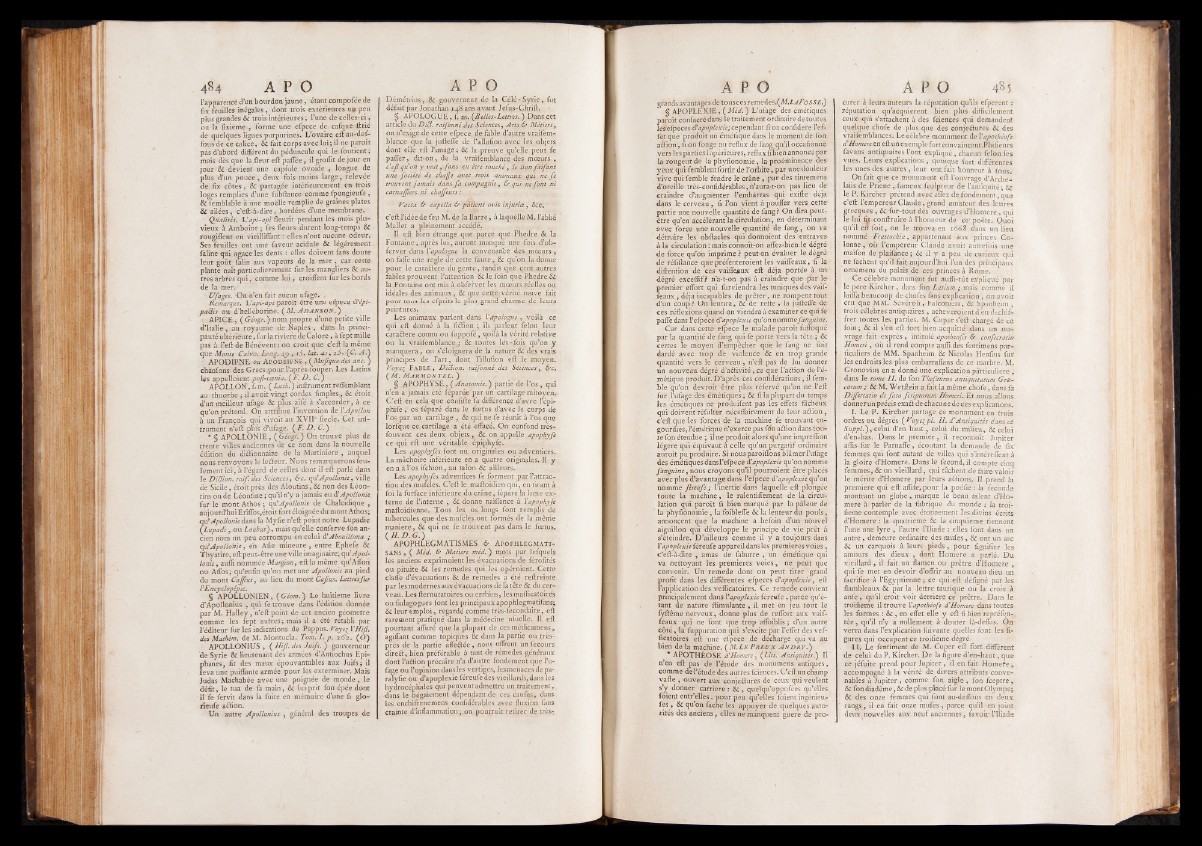
l’apparence d’un bourdon jaune, étant compofée de
fix feuilles inégales, dont trois extérieures us peu
plus grandes & trois intérieures ; l’une de celles-ci,
ou la fixieme., forme une efpece de cafque ftrié
de quelques lignes purpurines. L’ovaire eft au-def-
fousde ce calice, & fait corps avec lui; il ne par oit
pas d’abord digèrent du péduncute qui le foutient;
mais dès que la fleur eft paffée, il groflit de jour en
jour & devient une. capfule dvoïde , longue de
plus d’un' pouce, deux fois moins large, relevée
de fix côtes, 8c partagée intérieurement en trois
loges remplies d’une fubftance. comme fpongieufe ,
& fetnblable à une moelle remplie de graines plates
& ailées ; c’eft-à-dire, bordées d’une membrane,
Qualités. Vapi-api fleurit pendant les mois pluvieux
à Amboine ; fes fleurs durent long-temps 8c
rougiffent. en vieilliffant : elles n’ont aucune odeur.
Ses feuilles ont une faveur acidulé 8c légèrement
faline qui agace les dents : elles doivent fans doute
leur goût falin aux vapeurs de la m e r , car cette
plante naît particulièrement fur les mangliers 8c autres
arbres qui, comme lu i, croiffent fur les bords
de la mer.
Ufages. Onn’en fait aucun ufage. ,
Remarque. U api-api paroît être une efpece d'èpi-
paclis- ou d’helléborine. ( M. A d â n s o n . ) .
APICE, ( Géogr. ) nom propre d’une petite ville
d’Italie, au royaume de Naples , dans la principauté
ultérieure, fur la rivier’e de Calore, à fept mille
pas à.Teft de Bénévent: on croit que c’eft la même
que Monte Calvo. Long. 49,, a S . lat. 4/, 2$. (C. A.}
APOD1PNE ou A p .o d e i p n e , ( Mufique des anc. )
ehanfons des Grecs.pour l’après-foupér. Les Latins
les zpyeVLoxerA poß-ccenia,(F. D .C . )
APOLLON, f. m. ( Luth.) infiniment reffemblant
au ’ thuorbe ; il avoit vingt cordes fimples„ 8c étoit
d’un meilleur ufage & plus aife à s’accorder, a ce
qu’on prétend. On attribue l’invention de Y Apollon
à un François qui viVoit au XVIIe fiecle. Cet inl-
trument n’eft pluV d’ufage. (E . D . C.)
* § APOLLONIE, ( Géogr. ) On trouve plus de
trente villes anciennes de ce nom dans la nouvelle
édition, du diÉionnairtë de la Martiniere , auquel
nous renvoyons le lecteur. Nous remarquerons feulement
ic i, à l’égard de celles dont il eft parlé dans
le Diction, raif.des Sciences, &c. oy? Apollonie, ville
de Sicile, étoit près des Aloutins, 8c non des Léon-
tins ou de Léontine ; qu’il n’y a jamais eu d’Apollonie
fur le mont Athos ; qu’Apollonie de Chalcidique ,
aujourd’hui Eriffos,étoit fort éloignée du mônt Athos;
cpY Apollonie dans la Myfie n’eft point notre Lupadie
{Lupadi, ou Loubat) , mais qu’elle conferve fon ancien
nom un peu corrompu en celui <Y Abouillona ;
qu’'Apollonie, en Afie mineure , entre Ephefe 8c
Thyatire, eft peut-être une ville imaginaire; qu’Apollonie
, aufli nommée Margion, eft la même qu’Affon
ou Aflos; qu’enfin qu’on met une Apollonie au pied
du mont Cajjius, au lieu du mont Cafius. Lettres fur
VEncyclopépie.
§ APOLLONIEN, ( Gèom. ) Le huitième livre
d’Apollonius , qui fe trouve dans l’édition donnée
par M. Halley, n’eft point de cet ancien géomètre
comme les fépt autres; mais il a été rétabli par
l ’éditeur fur les indications de Pappus. Viye^ Y Hiß.
des Mathém. de M. Mpntucla. Tom. I. p .2 6 2 . (O)
APOLLONIUS , ( Hiß. des Juifs. ) gouverneur
de Syrie & lieutenant des armées d’Antiochus Epi-
phanes, fit des maux épouvantables aux Juifs; il
leva une puiffante armée pour les exterminer. Mais
Judas Machabée avec une poignée de monde, le
défit, le tua de fa main, 8c lui prit fon épée dont
il fe fervit dans la fuite en mémoire d’une fi glo-
rieufe aérion.
Un autre Apollonius , général des troupes de
Démétrius, 8c gouverneur de la Célé - Syrie, fut
défait par Jonathan 148 ans avant jefqs-Chrift. *
§ APOLOGUE, f. m. (B elles-Lettres. ) Dans cet
article du Dict. raifonné des Sciences, Arts & Métiers,
on n’exige de cette efpece de fable d’aptre vraifem-
blance que la jufteffe d,e i’allufion avec les objets
dont elle eft l’image ; 8c la preuve qu’elle peut fe
paffer, dit-on, de la vraifemblaUce des moeurs ,
c'efl quon y voit rfans'.en être touché , le lion faifant
une fociété de chajje avec trois animaux qui ne fe
trouvent jamais dans fa compagnie , 6* qui ne font ni
carnaffiers ni chaffturs :
Vacca & capella & patiens ovis injuria, 8cc.
c’eft l’idée de feu M. de la Barre, à laquelle M. l’àbbé
Mallet a pleinement accédé.
Il eft bien étrange que parce que Phedre & la
Fontaine, après lui, auront manque une fois d’ob-
ferver dans Y apologue la convenante des .moeurs,
on fafTe une réglé de cette faute, 8c qu’on la donne
pour le caraâiere du genre, tandis que cent autres
fables prouvent l’attention 8c le foin que Phedre 8c
la Fontaine ont mis <L obferver les moeurs réelles ou
idéales des animaux, 8c que cette)vérité naïve fait
pour tous les efprits le plus grand charme, de leurs
peintures. .
Les animaux parlent dans Y Apologue , voilà ce
qui eft donné à la fiérion ; ils parlent felpn leur
câràfterè connu .ou fuppofé, voilà la vérité relative
ou la vrailèmblance,; 8c toutes lés^ois qu’on y
manquera, on s’éloignera de la nature'& des vrais
principes de l’art, dont l'illufion eft le moyen.
Voye^ F A B L E , Diction, raifonné) des Sciences, &c.
( M . M a r m o n t e l . )
§ APOPHYSE, ( Anatomie.) partie de l’os , .qui
n’en a jamais été féparée par un cartilage mitoyen.
C ’eft en cela que confifte fa différence d’avec l’épi-
phife , os féparé dans le foetus d’avec le corps de
l’os par un cartilage , 8c qui ne fe réunit à l’os que
' lorfque ce. cartilage a été effacé. On confond très-
fouvent ces deux objets, 8c on appelle apophyfe
ce qui eft une véritable épiphyfe.
Les apophyfes-. font ou Originales ou adventices.
La mâchoire inférieure en a quatre originales. Il y
en a à l’os ifchion, au talon 8c ailleurs.
Les apophyfes adventices, fe*forment par l’attrac-
' tion des mufcles. C’eft le maftoïdien qui, en tirant à
foi la furface inférieure du crâne, fépare la lame exr
terne de l’interne , 8c donne naiffance à Y apophyfe
maftoïdienne. Tous les os longs font remplis, de
tubercules que des mufcles ont formés de la même
maniéré, 8c qui ne fe trouvent pas dans, le foetus,
( H. D . G. )
APOPHLEGMATISMES & A p o p h l e g m a t i -
SAN S , ( Méd. & Matière méd. ) mots- par lefquels
les anciens exprimoient les évacuations de férofités
ou pituite & lei remedes qui les opéroient. Cette
clafl’e d’évacuations & de remedes a été, reftreinte
par les modernes aux évacuations de la tête & du cerveau.
Les fternutatoires ou errhins,' lesmafticatoirès
ou fialagogues font les principaux apophlegmatifans;
& leur emploi, regardé comme très-fecondair.e, eft
rarement pratiqué dans la médecine ufuelle. Il eft
pourtant affuré que la plupart de ces méflicamens,
agiffant comme topiques & dans la partie ou très-
près de la partie affeâée, nous offrent un fecours
direâ, bien préférable à tant de rémedes généraux
dont l’a&ion précaire n’a d’autre fondement que l’u-
fage ou l’opinion dans les Vertiges, les menaces de pa-
ralyfie ou d’apoplexie féreufedes vieillards, dans les
hydrocéphales qui peuvent admettre un traitement,
'dans le bégaiement dépendant de çé$ caufes* dans
les enchifrenemens confidérables avec fluxion fans
crainte d’inflammation;;on pourvoit retirer de trèsgrands
avantages de tous ces remedes.(M.z:^A,o^5£.)
§ APOPLEXIE, ( Méd. ) L’ufagé des émétiques
paroît confacré dans le traitement ordinaire de toutes
les'efpeces $ apoplexie; cependant fi On confidere l’effet
que produit un émétique dans le moment de fonv
aftion, fi on fonge au reflux de fang qu’il occafionne
vers les parties fupérieures, reflux fi bien annoncé par
la rougeur de la phyfionomie, la proéminence des
yeux qui femblentfortir de l’orbite, par une douleur
vive qui femble fendre le crâne , par des tintemens
d’oreille très-confidérables, n’aura-t-on pas lieu de
craindre d’augmenter l’embarras qui exifte déjà
dans le cerveau , fi l’on vient à pouffer vers, cette
partie une nouvelle quantité de fang? On dira peut-
être qu’en accélérant la circulation, en déterminant
avec force une nouvelle quantité de fang., on va
détruire les obftacles qui donnoient des entraves
à la circulation : mais connoît-on affez-bien le dégré
de force qu’on imprime ? peut-on évaluer le dégré
de réfiftance que préfenteroient les vaiffeaux, fi la
difterition de ces vaiffeaux eft déjà portée à un
dégré exceffif? n’a:t-on pas à craindre que p’ar le
premier effort qui furviendra les tuniques des vaif-
.feaux , déjà incapables de prêter, ne rompent tout
d’un coup? On fentira, & de refte, la jufteffe de,
ces réflexions quand on viendra à examiner ce qui fe
paffe dans Yeïpece d’apopltxie qu’on nommefanguine.
Car dans cette efpece le malade paroît fuffoqué
par la quantité de fang qui fe porte vers la têtè^ &
certes le moyëh d’empêcher que le fang ne foit
dardé avec trop de violence & en trop gratide
quantité vers le cerveau, n’eft pas de lui donner
un nouveau dégré d’aftivité, ce que l'action de l’émétique
produit. D ’après ces confidérations, il femble
qu’on devroit être plus réfervé qu’on ne l’eft
fur l’ufage des émétiques ; & fi la plupart du temps
les émétiques ne produifent pas les effets fâcheux
qui doivent réfulter nécéffairement de leur aétion,
c’eft que les forces de la machine fe trouvant engourdies,
l’émétique n’exerce pas fdn aâiom dans toute
fon étendue ; il ne produit alors qu’une impreflion
légère qui équivaut à celle qu’un purgatif ordinaire
auroit pu produire. Si nous paroiflons blâmer l’ufage
des émétiques dansl’efpece d'apoplexie qu’on nomme
fanguine, nous croyons qu’il pourroient être placés
avec plus d’avantage dans l’efpece à!apoplexie qu’on
nomme ftreyfe ; l’inertie dans ‘laquelle eft plongée
toute la machine, le ralentiffement de la circulation
qui paroît fi bien marqué par la pâleur de
la phyfiônomie, la foibleffe & la lenteur du pouls,
annoncent que la machine a.befoin d’un nouvel
aiguillon qui développe le principe de vie prêt à
s’éteindre. D ’ailleurs comme il y a toujours dans
Y apoplexie féreufe appareil dans les premières voies,
c’eft-à-dire , amas de faburre , un émétique qui
va nettoyant les premières voies, ne peut que
convenir. Un remede dont on peut tirer grand
profit dans les différentes efpeces d'apoplexie, eft
l’application des veflicatoires. Ce remede convient
principalement dans Y apoplexie féreufe , parce qu’étant
de nature ftimulante , il met en jeu tout le
fyftême nerveux, donne plus de reflort aux vaiffeaux
qui ne font que trop affoiblis ; d’un autre
côté, la fuppuration qui s’excite par l’effet des vef-
ficatoires eft une efpece .de décharge qui va au
bien de la machine. ( M . L e P r e u x A n d r y . )
* APOTHÉOSE d’Homere 5 ( Litt. Antiquités) Il
n’en eft pas de l’étude des monumens antiques,
comme de l’étude des autres fciences. C’ eft:ûn champ
vafte , ouvert aux conjectures de ceux qui veulent
s’y donner carrière : & , quelqu’oppofées qu’elles
.ioieqt entr’elles, pour peu qu’elles foient ingénieur
fes , & qu on fâche les appuyer de quelques autorités
des anciens, elles ne manquent guere de procurer
à Ieiits auteurs la réputation qu’ils efperent :
réputation qu’acquierent bien plus difficilement
ceux '.qui s’attachent à des fciences qui demandent
quelque éhofe de plus que des eonjedures & des
vraisemblances. Le célébré monument de Yapothéofc
dlHomere en eft un exemple fort convaincant.Plufieurs
favans antiquaires l’ont expliqué, chacun félon fes
vues. Leurs explications, quoique fort différentes
les unes des autres , leur ont fait honneur à tous.
On fait que ce monument eft l’ouvrage d’Arche-
laiis de. Priene, fameux fculpteur de l’antiquité; 6c
le P. Kircher prétend .avec affez de fondement, que
c’eft l’empereur Claude, grand amateur des lettres
grecques , & fur-tout des ouvrages d’Homere', qui
le lui fit-conftruire à l’honneur de ce' poète. Quoi
qu’il eff fo it, on le trouva en 1668 dans un lieu
nommé Frattochia, appartenant aux princes Colonne,
où l’empereur Claude avoit autrefois une
maifon de plaifance ; & il y a peu de curieux qui
ne fâchent qu’il fait aujourd’hui l’un des principaux
ornemens du palais de ces princes à Rome.
Ce célébré monument fut aufli-tôt expliqué par
le pere Kircher, dans fon Latium ; mais comme il
laiffa beaucoup de chofes fans explication , on avoit
cru que MM. Sévéroli, Falconiéri, & Spanheim ,
trois célébrés antiquaires , acheveroient d’en déchiffrer
toutes les parties. M. Cupers’eft chargé de ce
foin ; & il s’en eft fort bien acquitté dans un .ouvrage
fait exprès , intitulé apotheofis & confecratiô
Homeri, où il rend compte aufli des fentîmens particuliers
de MM. Spanheim 6c Nicolas Henfius fur
les endroits les plus embarraffans de ce marbre* M.
Gronovius en a donné une explication particulière ,
dans le tome II. de fon Thefaurus antiquitatum Gm~
carum ; & M. Wetftein a fait la même chofe, dans fa
Differtatio de fato fcriptorum Homeri. Et nous allons
donner un précis exaft de chacune de ces explications.
I. Le P. Kircher partage ce monument en trois
ordres ou dégres ( Voye^pl. II. d'Antiquités dans ci
Suppl) y celui d’en haut, celui du milieu, 6c celui
d’en-bas. Dans le premier, il reconrioît Jupiter
aflis-fur le Parnaffe, écoutant la demande de fix
femmes qui font autant de villes qui s’intéreflent à
la gloirç d’Homere. Dans le fécond, il compte cinq
femmes, 6c un vieillard, qui tâchent de faire valoir
le mérite d’Homere par leurs aérions. Il prend la
première qui eft aflife, pour la poéfie : la féconde
montrant un globe, marque le beau talent d’Homere
à parler de la fabrique du monde : la troi-
fieme contemple avec, étonnement les divins écrits
d’Homere : la- quatrième êc la cinquième tiennent
l’une une lyre , l’autre l’Iliade : elles font dans un
antre, demeure ordinaire des mufes, 6c ont un arc
6c un carquois à leurs pieds, pour lignifier les
amours des dieux , dont Homere a parlé. Du
vieillard, il fait un flamen o,u prêtre d’Homere ,
qui fe met en devoir d’offrir au nouveau dieu un
facrifice à l’Egyptienne ; ce qui eft défigné par les
flambleaux 6c par la lettre tautique ou la croix à
anfe, qu’il croit voir derrière ce prêtre. Dans le
troifieme il trouve Y apothéofc d’Homere dans toutes
les formes : 6 c, en effet elle y eft fi bien repréfen-„
tée, qu’il n’y a nullement à douter là-deflus. On
verra dans l’explication fuivante quelles font les figures
qui occupent ce troifieme dégré.
I L Le fentiment de M. Cuper eft fort différent
de celui du P. Kircher. De la figure d en-haut, que
ce jéfuite prend pour Jupiter , il en fait Homefe ,
accompagné à la vérité de divers attributs convenables
à Jupiter, comme fon aigle , fon fceptre,
8c fon diadème, 6c de plus placé fur le mont Olympe;
6c des onze femmes qui font au-deffous en deux
rangs., il en fait onze mufes , parce qu’il en joint
deux,nouvelles aux neuf anciennes, lavoir l’Iliade