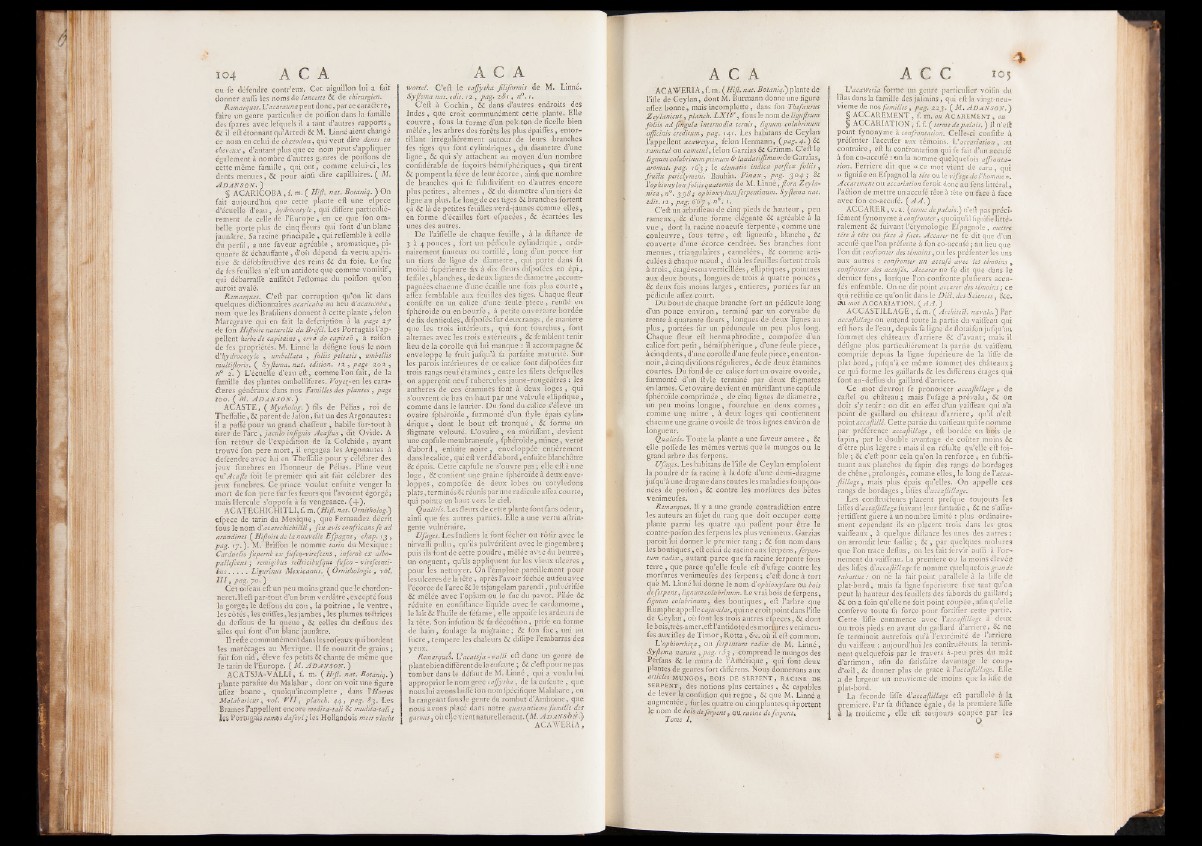
ou fe défendre contr’eux. Cet aiguillon lui a fait
donner auffi les noms de lancette 8c de chirurgien.
Remarques. Vacarauna peut donc, par ce caraâere,
faire un genre particulier de poiffon dans la famille
des fpares avec lefquels il a tant d’autres rapports,
8c il eft étonnant qu’Artedi 8c M. Linné aient changé
ce nom en celui de chceiodon, qui veut dire dents en
cheveux, d’autant plus que ce nom peut s’appliquer
également à nombre d’autres genres de poiffons de
cette même famille , qui ont, comme^ celui-ci, les
dents menues, 8c pour ainfi dire capillaires. ( M.
A d a N s o n . )
§ ACARICOBA , f. m. ( Hift. ndt. Botaniq.) On
fait aujourd’hui que cette plante eft une elpece
d’écuelle d’eau , hydrocotyle, qui différé particuliérement
de celle de l’Europe, en ce que fon ombelle
porté plus de cinq fleurs qui font d’un blanc
jaunâtre. Sa racine principale , qui reffemble à Celle
du periil, aune faveur agréable , aromatique, piquante
& échauffante, d’où dépend fa vertu apéri-
tive 8c défobftruftive des reins 8c du foie. Le lue
de les feuilles n’eft un antidote que comme vomitif,
qui débarraffe auffitôt l’eftomac du poiffon qu’on
auroit avalé.
Remarques. C ’eft par corruption qu’on lit dans
quelques dictionnaires acaricaba au lieu d'acaricoba,
nom que les Braliliens donnent à cette plante , félon
Marcgrave qui en fait la defeription à la page 2y
de fon Hijloire naturelle du Bréjil. Les Portugais l’appellent
herbe de capitaine , erva do capitao , à raifori
de fes propriétés. M. Linné la défigne fous' le nom
d’hydrocotyle , umbellata , foliis peltatis, umbellis
multiûoris. ( Syjlema. nat. édition, iz , page z o z ,
n° z. ) L’écuelle d’eau eft, comme l’on fait, de la
famille des plantes ombelliferes. Voye{-en les caractères
généraux dans nos Familles des plantes , page
ïô o . ( M. A n a n s o n . )
A C A S T E , ( Mytholog. ) fils de Pélias , roi de
Theffalie, 8c parent de Jalon, fut un des Argonautes :
il a paffé pour un grand chaffeur , habile fur-tout à
tirer de l’arc , jaculo injignis Acaftus , dit Ovide. A
fon retour de l’ expédition de la Colchide, ayant
trouvé fon pere mort, il engagea les Argonautes à
defeendre avec lui en Theffalie pour y célébrer des
jeux funèbres en l’honneur de Pélias. Pline veut
qu’Acafte foit le premier qui ait fait célébrer des
jeux funèbres. Ce prince voulut enfuite venger la
mort de fon pere fur fes foeurs qui l’avoient égorgé;
mais Hercule s’oppofa à fa vengeance. (+ ) .
A C ATECHICHITLI, f. m. (Hijl. nat. Ornitholog.)
efpece de tarin du Mexique, que Fernandez décrit
fous le nom d'‘acateckichiclli, feu avis confricans fe ad
arundines (Hijloire de la nouvelle Efpagne, chap. 13 ,
pag. 17. ). M. Brifîon le nomme tarin du Mexique :
Carduelis fupemï ex fufeq-virefeens , infèrnê ex albo-
pallefcens ; remigibus reclricibufque fufco - virefeentibus..........
Ligurinus Mexicanus. ( Ornithologie , vol.
1 1 1 , pag. 70. )
Cet oifeau eft un peu moins grand que -le-chardon-
neret. 11 eft par-tout d’un brun verdâtre, excepté fous
la gorge ; le defîous du cou , la poitrine , le ventre,
les côtés, les cuiffes, les jambes, les plumes teClrices
du deffous de la queue, 8c celles du defîous des
ailes qui font d’un blanc jaunâtre.
llrefte commu nément dans les rofeaux qui bordent
les marécages au Mexique. 11 fe nourrit de grains;
fait fon nid, élève fes petits 8c chante de même que
le tarin de l’Europe. ( M. A d a n s o n . )
ACATSJA-VALLI, f. m. ( HJL nat. Botaniq. )
plante paraflte du Malabar, dont on voit une figure
affez bonne , quoiqu’incomplette , dans YHortus
Malabaricus, vol. V I I , planch. 4 4 , pag. 83. Les
Brames l’appellent encore medica-tali 8c mudtid-tali ;
jes Portugais ramùs dafeyi; les Hollandais meer vlecht
wortel. C’eft le cajfytha filiformis de M. Linné.
Syjlema nat. edit. iz , pag. z 8 i , n°. 1.
C ’eft à Cochin, 8c dans d’autres endroits des
Indes, que croît communément cette plante. Elle
couvre , fous la forme d’un peloton de ficelle bien
mêlée., les arbres des forêts les plus épaiffes, entortillant
irrégulièrement autour de leurs branches
fes tiges qui font cylindriques, du diamètre d’une
ligne, 8c qui s’y attachent au moyen d’un nombre
confidérable de fuçoirs hémifphériques , qui tirent
8c pompent la fève de leur écorce, ainfi que nombre
de branches qui fe fubdivifent en d’autres encore
plus petites , alternes , 8c du diamètre d’un tiers de
ligne au plus. Le long de ces tiges 8c branches fortent
çà 8c là de petites feuilles verd-jàunes comme elles,
en forme a’écailles fort efpacées, 8c écartées les
unes des autres.
De l’aiffelle de chaque feuille , à la diftance de
3 à 4 pouces , fort un pédicule cylindrique, ordinairement
finueux ou tortillé, long d’un pouce fur
un tiers de ligne de diamètre., qui porte dans fa
moitié fupérieure fix à dix fleurs difpofées en épi ,
fefliles, blanches, de deux lignes de diamètre, accompagnées
chacune d’une écaille une fois plus courte ,
affez femblable aux feuilles des tiges; Chaque fleur
confifte en un calice d’une feule pie ce, renfle en
fphéroïde ou en bourfe, à petite ouverture bordée
de fix denticule's, difpofés fur deux rangs, de maniéré
que les trois intérieurs, qui font fourchus,. font
alternes avec les trois extérieurs , 8c femblent tenir
lieu de la corolle qui lui manque : il accompagne 8c
enveloppe le fruit jufqu’à fa parfaite maturité. Sur
les parois intérieures de ce calice font difpofées fur
trois rangs neuf étamines , entre les filets defquellés
on apperçoit neuf tubercules jaune-rougeâtres : les
anthères de ces étamines font à deux loge s, qui'
s’ouvrent de bas en haut par une valvule elliptique ,
comme dans le laurier. Du fond du calice s’élève un
ovaire fphéroïde , furmonté d’un ftyle épais cylindrique
, dont le bout eft tronqué, 8c forme un
ftigmate velouté. L’ovaire, en mûriffant, devient
une capfule membraneufe, fphéroïde, mince, verte
d’abord, enfuite noire, enveloppée entièrement
dans le calice, qui eft verd d’abord, enfuite blanchâtre
8c épais. Cette càpfule ne s’ouvre pas ; elle eft,à une
lo ge , 8c contient une graine fphéroïde à deux enveloppes
, compofée de deux lobes ou cotylédons
plats, terminés 8c réunis par une radicule affez courte,
qui pointe en haut vers le ciel.
Qualités. Les fleurs de cette plante font fans odeur ,
ainfi que fes autres parties. Elle a une vertu aftrin-
gente vulnéraire.
Ufages. Les Indiens la font fécher ou rôtir avec le
nirvalli pullu, qu’ils pulvérifent avec le gingembre ;
puis ils font de cette poudre, mêlée avec du beurre,
un onguent, qu’ils appliquent fur les vieux ulcer-es ,
pour les nettoyer. On l’emploie pareillement pour
les ulcérés de la tê te , après l’avoir féchée au feu avec
l’écorce de l’arec 8c le tsjangelam parendi, pulvérifée
8c mêlée avec l’opium ou le fuc du pavot. Pilée 8c
réduite en confiftance liquide avec le cardamome,
le lait 8c l’huile de féfame, elle appaife les ardeurs de
la tête. Son infufion 8c firdéco&ion, prife en forme
de bain, foulage la migraine ; 8c fon fu c , uni au
fucre, tempere les chaleurs 8c diffipe l’embarras des
yeux.
Remarqué. L’acatsja-Vulli eft donc un genre de
plante-bien différent de la eufeute ; 8c c’eft pourne pas
tomber dans le défaut de M. Linné , qui a voulu lui
approprier le nom grec cajfytha , de la eufeute , que,
nous lui avons laiffé fon nomfpécifique Malabare, en
la rangeant fous le genre du rombut d’Amboine, que
nous avons placé dans notre quarantième famille des
garons 3 où elle vient naturellement. (M .A d a n s ô n .)
ACAAVERIA,
%
ACANVERIAjf. m. (Hift. nat. Botaniq!) plante de
l’ifle de Ceylan, dont M. Burmann donne une figure
affez bonne, mais incomplette, dans fon Thefauras
Zeylanicus, planch. L X I F , fous le nom de liguflrum
foliis ad JÎÉgtda internodia ternis, lignum colubrinum
afficinis créditum, pag. 141. Les habitans de Ceylan
l’appellent acawerya, félon Hermann, (pag. 4 .) 8c
rametul ou came tu f félon Garzias 8c Grimm. C’eft le
lignum colubrinumprimum & Laudatifjimurnde Garzias,
aromat. pag. 163; le clematis indica perjica fo liis ,
fructu periclymeni. Bauhin. Pinax , pag. 3 04 ; 8c
Vopkionylonfoliis.quaternis de M. Linné, fora Zeyla-
nica, n°. 3ÿ8; ophioxylumferpentinum. Syjlema nat.
edit. iz , pag: 667 , n°:- i-,
C’eft un arbriffeau de cinq pieds de hauteur , peu
rameux, 8c d’une forme élégante 8c agréable à la
vue , dont la racine noueufe ferpente , comme une
couleuvre, fous terre, eft ligneufe, blapche , 8c
couverte d’une écorce cendrée. Ses branches- font
menues , triangulaires , Cannelées, 8c comme articulées
à chaque noeud, d’où les feuilles fortent trois
à trois, étagées ou verticillées, elliptiques, pointues
aux deux bouts, longues de trois à quatre pouces,
8c deux fois moins larges , entières , portées fur un
pédicule affez court.
Du bout de chaque branche fort un pédicule long
d’un pouce environ, terminé par un corymbe de
trente à quarante fleurs , longues de deux lignes au
plus, portées fur un péduneule un peu plus long.
Chaque fleur eft hermaphrodite, compofée d’un
calice fort p etit, hémifphérique , d’une feule piece,
à cinq dents, d’une corolle d’une feule piece, en entonnoir
, à cinq divifions régulières, 8c de deux étamines
courtes. Du fond de ce calice fort un ovaire ovoïde,
furmonté d’un ftyle terminé par deux ftigmates
en lames. Cet ovaire devient en mûriffant une capfule
fphéroïde comprimée , de cinq lignes de diamètre,
un peu moins longue, fourchue en deux cornes,
comme une mitre , à deux loges qui contiennent
chacune une graine ovoïde de trois iignes environ de
longueur.
Qualités. Toute la plante a une faveur amere , 8c
elle poffede les mêmes vertus que le mungos ou le
grand arbre des ferpens.
Ufages. Les habitans de l’ifle de Ceylan emploient
la poudre de fa racine à la dofe d’une demi-dragme
jufqu’à une dragme dans toutes les maladies foupçon-
nées de poifon, 8c contre les morfures des bêtes
venimeufes.
Remarques. Il y a une grande contradiftion entre
les auteurs au fujet du rang que doit occuper cette
plante parmi les quatre qui paffent pour être le
contre-poifon des ferpens les plus venimeux. Garzias
paroît lui donner le premier rang ; 8c fon nom dans
les boutiques, eft celui de racine aux ferpens ,ftrpen-
tum radix, autant parce que fa racine ferpente fous
terre , que parce qu’elle feule eft d’ufage contre les
morfures venimeufes des ferpens ; c’eft donc à tort
que M. Linné lui donne le nom à’ophioxylum ou bois
d e f irpent, lignum colubrinum. Le vraibois de ferpens,
lignum colubrinum, des boutiques, eft l’arbre que
Rumphe appelle caju-ular, qui ne croît point dans l’ifle
de Ceylan, oh font lés trois autres efpeces, 8c dont
le bois,très-amer,eft l’antidote dés morfures venimeufes
auxifles de Timor, Rotta, &c. où il eft commun.
L ’ophiorrhiça, ou ferpentum radix de M. Linné,
Syjlema natures, pag. 1S3 , comprend le mungos des
Perfans 8c le mitra dè l’Amérique , qui font deux
plantes de genres fort différens. Nous donnerons aux
articles MUNGOS, BOIS DE SERPENT, RACINE DE
serpent, . dès notions plus certaines, 8c capables
de lever la confufion qui régné, 8c que M. Linné a
augmentée, furies quatre ou cinq plantes qui portent
1? nom de bois deferpent f ou racine de ferpente
Tome I i
VâcaWeria forme tin genre particulier voifin du
lilas dans la famille des jafmins, qui eft la vingt-neu»
vieme de nos familles, pag. z z j . ( M. A d a n s o n . )
§ ACCAREMENT, f. m. ou Acarement , ou
§ A C C A R IA T IO N ,f.f.( terme de palais. ) Il n’eft
point fynonyme à confrontation. Celle-ci confifte à
prefenter laccufer aux témoins. accariation, au
contraire, eft la confrontation qui fe fait d’un accufé
à fon co-accufé : on la nomme quelquefois affronta-
tion. Ferriere dit que « ce mot vient de cara, qut
» fignifie en Efpagnol la tête ou le v if âge de l'homme ».
Accarement ou accariation feroit donc au fens littéral,
l’a&ion de mettre un accufé tête à tête ou face à face
avec fon co-accufé. (A A . )
ACC ARER, v. a.' (terme de palais.) n’eft pas préci*
fément fynonyme à confronter , quoiqu’il fignifie littéralement
8c fuivant l’étymologie Elpàgnole , mettre
tête à tête ou face d face. Accarer ne fe dit que d’un
accufé que l’on préfente à fon co-accufé ; au lieu que
l’on dit confronter des témoins, ou les préfenter les uns
aux autres : confronter un accufé avec les témoins ,
confronter des accufés. Accarer ne fe dit que dans le
dernier fens, lorfque l’on confronte plufieurs accufés
enfemble. On ne dit point accarer des témoins ; ce
qui reriifie ce qu’on lit dans le Dicl. des Sciences, 8cc.
au mot A ccariation. (A A . )
ACCASTILLAGE, f. m.. ( Architecl. navale.) Par
accaftillage on entend toute la partie du vaiffeau qui
eft hors de l’eau, depuisfa ligne de flotaifon jufqu’au
fommet des châteaux d’arriere 8c d’avant; mais il
défigne plus particuliérement la partie du vaiffeau
comprife depuis la ligne fupérieure de la liffe de
plat bord, jufqu’à ce même fommet des châteaux;
ce qui forme les gaillards 8c les différens étages qui
font âu-deffus du gaillard d’arriere.
Ce mot devroit fe prononcer accaflellage , de
caftel ou château ; mais Pufage a- prévalu, 8c on
doit s’y tenir : on dit en effet d’un vaiffeau qui n’a
point de gaillard ou château d’arriere, qu’il n’eft
point accaftillé. Cette partie du vaiffeau qui fe nomme
par préférence accaftillage, eft bordée en bois de
fapin, par le double avantage de coûter moins 8c
d’être plus légère : mais il en réfulte qu’elle eft foi-
ble ; 8c c’eft pour cela qu’on la renforce ,- en fubfti-
tuant aux planches de fapin des rangs de bordages
de chêne, prolongés, comme elles, le long de Yacca~
Jlillage, mais plus épais qu’elles. ■ On appelle ces
rangs de bordages , lifi'es d'accaftillage.
Les conftrufteurs placent prefque toujours les
liffes d’accaftillage fuivant leur fantaifie , 8c ne s’affu-
jettiffent guere à un nombre limité : plus ordinairement
cependant ils en placent- trois dans les- gros
vaiffeaux , à quelque diftance les unes des autres :
on arrondit leur faillie ; 8c , par quelques mollir es
que l’on trace deffus, on les fait fervir auffi à l’ornement
du vaiffeau. La première ou la moins élevée
des liffes d'accaftillage fe nomme quelquefois grande
rabattue: on ne la fait point parallèle à la liffe de
plat-bord, mais fa ligne fupérieure fixe tant qu’en
peut la hauteur des feuillets des fabords du gaillard;
8c on a foin qu’elle ne foit point coupée, afin qu’elle
conferve toute fa force pour fortifier cette partie.
Cette liffe commence avec Y accaftillage à deux
ou trois pieds en avant du gaillard d’arriere, 8c ne
fe terminoit autrefois qu’à l’extrémité de 1 arriéré
du vaiffeau : aujourd’hui les conftru&eurs la terminent
quelquefois par le travers à-peu-près du mâfi
d’artimon, afin de fatisfaire davantage le coup-
d’oe il, 8c donner plus de grâce à Y accaftillage. Elle
a de largeur un neuvième de moins que la liffe de
plat-bord. - . r v ' . . •
La fécondé liffe d'accaftillage eft parallèle à la
première. Par fa diftance égale, de la première liffe
à la troifieme, elle eft toujours coupée par les