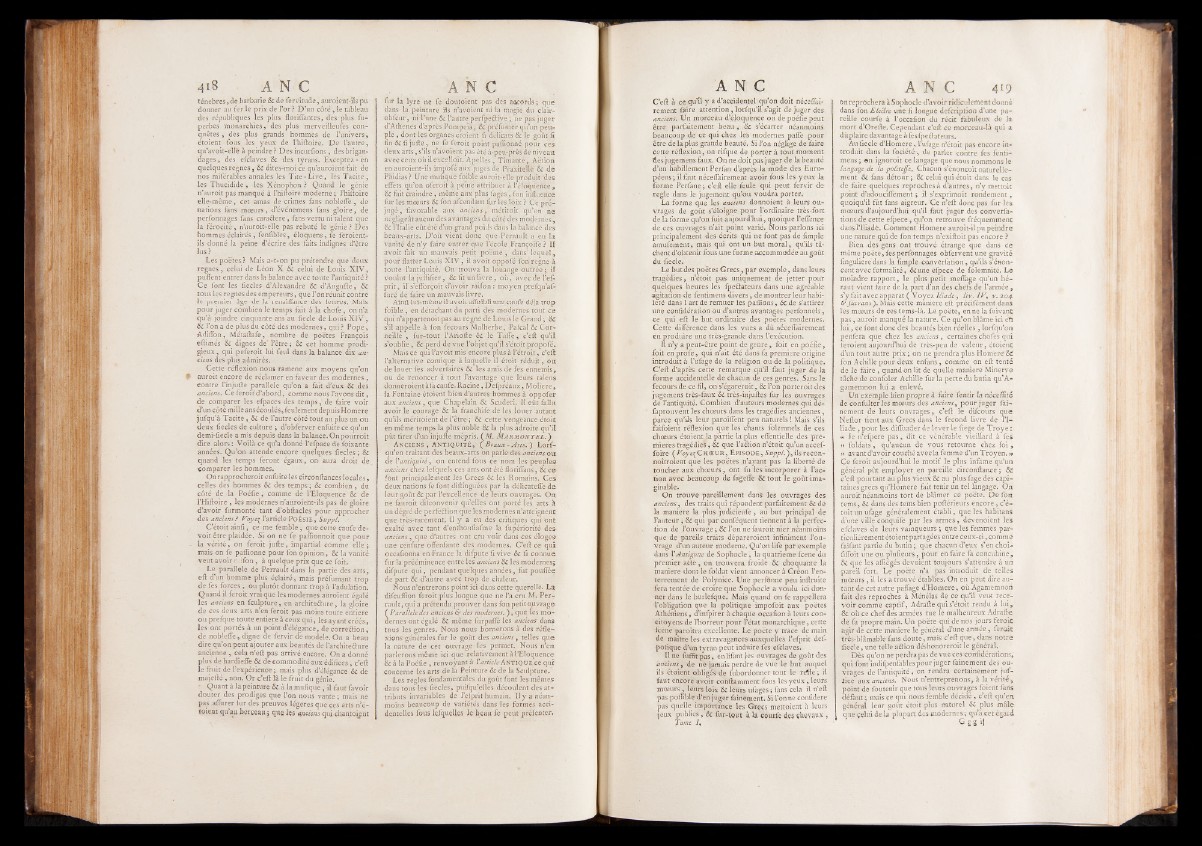
ténèbres, de barbarie & de fervitude, auroie'nt-ils pu
donner au ferle prix de l’or ? D ’un côté , le tableau
-des républiques les plus floriffantes, des plus fu-
perbes monarchies, des plus merveilleufes conquêtes,
des plus grands hommes de l’univcrs,
étoient fous.-Jes yeux de l’hiftoire. De l’autre,
qu’avoit-ëllë à peindre ? Des ineurfions, des brigandages
, des efclaves & -des tyrans. Exceptez- en
quelques régnés, & dites-moi ce qu’auroient-fait de
nos miférables annales les Tite -L iv e , lès Tacite,,
les Thueidide, les Xénophon ? Quand', le génie
n’auroit pas manqué à Thjiftoire moderne ; l’hiftoire
elle-même, cet amas de crimes fans noblefl'e, de
nations fans moeurs, d’événemens fans gloire, de
perfonnages fans caractère, fans vertu ni talent que
la férocité , n’auroit-elle pas rebuté le génie ? Des
hommes éclairés, fenfibles, éloquens, fe feroient-
ils donné la peine d’écrire des faits indignes d’être
lus ? •
Les poëtes ? Mais a-t-on pu prétendre que deux
régnés, celui de Léon X & celui de Louis XIV,
puffent entrer dans la balance avec toute l’antiquité ?
Ce font les fiecles d’Alexandre & d’Augufte, &
tous les régnés des empereurs, que l’on réunit contre
le premier âge de la renaiffance des lettres. Mais
pour juger combien le temps fait à.la chôfe, on n’a
qu’à joindre cinquante ans au, fiecle de Louis X IV ,
& l’on a de plus du côté des modernes, qui ? Pope,
•Adiffon, Métaftafe, nombre de poëtes François
eftimés & dignes dé* l’être; & cet homme prodigieux,
qui peferoit lui feul dans la balance dix anciens
des plus admirés.
Cette réflexion nous ramene aux moyens qu’on
• auroit encore de réclamer en faveur des modernes ,
contre l’in jufte parallèle qu’on a fait d’eux & des
anciens. Ce feroit'd’abord, comme nous l’avons dit,
de comparer les efpaces des temps, de faire voir
d’un côté mille ans écoulés, feulement depuis Homere
jùfqu’à Tacite, & de l’autre côte tout au plus un ou
deux fiecles de culture ; d’obferver enfuite ce qu’un
demi-fiecle amis depuis dans la balance.Onpourroit
dire alors : Voilà ce qu’a donné l’efpace de foixante
années. Qu’on attende encore quelques fiecles ; &
quand les temps feront égaux, on aura: droit de
-comparer les hommes.
On rapprocheroit enfuite les circonflances locales,
celles des hommes & des temps; & combien, du
côté de la Poéfie, comme de l’Eloquence & de
l’Hiftoire , les modernes n’auroient-ils pas de gloire
d’avoir furmonté tant d’obftacles pour approcher
des anciens? Voye^ l’article Poésie, Suppl.
C’étoit ainfi, ce me femble, que cette caufe de-
voit être plaidée. Si on ne fe paffionnoit que pour
- la vérité, on feroit jufte, impartial comme elle ;
mais on fe paffionne pour fon opinion , & la vanité
veut avoir r .ifon, à quelque prix que ce foit.
Le parallèle de Perrault dans la partie des arts,
eft d’un homme plus éclairé, mais préfumant trop
de fes forces , ou plutôt donnant trop à l’adulation.
Quand il ferpit .vrai que les modernes auraient égalé
les anciens en fculpture, en architecture, la gloire
de ces deux arts n’en feroit pas moins toute entière
ou prefque toute entière à ceux qui, les ayant créés,
les ont portés à un point d’élégance, de correction,
de noblefl'e, digne de fervir de modèle. On a beau
dire qu’on peut ajouter aux beautés de l’archite&ure
ancienne, cela n’eft pas arrivé encore. On a donné
plus de hardiefle & de commodité aux édifices c’eft
le fruit de l’expérience ; mais plus d?élégance & de
majefté , non. Or c’eft tà le fruit du génie.
Quant à la peinture & à la mufique, il faut fa voir
douter des prodiges que l’on nous vanté ; mais ne
pas aflurer fur des preuves légères que ces arts n’é-
toient qu’au berceau j que les ajicims qui çhantojpot
fut la lyre ne fe doütoient pas dés aocords ; que
dans la peinture ils n’avôient ni la magie du clair-
obfcur, ni l’une & l’autre perfpeérive ; n,e pas juger
d’Ath'enes d’après Pompeïa, & préfumef qu’un peuple
, dont les organes étoient fi délicats & le goût fi
fin & fi jufte, ne fe feroit point paflïonné pour ces
deux arts, s’ils n’âvoient pas été à-peu-près de niveau
avec ceux où il excelloit. Apelles , Timàntè, A.ëtioii
en auroient-ils impofe'aux jugés de Praxitéllë & de
Phidias? Une mufique foible auroit élle produit 'des
effets qu’on oferoit à pèin'e attribuer à l’éloquence,
&c fait craindre, même aux plus fages, fon influence
fur les moeurs & fori afcendant fur les lôix ? Ce préjugé
, favorable aux anciens, méritôit qu’on ne
négligeât aucun des avantagés dii côté des modernes ,
& l’Italie eûtété d’un grand poids dans là balance des
beàüx-arts. D’où vient donc que.Perrault a eu la
vanité de n’y faire entrer que l’école Françoise ? II
a voit fait un mauvais petit poëme , dans’ lequel,
pour flatter Louis X IV , il âvoit oppofe fon régné à
toute l’antiquité. On trouva la louange outrée ; if
voulut la juftifier, & fit un livre, où, avec de l’efi
prit, il s’efforçoit d’avoir raifon : moyen prefqu’afi
furé de faire un mauvais livre.
Ainfi lui-même il avoit àffoibli une caufe déjà trop
foible, en détachant du parti des modernes tout Ce
qui n’appartenoit pas au régné de Louis le Grand ; &c
s’il appelle à Ion fecours Malherbe, Pafcal & Corneille
, fur-tout l’Ariofie & lé Tafle,. c’eft qu’il
s’oublie, & perd de vue l ’objet qu’il s’étdit propofé.
Mais ce qui l’avoit mis encore plus à l’étroit, c’eft
l’alternative comique à laquelle il étoit réduit, ou
de louer fes adverfaires & les amis de fes ennemis,
ou de renoncer à tout l’avantage que' "leurs talens
donneraient à fa caufe. Racine, Defpréaux, Moliere,
la Fontaine étoient bien d’autres hommes à oppofer
aux anciens, que Chapelain & Scuderi. Il eût fallu
avoir le courage & la franchife de les louer autant
qu’ils méritoient de i’être ; & cette vengeance étoit
en même temps la pliis'noble & la plus adroite qu’il
pût tirer d’un injufte mépris. (M. Ma rm o n t e l . )
A n c i e n s , A n t i q u i t é , (Beaux-Arts. ) Lorfi-
qu’en traitant des beaux-arts on parle des anciens ou
de l’antiquité, on entend fous ce nom les peuple»
anciens chez lefquels ces arts ont été floriffans, & ce
font principalement les Grecs & les Romains. Ces
deux nations fe font diftinguées par la délicateffe de
leur goût & par l’excellence de leurs ouvrages. On
ne fauroit difconvenir qu’elles ont porté les. arts à
un degré de perfection que les modernes n’atteignent
que très-rarement. Il y â eu des,critiques qui ont
exalté avec tant d’enthoufiafme la fupériorité des-
anciens, que d’autres ont cru voir dans cès éloges»
une cenfure ôffenfante des modernes. C’eft ce qui
occafionna en France la difpute fi vive & fi connu b
fur la prééminence entre les anciens & les modernes;
difpute qui, pendant quelques années, fut pouffée
de part & d’autre avec trop, de chaleur.
Nous n’entrerons point ici dans cette querelle. La
difcuifion feroit.plus.longue que ne l’a cru M. Perrault,
qui a prétendu prouver dans fon petit ouvrage-
Parallèle des anciens & des modernes. ) , que, les mo-
ernes ont égalé & même furpaffé les anciens dans
tous les genres. Nous nous bornerons à des réfle--
xions générales fur le goût des anciens, telles que
la nature de cet ouvrage les permet. Nous n’en
parlerons même ici que relativement à l’Eloquence
& à la Poéfie , renvoyant à article A n t i q u e ce q u i
concerne les arts delà Peinture & de la Sculpture.
Les réglés fondamentales du goût font les mêmes
dans tous les fiecles, piiifqu’elles découlent des attributs
invariables de l’efprit humain. Il y a néanmoins
beaucoup de variétés dans les formes accidentelles
fous léfquellçs le beau fe peut préfentcr.
C’eft à ce qu’il y a d’accidentel qu’on doit néceflai-
rement faire a tten tio n , lorfqu’il s’agit de juger des
anciens. Un morceàu d’éloquence ou de poéfie peut
être parfaitement beau , & s’écarter néanmoins
beaucoup de ce qui chez l.e's modernes paffe pour
ê tre de la plus grande beauté. Si l’on néglige de faire
ce tte réflexion, on rifque de porter à to u t moment
Îles jugemens faux. On ne doit pas juger de la beauté
d’un habillement Perfan d’après la mode des Européens
; il faut néceffairement avoir fous les y eux la
forme Perfane ; c’eft elle feule qui peut fervir de
réglé dans le jugement qu’o u voudra porter.
La forme que les anciens donnoient à leurs o u vrages
de goût s’éloigne p o u r l’ordinaire très-fort
de la forme qu’on fuit aujourd’h u i, quoique l’eflence
de ces ouvrages n’ait point varié. Nous .parlons ici
principalement des écrits qui ne font pas de fimple
amufement, -mais qui ont un but m o ra l, qu’ils tâchent
d’obtenir fous une forme accommodée au goût
du fiecle.
Le but des poëtes G re c s, par exemple, dans leurs
tragédies, n’étoit pas uniquement de je tte r pour
quelques heures les fpeûateurs dans une agréable
agitation de fentimens d iv ers, de montrer leur habileté
dans l'a rt de remuer les paflîons , & de s’attirer
une confidération ou d’autres avantages perfonnels,
ce qui eft le but ordinaire des .poëtes modernes.
C e tte différence dans les vues a dû néceffairement
en produire une très-grande dans l'exécution.
Il n’y a peut-ê tre point de gen re, foit en poéfie,
foit en p ro fe , qui n’ait été dans fa première origine
introduit à l’ufage de la religion ou de la politique.
C ’eft d’après cette remarque .qu’il faut juger de la
forme accidentelle de chacun de ces genres. Sans le
fecours de ce fil, on s'éga rerait, & l’on p orterait des
jugemens très-faux & très-injuftes fur les ouvrages
de l’antiquité. Combien d’auteurs modernes qui dé-
faprouvent les choeurs dans les tragédies anciennes,
parce qu’ils leur paroiffent peu naturels ! Mais s’ils
iaiforènt réflexion que les chants folemnels de ces
choeurs étoient la partie la plus effentielle des p re mières
tragédies, & que l’a â io n n’étoit qu’unaccef-
foire C h oe u r , E p i s o d e , 5'«/y>/.)-, ilsrec o n -
noîtroient que les poëtes n’ayant pas la liberté de
toucher aux choe u rs, ont fu les incorporer à l’action
avec beaucoup de fageffe & to u t le goût imaginable.
On trouve pareillement dans les ouvrages des
anciens, des traits qui répondent parfaitement & de
la manière la plus jüdicieufe, au but principal de
l’auteiir , & qui par conféquent tiennent à la perfection
de l’ouvrage ; & l’on ne fauroit nier néanmoins
que de pareils traits dépareraient infiniment l’o u vrage
d’un auteur moderne. Q u’on life p a t exemple
dans l’Antigone de Sophocle, la quatrième fcene du
premier a û e , on trouvera froide & choquante la
maniéré dont le foldat vient annoncer à Créon l’enterrement
de Polynice. Une perfônne peu inftruite
fera tentée de croire que Sophocle a voulu ici donner
dans lé burlefque. Mais quand on fe rappellera
l’obligation que la politique impofoit aux poëtes
Athéniens, d’infpirer à chaque occafion à leurs concitoyens
de l’horreur pour l’état monarchique, cette
fcene paroîtra excellente. Le poëte y trace de main
de maître les extravagances auxquelles l’efprit défi
potiqtie d’un tyran peut induire fes efclaves.
Il ne fuffit p a s , en lifant }es ouvrages de goût des
anciens, de nè jamais perdre de vue -le b u t auquel
ils étoient obligés de fubordonner tout le re fte ; il
faut encore avoir conftamment fous les y e u x , leurs
moeurs , leurs loix & leurs ufages ; fans cela il n’eft
pas pofîible d’en juger fainement. Si l’on ne confidere
pas quelle importance les Grecs mettoient à leurs
jeux publics, & fur-tout à la courfe des çheyaux ,
J'orne h
on reprochera à Sophocle d’avoir ridiculement donné
dans fon Electre une fi longue defcription d’une pareille
courfe à l’occafion du récit fabuleux de la
mort d’Orefte. Cependant c’eft ce morceau-là qui a
dûpiaire davantage àfesfpe&ateurs.
Au fiecle d’Hom ere, l’ufage n’étoit pas encore introduit
dans la fo c ié té, de parler contre fes fentimens
; ©n ignorait ce langage que nous nommons le
langage de la politejfc. Chacun s’énoncoit naturellement
& fans détour-; & celui qui étoit dans le cas
de faire quelques reproches à d’a u tre s, n’y mettoit
point d’adouciffement ; il s’exprimait rondement ,
quoiqu’il fû t fans aigreur. 'Ce n’eft donc pas fur les
moeurs d’aujourd’hui qu’il faut juger des converfa-
tions de cette efpece , qu’on re trouve fréquemment
dans l’Iliade. Comment Homere aurait-il pu peindre
une nature qui de fon temps n’exiftoit pas encore ?
Bien .des gens ont tro u v é étrange que dans ce
même p o ë te , fes perfonnages obfervent une gravité
finguliere'dans la fimple canverfatiort, qu’ils s’énoncent
avec formalité, &une efpece de folemnité. Le
moindre ra p p o rt, le plus petit meflàge qu’un héraut
vient faire de la part d’un des chefs de l’armée ,
s’y fait avec apparat ( Voyez Iliade, liv . IV , v. 204
& fuivans'). Mais cette maniéré eft précifément dans
les moeurs de ces tems-là. Le poëte , en ne la fuivant
pas-, auroit manqué la nature. Ce qu’on blâme ici efi
lu i, ce font donc des beautés bien réelles , lorfiqu’on
penfera que chez les anciens, certaines chôfes qui
feraient aujourd’hui de très-peu de v a le u r, étoient
d’un to u t autre prix ; on ne prendra plus Homere S t
fon Achille po u r deux enfaris , comme on eft tenté
de le faire , quand on lit de quelle maniéré Minerve
tâche de confoler Achille fur la p erte du butin qu’A-
gamemnon lui a enlevé.
Un exemple bien p ropre à faire fenrir la néceflîté
de confulterles moeurs des anciens, po u r juger fainement
de leurs ouvragés, c’eft le difcours que
Neftor tient aüx Grées dans le fécond livre, de l’Iliade
, p our les diffuadër de lever le fiege de T ro y e :
« Je n’efpere p a s , dit ce vénérable vieillard à fes
» fo ld a ts, qu’aucun de vous retourne chez f o i ,
» avant d’avoir couché avecla femme d’un Troyen. »
Ce feroit aujourd’hui le motif le plus infâme qu’un
général pût employer en pareille circonftance ; &
c’eft pourtant au plus vieux & au plus fage des capitaines
grecs qu’Homere fait tenir un tel langage. On
auroit néanmoins to rt de blâmer ce poëte. D e fon
tems, & dans des tems bien poftérieurs e n c o re , c’étoit
un ufage généralement établi, que les habitans
d’une ville çonquifé par les armes , devenôient les
efclaves de leurs vainqueurs ; que les femmes particuliérement
étoient partagées entre ceux-ci, comme
fàifànt partie du butin ; que chacun d’eux s’en choi-
fiffoit une o u p lufieurs, p our en faire fa concubine ,
& que les affiégés dévoient toujours s’attendre à un
pareil fort. Le poëte n’a pas introduit de telles
m oe u rs , il les a trouvé établies. On en peut dire autant
de cet autre paffage d’Homerë -, où. Agamémnon
fait des reproches à Ménélas de ce qu’il veut recev
o ir comme captif, Adrafte qui s’étoit rendu à lui,
& o ù ce chef des armées tue le malheureux Adrafte
de fa propre main. Un poëte qui de nos jours fe ro it
agir de cette maniéré le général d’une armé e, fe roit
très-blâmable fans do u te, mais c’eft^que, dans n o tre
fiecle, une telle a â io n déshonorerait le g én é ral
Dès qu’on ne perdra pas de vue ces confidérations,
qui font indifpenfables pour juger fainement des ouvrages
de l’antiquité, on rendra certainement juf-
îice aux anciens. Nous n’entreprenons, à la vérité ,
point de foutenir que tous leurs ouvrages foient fans
défaut ; mais ce qui nous femble décidé, c’eft qu’en
général leur goût étoit plus naturel & plus mâle
que celui de la plupart des m odernes ; qu’à c e t égard