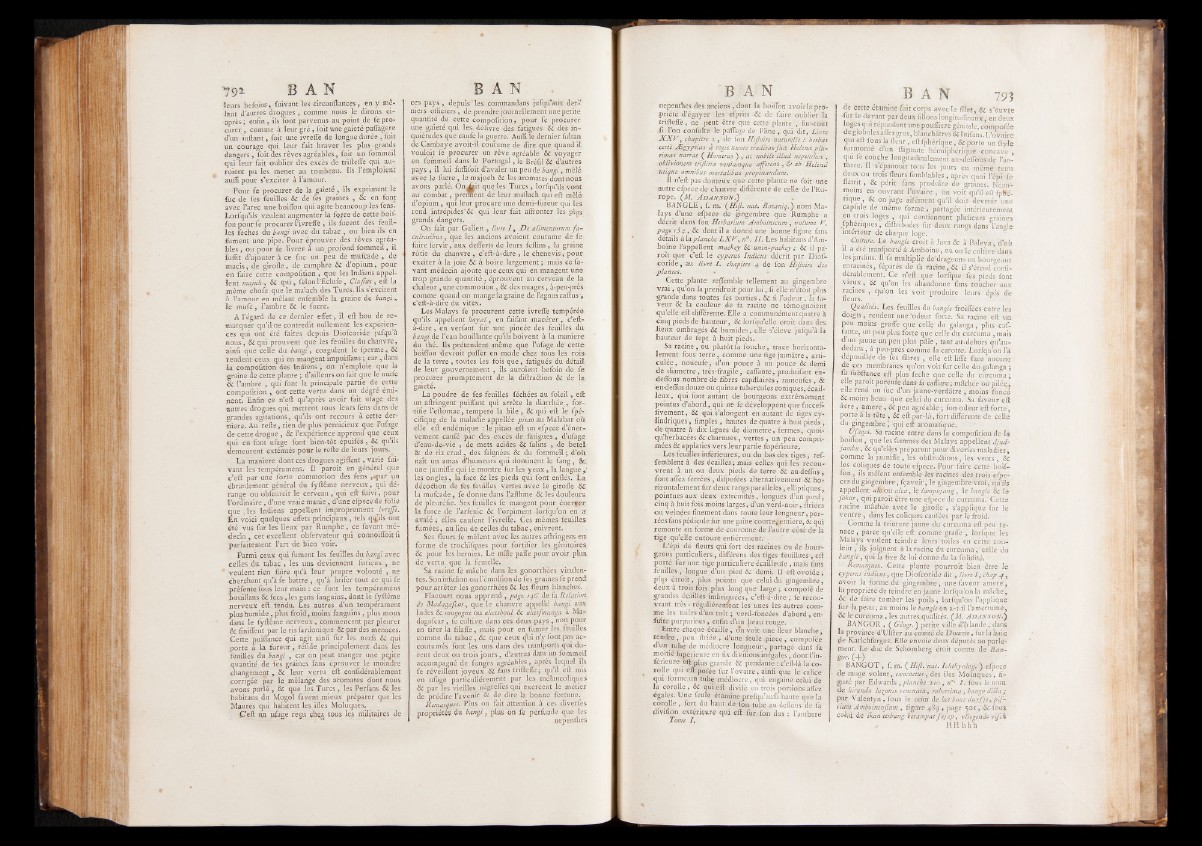
B A N
leurs befoins, fuivant les circonftances, en y mêlant
d’autres drogues , comme nous le dirons ci-
'après ; enfin, ils font parvenus au p o in t de fe procurer
, comme à leur gré , foit une gaieté paffagere
d’un inftant, foit une ivreffe de longue durée , foit
un courage qui leur fait braver les plus grands
dangers , foit des rêves agréables, foit un fommeil
qui leur fait oublier des excès de trifte ffe qui au-
roient pu les mener au tombeau» Ils l’emploient
auffi pour s’exciter à l’amour.
Pour fe procurer de la gaieté, ils expriment le
fuc de fes feuilles ôc de fes graines , ôc en fo n t
avec l’arec une boiffon qui agite beaucoup les fens.
Lorfqu’ils v.eulent augmenter la force de cette boiffon
pour fe procurer l’ivreffe , ils fucent des feuilles
feches du bangi avec du tabac , ou bien ils en
fument une pipe. Pour éprouver des rêves agréables
, ou pour fe livrer à un profond fommeil, il
fuffit d’ajouter à ce fuc un peu de mufcade , de
macis, de girofle, de camphre ôc d’opium, pour
en faire cette compofition , que les Indiens appellent
majuh -, ÔC q u i, félon l’Eclufe, Clufiits , eft la
même chofe que le malach des Turcs. Ils s’excitent
à l’amour en mêlant enfemble la graine de bangi,
le mufc, l’ambre ôc le fucre.
A l’égard de ce dernier effet, il eft bon de remarquer
qu’il ne contredit nullement les expériences
qui ont été -faites depuis Diofcoride jufqu’à
nous, ôc qui prouvent que les feuilles du chanvre,
ainfi que -celle du bangi, coagulent le fperme, ôc
rendent ceux qui en mangent impuiffans ; car , dans
la compofition des Ind ien s , .on n’emploie que la
graine de cette plante ; d’ailleurs on fait que le mufc
& l’ambre , qui fo n t la principale partie de^ cette
compofition , ont cette vertu dans un dégré éminent.
Enfin ce n’eft qu’après avoir fait ufage dès
autres drogues qui mettent tous leurs fens dans de
grandes agitations, qu’ils ont recours à cette dernier
©. Au refte, rien de plus pernicieux que l’ufage
de cette drogue , ôc l’expérience apprend que ceux
qui en font ufage font bien-tôt épuifes, ôc qu’ils
demeurent exténués pour le refte de leurs jo u r s .
La maniéré dont ces drogues agiffent, Varie fuivant
les tempéramens. Il paroît en général que
c’eft par une forte commotion des fens ,#par un
ébranlement général du fyftême nerveux, qui dérange
ou obfcurcit lé cerveau, qui eft fuivi, pouf
l ’ordinaire, d’une vraie manie , d’une efpece de folie
que ,/les Indiens appellent improprement ivreffe.
En voici quelques effets principaux, tels q%’ils ont
été vus fur les lieux par Rumphe, ce favant médecin
, cet excellent obfervateur qui connoifToit fi
parfaitement l’art -de bien voir.
Parmi ceux qui fument les feuilles du bangi avec
celles du tabac , les uns deviennent furieux , ne
* veulent rien faire qu’à leur propre volonté , ne
cherchent qu’à fe battre , qu’à brifer tout ce qui fe
.préfente fous leur main : ce font les tempéramens
bouxllans ôc fecs ,les gens fanguins, dont le fyftême
nerveux eft tendu. Les autres d’un tempérament
plus humide, plus froid, moins fanguins, plus mous
dans le fyftême nerveux, commencent par pleurer
& finiffent par le ris fardonique ôc par des menaces.
Cette puiffance qui agit ainfi fur les nerfs ôc qui
porte à la fureur, réfide principalement dans les
feuilles du bangi , car on peut manger une petite
quantité de fes graines fans éprouver lé moindre
changement , & leur vertu èft confidérablement
corrigée par le mélange des aromates dont nous
avons parlé , ôc que les Turcs , les Perfans ôc les
habitans du Mogol favent mieux préparer que les
Maures qui habitent les ifles Moluques.
C’eft un ufage reçu chez tous les militaires de
BAN
ces pays , depuis'les commandàns jufqü’aiix derniers
officiers , de prendre journellement une petite
quantité de cette compofition, pour fe procurer
une gaieté qui les. délivre des fatigues ôc des inquiétudes
que caufe la guerre. Auffi le dernier fultan
de .Cambaye avoit-il coutume de dire que quand il
vouloir fe .procurer un rêve agréable ôc voyager
en fommeil dans le Portugal, le Bréfil & d’autres
pays , il lui fuffifoit d’avaler un peu de bangi, mêlé
avec le fucre, le majoeh ôc les aromates dont nous
avons parlé. Onégit que les Turcs , lo r fq u ’ils vont
au combat, p ren n en t dé leur maflach qui eft mêlé
d’opium , qui leur procure une demi-fureur qui les
rend intrépides* & qui leur fait affronter les plus
grands dangers»
On fait par Galien livre I , De alimentortim fa-
cultatibus, que les anciens avoient coutume de fe
faire fervir, aux defferts de leurs feftins , la graine
rôtie du chanvre , c’eft-à-dire , le chenevis, pour
exciter à la joie & à boire largement; mais ce favant
médecin ajoute que ceux qui en mangent une
trop grande quantité , éprouvent au cerveau de la
chaleur, une commotion , ôc des nuages, à-peu-près
comme quand on mange la graine de l’agnuscaftus
c’eft-à-dire du vitex.
Les Malays fe procurent cette ivreffe tempérée
qu’ils appellent hayal, en faifant macérer, c’eft-
à-dire , en verfant fur une pincée des feuilles du
bangi de l’eau bouillante qu’ils boivent à la maniéré
du thé. Ils prétendent même que l’ufage de cette
boiffon devroit paffer. en mode chez tous lés rois
de la terre , toutes les fois que, fatigués du détail
de leur gouvernement , ils auroient befoin de fe
procurer promptement de la diftraûion ôc de la
gaieté.
La poudre de fes feuilles féchees au foleil, eft
un aftringent puiffant qui arrête la diarrhée., fortifie
l’eft.omac, tempere la bilê, ôc qui eft le fpé-.
cifiquç de la maladie appellée pitao au Malabar où
elle eft endémique : le pitao eft un efpece d’énervement
caufé par des excès de fatigues , d’ufage
d’eau-de-vie , de mets acides ô»c falins , de betel
& de riz crud, des faignées ôc du fommeil ; d’où
naît un amas d’humeurs qui dominent le fang, 8c
une jaiiniffe qui fe montre fur les yeux , la langue *
les ongles, la facë ôc les pieds qui font enflés. La
décoction de fes feuilles vertes avec le girofle ÔC
la mufcade, fe donne dans l’àfthme ôc. les douleurs
de pleuréfie. Ses feuilles fe mangent pour énerver
la force de l’arfenic ôc l’orpiment lorsqu’on en a
avalé ; elles caufent l ’ivreffe. Ces mêmes feuilles
fuméeS, au lieu de celles du tabac, enivrent.
Ses fleurs fe mêlent avec les autres aftringen's en
forme de trochifques pour fortifiér les génitoires
ôc pour les hernies. Le mâle paffe pour avoir plus
de vertu que la femelle.
Sa racine fe mâche dans les gonorrhées virulentes.
Soninfufion ou l’émulfion de fes graines fe prend
pour arrêter les gonorrhées 6c les fleurs blanches.
Flacourt nous apprend , page. $$f| de fa Relation
de Madagafcar, que le chanvre appelié bangi aux
Indes ÔC rougogne ou ahetsboul ôc aketfmanga à M a d
a g a fc a r , fe cultive dans ces deux pays ,.non pour
en tirer la filaffe, mais pour en fumer les, feuilles
comme du tabac, ôc que ceux qui n’y font pas accoutumés
font les uns dans des tranlporfs qui durent
deux ou trois jours, d’autres dans un fommeil
accompagné de fonges agréables, après lequel ils
fe réveillent joyeux ôc fans trifteffe ; qu’il eft mis
en ufage particuliérement par les mélancoliques!
ôc par les vieilles négreffes qui exercent le métier
de prédire l’avenir & de dire là bonne fortune.
Remarques. Plus on fait attention à ces diverfes
propriétés du bangi, plus on fe perfuade que les
nep en th es
B A N
nepenthes des anciens , dont la boiffon a voit la propriété
d’égayer les efprits ôc de faire oublier la
trifteffe, ne peut être que cette plante , fur-tout
- .fi l’on confultele paffage de Pline,-qui dit, Livre
X X V , chapitre 2., de fon Hijloirenaturelle rherbas
certe Ægyptias à regis uxore traditas fuce Helence plu-
rimas narrât f Homerus ) , ac' no bile illud nepenthes ,
■ oblivionem trijiitice veniamqiie afferens , & ab Helenâ
utique omnibus mortalibus propinandum.
Il n’èft pas douteux que cette plante ne foit mne
.autre efpece de chanvre différente de celle de l’Europe.
(M. A d a n s o n .') .
BANGLE , f. m.- (Hiji. nat. B o ta n iq nom Malays
d’une efpece de gingembre que Rumphe a
décrit dans fon Herbarium Amboinicujn, volume V,
page i6q , ÔC dont il a donné une bonne figure fans
• détails à la planche LX V , n°. II. Les habitans d’Am-
boine l’appellent mackey ÔC unin-packey ; 8c il paroît
que c’eft le cyperus Indiens décrit par Diofcoride,
au livre 1. chapitre 4 de fon Hijloire des
plantes.
Cette plante reffemble tellement au gingembre
v ra i, qu’on la prendroit pour lui, fi elle n’étoit plus
grande dans toutes fes parties, ôc fi l’odeur, fa faveur
ôc la couleur de fa racine ne té-moignoi'ent
qu’elle eft différente. Elle a communément quatre à
cinq pieds de hauteur, ôc Iorfqu’elle croît dans des,
lieux ombragés ôc humides, .elle s’élève jufqu’à.la
hauteur de fept à huit pieds. ' 1
Sa racine , ou plutôt fa fouché , trace horizontalement
fous terre, comme une tige jaunâtre, articulée,
noueufe, d’un pouce à un pouce Ôc demi
de diamètre, très-fragile, caffante, produifant en-
deffous nombre de fibres capillaires, rameufes , &
en-deffus douze ou quinze tubercules coniques, écailleux
, qui font autant de bourgeons extrêmement
pointus d’abord, qui ne fe développent que fuccef-
fivement, ÔC qui s’alongent en autant de tiges cy-
lindriques, fimples , hautes de quatre à huit pieds,
de fcpiatre à dix lignes de diamètre, fermes -, quoi-
qu’herbacées ôc charnues, vertes , un peu comprimées
ôc applaties vers leur partie fupérieure.
Les feuilles inférieures, ou du bas des tiges, ref-
femblent à des écailles ; mais celles qui les recouvrent
à un ou deux pieds de terre ôc au-deffus,
font affez ferrées, difpofées alternativement ôc hor
rizontalement fur deux rangs parallèles, elliptiques,
pointues aux deux extrémités, -longues d’un pied,
cinq à huit fois moins larges , d’un verd-noir, ftriées
ou veinçes finement dans toute leur longueur, portées
fans pédicule fur une gaîne courte^entiere, & qiii
remonte en forme de couronne de l’autre côté de là
tige qu’elle entoure entièrement.
L’épi de fleurs qui fort des. racines ou de bourgeons
particuliers, différens des tiges feuillues ,-eft
porté fur une tige particulière écailleule , mais fans
feuilles , longue d’un pied ôc demi. Il eft ovoïde,
plus étroit, plus pointu que celui du gingembre,
deux à trois fois plus long que large; compofé de
grandes écailles imbriquées, c’eft-à-dire ; fe recouvrant
tçes - réguliérenîent les unes les autres comme
les tuiles d’un toît ; verd-foncées d’abord, en-
fuite purpurines, enfin d’un beau rouge.
Entre chaque écaille, <?n voit une fleur blanche, ■
tendre , • peu ftrrée , d’une feule .piece, compofée
ri’un-' tube de médiocre longueur , partagé . danS fa
moitié fupérieure en fix divifionsinégales, dont l’in- -
férieuré ëft plus grande ÔC pendante : c’eft-là la co- .
rolle qui eft pofée fur l’ovaire, ainfi que le calice
qui forme,un tube médiocre, qui engaine.celui de
la corolle , ôc qui eft divifé en trois portions affez
égales. Une feule étamine prefqu’aufli haute que la
corolle, fort du haut de fon, tube au cleffous de fa
divifion extérieure qui eft..fur.fon dos : l’anthere
Tome /,
B A N 793
de Gétté étamine faitcorps avec le’ filet, 6c s’ôuvçe
-fur le devant par deux filions longitudinaux, en deux
•loges qui répandent Une poufliere génitale, compofée
de globules affez gros, blanchâtres ôc Iuifans. L’ovaire
qui eft fous la fleur, eft fphérique, ôc porte un ftyle
iurmqnté d’un ftigmate hémifphérique concave ,
qui fe couche longitudinalement au-deffoùs de l’anthere.
Il s’épanouit tous les jours en même tems
deux ou trois fleurs femblables , après quoi l’épi fe
flétrit, ôc périt fans produire de graines. Néanmoins
en ouvrant l’ovaire , on voit qu’il eftfpié'-
nque , Ôc on jugé aifément qu’il" doit devenir une
capfule de même forme ^ partagée intérieurement
en trois loges , qui- contiennent plufieurs graines
^fphériques, diftribuées fur deux rangs dans l’angle
. intérieur dé chaque loge.
, Culture. Le b angle^ croît à Java ôc àBaleya, d’où
il a ete tranfporte à Amboine, où on le cültive dans
les jardins. Il fe multiplie de'drageons ou bourgeons
enracinés , féparés de fa racine, ôc il s’étend confi-
derablement. Ce n’eft. que lorfque fes pieds font
vieux, ôc qu’on les abandonne fans toucher aux
racines , - qu’on les voit produire leurs épis de
fleurs.
Qualités. Les feuilles du b angle froiffées entre les
• doigts, rendent une *odeur forte. Sa racine eft un
! Peu moins groffe que celle du galanga, plus caffante,
un peu plus forte que celle du curcuma , mais
d un jaune-un peu plus pâle, tant au-dehors qu’au-
dedans, à peu-près comme la carotte. Lorfqu’on l’a
dépouillée de fes fibres , elle eft liffe fans aucune
de ces membranes qu’on voit fur celle du galanga ;
fa fubftance eft plus feche que celle du cùrcuma ;
elle paroît poreufe dans fà caffure ; mâchée où pilée,;
elle rend un fuc d’un jaune-verdâtre, moins foncé
ôc moins beau que celui du curcuma. Sä faveur eft
acre, amere , Ôc peu agréable ; fon odeur eft forte;
porte à la tête , ôc eft par-là, fort différente de celle
du gingembre ‘ qui eft aromatique.
Ufâges'. Sa racine entre dans la compofition dé la
boiffon, que les femmes des Malays appellent djud-
jambu, ôc qu’elles préparent pour diverfes niala dies ;
comme la jàuniffe , les obftru&ions, les vents , ôc
les coliques de toute efpece. Pour faire cette boif-
fqn., ils mêlent enfemble les racines des trois efpe*
ces du gingembre, fçavoir, le gingembre vrai , qu’ils
appèllènt ah ou aléa, le lâmpujang\ le bangle ôc le
fokur, qui paroît être une éfpécede curcuma. C e t te
racine mâchée avec le girofle , 's’applique fur le
ventre-, dans les coliques caiiféës ' par le froid.
• Comme la teinture .jaune du curcuma eft peu tenace
, parce qu’elle eft comme graffe , lorfqiie les
Malays veulent teindre leurs toiles en cette couleur
, ilj joignent à la racine du curcuma,' celle du
bangle, qui la fixe ôc lui donne de la folidité. -
: Remarques. • Cette plante pourroit bien être le
cyperus indiens, que Diofcoride d it , livre I , chap 4 ,
avoir la forme du 'gingembre, une faveur amere,
la propriété de teindre én jaune lorfqu’on la mâche,
ôc de faire tomber les poils, lorfqu’on l’applique
fur -la peau ; au moins le bangle en a-t-il l’amertume,
ôc le curcuma, les autres, qualités. ( M. A dan son.')
BANGOR , ( Géogr. ) petite ville d’Irlande, dans
la province'd’Ulfter àu comté de D awne, fur la baie
de Karichfergus. Elle envoie deux députés au parlement.
Le duc de Schömberg étoit comte- de Ban-
gor. (+ )
BANGOT, f. m. ( Hiß. nat. Ichthyolog: ) efpeçe
de muge volant,,e^rocoem5 des îles Moluques, figuré
par Edwards, planche 2.10 , n0’ I. fous le nom .
de hirundo luçonis venenata, ruberrima, bango dicta ;
par Valentÿn , fous le nom de het bont duyfje, pif-
cium Amboinenfium , figure 489 , page 501, ôc fous
celui de ikan terbpng bcràmpat fajap, r liegende vifeh
H H h b h