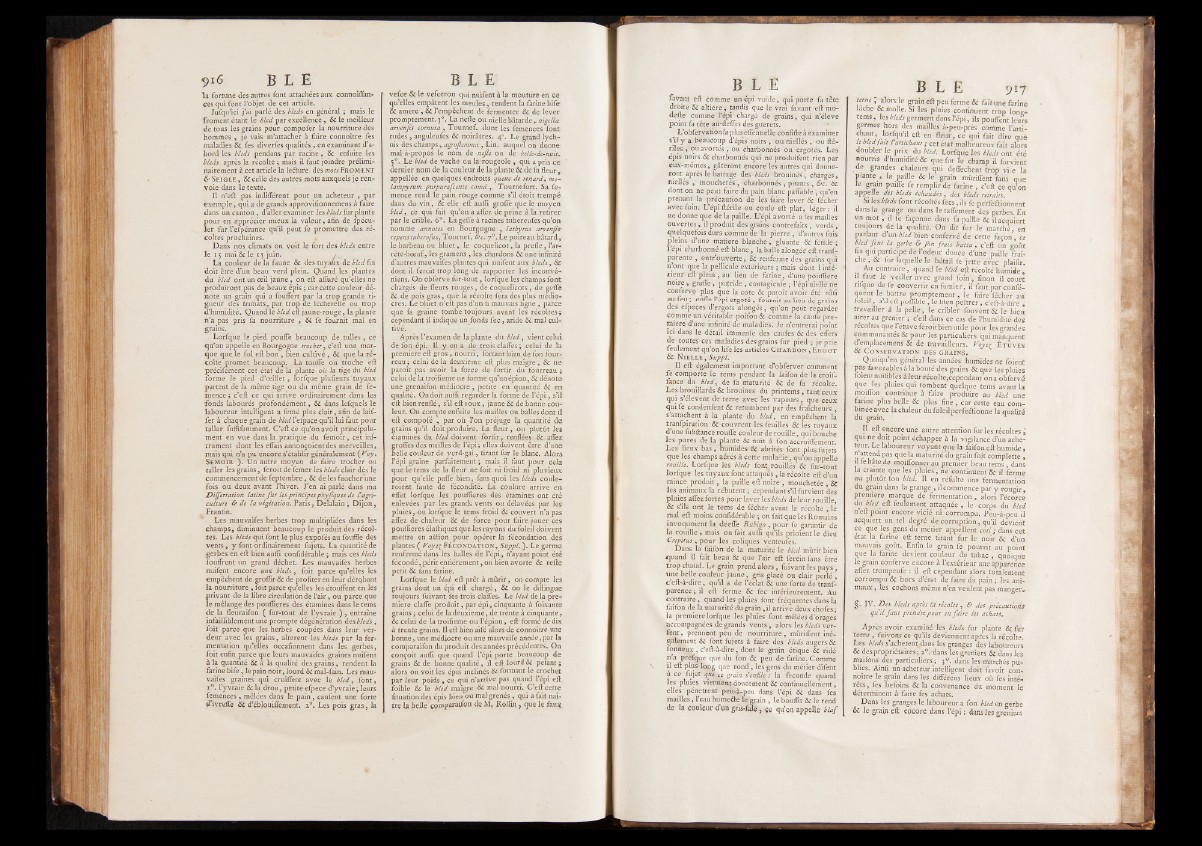
la fortune des autres font attachées aux connoiffan-
ces qui font l’objet de cet article.
Jufqu’ici j’ai parlé des bleds en général ; mais le
froment étant le b led par excellence, & le meilleur
de tous les grains pour compofer la nourriture des
hommes , je vais m’attacher à faire connoître fes
maladies & fes diverfes qualités , en examinant d’abord
les bleds pendans. par racine, & enfuite les
bleds après la récolte ; mais il faut joindre préliminairement
à cet article la ledure des mots F r o m e n t
& S e i g l e , & celle des autres mots auxquels je ren-
yoie dans le texte.
Il n’eft pas indifférent pour un acheteur , par
exemple, quia de grands approvifionnemens à faire
dans un canton , d aller examiner les bleds fur plante
pour en apprécier mieux la valeur, afin de fpecu-
ler fur l’efpérance qu’il peut fe promettre des récoltes
prochaines.
Dans nos climats on voit le fort des bleds entre
le 1 5 mai & le 1 5 juin.
La couleur de la faune & des tuyaux de bled fin
doit être d’un beau verd plein. Quand les plantes
du bled ont un oeil jaUne, on eft affuré qu’elles ne
produiront pas de beaux épis ; car cette couleur dénote
un grain qui a fouffert par la trop grande rigueur
des frimats, par trop de féchereffe ou trop
d’humidité. Quand le bled eft jaune-rouge, la plante
n’a pas pris fa nourriture , & fe fournit mal en
grains.
. Lorfque le pied pouffe beaucoup de tulles, ce
qu’on appelle en Bourgogne trocher, c’eft une marque
que. le fol eft bon , bien cultivé , & que la récolte
promet beaucoup. La touffe ou troche eft
précifement cet état de la plante où la tige du bled
forme le pied d’oeillet , lorfque plufieurs tuyaux
partent de la même tige ou du même grain de fe-
mence ; c’eft ce qui arrive ordinairement dans les
fonds labourés profondément, & dans lefquels le
laboureur intelligent a femé plus clair, afin de laif-
fer à chaque grain de bled l’efpace qu’il lui faut pour
taller fuffifamment. C’eft ce qu’on avoit principalement
en vue dans la pratique .du femoir, cet instrument
dont les effais annonçoientdes merveilles,
mais qui n’a pu encore s’établir généralement (Voy.
S e m o i r ). Un autre moyen de faire trocher ou
taller les grains, feroit de femer les bleds clair dès le
commencement de Septembre, & de les faucher une
fois ou deux avant l’hiver. J’en ai parlé dans ma
D ijfe r ta tio n latine f u r les principes phyjiques de Üagriculture
& de la végétation. Paris, Delalain ; Dijon,
Frantin.
Les mauvaifes herbes trop multipliées dans les
champs, diminuent beaucoup le produit des récoltes.
Les bleds qui font le plus expofés au fouffle des
vents, y font ordinairement Sujets. La quantité de
gerbes en eft bien aufli confidérable ; mais ces bleds
Jouffrent un grand déchet. Les mauvaifes herbes
nuifent encore aux b le d s , Soit parce qu’elles les
empêchent de groflir & de profiter en leur dérqbant
la nourriture , loit parce qujelles les étouffent en les
privant de la libre circulation de l’air, ou parce que
le mélange des pouffieres des étamines dans le tems
de la fleuraifon ( fur-tout de l’yvraie ) , entraîne
infailliblement une prompte dégénération des b le d s ,
Soit parce que les herbes coupées dans leur verdeur
avec les grains, altèrent les bleds par là fermentation
qu’elles occafionnent dans les gerbes,
foit enfin parce que leurs mauvaifes graines nuifent
à la quantité & a la qualité des grains, rendent la
farine bife, le pain noir, lourd & mal-fain. Les mauvaifes
graines qui croiffent avec le b le d , font,
i° . l’yvraie & la drou, petite efpece d’y vraie ; leurs
femences, mêlées dans le pain, caufent une forte
d’ivreffe & d’éblouiffement. a0. Les pois gras, la
vefce & le vefceron qui nuifent à la mouture en ce
qu’elles empâtent les meules, rendent la farine bife
& amere , & l’empêchent de fermenter & de lever
promptement. 30. La nefle ou nielle bâtarde r nigella
arvenjis cornuta, Tournef. dont les femences font
rudes , anguleufes & noirâtres. 40. Le grand lych-
nis des champs, agrojlemma, Lin. auquel on donne
mal-à-propos le nom de nefle ou de belle-de-nuit.
59.. Le bled de vache ou la‘rougeole , qui a pris ce
dernier nom de la couleur de la plante & de fa fleur,
appellée en quelques endroits queue de renard, me-
lampyrum purpurafcente comâ , Tournefort. Sa fe-
mence rend le pain rouge comme s’il étoit trempé
dans du vin, & elle eft a u fli groffe que le moyen
bled, ce qui fait qu’on a affez de peine à la retirer
par le crible. 6°. La geffe à racines tubereufes qu’on
nomme annotes en Bourgogne , lathyrus arvenjis
repenstuberofus, Tournef. &c. 7° .Le poireau bâtard,
le barbeau ou bluet, le coquelicot, la prefle, l’arrête
boeuf, les gramens , les chardons & une infinité
d’autres mauvaifes plantes qui nuifent aux bleds, 6c
dont il feroit trop long de rapporter les inconvé-
niens. On obferve fur-tout, lorfque les champs font
chargés de fleurs rouges, de èoquelicots, de geffe
& de pois gras, què la récolte fera des plus médiocres.
Le bluet n’eft pas d’un fi mauvais ligne , parce
que fa graine tombe toujours avant les récoltes ;
cependant il indique un fonds fe c , aride & mal cul-,
tivé.
Après l ’examen de. la plante du bled, vient celui
de fon épi. 11 y en a de trois claffes ; celui de la
première eft gros, nourri, fortant bien de fon fourreau;
celui de la deuxiemq eft plus maigre, & ne
paroît pas avoir la force de fortir du fourreau ;
celui de la troifieme ne forme qu’unépion, & dénote
une grenaifon médiocre , petite en quantité 6c en
qualité. On doit aufli regarder la forme de l’ép i, s’il
eft bien renflé, s’il eft roux, jaune & de bonne couleur.
On compte enfuite les mailles ou balles dont il
•eft compofé , par où l’on préjuge la quantité de
grains qu’il doit produire. La fleur, ou plutôt les
étamines du bled doivent fortir , renflées & affez
groffes des mailles de l’épi; elles doivent être d’une
belle couleur de verd-gai, tirant fur le blanc. Alors
l’épi graine parfaitement ; mais il faut pour cela
que le tems de la fleur ne foit ni froid ni pluvieux
pour qu’elle paffe bien, fans quoi les bleds coule-
roient faute de fécondité. La. coulure arrive en
effet lorfque les pouffieres des étamines ont été
enlevées par les grands vents ou délavées par les
pluies, ou lorfque le tems froid 6c couvert n’a pas
affez de chaleur 6c de force pour faire jouer ces
pouffieres élaftiques que les rayons du foleil doivent
mettre en a&ion pour opérer la fécondation des
plantes ( Voye%_ Fé c o n d a t io n , Suppl. ). Le germe
renfermé dans les balles de l’épi, n’ayant point été
fécondé, périt entièrement, ou bien avorte 6c refte
petit & fans farine.
Lorfque le bled eft prêt à mûrit, on compte les
grains dont un épi eft chargé, & on le diftingue
toujours fuivant fes trois claffes. Le bled de la première
claffe produit, par épi, cinquante-à foixante
grains ; celui de la deuxieme, de trente à cinquante,
6c celui de la troifieme ou l’épion, eft forme de dix
à trente grains. Il eft bien aifé alors de connoître une
bonne, une médiocre ou une mauvaife année, par la
comparaifon du produit des années précédentes. On
conçoit aufli que quand l’épi porte beaucoup de
grains & de bonne qualité, il eft lourd & pelant ;
alors on voit les épis inclinés 6c formant le crochet
par leur poids ,. ce qui n’arrive pas quand l’épi eft.
foible & le bled maigre & mal nourri. C ’eft cette
fituation des épis bien ou mal grenes , qui a fait naître
la belle cqmparaifon de M, Rolfin, que le fait£
lavant eft comme un épi vuide, qui porte fa tête
droite 6c altiere, tandis que le vrai favant eft mo-
defte comme l’épi chargé de grains, qui n’éleve
point fa tête aù-deffus des guerets.
L’obfervationla plus effentielle confifte à examiner
s’il y a beaucoup d’épis noirs , ou niellés , ou fté-
riles , ou avortés, ou charbonnés ou ergotés. Les,
épis noirs & charbonnés qui ne produifent rien par
eux-mêmes, gâteront encore les autres qui-donné-'-
ront apres le battage dès-bleds brôuinés, chargés,
niellés, mouchetés , charbonnés , pt'ftnts-, &c. 6c
dont on ne peut faire du pain blanc paffable , qu’en
prenant la précaution de les faire laver 6c fécher
avec foin: L’épi ftérile ou coulé eft plat, léger : il
ne donne que de la paille. L’épi avorté a lès mailles
ouvertes, il produit des grains -contrefaits'^:' verdsy
quelquefois durs comme de la pierre, d’autres fois
pleins d’une matière blanche, gluante & fétide ;
l ’épi charbonné eft blanc, la balle alongéé eft tranf-
parente , entr’ouverte, & renferme des grains qui
n’ont que la pellicule extérieure ; mais dont 1 intérieur
eft plein , au lieu de farine, d’une poiiffiere
noire , graffe, putride, contagieufe ; l’épi niellé ne
conferve plus que la cote & paroît avoir été rôti
au feu ; enfin l’épi ergoté, fournit au lieu de- grains
des efpeces d’ergots alongés, qu’on peut règarder
comme un véritable poifon & comme la caufe première
d’une infinité de maladies. Je n’entrerai point
ici dans le détail immenfe des caufes & des effets
de toutes ces maladies des grains fur pied ; je prie
feulement qu’on life les articles Charbon , Ergot
6c Nie l le , Suppl.
Il eft également important d’obferver comment
fe comporté le tems pendant la faifon de la croif-
fance'du1 bled, de fa maturité & de fa récolte.
Les brotiillards & brouines du printems, tant ceux
qui s’élèvent de terre avec les vapeurs, que ceux
qui.fe condenfent & retombent par des fraîcheurs ,
s attachent à la plante du bled, en empêchent la
tranfpiration 6c couvrent les feuilles 6c les tuyaux
d’une fubftance rouffe couleur de rouille, qui bouche
les pores de la plante & nuit à fon accroiffement.
Les lieux bas, humides & abrités font plusfujets
que les champs aérés à cette maladie, qu’on appelle
rouille. Lorfque les bleds font^ rouilles & fur-tout
lorfque les tuyaux font attaqués , la récolte eft d’un
mince produit, la paille eft noire, mouchetée , &
les animaux la rébutent ; cependant s’il furvient des
pluies affez fortes pour laver les bleds de leur rouille,
6c s’ils ont le tems de fécher avant la récolte , le
mal eft moins cdnfidérable ; on fait que les Romains
invoquoient la. déeffe Rubigo , pour fe garantir de
la rouille , mais on fait auffi qu’ils prioient le dieu
Crépit us , pour les coliques venteufes.
Dans la faifon de la maturité le bled mûrit bien
quand il fait beau & que l’air eft ferein fans être
trop chaud. Le grain prend alors, fuivant les pays,
une belle couleur jaune, gris glacé ou clair perlé ,
c’eft-à-dire, qu’il a de l’éclat 6c une forte de tranf-
parence ; il eft ferme & fec intérieurement. Au
contraire, quand les pluies font fréquentes dans la
faifon de la maturité du grain ,il arrive deuxchofes;
la première lorfque les pluies font mêlées d’orages
accompagnées de grands vents , alors les bleds ver-
fent, prennent peu de nourriture, muriffent inégalement
& font fujets à faire des bleds augers &
fonneux, c’eft-à-dire, dont le grain étique 6c ridé
n’a prefque que du fon 6c peu de farine. Comme
il eft plus long que rond, les gens du métier difent
à ce fujet que ce grain s'enfile : la fécondé quand
les pluies viennentyloucement 6c continuellement,
elles pénètrent peù-à-peu dans l’épi & dans fes
mailles, l’eau humeâe le grain , le bouffit 6c le rend
de la couleur d’un gris-fale, ce qu’on appelle blaf
terne ; àlôrs lé grain eft peu ferme & fait Une farine
lâche 6c molle. Si les pluies continuent trop long*
tems, les bleds germent dans l’épi, ils pouffent leurs
germes hors des mailles à-peu-près comme Parti*
f î ! lt,V or iiu’i1 en fleur, ce qui fait dire que
le bled, fait l’artichaut ; cet état malheureux fait alors
doubler le prix du bled. Lorfque les bleds ont été
nourris d’humidité & que fur le champ il furvient
de grandes chaleurs qui deffechent trop vî'.e la
plante , la paille & le grain mûriffent fans que
le grain puiffe fe remplir de farine , c’eft Ce qu’on
appelle des bleds échaudés, des bleds retraits.
Si les bleds font récoltés fecs, ils fe perfectionnent
dans la grange ou dans le taffement des gerbes. En
un mot , il fe façonne dans fa paille & il acquiert
to u jo u r s de là qualité; On dit fur le marché, en
parlant d’un bled^bien conferve de cette façon, ce
bled fent la gerbe 6* fon frais battu, c’eft un goût
fin qui participe de l’odeur douce d’une paille fraîche
, & fur laquelle le bétail fe jette avec plaifir.
Au contraire, quand le bled eft récolté humide,
il faut le veiller avec grand foin, finon il court
rifque de fe convertir en fumier, il faut par confé-
quent le-- battre promptement, le faire fécher au
foleij, s’il eft poffible, le bien peltrer, c’éft-à-dirë *
travailler à la pelle, le cribler fouvent & lé bien
amer au grenier ; c’eft dans ce cas de l’humidité des
récoltés que l’étuvè feroit bien utile pour les grandes
communautés & pour les particuliers qui manquent
d’emplacemens & de travailleurs. Voye^ Étuves
& C o n s e r v a t io n d e s g r a i n s .
Quoiqu’en générai les années humides ne foient
pas favorables à la bonté des grains & que les pluies
foient nuifibles à leur récolte,cependant ona obfervé
que les pluies qui tombent quelque tems avant la
moiffon contribue à faire produire au bled une
farine plus belle & plus fine , car cette eau combinée
avec la chaleur du foleilperfeéHonne la qualité
du grain.
II eft encore une autre attention furies récoltes l
qui ne doit point échapper à la vigilance d’un acheteur.
Le laboureur voyant que la faifon eft humide,
n’ attend pas que la maturité du grain foit complette ,
il le hâte de inoiffonner au premier beau tems, dans
la crainte que les pluies, ne continuent & il ferme
au plutôt ion bled. Il en réfulte une fermentation
du grain dans la grange , il commence par y rougir,
première marque de fermentation, alors l’écorce
du bled eft. feulement attaquée , le corps du bled
n’eft point encore vicié ni corrompu. Peu-à-peu il
acquieft un tel degré de corruption, qu’il devient
ce que les gens du métier appellent coti ; dans cet
état la farine eft terne tirant fur le noir & d’un
mauvais goût. Enfin le grain fe pourrit au point
que la farine devient couleur de tabac , quoique
le grain conferve encore à l’extérieur une apparence
affez trompeufe : il eft cependant alors totalement
corrompu & hors d’état de faire du pain; les animaux
, les cochons même n’en veulent pas manger*-
§ . IV. Des bleds après là récolte , & des précautionS
qu il faut prendre pour en faire les achati.
Après avoir examiné les bleds fur plante & fut
terre , fuivons ce qu’ils deviennent après la récolte.
Les bleds s’achetent^dans les granges des laboureurs
& des propriétaires; zVdans les greniers & dans les
maifons des particuliers ; 3«. dans les marchés pu*
blics. Ainfi un acheteur intelligent doit favoir cou*
noître le grain dans les différens lieux où fes intérêts
, fes befoins & la convenance du moment le
déterminent à faire fes achats.
Dans les granges le laboureur a fon bled en gerbe
& te grain eft encore dans l’épi; dans les grenier*