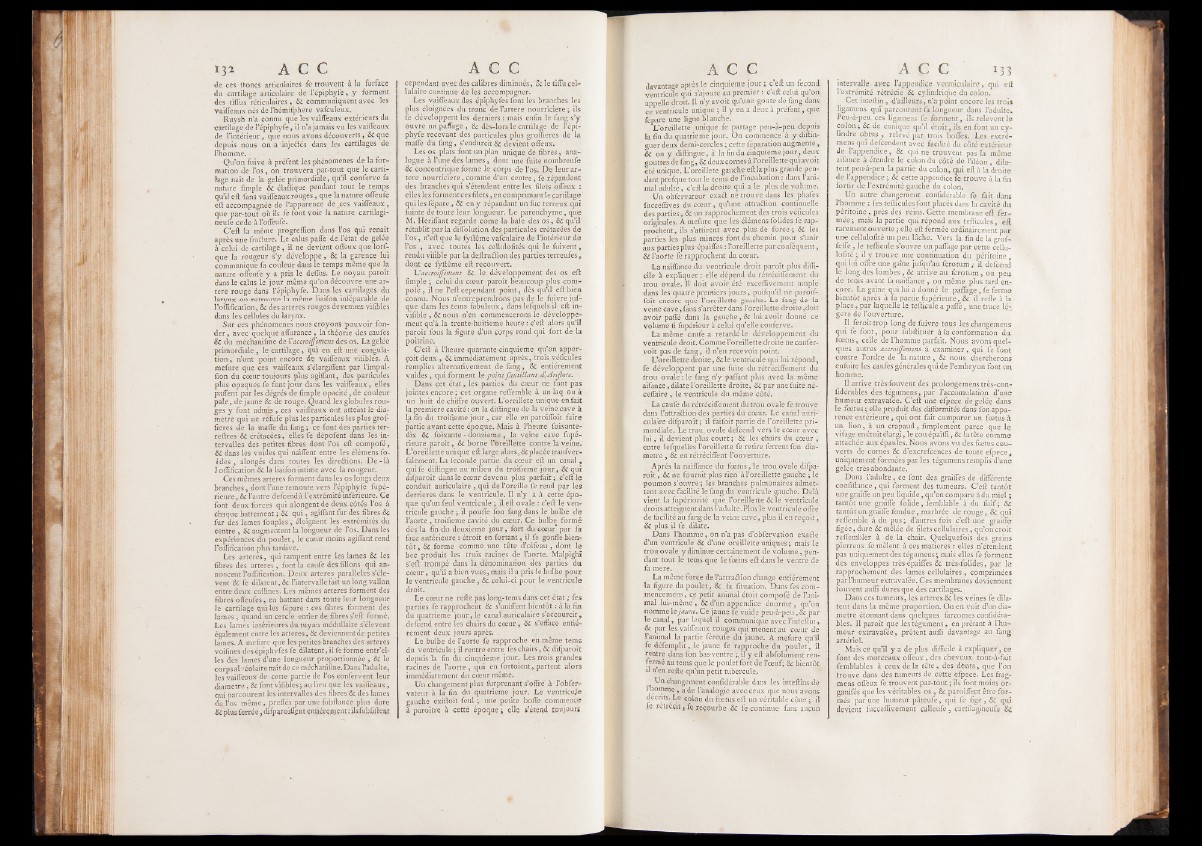
*3î A C C
de ces troncs articulaires fe trouvent à la furface
du cartilage articulaire de l’épiphyfe, y forment
des tiffus réticulaires , 8c communiquent avec les
vaiffeaux nés de l’hémifphere vafculeux.
Ruysh n’a connu que les vaiffeaux extérieurs du
•cartilage de l’épiphyfe, il n’a jamais vu les vaiffeaux
de l’intérieur, que -nous avons découverts, 8cque
depuis nous on a injettés dans les cartilages de
l’homme. '
Qu’on fuive à préfent les phénomènes de la formation
de l’o s , on trouvera par-tout que le cartilage
naît de la gelée primordiale, qu’il conferve fa
nature limple 8c élaftique pendant tout le temps
qu’il eft fans vaiffeaux rouges, que la nature offeufe
eft accompagnée de l’apparence de .ces vaiffeaux,
que par-tout où ils fe font voir la nature cartilagi-
neufe ce de à l’offeufe.
C ’eft la même progreflion dans l’os qui renaît
après une fra&ure. Le calus paffe de l’état de gelée
à celui de cartilage , il ne devient offeux que lorsque
la rougeur s’y développe, 8c la garence lui
communique fa couleur dans le temps même que la
nature offeufe y a pris le deffus. Le noyau paroît
dans le calus le jour même qu’on découvre une artère
rouge dans l’épiphyfe. Dans les cartilages du
larynx on retrouve la même liaifon inféparable de
l ’offification, 8c des arteres rouges devenues vifibles'
dans les cellules du larynx.
Sur ces phénomènes nous croyons pouvoir fonder
, avec quelque affurance, la théorie des caufes
& du méchanifme de l’accroijjemmt des os. La gelée
primordiale ,. le cartilage, qui en eft une coagulation,
n’ont point encore de vaiffeaux vifibles.. A
mefure que ces vaiffeaux s’élargiffent par l’impul-
fion du coeur toujours plus agiffant, des particules
plus opaques fe font jour dans les vaiffeaux, elles
paffent par les dégrés de fimple opacité, de couleur
pale, de jaune 8c de rouge. Quand les globules rouges
y font admis , ces vaiffeaux ont atteint le diamètre
qui ne rèfufe plus les particules les plus grof-
fieres de la maffe du fang ; ce font des parties ter-
reftres 8c crétacées, elles fe dépofent dans les intervalles
des petites fibres dont l’os eft compofé,
8c dans les vuides qui naiffent entre les élémens fo-
i des , alongés dans toutes les direétions, De - là
1 offifîcation 8c la liaifon intime avec la rougeur.
Ces mêmes arteres forment dans les os longs deux
branches, dont l ’une remonte vers l’épiphyfe fupé-
r-ieure, 8c l’autre defcendà l’extrémité inférieure. Ce
font deux forces qui alongent de deux côtés l’os à
chaque battement ; 8c q u i, agiffant fur des fibres 8c
fur des lames fouples, éloignent'les extrémités du
centre , 8c augmentent la longueur de l’os. Dans les
expériences du poulet, le coeur moins agiffant rend
l’offification plus tardive.
Les arteres, qui rampent entre les lames 8c les
fibres des arteres , font la caufe des filions qui annoncent
l’offification. Deux arteres parallèles s’élèvent
8c fe dilatent, 8c l’intervalle fait un long vallon
entre deux collines. Les mêmes arteres forment des
fibres offeufes, en battant dans toute leur longueur
le cartilage qui les fépare : ces fibres forment des
lames, quand un cercle entier de fibres s’eft formé.
Les lames intérieures du tuyau médullaire s’élèvent
également entre les arteres, 8c deviennent de petites
lames. A mefure que les petites branches des arteres
voifinès desépiphyfes fe dilatent, il fe forme entr’el-
les dés lames d’une longueur proportionnée , 8c le
corps alvéolaire naît de ce méchanifme. Dans l’adulte,
les vaiffeaux de cette partie de l’os confervent leur
diamètre , 8c font vifibles; au lieu que les vaiffeaux,
qui parcourent les intervalles des fibres 8c des lames
de, l’os même, preffésjpar une fubftance plus dure
8c plus ferrée, difparoilfent entièrement ; ilsfubfiftent
A C C
cependant avec des calibres diminués, 8c le tiffu cellulaire
continue de les accompagner.
Les vaiffeaux des épiphyfes font les branches les
plus éloignées du tronc de l’artere nourricière ; ils
fe développent les derniers : mais enfin le fang s’y
ouvre un partage , 8c dès-lors le cartilage de l’épiphyfe
recevant des particules plus groffieres de la
maffe du fang, s’endurcit 8c devient offeux.
Les os plats font un plan unique de fibres, analogue
à l’une des lames, dont une fuite nombreufe
8c concentrique forme le corps de l’os. De leur artère
nourricière, comme d’un centre, fe répandent
des branches qui s’étendent entre les filets offeux :
elles les forment ces filets, en comprimant le cartilage
qui les fépare, 8c en y répandant un fuc terreux qui
fuinte de toute leur longueur. Le parenchyme, que
M. Heriffant regarde corne la baie des o s , 8c qu’il
rétablit par la diffolution des particules crétacées de
l’o s , n’eft que le fyftcme vafculaire de l’intérieur de
l’os , avec toutes les cellulofités qui le fuivent,
rendu vifible par la deftruétion des parties terreufes,
dont ce fyftême eft recouvert.
L’accroijfement 8c le développement des os eft
fimple ; celui du coeur paroît beaucoup plus compofé
, il ne l’eft cependant point, dès qu’il eft bien
connu. Nous rt’entreprendrons pas de le fuivre juf-
que dans les tems fabuleux, dans lefquels il eft in-
vifible , 8c nous n’en commencerons le développement
qu’à la trente-huitieme heure : c’eft alors qu’il
paroît fous la figure d’un corps rond qui fort de la
poitrine.
C ’eft à l’heure quarante-cinquieme; qu’on apper-
ço itd eu x , 8c immédiatement après, trois véficules
remplies alternativement de fang, 8c entièrement
vuides, qui forment le point fautillant d'.Arijiote.
Dans cet état, les parties du coeur ne font pas
jointes encore; cet,organe reffemble à unlaq ou à
un huit de chiffre ouvert. L’oreillete unique en fait
la première cavité: on la diftingue de la veine cave à
la fin du troifieme jou r , car elle enparoiffoit faire
partie avant cette époque. Mais à l’heure foixante-
dix 8c foixante - douzième , la veine cave fupé-
rieure paroît, 8c borne l’oreillette contre la veine.
L’oreillette unique eft large alors ,8c placée tranfver-
falement. La fécondé partie du coeur eft un canal ,■
quife diftingue au milieu du troifieme jou r, 8c qui
difparoît dans le coeur devenu plus parfait ;.c’eft le
conduit auriculaire , qui de l’oreille fe rend par les
derrières dans le ventricule. Il n’y à à cette époque
qu’un feul ventricule ; il eft ovale :.c!eft le ventricule
gauche ;.il pouffe fon fang dans le bulbe de
l’aorte , troifieme cavité du coeur. Ce bulbe formé
dè$ la fin du deuxieme jou r, fort du coeur par fa
face antérieure : étroit en fqrtant, il fe gonfle bientôt
, 8c forme comme une tête d’oifeau, dont le
bec produit les trois racines de l’aorte. Malpighi
s’eft trompé dans la dénomination des parties du
coeur, qu’il a bien vues, mais il a pris le bulbe pour
le ventricule gauche, 8c celui-ci pour le ventricule
droit.
Le coeur ne refte pas long-tems dans cet état ; fes
parties fe rapprochent 8c s’uniffent bientôt : . à la fia
du quatrième jour, le canal auriculaire s’accourcit,
defcend entre les chairs du coeur, 8c s’efface entièrement
deux jours après.
Le bulbe de l’aorte fe rapproche en même tems
du ventricule ; il rentre entre fes chairs, 8c difparoît
depuis la fin du cinquième jour. Les trois grandes
racines de l’aorte , qui en fortoient, partent alors
immédiatement du coeur même.
Un changement plus furprenant s’offré à l’obfer-
vateur. à la fin du quatrième jour. Le ventricule
gauche exiftoit feul ; une petite boffe commence
à paroître à cette époque ; elle s’étend toujours
davantage après le cinquième jour ; c’eft un fécond
ventricule qui s’ajoute au premier : c’eft celui qu’on
appelle droit. Il n’y avoit qu’une goûte de fang dans
ce ventricule unique ; il y en a deux à préfent, que.
fépare une ligné blanche. ■
L’oreillette unique fe partage peu-à-peu depuis
la fin du quatrième jour. On commence à y diftin-
guer deux demi-cercles ; cette féparation augmente,
8c on y diftingue,^ la fin du cinquième jour, deux
gouttes de fang, 8c deux cornes à l’oreillette qui a voit
été unique. L’oreillete gauche eft la plus grande pendant
prefque tout le tems de l’incubation : dans l’animal
adulte, c’eft la droite qui a le plus de volume.
Un obfervateur exaft ne trouve dans les phafes
fucceffives du coeur, qu’une attraction continuelle
des parties, 8c un rapprochement des trois véficules
originales. A mefure que les élémens folides fe rapprochent,
ils s’attirent avec plus de force ; 8c les
parties les plus minces font du chemin pour s’unir
aux parties plus épaiffes : l’oreillette par conféquent,
8c l’aorte fe rapprochent du coeiir.
Lanaiffance du ventricule droit paroît plus difficile
à expliquer : elle dépend du retréciffement du
trou ovale. Il doit avoir été exceffivément ample
dans les quatre premiers jours, puifqu’il ne paroif-
foit encore que l’oreillette gauche. Le fang de la
veine cave, fans s’arrêter dans l’oreillette droite ,doit
avoir paffé dans la gauche, 8c lui avoir donné ce
volume fi fupérieur à celui qu’elle conferve.
La même caufe a retardé le développement du
ventricule droit. Comme l’oreillette droite ne confer-
voit pas de fang, il n’en recevoit point.
L’oreillette droite, 8cle ventricule qui lui répond,
fe développent par une fuite du rétréciffement du
trou ovale : 1e- fang n’y paffant plus avec la même
aifance, dilate l’oreillette droite, 8c par une fuite né-
ceffaire, le ventricule du même côté.
La caufe du rétréciffement du trou ovale fe trouve
dans l’attraétion des parties du coeur. Le canal auriculaire
difparoît ; il faifoit partie de l’oreillette primordiale.
Le trou, ovale defcend vers le coeur avec
lu i , il devient plus court ; & les chairs du coeur ,
entre lèfquelles l’oreillette fe retire ferrent fon diamètre
, 8c en rétréciffent l’ouverture.
Après la naiffance du foetus, le trou ovale difparoît
, 8c ne fournit plus rien à l’oreillette gauche ; le
poumon s’ouvre ; les branches pulmonaires admettent
avec facilité le fang du ventricule gauche. Delà
vient la fiipériorité que.l’oreillette 8cle ventricule
droits atteignent dans l’adulte. Plus le ventricule offre
de facilité au fang de la veine cave, plus il en reçoit,
8c plus il fe dilate.
Dans l’homme, on n’a pas d’obfervation èxa&e
d’un ventricule 8c d’une oreillette uniques ; mais le
trou ovale y diminue certainement de volume, pendant
tout le tems que le foetus eft dans le ventre de
famere.
La même force de l’attraétion change entièrement
la figure du poulet, 8c fa fituation. Dans fes com-
mencemens, ce petit animal étoit compofé de l’animal
lui-même, 8cd’im appendice énorme, qu’on
nomme le jaune. Ge jaune fe vuide peu-à-peu, 8c par
le canal, par lequel il communique avec l’inteftin,
8c par les vaiffeaux rouges qui mènent au coeur de
l’animal la partie féreule du jaune. A mefure qu’il
fe défemplit, le jaune fe rapproche du poulet, il
rentre dans fon bas-ventre il y eft abfolument renfermé
au tems que le poulet fort de l’oeuf; 8c bientôt
il n’en refte qu’un petit tubercule.
Un changement confidérable dans les inteftins de
1 homme , a de l’analogie avec ceux que nous avons
décrits. Le colon du foetus eft un véritable cône ; il
fe rétrécit, fe recourbe • 8c fe continue fans aucun
intervalle, avec l’appendice vermiculaire, qui eft
l’extrémité rétrécie 8c cylindrique du colon.
Cet inteftin, d’ailleurs, n’a point encore les trois
hgamens qui* parcourent fa longueur dans l’adulte.
Peu-à-peu ces ligamens fe forment, ilsreleventle
colon ; 8c de conique qu’il étoit, ils en font un cylindre
obtus , relevé par trois boffes. Les excré-
mens qui descendent avec facilité du côté extérieur
de l’appendice, 8c qui ne trouvent pas la même
aifance à étendre le colon du côté de l’iléon, dilatent
peu-à-peu la partie du colon, qui eft à la droite
de l’appendice ; 8c cette appendice fe trouve à la fia
fortir de l’extrémité gauche du colon.
Un autre changement confidérable fe fait dans
l’homme : fes tefticules font placés dans la cavité dit
péritoine , près des reins. Gette membrane eft fermée
; mais la partie qui répond aux tefticules, eft
rarement ouverte ; elle eft fermée ordinairement par
une cellulofité un peu lâche. Vers la fin de la grof-
feffe, le tefticule s’ouvre un paffage par cette cellu-
lofité ; il y trouve une continuation du péritoine ,
qui lui offre une gaîne jufqu’au fcrotum ; il defcend
le long des lombes, 8c arrive au fcrotum, ou peu
de tems avant fa naiffance , ou même plus tard encore.
La gaîne qui lui a donné le paffage, fe ferme
bientôt après à fa partie fupérieure, 8c il refte à la
place, par laquelle le tefticule a paffé, une trace lé-,
gere de l’ouverture.
Il feroittrop long de fuivre tous les chângemens
qui fe font, pour ïùbftituer à la conformation du
foetus, celle de l’homme parfait. Nous avons quelques
autres accroijfemens à examiner, qui fe font
contre l’ordre de la nature, 8c nous chercherons
enfuite les caufes générales qui de l’embryon font un
homme.
Il arrive très-fouvent des prolongemens très-con-
fidérables des tégumens, par l’accumulation d’une
humeur extravafée. C ’eft une eipece de gelée dans
le foetus ; elle produit des difformités dans fon apparence
extérieure, qui ont fait comparer un foetus à
un lion, à un. crapaud, Amplement parce que le
vifage en étoit élargi, le couépaiffi, 8c la tête comme
attachée aux épaules. Nous avons vu des foetus couverts
de cornes 8c d’excrefcences de toute efpece ,
uniquement formées par les tégumens remplis d’une
gelee très-abondante.
Dans l’adulte, ce font des graiffes de différente
confiftance , qui forment des tumeurs. C ’eft tantôt
une graiffe un peu liquide, qu’on compare à du miel ;
tantôt une graiffe folide, .femblable à du fuif ; 8c
tantôt un graiffe fondue, marbrée de rouge, 8c qui
reffemble à du pus ; d’autres fois c’eft une graiffe
figée, dure 8c melée de filets cellulaires, qu’on croit
reffembler à de la chair. Quelquefois des grains
pierreux fe mêlent à ces matières : elles n’étendent
pas uniquement des tégumens ; mais elles fe forment
des enveloppes très^épaiffes 8c très-folides, par le
rapprochement des lames cellulaires, comprimées
par l’humeur extravafée. Ces membranes deviennent
fouvent auffi dures que des cartilages.
Dans ces tumeurs, les arteres 8c les veines fe dilatent
dans la même proportion. On en voit d’un diamètre
étonnant dans quelques farcomes confidéra-
bles. Il paroît que les tégumens , en prêtant à l’humeur
extravafée, prêtent auffi davantage au fang
artériel.
Mais ce qu’il y a de plus difficile à expliquer', ce
font des morceaux offeux , des cheveux tout-à-fait
femblables à ceux de la tête , des dents, que l’on
trouve dans des tumeurs de cette efpece. Les frag-
mens offeux fe trouvent par-tout ; ils font moins or-
ganifés que les véritables Os , 8c paroiffent être formés
par une humeur pâteufe, qui fe fige , 8c qui
devient fucceffiyement calleufe, cartilagineufe 8c