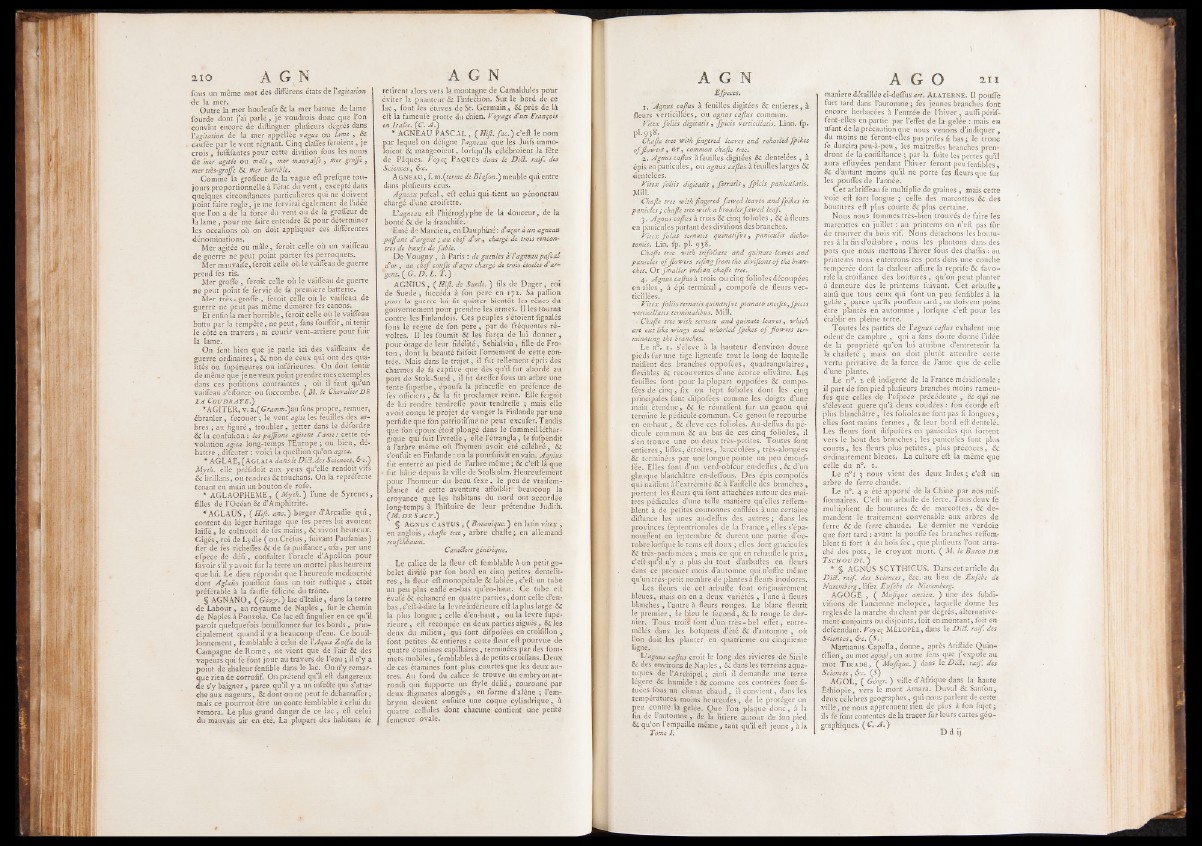
aïo A G N
fous un même mot des différens états1 de Y agitation
de la merv
Outre la mer houleufe & la mer battue de lame
fourde dont j’ai parlé, je voudrois donc que l’on
convînt encore de diftinguer plufieurs degrés dans
P agitation de la mer appellée vague ou lame , &
caufée par le vent régnant. Cinq çlaffes feroient, je
crois , fuffifantes pour cette divifion fous les noms
de mtr agitée ou mâle, mer mauvaife , mer groffe ,
mer très-grojfe & mer horrible.
Comme la groffeur de la vague eft prefque toujours
proportionnelle à l’état du v ent, excepte dans
quelques circonftances particulières qui ne doivent
point faire réglé, je me fervirai également de l’idee
que l’on a de la force du vent ou de la groffeur de
la lame , pour me faire entendre & pour déterminer
les occafions où on doit appliquer ces differentes
dénominations.
Mer agitée ou mâle, feroit celle oii un vaiffeau
de guerre ne peut point porter fes perroquets..
Mer mauvaife, feroit celle où lé vaiffeau de guerre
prend fes ris.
Mer groffe , feroit celle où le vaiffeau de guerre
ne peut point fe fervir de fa première batterie.
Mer très-groffe , feroit celle où le vaiffeau de
guerre ne peut pas même démarer fes canons.
Et enfin la mer horrible, feroit celle où le vaiffeau
battu par la tempête, ne peut, fans fouffrir, ni tenir
le côté en travers, ni courir vent-arriere pour fuir'
la laipe. . # ’
On fent bien que je parle ici des vaiffeaux de
guerre ordinaires, & non de ceux qui ont des qualités
ou fupérieures ou inférieures. On doit fentir
de même que je ne veux point prendre mes exemples
dans ces polirions contraintes , où il faut qu’un
vaiffeau s’efforce ou fuccombe. ( M. le Chevalier DE
LA CûUDRAYE.')
*AGITER, v. z.{Gramm.)dx\ fens propre, remuer,
ébranler, fecouer ; le vent agite les feuilles des arbres
; au figuré, troubler, jetter dans le defordre
& la confufion : Us pajjîons agitent Vame : cétte révolution
agita long-temps l’Europe ; ou bien, débattre
, difeuter : voici la queftion qu’on agita.
* AGLAÉ,(AglAIA dans le D ici. des Sciences* &c.)
Myth. elle préfidoit aux yeux qu’elle rendoitvifs
& brillans, ou tendres & touchans. On la repréfente
tenant en main un bouton de rofe.
* AGLAOPHEME, {M yth .) l’une de Syrenes,
filles de l’Océan & d’Amphitrite.
* AG LAÜS, ( Hifi. anc. ) berger d’Arcadie q u i,
content du léger héritage que fes peres lui avoient
laiffé, le cultivoit de fes mains, & vivoit heureux.
Gigés, roi de Lydie ( ou Créfus, fuivant Paufanias)
fier de fes richeffes & de fa puiffance, ofa , par une
efpece de défi , confulter l’oracle d’Apollon pour
favoir s’il y avoit fur la terre un mortel plus heureux
que lui. Le dieu répondit que l’heureufe médiocrité
dont A glatis jouiffoit fous un toît ruflique , étoit
préférable à la fauffe félicité du trône.
§ AGNANO, ( Géogr. ) lac d’Italie, dans la terre
de Labour , au royaume de Naples , fur le chemin
de Naples à Pouzole. Ce lac eft fingulier en ce qu’il
paroît quelquefois bouillonner fur les bords, principalement
quand il y a beaucoup d’eau. Ce bouillonnement
, lemblable à celui de YAqua Zolfa de la
Campagne de Rome , ne vient que de l’air & des
vapeurs qui fe font jour au travers.de l ’eau ; il n’y a
point de chaleur fenfible dans le lac. On n’y remarque
rien de corrofif. On prétend qu’il eft dangereux
de s’y baigner, parce qu’il y a un infeéte qui s’atta-'
che aux nageurs, & dont on ne peut fe débarraffer ;
mais ce pourroit être un conte lemblable à celui du
rémora. Le plus grand danger de ce lac , eft celui
du mauvais air en été. La plupart des habitans fe
A G N
retirent alors vers la montagne de Camaldules pour
éviter la puanteur & l’infe&ion. Sur le bord de ce
lac , font les étuves de St. Germain, & près de là
eft la fameufe grotte du chien. Voyage d'un François
en Italie. (C. A.)
* AGNEAU PASCAL , {Hifi. fac.) c’eft le nom
par lequel on défigne Y agneau que les Juifs immo-
loient & mangeoient, lorfqu’ils célébroîent la fête
de Pâques. Voye\ Pâques dans le Dict. raif. des
Sciences, &c.
A gneau, Cm .{terme de Blafon.) meuble qui entre
dans plufieurs écus. ,
Agneau pafcal, eft celui qui -tient un pénonceau
chargé d’une croifette.
L’agneau eft l’hiéroglyphe de la douceur, de la
bonté & de la franchife.
'Emé de Marcieu, en Dauphiné: d attira un agneau
pajfant d’argent ; au chef d’or., chargé de trois rencontres
de boeufs de fable.
De Vougny , à Paris : de gueules a Üagneau pafcal
(Cor , au chef coufu d’azur chargé de trois étoiles d’ar-
*gent. { G. D . L. T. )
AGNIUS, {Hifi. de Suede. ) fils de Dager, roi
de Suede, fuccéda à fon pere en 172. Sa paffion
pour la guerre lui fit quitter bientôt les rênes du
gouvernement pour prendre les armes. Il les tourna
contre les Finlandois. Ces peuples s’étoient fignalés
fous le régné de fon p e re , par de fréquentes révoltes.
Il les fournit & les força de/lui donner,
pour otage de leur fidélité, Sehialvia , fille de Fro-
ton , dont la beauté faifoit l’ornement de cette contrée.
Mais dans le trajet, il fut tellement épris des
charmes de fa captive que dès qu’il fut abordé au
port de Stok-Sund , il fit dreffer fous un arbre une
ténte fuperbe, époufa la princeffè en préfence de
fes officiers , & la fit proclamer reine. Elle feignit
de lui rendre tendreffe pour tendreffe ; mais elle
avoit conçu le projet de venger la Finlande par une
perfidie que fon patriotifmë ne peut exeufer. Tandis
qué fon époux étoit plongé dans le fommeil léthargique
qui fuit l’ivreffe , elle l’étrangla ; le fufpendit
à l’arbre même où l’hymen avoit été célébré, &
s’enfuit en Finlande : on là pourfuivit en vain. Agnius
fut enterré au pied de l’arbre même ; & c’eft là que
• fut bâtie depuis la ville de Stolkolm. Heureufement
pour l’honneur du beau fe x e , le peu de vraifem-
blance de cette aventure affoiblit' beaucoup la
croyance qué les habitans du nord ont accordée
long-temps à l’hiftoire de leur prétendue Judith.
{M. d ESa c y .)
§ AGNUS CASTUS , {Botanique.) en latin vitex ,
en anglois, chafie tree, arbre chafte ; en allemand
reufckbaùm,.
Caractère générique.
Le calice de la fleur eft femblable à un petit gobelet
divifé par fon bord en cinq petites dentelures
, la fleur eft monopétale & labiee, c’eft un tube
un peu plus enflé en-bas qu’en-haut. Ce tube eft
évafé & échancré en quatre parties, dont celle d’en-
bas , c’eft-à-dire la le vre inférieure eft la plus large &
la plus longue ; celle d’en-haut, ou la levre fupé-
rieure , eft recoupée én deux parties aiguës, & les
deux du milieu, qui font difpofées en croifillon ,
font petites & entières : cette fleur eft pourvue de
quatre étamines capillaires, terminées par des fom-
mets mobiles, femblables à de petits croiffans. D eux
de ces étamines font plus courtes que les deux autres.
Au fond du calice fe trouve un embryon arrondi
qui fupporte un ftyle délié, couronné par
devient enfuite une coque cylindrique, à
deux ftigmates aloneés , en forme d’alêne ; l’embryon
quatre cellules dont chacune contient une petite
iemence ovale.
A G N 2 . 1 1
Efpeces.
T. Agnus cafius à feuilles digitées & entières, à
fleurs verticillées, ou agnus cafius commun.
Vit ex foliis digitat is , fpicis verticillatis. Linn. fp.
pl.938. -
Chafie tree with fingered leaves and rohorled fpikes
o f flowers, o r , common chafie tree. .
2. Agnus cafius à feuilles digitées & dentelées , à
épis en panicules , ou agnus cafius à feuilles larges &
dentelées.
Vitex foliis digitalis , ferratis, fpicis paniculatis.
Mill.
Chafie tree with fingered fawed leaves and fpikes in
panicles ; chafie tree with a broader fawed leaf.
3. Agnus cafius à trois & cinq folioles , & à fleurs
en panicules partant des divifions des branches.
Vitex foliis ternatis quinatifve, panicults dicho-
tomis. Lin. fp. pl. 938.
Chafie tree with trifoliate and quinate leavts and
panicles o f flowers rifing from the divifions of the branches.
Or fmaller Indian chafie tree.
4. Agnus cafius à trois ou cinq folioles découpées
en ailes , à épi terminal , compofé de fleurs verticillées.
Vitex foliis ternatis quinatifve pinnato incifis, fpicis
•verticillatis terminaltbus. Mill..
• Chafie tree with, ternate and quinate leaves, which
are cut like wings and whorled fpikes o f flowers terminating
the branchesi
Le n°. I . - s’élève à la hauteur d’environ douze
pieds fur une tige ligneiife tout le long de laquelle
naiffent des branches oppofées, quadraneulaires,
flexibles & recouvertes d’une écorce olivâtre. Les
feuilles font pour la plupart oppofées & compo-
fées de cinq, fix ou fept folioles dont les cinq
principales font difpofées comme les doigts d’une
main étendue, & fe réunifient fur un genou qui
termine le pédicule commun. Ce genou fe recourbe
en en-haut, & éleve ces folioles. Au-deffus du pédicule
commun & au bas de ces cinq folioles, il
s’en trouve une bu deux très-petites. Toutes font
entières , lifles, étroites, lancéolées , très-alongées
& terminées par une longue pointe un peu émouf-
fée. Elles font d’un verd-oblcur en-deffus , & d’un
glauque blanchâtre en-deflous. Des épis compofés
qui naiffent à l’extrémité & à l’aiffelle des branches ,
portent les fleurs qui font attachées autour des maîtres
pédicules d’une telle maniéré qu’elles reffem-
blent à de petites couronnes enfilées à une certaine
diftance les unes au-deffus des autres ; dans les
provinces feptentrionales de la France , elles s’épa-
nouiflènt en feptembre & durent une partie d’octobre
lorfque le tems eft doux ; elles font gracieufes
& très-parfumées ; mais ce qui en rehaufle le prix,
c’eft qu’il n’y a plus du tout d’arbuftes en fleurs
dans ce premier mois d’automne qui n’offre même
qu’un très-petit nombre de plantes à fleuifs inodores..
Les fleurs de cet arbufte font originairement
bleues-, mais on en a deux variétés , l’une à fleurs
blanches/,- l’autre à fleurs rouges. Le blanc fleurit
le premier, le bleu le fécond, & le rouge le dernier.
Tous trois font d’un trè s-b e l effet, entremêlés
dans les bofquets d’été & d’automne , où
l’on doit les planter en quatrième ou cinquième
ligne.
klagnus cafius croît le long des rivieres de Sicile
& des environs de Naples , & dans les terreins aquatiques
de l’Archipel ; ainfi il demande une terre
légère & humide : & comme ces contrées font fi-
tuéësfous un climat chaud, il convient, dans les
températures moins heureufes, de le protéger un
peu contre la gelée. Que l’on plaque donc, à la
fin de l’automne, de la litiere autour de fon pied
& qu’on l’empaille même, tant qu’il eft jeune , à la
. T om e l. ■ 7
A G O
maniéré détaillée ci-deffus art. Alaterne. Il pouffe
fort tard dans l’automne ; fes jeunes branches font
encore herbacées à l’entrée de l’hiver, aufli périf-
fent-elles en partie par l’effet de la gelée : mais en
ufant de la précaution que nous venons d’indiquer ,
du moins ne feront-elles pas prifes fi bas ; le tronc
fe durcira peu-à-peu, les maîtreffes branches prendront
de la confiftance ; par la fuite les pertes qu’il
aura effuyées pendant l’hiver feront peu fenfibles,
& d’autant moins qu’il ne porte fes fleurs que fur
les pouffes de l’année.
Cet arbriffeau fe multiplie de graines , mais cette
voie eft fort longue ; celle des .marcottes & des
boutures eft plus courte & plus certaine.
Npus nous fommes très-bien trouvés de faire les
marcottes en juillet : au printems on n’eft pas fur
de trouver du-bois vif. Nous détachons les boutures
à la fin d’ottobre , nous les plantons dans des
pots que nous mettons l’hiver fous des chaffis : au
printems nous enterrons ces pots dans une couche
tempérée dont la chaleur affure la reprife & favo-
rife la croiffance des boutures, qu’on peut planter
à demeure dès le printems fuivant. Cet arbufte -,
ainfi que tous ceux qui font un peu fènfibleS à la
gelée , parce qu’ils pouffent tard , ne doivent point
être plantés en automme , lorfque c’eft pour les
établir en pleine terre.
Toutes les parties de Y agnus cafius exhalent une
odeur de camphre , qui a fans doute donné l’idée
de la propriété qu’on lui attribue d’entretenir la
la chafteté ; mais on doit plutôt attendre- cette
Vertu privative de la force de l’ame que de celle
d’une plante.
Le n°. 2 eft indigène de la France méridionale :
il part de fon pied plufieurs branches moins rameu-
fes que celles de l’efpece précédente ÿ & qui ne
s’élèvent guere qu’à deux coudées : fon éconfe eft
plus blanchâtre , les folioles ne font pas fi longues,
elles font moins fermes , & leur bord eft dentelée
Les fleurs font difpofées en panicules qui fortent
vers le bout des branches ; les panicules font plus
courts, les fleurs plus petites, plus précoces, ôc
ordinairement bleues. La culture eft la même que
celle du n°. 1.
Le n°j 3 nous vient des deux Indes ; c’eft un
arbre de ferre chaude.
Le n°. 4 a été apporté de la Chine par nos mif-
fionnaires. C ’eft un arbufte de ferre. Tous deux fe
multiplient de boutures & de marcottes, & demandent
le traitement convenable aux arbres de
ferre & de ferre chaude. Le dernier ne verdoie
que fort tard : avant la pouffe fes branches reffem-
blént fi fort à du bois*fec, que plufieurs l’ont arraché
dès pots, le croyant mort. { M. le Baron d e
T s c h o u d i . )
* § AGNUS SCYTHICUS. Dans cet article du
Dicl. raif. des Sciences, &c. au lieu de Eufebe de
Nuremberg, lifez Eufebe de Nieremberg.
AGOGÉ , ( Mufique ancien. ) une des fubdi-
vifions de l’ancienne mélopée, laquelle donne les
réglés de la marche du chant par dégrés, alternativement
conjoints ou disjoints, foit en montant, foit en
defeendant. Voye^ Mélopée, dans le Dicl. raif. des
Sciences, &c. {S.)
Martianus Capella, donne, après Ariftide Quin-
tilien , au mot agogé, un autre fens que j’expofe au
mot T irade, ( Mufique.) dans le Dicl. raif. des
Sciences, H f f l -*%■ ■ ■
AGO L, ( Géogr. ) ville d Afrique dans la haute
Éthiopie, vers le mont Amara. Duval & Sanfon,
deux célébrés géographes, qui nous parlent de cette
v ille , ne nous apprennent rien de plus à fon fujet ;
ils fe font contentés de la tracer fur leurs cartes géographiques.
{C. A .)
D d ij