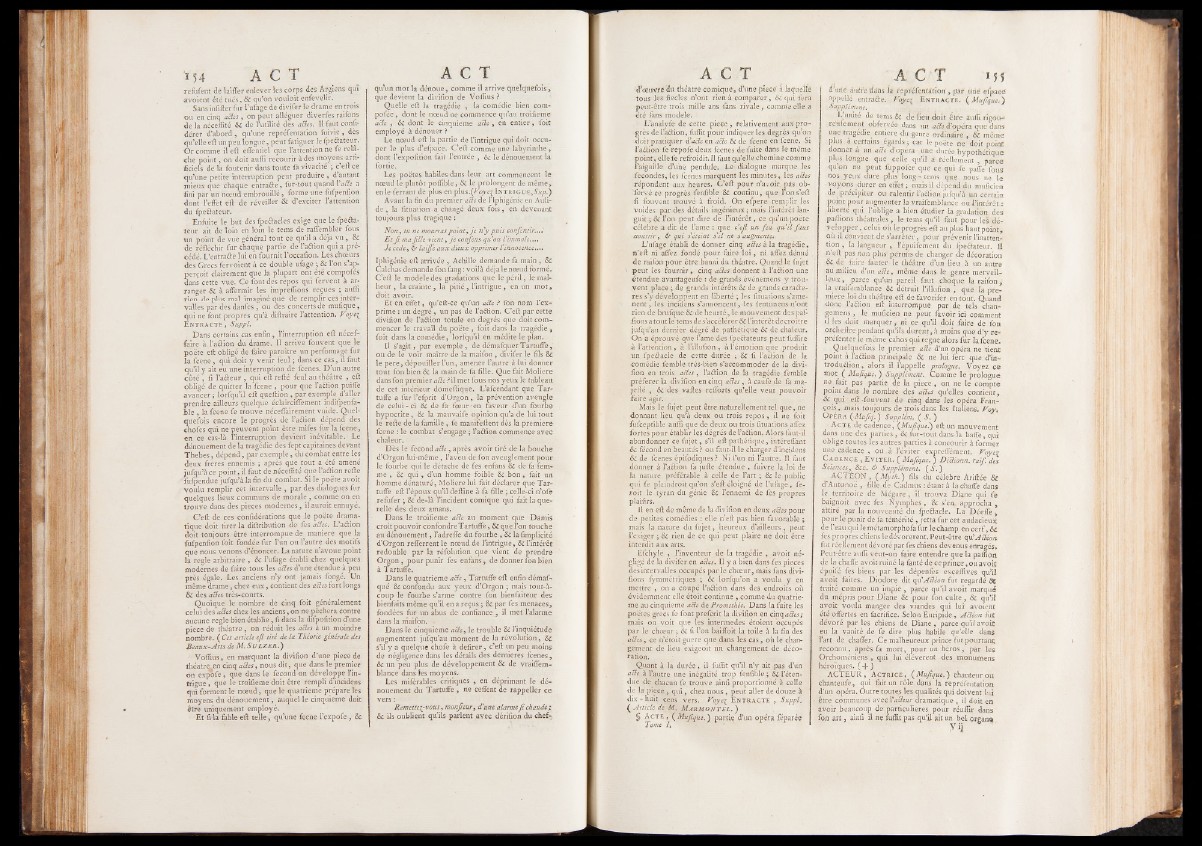
refufent de îaider enlever les corps des Argiens qui
avoient été tués, & qu’on vouloit enfevelir.
Sans infifter fur l ’ufage de divifer le drame en trois
ou en cinq actes, on peut alléguer diverfes raifons
de la néceffité & de l’utilité des actes. Il faut confi-
dérer d’abord , qu’une repréfentation fuivie , dès
qu’elle eft un peu longue, peut fatiguer le fpeâateur.
Or comme il eft effentiel que l’attention ne fe relâche
point, on doit auffi recourir -à des moyens -artificiels
de la foutenir dans toute fa vivacité ; c eft ce
qu’une petite interruption peut produire , d’autant
mieux que chaque entraâe, fur-tout quand Y acte a
fini par un noeud embrouillé, forme une fufpenfion
dont ■ l’effet eft de réveiller & d ’exciter l’attention
du fpeâateur.
Enfuite le but des fpeôacîes exige que le fpeâateur
ait de loin en loin le tems de raffembler fous
Un point de vue général tout Ce qu’il a déjà vu , &c
de réfléchir fur fchaque partie de l’aâion qui a précédé.
L’entraâe lui en fournit Foccafion. Les choeurs
des Grecs fervoient à ce double ufage ; & l’on s’ap-
perçoit clairement que la plupart ont été compofés
dans cette vue. Ce font des repos qui fervent à arranger
& à affermir les impreflions reçues ; aufîi
rien de plus mal imaginé que de remplir ces intervalles
par des danfes , ou des concerts de mufique,
qui ne font propres qu’à diftraire l’attention. Voyez
E n t r a c t e , Suppl.
Dans certains cas enfin, l’interruption eft nécef-
faire à j ’aâion du drame. Il arrive fouvent que le
poëte eft obligé de faire paroître un perfonnage fur
la fcene , qui doit y venir feul ; dans ce cas, il faut
qu’il y ait eu une interruption de fcenes. D un autre
côté , fi l’aâeur , qui eft refté feul au théâtre , eft
obligé de quitter la fcene , pour que faction puiffe
avancer ; lorfqu’il eft queftion , par exemple d’aller
prendre ailleurs quelque éclairciffement indifpenfa-
ble , la fcene fe trouve néceffairement vuide. Quelquefois
encore le progrès de l’aâion dépend des
chofes qui ne peuvent point être mifes fur la fcene,
en ce cas-là l’interruption devient inévitable. Le
dénouement de la tragédie des fept capitaines devant
Thebes, dépend, par exemple, du combat entre les
deux freres ennemis ; après que tout a été amené
iufqu’àce point, il faut de néceffité que l’aâion refte
fufpendtie jufqu’àlafin du combat. Si le poète avoit
voulu remplir cet intervalle , par des dialogues fur
quelques lieux communs de morale , comme on en
trouve dans des pièces modernes, il auroit ennuyé.
- C’eft de ces confidérations que le poëte dramatique
doit tirer la diftribution de fes actes. L ’aâion
doit toujours être interrompue de maniéré que la
fufpenfion foit fondée fur l’un ou l’autre des motifs
que nous venons d’énoncer. La nature n’avoue point
la réglé arbitraire , & l’ufage établi chez quelques
modernes de faire tous les actes d’une etendue à peu
près égale. Les anciens n’y ont jamais fonge. Un
même drame, chez eu x, contient des actes fort longs
& des actes très-courts.
Quoique le nombre de cinq foit généralement
celui des actes chez les anciens, on ne pechera contre
aucune réglé bien établie, fi dans la difpofition d’une
piece de théâtre, on réduit les actes à un moindre
nombre. ( Cet article eft tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. S u l z e r .)
Voffius, en marquant la divifion d’une piece de
théatrf^en cinq actes, nous dit, que dans le premier
on expofe , que dans le fécond on développe l ’intrigue
, que le troifieme doit être rempli d’incidens
qui forment le noeud, que le quatrième prépare les
moyens du dénouement, auquel le cinquième doit
être uniquement employé.
Et fila fable eft telle, qu’une fcene l’çxpofe, &
qu’un mot la dénoue, comme il arrive quelquefois,
que devient la divifion de Vofiius ?
Quelle eft la tragédie , la comédie bien com-
pofée, dont le noeud ne commence qu’au troifieme
acte , & dont le cinquième acte , en entier, foit
employé à dénouer ?
Le noeud eft la partie de l’intrigue qui doit occuper
le plus d’efpace. C’eft comme une labyrinthe,
dont l’expofition fait l’entrée , & le dénouement la
fbrtie.
Les poètes habiles dans leur art commencent le
noeud le plutôt poflible, & le prolongent de même,,
en le ferrant de plus en plus.(Voyez Intrigu e,Sùp.)
Avant la fin du premier acte de l’Iphigénie en Auli-
de , la fituation - a changé deux fois , en devenant
toujours plus tragique :
Non, tu ne mourras point, je n'y puis eonfentir.,,1
E t J i ma fille vient, je confens qu'on l'immole. . . . ,
Je cede, 6* laijfie aux dieux opprimer l'innocence....
Iphigénie eft arrivée , Achille demande fa main , &
Calchas demande fon fang : voilà déjà le noeud formé.'
C’eft le modèle des gradations que le péril, le malheur
, la crainte , la pitié , l’intrigue , en un mot,
doit avoir.
Et en effet, qu’eft-ce qu’un acte ? fon nom l’exprime
: un degré , un pas de l’aâion. C’ eft par cette
divifion de l’aâion totale en degrés que doit commencer
le travail du poëte , foit dans la tragédie ,
foit dans la comédie, lorfqu’il en médite le plan.
Il s’agit, par exemple, de démafquer Tartuffe,
ou de le voir maître de la maifon, divifer le fils &c
le pere, dépouiller l’un, amener l’autre à lui donner
tout fon bien & la main de fa fille. Que fait Moliere
dans fon premier acte?il met fous nos yeux le tableau
de cet intérieur domeftique. L’afcendant que Tartuffe
a fur l’efprit d’Orgon , la prévention aveugle
de ce lu i-ci & de fa foeur-en faveur d’un fourbe
hypocrite, & la màuvaife opinion qu’a de lui tout
le refte de la famille , fe manifeftent dès la première
fcene : le combat s’engage ; l’aâion commence avec
chaleur.
Dès le fécond acte, après avoir tiré de la bouche
d’Orgon lui-même, l’aveu de fon aveuglement pour
le fourbe qui le détache de fes enfans oc de fa femme
, & qui , d’un homme foible & bon, fait un
homme dénaturé, Moliere lui fait déclarer que Tartuffe
eft l’époux qu’il deftine à fa fille ; celle-ci n’ofe
refufer ; & de-là l’incident comique qui fait la querelle
des deux amans.
Dans le troifieme acte au moment que Damis
croit pouvoir confondre Tartuffe, & que l’on touche
au dénouement, l’adreffe du fourbe , & la fimplicité
d’Orgon refferrent le noeud de l’intrigue, & l’intérêt
redouble par la réfolution que vient de prendre
Orgon, pour punir fes enfans, de donner fon bien
à Tartuffe.
Dans le quatrième acte, Tartuffe eft enfin démaf-
qué & confondu aux yeux d’Orgon ; mais tout-à-
coup le fourbe s’arme contre fon bienfaiteur des
bienfaits même qu’il en a reçus ; & par fes menaces,
fondées fur un abus de confiance , il met l’alarme
dans la maifon. •-
Dans le cinquième acte, le trouble & l’inquiétude
augmentent jufqu’au moment de la révolution, &
s’il y a quelque chofe à defirer, c’eft un peu moins
de négligence dans les détails des dernieres fcenes,
& un peu plus de développement & de vraisemblance
dans fes moyens.
Les miférables critiques , en déprimant le dénouement
du Tartuffe , ne ceffent de rappeller ce
vers :
Remettez-vous, monfieur, d'une alarme J i chaude ;
& ils oublient qu’ils parlent avec dérifion du chefs
cFceuvré du théâtre comique, d’une piece a laquelle
tous les fiecles n’ont rien à comparer, oé qui fera
peut-être trois mille ans fans rivale, comme elle a
été fans; modèle.
L’analyfe de cette piece, relativement aux progrès
de l’aâion, fuffit pour indiquer les degrés qu’on
doit pratiquer d'acte en acte & de fcene en fcene. Si
l’aâion fe repofe deux fcenes de fuite dans le même
point, elle fe refroidit* Il faut qu’elle chemine comme
l’aiguille d’unè pendule* Le dialogue marque les
fécondes, les fcenes marquent lés minutes, les actes
répondent aux heures. C’eft pour n’avoir, pas obs
e rv é ce progrès, fenfible &£ continu , que l’ons’eft
fi fouvent trouvé à froid. On efpere remplir les
vuides par des détails ingénieux ; mais l’intérêt languit.;
& l’on peut dire de l’intérêt, ce qu’un poète
célébré a dit de Taine : que c'efi uti fieu qü'il faut
■ nourrir, & qui s'éteint s'il ne s*augmente*,
L’ufage établi de donner cinq actes â la tragédie,
n’eft ni allez fondé pour faire lo i , ni àffez dénué ,
de raifon pour être banni du théâtre. Quand le fujet
' peut les fournir, cinq actes donnent à l’action une
étendue avantageufe : de grands événemens y trouvent
place ; de grands intérêts & de grands caractères
s’y développent en libèrté ; les fituations s’amènent
, les incidens s’annoncent, les fentimens n’ont
rien de brufque &'de heurté, le mouvement despaf-
fions a tout le tems de s’accélérer & l’intérêt de croître
.jufqiï’au dernier dégré de pathétique & de chaleur.
On a éprouvé que l’ame des fpéclateurs peut fuffire
à l’attention , à Fillufion , à l’émotion que .produit
un fpeâacle de cette durée ; & fi l’aâion de la
comédie femble très-bien s’accommoder de la divifion
en trois actes, l’aâion de la tragédie femble
préférer la divifion en cinq actes,. à caufè de fa ma-
jefté , &; des vaftes refforts qu’elle veut pouvoir
faire agir.
Mais le fujet peut être naturellement tel que, ne
donnant lieu qu’à deux ou trois repos, il ne foit
fufceptible auffi que de deux ou trois fituations affez
fortes pour établir les dégrés de l’aâion. Alors faut-il
abandonner ce fujet, s’il eft pathétique, intéreffant
êc fécond en beautés ? ou faut-il le charger d’incidens
& de fcenes épifodiques ? Ni l’un ni l’autre. Il faut
donner à l’aâion fa jufte étendue , fuivre la loi de
la nature préférable à celle de l’art ; & le public
qui fe plaindroit qu’on s’eft éloigné de l’ufage, fe-
roit le tyran du génie & l’ennemi de fes propres j
plaifirs.
11 en eft de même de la divifion en deux actes pour
de petites comédies •’ elle ’n’eft pas bien favorable ;
mais la nature du fujet, heureux d’ailleurs, peut
l’exiger ; & rien de ce qui peut plaire ne doit être
interdit aux arts.
Efchyle , l’inventeur de la tragédie , avoit négligé
de la divifer en actes. Il y a bien dans .fes pièces
des intervalles occupés parle choeur, mais fans divi-
fions fymmétriques ; & lorfqu’on a voulu y en
mettre , on a coupé l’aâion dans des endroits où
évidemment elle étoit continue ,.comme du quatrième
au cinquième acte de Promethèe. Dans la fuite les
poètes grecs fe font preferit la divifion en cinq actes;
mais on voit que les intermèdes étoient "occupés
par le choeur ; & fi l’on baiffoit la toile à la fin des
actes, ce n’étoit guere que dans les cas, où le changement
de lieu exigeoit un changement de décoration.
Quant à la durée, il fuffit qu’il n’y ait pas d’un
acte à l’autre une inégalité trop fenfible ; éc l’étendue
de chacun le, trouve ainfi proportionné à celle
de la piece , q ui, chez nous , peut aller de douze à
d ix-huit cens vers. Voyez Entracte , Suppl.
( Article de M. Ma r m o n t e l . )
§ Acte , ( Mujique. ) partie d’un opéra féparée
Tome /, *
a’utîë âùtfe fddfls la rèpféfentafiori , par iîné‘ éfpaeé
appelle entraâe. Voyez Entracte. ( Mujique. )
Supplément.
L unité dé tems & de lieu doit être auffi rigoù-
reufement obfeçvée dans un acte, d’opéra que dans
une tragédie^ entière du genre ordinaire , & même
plus à certains égards ; car le poëte ne doit point
donner a un acte d opéra une durée hypothétique
plus longue, que celle qu’il U réellement , parce
qu’on ne peut fuppofer que ce qui fe paffe fous
nos yeux dure plus long - tems que nous ne lé
- voyons .durer en effet ; mais il dépend du muficien
de précipiter ou-ralentir l’aâion jufqu’â un certain
point pour augmenter la vraifemblance ou l’intérêt.:
liberté qui l’oblige a bien étudier la gradation des
-pafliorts théâtrales, le tems qu’il faut pour les développer,
celui où le progrès eft au plus haut point,
qù il convient de s’arrêter, pdur prévenir l’inattention
, la langueur , l’épuifement du. fpeâaféur. Il
n’eft pas- non plus permis de changer de décoration
& dé faire fauter le théâtre d’un lieu à un autre
au milieu d’un acte, même dans- le genre merveilleu
x , parce qu’urt pareil faut choque la raifon ,
la vraifemblance & détruit l’illufion , que la première
loi du théâtre eft de favorifer en tout. Quand
donc l’aâion eft interrompue par de tels chan^
gemens , le muficien ne peut favoir ici comment
il lés - doit marquer, ni ce qu’il doit faire de. fon
orcheftre pendant qu’ils durent, à moins que d'y re-
préfenter le même cahos qui régné alors fur la fcene.
Quelquefois le premier acte d’un opéra ne tient
point à l’aâion principale & ne lui fert que d’in-
troduâion, alors il l’appelle prologue. Voyez ce
ûlot. ( Mufiqïie. ) Supplément. Comme le prologue
ne fa it pas partie de la piece , on, ne le compté
point dans le nombre des actes qu’elles contient,
& qui - eft-fouvent de cinq dans les opéra François
mais toujours de trois dans les Italiens. Voy.
Opéra (-Mufiq. ) Supplém. ( S. )
Acte de cadence, (Mufique.) eft un mouvement
dans une des parties , §£ fur-tout dans-la baffe, qui
oblige toutes les autres parties à concourir à former
une cadence , ou . à l’éviter expreffément. Voyez
Cadence , Eviter. ( Mujique. ) Diçtionn. raifi. des
Sciences, & c . & Supplément. ( S. )
A C T É O N , ( Myth. ) fils du célébré Ariftée &
d’Autpnoë , fille de Çadmûs : étant à la chaffe dans
le territoire de Mégare , il trouva Di^ne qui fe
hefigpoit avec fes Nymphes, & s’en, approcha j
attiré par la nouveauté, du fpeâacle. La Déeffe ,
pour le punir de fa témérité , jetta fur cet audacieux
de l’eau qui le métamorphofa fur le champ en ce rf,
fes propres chiens le dévorèrent. Peut-être qu'Actéort
fut réellement dévoré par fes chiens devenus enragés,
Peut-être auffi veut-on faire entendre que la paffioil
de la chaffe avoit ruiné la fanté de ce prince, ou avoit
épuiié fes biens par les dépenfes exceffives qu’iî
avo.it faites. Diodore dit qu'Actéon fut regardé ÔE
traité comme un impie , parce qu’il avoit marqué
du mépris pour Diane & pour fon culte, & qu’il
avoit voulu manger des viandes qui lui- avoient
été offertes en facrifice. Selon Euripide , Actéon fut
dévoré par les chiens de Diane , parce qu’il avoit
eu la vanité de fe dire plus habile qu’elle dans
l’art de chaffer. Ce malheureux prince fut pourtant
reconnu, après fa mort, pour un héros, par les
Orchoméniens , qui lui éléverent des monumens
héroïques. ( + )
A CTEU R , Actrice-, (Mufique.) chanteur ou
chanteufe, qui fait un rôle dans la repréfentation
d’un opéra. Outre toute^s les qualités qui doivent lui
.être communes avec l'acteur dramatique , il doit en
avoir beaucoup de particulières pour réuffir dans
fon art, ainfi il ne fuffit pas qu’il ait ün bel organe