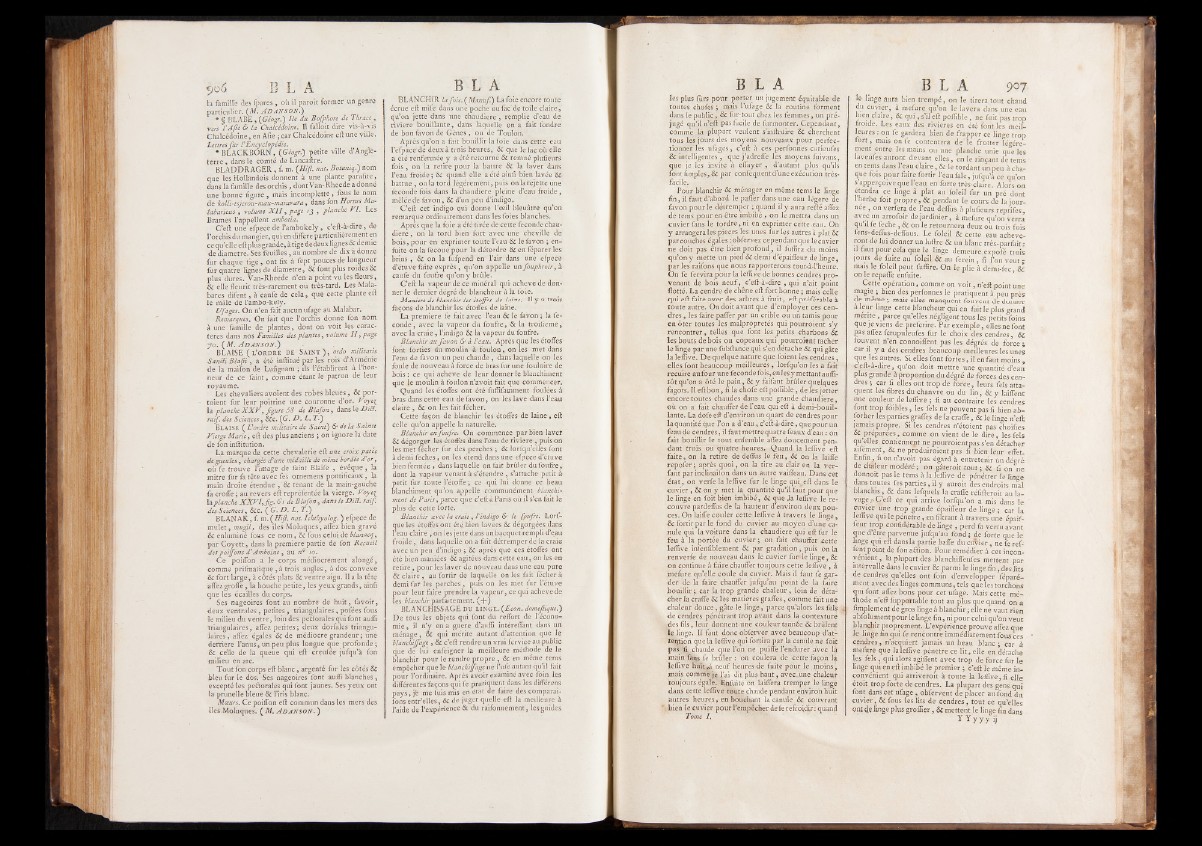
ia famille Ses fpares , où il paroît former un genre
particulier. (AL A d a n s o n .)
-* § -BLABE, (Géogr.) Ile du Bofpkore de Thracej
Vers L'A fie & la Chalcédoine. Il falloit dire vis-à-vis
Chalcédoine, en Afie ;car Chalcédoine eft une ville.
Lettres fur l’Encyclopédie.
* BLACKBORN, {Géogr.) petite ville d’Angleterre
, dans le comté de Lancaftre.
BLADDRAGER , f. m. {Hifl. nat. Botaniq,) nom
que les Hollandois donnent à une plante paraître,
dans la famille des orchis, dont Van-Rheede a donné
une bonne figure , mais incomplette , fous le nom
de kolCi-tsjerou-mau-maravara, dans fon Hortus Ma-
labaricus , volume X I I , page 13 , planche FI. Les
Brames l’appellent ambotia.
C’eft une efpece de l’ambokely, c’eft-a-dire, de
l’orchis du mangier, qui en différé particuliérement en
ce qu’elle eft plus grande, à tige de deux lignes 8c demie
de diamètre. Ses feuilles, au nombre de dix à douze
fur chaque tige, ont fix à fept pouces de longueur
fur quatre lignes de diamètre, & font plus roides &
plus dures. Van-Rheede n’en a point vu les fleurs,
& elle fleurit très-rarement ou très-tard. Les Mala-
bares difent, à caufe de cela, que cette plante eft
le mâle de l’ambo-kely.
Ufages. On n’ en fait aucun ufage au Malabar.
Remarqués. On fait que l’orchis donne fon nom
à une famille de plantes, dont on voit les caractères
dans nos Familles des plantes, volume I I , page
7 o. (M . A d an so n .)
BLAISE ( l’o r d r e d e S a in t ) , ordo militaris
Sancli B lafii, a été inftitué par les rois d’ Arménie
de la maifon de Lufignam ; ils l’établirent à l’honneur
de ce faint, comme étant le patron de leur
royaume.
Les chevaliers avoient des robes bleues, 8c por-
toient fur leur poitrine une couronne d’or. Voye£
la planche X X V , figure 58 de Blafon, dans le Dicl.
raif. des Sciences, &c. (G. D . L. T.)
BLAISE ( U ordre militaire de Saint) & de la Sainte
■ Vierge Marie, eft des plus anciens ; on ignore la date
de fon inftitutiori.
La marque de cette chevalerie eft une croix pâtée
de gueules, chargée d’une médaille de même bordee eTor,
où fe trouve l’image de feint Blaife , évêque, la
mitre fur fe tête avec fes ornemens pontificaux, la
main droite étendue tenant de la main-gauche
fa croffe ; au revers eft repréfentée la vierge. Voye{
la planche X X V /, fig. S i de Blafon, dans le Dicl. raif.
des Sciences, &c. ( G. D . L. T.)
BLAN AK, f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog. ) efpece de
mulet, mugil, des îles Moluques, affez bien gravé
8c enluminé fous ce nom, 8c fous celui de blanacq,
par Coyett, dans la première'partie de fon Recueil
despoijfons d'Amboine, au nQ 10.
Ce poiflon a le corps médiocrement alongé,
comme prifmatique ,à trois angles, à dos convexe
& fort large, à côtés plats 8c ventre aigu. Il a la tête
aflez groffe, la bouche petite, les yeux grands, ainfi
que les écailles du corps.
Ses nageoires font au nombre de huit, favoir,
deux ventrales, petites , triangulaires, pofées fous
■ le milieu du ventre, loin des peftorales-qui font aufli
triangulaires, aflez petites ; deux dorfales triangulaires
, aflez égales & de médiocre grandeur ; une
derrière l’anus, un peu plus longue que profonde ;
& celle de la queue qui eft creufée jufqu’à fon
milieu en arc.
Tout fon corps eft blanc, argenté fur les côtés 8c
bleu fur le dos. Ses nageoires font aufli blanches,
excepté les peftorales qui font jaunes. Ses yeux ont
la prunelle bleue & l’iris blanc.
Moeurs. Ce poiflon eft commun dans les mers des
îles. Moluques. ( M, A d an son . )
BLANCHIR la foie.(Mamif.) La foie encore toute
écrue eft mife dans une poche ou fac de toile claire,
qu’on jette dans une chaudière , remplie d’eau de
riviere bouillante, dans laquelle on a fait fondre
de bon favon de Gènes , Ou de Toulon.
Après qu’on a fait bouillir la foie dans cette eau
l’éfpàce de deux à trois heures, 8c que le fac où elle
a été renfermée y a été retourné 8c remué plufieurs
fo is , on la retire pour la battre 8c la laver dans
l’eau froide ; & quand elle a été ainfi bien lavée 8c
battue , onia tord légèrement, puis on la rejette une
fécondé fois dans la chaudière pleine d’eau froide,
mêlée de favon, 8c d’un peu d’indigo.
C ’eft cet indigo qui donne l’oeil bleuâtre qu’on
remarque ordinairement dans les foies blanches.
Après que la foie a été tirée de cette feçonde chaudière
, on la tord bien fort avec une cheville de
bois, pour en exprimer toute l’eau & le favon ; en-
fuite on la fecoue pour la détordre 8c en féparer les
brins , & on la fufpend en l’air dans une efpece
d’étuve faite exprès, qu’on appelle un fouphroir, à
caufe du foufre qu’on y brûle.
C’eft'la vapeur dé ce minéral qui achevé de donner
le dernier dégré de blancheur à la foie.
Maniéré de blanchir les étoffes de laine. Il y a trois
façons de blanchir les étoffes de laine.
La première fe fait avec l’eau & le favon ; la fécondé
, avec la vapeur du foufre, & la troifieme,
avec la craie , l’indigo 8c la vapeur du foufre.
Blanchir au favon & a Ceau. Après que les étoffes
font forties du moulin à foulon, on les met dans
l’eau de favon un peu chaude, dans laquelle on les
foule de nouveau à force de bras fur une fouloire de
bois : ce qui achevé de leur donner le blanchiment
que le moulin à foulon n’avoit fait que commencer.
Quand les étoffes ont été fuffifamment foulées à
bras dans cette eau de favon, on les lave dans l’eau
claire , 8c on les fait fécher.
Cette façon de blanchir les étoffes de laine , eft
celle qu’on appelle la naturelle.
Blanchir en foufre. On commence par bien laver
& dégorger les étoffes dans l’eau de riviere , puis on
les met fécher fur des perches ; & lorfq.u’ e llç s font
à demi feches, on les étend dans une efpece d’étuve
bien fermée > dans laquelle on fait brûler du foufre,
dont la vapeur venant à s’étendre , s’attache petit à
petit fur toute l’étoffe; ce qui lui donne ce. beau
blanchiment quon appelle communément blanchiment
de Paris, parce que c’eft à Paris où il s’en fait le
plus de cette forte.
Blanchir avec la craie, l'indigo & le fpufre. Lorsque
les étoffes ont été. bien lavées 8c dégorgées dans
l’eau claire , on les jette dans un bacquet rempli d’eau
froide, dans laquelle on a fait détremper de la craie
avec un peu d’indigo ; & après que ces étoffes ont
été bien maniées & agitées dans cette eau, on les en
retire, pour les laver de nouveau dans une eau pure
& claire , au fortir de laquelle on les fait fécher à
demi fur les perches , puis on les met fur l’étuve
pour leur faire prendre la vapeur, ce qui achevé de
les blanchir parfaitement. (+ )
BLANCHISSAGE DU l in g e . (Econ. domefiique.)
De tous les objets qui font du reffort de l'économie
, il n’y en a guere d’aufli intéreffant dans un
ménage, 8c qui mérite autant d’attention que le:
blanchiffage, 8c c’eft rendre un vrai fervice au public
que de lui enfeigner la meilleure méthode de le
blanchir pour le rendre propre , 8c en même tems
empêcher que le blanchiffage ne l’ufe autant qu’il fait
pour l’ordinaire. Après avoir examiné avec loin les
différentes façons qui fe pratiquent dans les differens
pays, j*e me fuis mis en état de faire des comparai-
fons entr’elles, 8c de juger quelle eft la meilleure à
l’aide de l’expérience & du raifonnement, les guides
les plus furs pour porter un jugement équitable de
toutes chofes ; mais l’ufage & la routine forment
dans le public, 8c fur-tout chez les femmes, un préjugé
qu’il n’èft pas facile de furmonter. Cependant,
comme là plupart veulent s’inftrüire 8ç cherchent
tous les jours des moyens nouveaux pour perfectionner
les ufages, c’eft à ces perfonnes curieufes
8c intelligentes , que j ’adreffe les moyens fuivans,/
que je . les invite à effayer , d’autant plus qu’ils
fontfimples, 8c par conféquentd’une exécution très-
facile. .
Pour blanchir 8c ménager en même tems le linge
fin, il faut d’abord le palier dans une eau légère de
favon pour le détremper ; quand il y aura refté aflez
de tems pour en être imbibé, on le mettra, dans un
cuvier fans le tordre, ni en exprimer cette .eau. On
y arrangera les pièces les unes fur les autres à plat 8c
par couches égales robfervez cependantque lecuvier
ne doit pas être bien profond, il fùffira du moins
qu’on y mette un pied 8c demi d’épaiffeur de linge,
par les raifons que nous rapporterons tout-à-l’heure.
On fe fervira pour la leffïve de bonnes cendres provenant
de bois neuf, c’eft-à-dire , qui n’ait point
flotté. La cendre de chêne eft fort bonne ; mais celle
qui eft faite avec des arbres à fruit, eft préférable à
toute autre. On doit avant que d’employer ces cendres
, les faire paffer par un crible pu un tamis pour
en ôter toutes les malpropretés qui pourroient s’y
rencontrer, telles que font les petits charbons 8c
les bouts de bois ou copeaux qui pourroient tacher
le linge par une fubftance qui s’en détache & qui gâte
la leffive. De quelque nature que foient les cendres,
elles font beaucoup meilleures, lorfqu’on les a fait
recuire aufour une fécondé fois, enlesymettantauffi-
tôt qu’on a ôté le pain, & y faifent brûler quelques
fagots. Il eft bon, fi la chofe eft poflible, de les jetter
encore toutes chaudes dans une grande chaudière,
où on a fait chauffer de l’eau qui eft à demi-bouillante.
La dofeeft d’environ un quart de cendres pour
la quantité que l’on a d’eau, c’eft-à-dire, que pour un
feau de cendres, il faut mettre quatre féaux d’eau : on
fait bouillir le tout enfemble aflez doucement pendant
trois ou quatre heures. Quand la leffive eft
faite, on la retire de deflùs le feu, & on la laiffe
repofer ; après quoi, on la tire au clair en la ver-
fant par inclinaifon dans un autre vaiffeau. Dans cet
état, on verfe la leffive fur le linge qui^eft dans le
cuvier , & on y met la quantité qu’il faut pour que
le linge en foit bien imbibé, & que Ja leffive le recouvre
pardeffus de la hauteur d’environ deux pouces.
On laiffe couler cette leffive à travers le linge,
& fortir par le fond du cuvier au moyen d’une canule
qui la voiture dans la chaudière qui eft fur le
feu à la portée du cuvier ; on fait chauffer cette
leffive infenfiblement 8c par gradation, puis on la
renverfe de nouveau dans le cuvier fur le linge, 8c
on continue à faire chauffer toujours cette leffive , à
jtnëfure qu’elle coule du cuvier. Mais il faut fe garder
de la faire chauffer jufqu’au point de la faire
bouillir; car la trop grande chaleur, loin de détacher
la craffe 8c les matières graffes, comme fait une
chaleur douce, gâte le linge, parce qu’alors les fels .
de cendres pénétrant trop avant dans la contexture
^des fils, leur donnent une couleur tannée & brûlent
le linge. Il faut donc obleryer. avec beaucoup d’at-
ieqtion que la leffive qui fortira par la canule ne foit
pas fi chaude que l’on ne puiffe l’endurer avec là
main faqs fe brûler : on coulera de cette façon la
leffive huit(<à neuf heures de fuite pour le moins *
mais comme je l’ai dit plus haut, avec.une chaleur
toujours égale. Enfuitë on laifl'era tremper le linge
dans cette leffive toute chaude pendant, environ huit
autres heuresen bouchant la canule & couvrant
■ bien le cuvier pour l’empêcher de fe refroidir: quand
Tome I,
le linge aura bien trempé, on le tirera tout chaud
du cuvier, à mefure qu’on le lavera dans une eau
bien claire, & qui, s’il eft poflible, ne foit pas trop
froide. Les eaux des rivières en été font les meil-
Ieures : on fe gardera bien de frapper ce linge trop
fo r t , mais on fe contentera de le frotter légèrement
entre les mains ou une planche unie que les
laveùfes auront devant elles, en le rinçant de tems
en tems dans l’eau claire, & le tordant un peu à chaque
fois pour faire fortir l’eau fale, jufqu’à ce qu’on
s’apperçoivc que l ’eau en forte très-claire. Alors on
etendra ce linge à plat au foleil fur un pré dont
1 herbe foit propre, & pendant le cours de la journée
, on verferade l’eau deffus à plufieurs reprifes,
avec un arrofoir' de jardinier, à mefure qu’on verra
qu’il fe feche , & on le retournera deux ou trois fois
lens-defliis-deffous. Le foleil & cette eau achèveront
de lui donner un luftre & un blanc très-parfait:
il faut pour cela que le linge demeure expofé trois
jours de fuite au foleil. & au ferein, li l’on veut -
mais le foleil peut fuffire. On le plie à demi-fec, 8c
on le repaffe enfuite.
Cette' opération, comme on v o it , n’eft point une
magie ; bien des perfonnes le pratiquent à peu près
de même ; mais elles manquent fouvent de donner
à leur linge cette blancheur qui en fait le plus grand
mente » parce qu’elles négligent tous les petits foins
que je viens de preferire. Par exemple, elles ne font
pas aflez fcrupuleufes fur le choix des cendres, 8c
fouvent n’en connoiflent pas les dégrés de force j
car il y a des cendres beaucoup meilleures les unes
que les autres. Si elles font fortes, il en faut moins ,
c’eft-à-dire, qu’on doit mettre une quantité d’eau
plus grande à proportion du dégré de forces des cendres
J car fi elles ont trop de force, leurs fels attaquent
les fibres du chanvre ou du lin, 8c y laiffent
une couleur de leffive ; fi au contraire les cendres
(qnt trop fôibles, les fels ne peuvent pas fi bien ab-
forber les parties graffes de la craffe, & le linge n’eft
jamais propre. Si les cendres n’étoient pas choifies
& préparées , comme on vient de le dire , les fels
qu’elles .contiennent ne pourroientpas s’en détacher
aifément, 8c ne produiroient pas fi bien leur effet.
Enfin, fi on n’avoit pas égard à entretenir Un dégré
de chaleur modéré ; on gâteroit tout ; 8c fi on ne
donnoit pas le tems à la leffive de pénétrer le linge
dans toutes fes parties, il y auroit des endroits mal
blanchis, 8c dans lefquels la craffe réfifteroit au la-
vage^ C ’eft ce qui arrive lorfqu’on a mis dans le
cuvier une trop grande ©paiffeur de linge ; car la
leffive qui le pénétré, en filtrant à travers une épaif-
feur trop confidérable de linge , perd fa vertu avant
que d’être parvenue jufqu’au fond ; de forte que le
linge qui eft dans la partie baffe du cuvier, ne fe ref-
fent point de fon aftion. Pour remédier à cét inconvénient
, la plupart des blanchiffeufes mettent par
intervalle dans le cuvier & parmi le linge fin, des Jits
de cendres qu’elles ont foin d’envelopper féparé-
ment avec des linges communs, tels que les torchons
qui font aflez bons pour cet ufage. Mais cette méthode
n’eft fupportable tout au plus que quand on a
Amplement de gros linge à blanchir ; elle ne vaut rien
abfolument pour le linge fin, ni pour celui qu’on veut
blanchir proprement. L’expérience prouve affez que
le linge fin qui fe rencontre immédiatement fous ces
cendres, n’acquiert jamais un beau blanc ; car à
mefure que la leffive pénétré ce lit, elle en détache
les fels, qui alors agiffent avec trop de force fur le
linge qui en eft imbibé le premier ; c’eft le même inconvénient
qui arriveroit à toute la leffive, fi elle
étoit trop forte de cendres. La plupart des gens qui
font dans cet ufage, obfervent déplacer au fond du
cuvier, & fous les lits de cendres, tout ce qu’elles
ont4è linge plus groffier, 8c mettent le linge fin dans