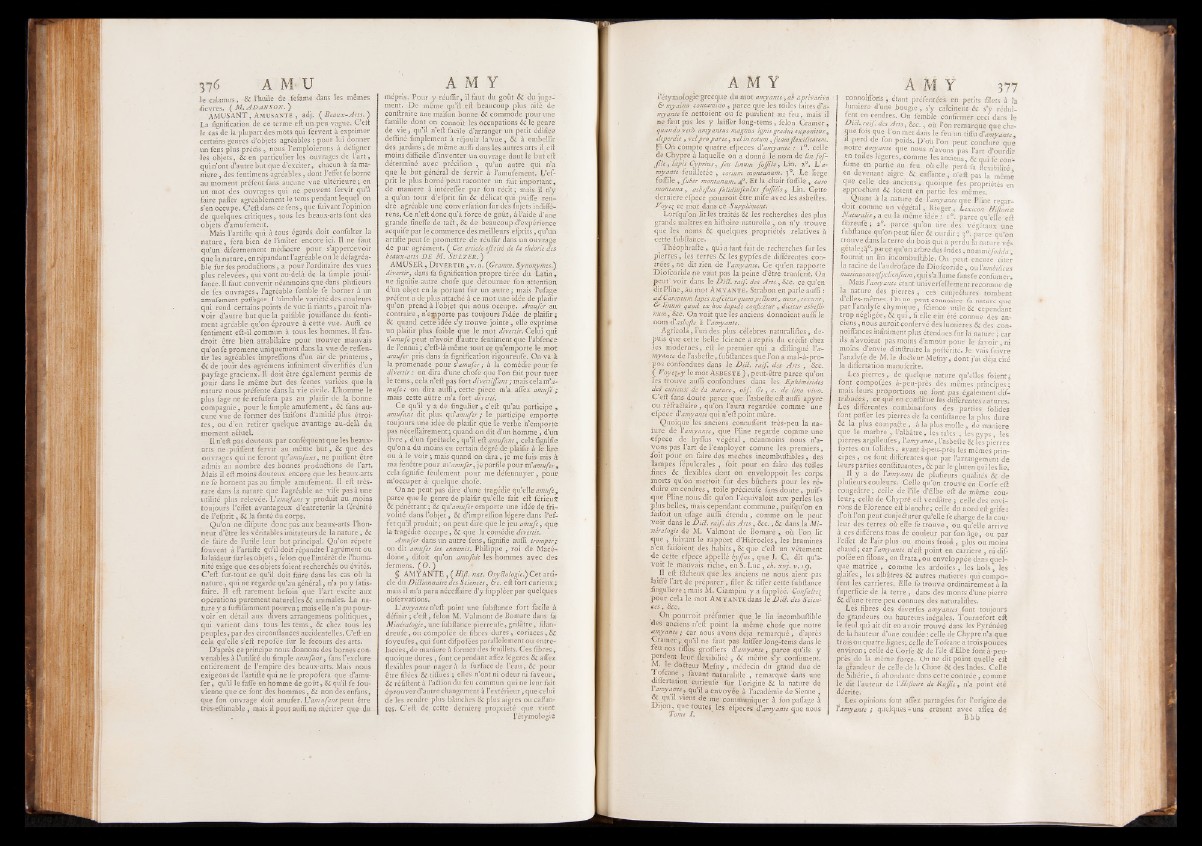
le calanurs, & l ’huile de -fefame dans les mêmes
.fièvres. ( M. A d a n so n . )
AMUSANT, A m u s a n t e , ad}. ( Beaux-Arts.)
La lignification de ce terme eftun peu vague. C’eft
le cas de la plupart des mots qui fervent à exprimer
certains genres d’objets agréables : pour lui donner
un fens plus précis , nous l’emploierons à défigner
les objets, & en particulier les ouvrages de l’art,
qui n’ont d’autre but que d’exciter, chacun à fa maniéré
, des fentimens agréables, dont l’effet fe borne
au moment préfent fans aucune vue ultérieure ; en
un mot des ouvrages qui ne peuvent fervir qu’à
faire paffer agréablement le tems pendant lequel on
s’en occupe. C’ eft dans ce fens, que fuivant l’opinion
de quelques critiques, tous lès beaux-arts font des
objets d’amufement.
Mais l’artifte qui à tous égards doit confulter la
nature, fera bien de l’imiter encore ici. 11 ne faut
qu’un difcernement médiocre pour s’appercevoir
que la nature, en répandant l’agréable ou le défagréa-
ble fur fes productions, a pour l’ordinaire des vues
plus relevées, qui vont au-delà de la fimple jouif-
fance.Ilfaut convenir néanmoins que dans plufieurs
de fes ouvrages, l’agréable femble fe borner à un
amufement paffager. L’aimable variété des couleurs
qui rend certains points de vue li riants, paroît n’avoir
d’autre but que la paifible jouiffance du fentiment
agréable qu’on éprouve à cette vue. Aufli ce
fentiment eft—il commun à tous les hommes. Il fau-
droit être bien atrabilaire pour trouver mauvais
qu’on fe promene uniquement dans la vue de reffen-
tir les agréables impreffions d’un air de printems,
Sc de jouir des agrémens infiniment diverfifiés d’un
payfage gracieux. Il doit être également permis de
jouir dans le même but des fcenes variées que la
nature nous préfente dans la vie civile. L’homme le
plus fage ne le refufera pas au plaifir de la bonne
compagnie, pour le fimple amufement, & fans aucune
vue de former des liaifons d’amitié plus étroite
s , ou d’en retirer quelque avantage au-delà du
moment aftuel.
Il n’eft pas douteux par conféquent que les beaux-
arts ne-puiffent fervir au même but , & que des
ouvrages qui ne feront qa’amufans, ne puiffent être
admis au nombre des bonnes productions de l’art.
Mais il eft moins douteux encore que les beaux-arts
ne fe bornent pas au fimple amufement. Il eft très-
rare dans la nature que l’agréable ne. vife pas à une
utilité plus relevée. U amufant y produit au moins
toujours l’effet avantageux d’entretenir la férénité
de l ’efprit, & la fanté du corps.
Qu’on ne difpute donc pas aux beaux-arts l’honneur
d’être les véritables imitateurs.de la nature, &
de faire de l’utile léur but principal. Qu’on répété
fouvent à l’artifte qu’il doit répandre l’agrément ou
la laideur furies objets, félon que l’intérêt de l’humanité
exige que ces objets foient recherchés ou évités.
C ’eft fur-tout ce qu’il doit faire dans les cas où la
nature-, qui ne regarde qu’au général, n’a pu y fatis-
faire. Il eft rarement befoin que l’art excite aux
opérations purement naturelles & animales. La nature
y a fuffifàmment pourvu ; mais elle n’a pu pourvoir
en détail aux divers arrangemens politiques,
qui varient dans tous les tems, & chez tous les
peuples, par des circonftances accidentelles. C’eft en
cela qu’elle s’eft repofée fur le fecours des arts.
D’après ce principe nous donnons des bornes convenables
à l’utilité du fimple amufant, fans l’exclure
entièrement cje l’empire des beaux-arts. Mais nous
exigeons de l’artifte qui ne fe propofera que d’amu-
fe r , qu’il le faffe en homme de goût, & qu’il fe fou-
vienne que ce font des hommes, & non des enfans,
que fon ouvrage doit amufer. Vamufant peut être
îrès-e Aimable , mais il peut aufli ne mériter que du .
mépris. Pour y réuflîr, il faut du goût & du jugement.
De même qu’il.eft beaucoup plus ailé de
conftruire une maifon bonne & commode pour une
famille dont on connoît les occupations & le genre
de vie * qu’il n’eft facile d’arranger un petit édifice
deftiné Amplement à réjouir la vu e , & à embellir
des jardins ; de même aufli dans les autres arts il eft
moins difficile d’inventer un ouvrage dont le but eft
déterminé avec précifion , qu’un autre qui n’a
que le but général de fervir à l’amufement. L’efprit
le plus borné peut raconter un fait important,
de maniéré à intéreffer par fon récit; mais il n’y
a qu’un tour d’efprit fin & délicat qui puiffe rendre
agréable une converfation fur des fujets indiffé-
réns. Ce n’eft donc.qu’à force de goût, à l’aide d’une
grande fineffe de taft, & de beaucoup d’expérience
acquife par le commerce des meilleurs efprits, qu’un
artifte peut fe promettre de réuflir dans un ouvrage
de pur agrément. ( Cet. article eß tiré de la théorie des
beaux-arts D E M. S u l 'ze r . )
AMUSER, D i v e r t i r , v . a. {Gramm. Synonymes.)
divertir, dans fa' lignification propre tirée" du Latin,
ne lignifie autre chofe que détourner fon attention
d’un objet en la portant fur un autre ; mais l’ufage
préfent a de plus attaché à ce mot une idée de plaifir
qu’on prend à l’objet qui nous occupe. Amufer au
contraire, n’emporte pas toujours l’idée de plaifir ;
& quand cette idée s’y trouve jointe, elle exprime
un plaifir plus foible que le mot divertir. Celui qui
s’amufe peut n’avoir d’autre fentiment que l’abfence
de l’ennui ; c’eft-là même tout ce qu’emporte le mot
amufer pris dans fa lignification rigoureufe. On va à
la promenade pour s’amufer ; à la comédie pour fe
divertir : on dira d’une chofe que l’on fait pour tuer
le tems, cela n’eft pas fort divertiffant ; mais cela rcda-
mufe : on dira aufli, cette pieee m’a affez amufè ;
mais cette aîitre m’a fort diverti.
Ce qu’il y a de fingulier, c’eft qu’au participe ,
amufant dit plus qu''amufer ; le participe emporte
-toujours une idée de plaifir que le verbe h’emporte
pas néceffairement; quand on dit d’un homme , d’un
livre , d’un fpeâacle, qu’il eft amufant, cela lignifie
qu’on a du moins eu certain dégré de plaifir à le lire
ou à le voir ; mais quand on dira, je me fuis mis à
ma fenêtre pour m'amufer, jeparfile pour m’amufer,
cela fignifie feulement pour me défennuyer, pour,
m’occuper à quelque chofe.
On ne peut pas dire d’une tragédie qu’elle amufe,
parce que le genre de plaifir qu’elle fait eft férieux
& pénétrant ; & qu’amufer emporte une idée de fri-
. volité dans l’objet, & d’impreflion légère dans l’effet
qu’il produit ; on peut dire que le jeu amufe, que
la tragédie occupe, & que la comédie divertit.
Amufer dans un autre fens, fignifie aufli tromper;
on dit amufer les ennemis. Philippe , roi de Macédoine,
difoit qu’on amufoit les hommes avec des
fermens. ( O. )
§ AMYANTE , ( Hiß. nat. Otyclologie.) Cet article
du Dictionnaire des Sciences, &c. eft fort curieux;
mais il m’a paru néceffaire d’y fuppléerpar quelques
obfervations.
\J amy ante n’eft point une fubftance fort facile à
définir ; c’eft, félon M. Valmont de Bomare dans fà
Minéralogie, une fubftance pierreufe, grifâtre, filan-
dreufe, ou compofée de fibres dures, coriaces, &
foyeufes, qui font difpofées parallèlement ou entrelacées,
de maniéré à formèr des feuillets. Ces fibres,
quoique dures, font cependant affez légères & affez
flexibles pour- nager à la furface de l’eau, & pour
être filées & tiffues ; elles n’ont ni odeur ni faveur,
& réfiftent à l’aftion du feu commun qui ne leur fait
éprouver d’autre changement à l’extérieur, que celui
de les rendre plus blanches & plus aigres ou caftantes.
C ’eft de. cette dernière propriété que vient
l’étymologie
l’étymologie grecque du mot amyante ; al àprivativo
& myaino contamino , parce que les toiles faites d’a-
myante le nettoient ou fe purifient au feu, mais il
ne faut pas les y laiffer long-tems, félon Cramer,
quando verb amyantus magnus ignis gradui exponitùr,
deperdit , velproparte, vélin totum ffuam’fiexilitatem.
On compte quatre efpeces d’amyante : i° . celle
de. Chypre à laquelle on a donné lé nom de lin fof-
Jile , lapis Cyprius, feu lïnum fofjile * Lin. 2°. L'a-
myatïce feuilletée , corium montanum. 30. Le liege
fofîilë j fuber montanum. 40. Et la. chair foflile , caro
montana , asbefus folidiufculus foJJilis, Lin. Cette
derniere efpecè pourroit être mife avec les âsbeftes.
J^oye^ ce mot dans cè Suppléments
Lorfqu’on lit les traités & les recherches des plus
grands maîtres en hiftpire naturelle, on n’y trouve
que lès noms & quelques propriétés relatives à
cette fubftance;
Théopbrafte, qui a tant fait de recherches fur les
pierres, les terres & les gypfes de différentes contrées
, ne dit rien de ¥amyante. Ce qu’en rapporte
Diofcoride ne vaut pas la peiné d’être tranfcrit. On
peut' Voir dans le Dicl. raif. des Arts, &e. ce qu’en
dit Piine, au mot A m y a n t e . Strabon en parle aufli :
ad Careptûm lapis nafciturquem peclunt, nent, texunt,
& liniinï quod ex hoc lapide conficitur, dicitur asbejli-
humfStc. On vo it qiie les anciens donnôient aufli le
nom aasbefle à ¥cimyante.
Agriçdlà, l’un des plus célébrés naturaliftes, der
puis que cètte belle îcience à repris du crédit chez
les modernes j eft le premier qui a diftingué l’a-
myahte de l’asbefte, fubftances que l’on a mal-à-pro- 1
pos confondues dans le Dicl. raif. des Arts -, &c.
( y°yef?y le mot à s b e s t e ) , peut-être parce qu’on
les trouve aufli confondues dans les Ephémérides
deS curieux de la nature , obf. Ç t , c. de lino vivo. ,
C ’eft fans doute parce que l’asbefte eft aufli apyre
Ou réfracràire, qu’ori l’aura regardée comme une
ëfpece d'amyante qui n’eft point mûre.
Quoique lés anciens corinuffent très-peu la nature
de ¥ amyante, que Pline regarde comme une
ëfpece de byffiis végétal, néanmoins nous n’avons
pas l’art de i’employer comme les premiers,
ifoit pour en faire des meches incombuftibles $ des
lampes fépulcrales , füit pour en faire des toiles
fines & flexibles dont on enveioppdit les corps
morts qu’ôn niettoit fur des bûchers pour les réduire
en cendres * toile précieufe fans doute, puif-
que Pline nous dit qu’on l’équivaloit aux perles les
plus belles, mais cependant commune, puifqu’on en
faifoit un ufage aufli étendu, comme on te peut "
.voir dans lé Dicl. raif. des A rts, & c ., & dans la Minéralogie
dë M. Vaimônt de Bomare , où l’on lit
que , fuivant le rapport d’Hiéroeles , ies bramines
s’en faifolent des habits ,& que c’eft un vêtement
de cette efpece àppellé byjfus, que J; C. dit qu’â-
.voit le mauvais riche, eh S. Luc , chi xvj. v. / o.
Il eft fâcheux que .les anciens ne nous aient pas
laiffé l’art de préparer , filer & tiffer cette fubftance
finguliere ; mais M. Ciampini y a fuppléé. Confulte£
pour cela le mot Am Y a n t e dans le Dict. des Sciences,
Scc.
On poufroit préfiinier que.ie lin incombuftible
des anciens n’eft point la même chofe que notre
amyante ; éar nous, avons déjà remarqué, d’après
Cramer, qu’il ne faut pas laiffer lortg-tenis dans le
feu nos tiffus grofliers d?amyante, parce qu’ils y
perdent leur flexibilité * & même s’y confument.
M. le dofteur Mefny, médecin du grand duG de
.Tofcane , favânt natiiralifte , remarque dans une
dmertation curiêufe fur l’origine & la nature de
lamy an té, qu’il a envoyée à l’académie de Sienne ,
& qiixl vient de me communiquer à fon paffage à
• Dijon, que toutes les efpeces dû amyante que nous
Tome l t :
connoifforis , étant présentées en petits filets à h
lumière d’une bougie , s’y calcinent & s’y rédul-
font en cendrés. On femble confirmer ceci dans le
Dicl. raif. des.Arts, & c . , où l’on remarque que chaque
fois que l’on met dans le feu un tiffu d’amyante,
1 per de fon poids. D’où l’on peut conclure que
notre amyante . que nous n’avons pas l’art d’ourdir
en toiles lege.res, comme les anciens, & qui fe con-
lume en partie au feu où elle perd fa flexibilité v
en devenant aigre & caftante, n’eft pas la même
que celle des anciens * quoique fes propriétés en
approchent & foient en partie les mêmes.
Quant a la nature de ¥ amyante que Pline regardait
comme un végétal, Rieger, Uxicon Hiftorias
N attirails, a eu la même idée : i° . parce qu’elle eft
fibreufe ; 20. parcé qu’on tire-des végétaux une
fubftance qu’on peut filer & ourdir ; 30; parce qu’on
trouve dans la terre du bois qui a perdu la nature vé*
gétale ;4°. parce qu’un arbre des Indes ;nommêfodda,
fournit un lin incombuftible; On peut encore citer
la racine de l’audrbface de Diofcoride, ou ¥umbilicus
marinusmonfpplienfium, qui s’allume fans fe confumer;
Mais 1 amyante étant uni v erfellement reconnu e de
la nature^ des pierres ; ces conjectures tombent
d’elles-mêmes. On ne peut connoître fa nâtiire que
par l’analyfe chymique, fcience utile & cependant
trop négligée, & qui, fi elle eût été connue des anciens,
nous auroit confervé des lumières & des con*
poiffances infiniment plus étendues fur là nature ; car
ils n’avoient pas moins d’amoùr pour le favoir , ni
moins d’envie d"înftruire la poftérité. Je. vais fuivre
l’analyfe de M. le doéïeur Mefiiy, dont j’ai déjà cité
la differtation manuferite;
Les pierres j de quelque nature qu’elles foient ;
font compofees à-peu-près des mêmes principes;
mais leurs proportions në font pas également dif-
tribuées,; ce qui en çonllitue les différentes natures;
Les différentes -combinaifons des parties, folides
font paffer ies pierres de la confiftance la plus dure
& la plus compare , , à la plus molle* de maniéré
que le marbre , l’albâtre, les talcs , les gyps , les
pierres argilleufes, ¥ amyante, l’asbefte & les pierres
fortes ou folides ; ayant à-peu-près lès mêmes principes
, ; ne font différentes que par l’arrangement de
leurs parties eonftituantes, & par le gluten qui les lie;
Il y a de ¥ amyante de plufieurs qualités & de
plufieurs couleurs; Celle qu’on trouve en Corfe eft
rougeâtre ; celle de l’île d’Elbe eft de même couleur;
celle de Chyprê eft verdâtre ; celle des environs
de Florence eft blanche; celle du nord eft grife:
d’où l’ort peut cbnjeéhirer qu’elle fe charge de la couleur
des terres où elle fe trouve, .6u qu’elle arrivé
à ces différens tons de couleur par fon âge, ou par
l’effet de l’air plus ou moins froid , plus ou moins
chaud ; car ¥ amyante n’eft point eh carrière , ni difi
pofée en filons, en ftrata, ou enveloppée dans quelque
matrice , comme les ardoifes , les bols, les '
glaifes, les albâtres & autres matières qui eompo-
fént les carrières. Elle fe trouve ordinairement à la
fuperficie de la terre , dans des monts d’une pierre
& d ’ une terre peu connues des naturaliftes;
LeS fibres des diverfes amyantes font toujours
de grandeurs ou hauteurs inégales. Tournefort eft
le feul qui ait dit en avoir trouvé dans les Pyrénées
de la hauteur d’une coudée : celle de Chypre n’a qué
trois ou quatre lignes; celle de Tofcane a trois pouces
environ; celle de Corfe & de file d’Elbe font à-peu-
près de la même force. On ne dit point quelle eft
la grandeuf de celle de la Chine & des Indes. Celle
de Sibérie, fi abondante dans cette contréecomme
le dit l’auteur de YHi.foire de Ruffe , n’a point été"
décrite.
Les opinions font affez partagéès fur l’origine dé
¥ amy ante ; quelques - uns croient avec affez de
Bb b