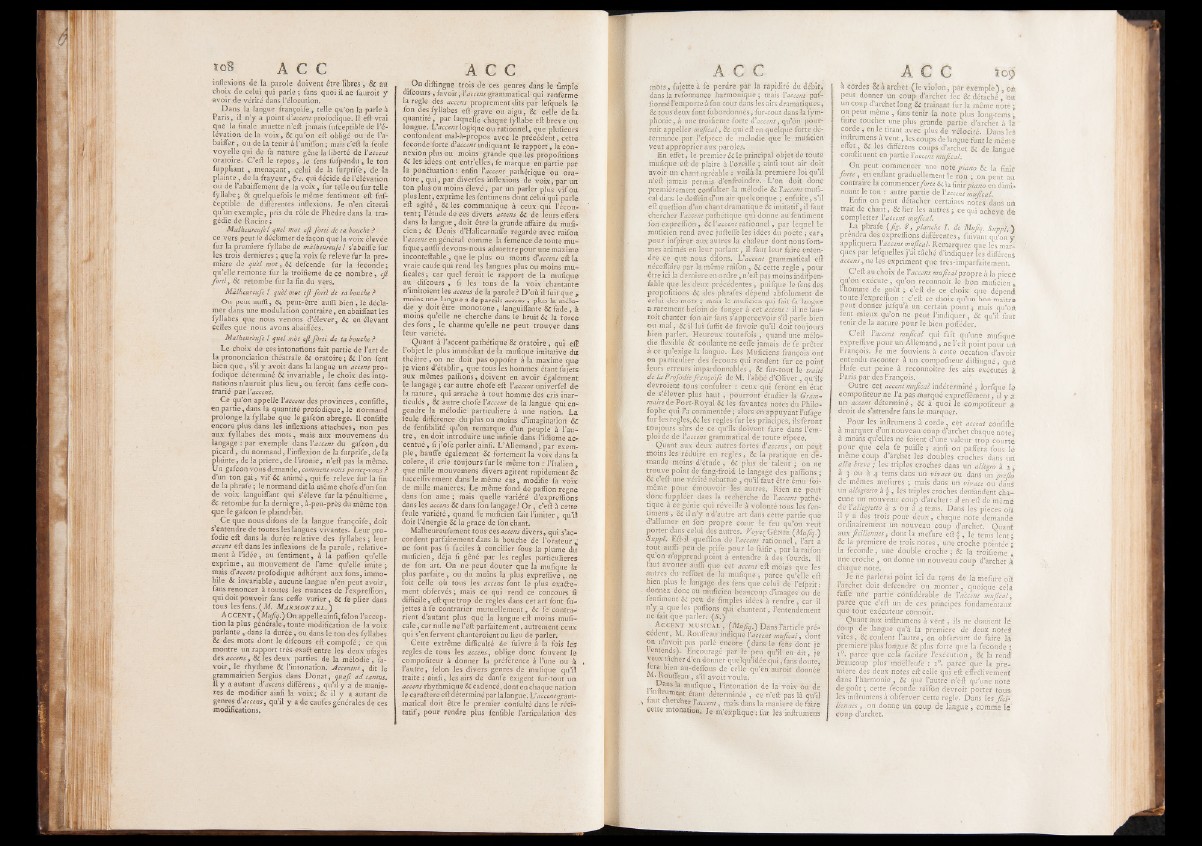
inflexions de la parole doivent être libres, & âu
choix de celui qui parle ; fans quoi il ne fauroit y
avoir de vérité dans rélocution.
Dans la langue françoife-, telle qu’on la parle à
Paris, il n’y a point à?accent profodique. Il eft vrai
que la finale muette n’eft jamais fufceptible de l ’élévation
de la v o ix , & qu’on eft obligé ou de l’a-
baiffer, ou de la tenir à Funiffon ; mais c ’eft la feule
voyelle qui de fa nature gêne la liberté de Vaccent
oratoire. C’eft le repos, le fens fufpendu, le ton
fuppliant , menaçant, celui de la furprife, de la
plainte , de la fra yeur, &c. qui décide de l’élévation
ou de l’abaiffement de la voix, fur telle ou fur telle
fyllabe ; & quelquefois le même fentiment eft fuf-
fceptible de différentes inflexions. Je n'en citerai
qu’un exemple, pris du rôle de Phedre dans la tragédie
de Racine ;
Màlheureufe! quel mot efl fôrti de ta bouche ?
Ce vers peut fe déclamer de façon que la voix élevée
fur la première fyllabe de màlheUreuJe ! s’abaiffe ‘finies
trois derniefes ; que la voix fe releve fur la première
de quel mot) & defcende fur la fécondé;
qu’elle remonte fur la troifieme de ce nombre , efl
fort!, & retombe fur la fin du vers.
Màlheureufe ! quH mot efl fortï de ta bouche ?
On peut aufli, & peut-être auffi bien , le déclamer
dans une modulation contraire, en abaiffant les
fyllabes que nous venons d’élever, & en élevant
celles que nous avons abaiffées.
Màlheureufe ! quel mbt efl fbrti de ta bouche ?
Le choix de ces intonations fait partie de l’art de
la prononciation théâtrale & oratoire ; & l’on fent
bien que, s’il y avoit dans la langue un accent profodique
déterminé & invariable, le choix des intonations
n’auroit plus lieu, ou feroit fans cèffe contrarié
par Y accent.
Ce qu’on appelle l’accent des provinces, confifte,
en partie, dans la quantité profodique, le normand
prolonge la fyllabe que le gafcon abrégé. Il confifte
encore plus dans les inflexions attachées, non pas
aux fyllabes des mots, mais aux mouvemens du
langage : par exemple dans l'accent du gafcon , du
picard, du normand, l’inflexion de la furprife, de la
plainte, de la priere, de l’ironie, n’eft pas la même.
Un gafcon vous demande, comment vous portez-vous ?
d’un ton gai, v if & animé , qui fe releve fur la fin
de la phrafe ; le normand dit la même chofe d’un fon
de voix languiflant qui s’élève fur la pénultième,
& retombe fur la derniere, à-peu-près du même ton
que le gafcon fe plaindroit.
Ce que nous difons de la langue françoife, doit
s’entendre de toutes les langues vivantes. Leur pro-
fodie eft dans la durée relative des fyllabes ; leur
accent eft dans les inflexions de la parole, relativement
à l’id ée, au fentiment, à la paflion qu’elle
exprime, au mouvement de l’ame qu’elle imite ;
mais dyaccent profodique adhérant aux fons, immobile
& invariable, aucunfe langue n’en peut avoir,
fans renoncer à toutes les nuances de Fexpreflion,
qui doit pouvoir fans ceffe varier, & fe plier dans
tous les fens. (Af. Ma rm o n t e l . )
Accent 9 [Muflq.) Ou appelle ainfi, félon l’acception
la plus generale, toute modification de la voix
parlante ,-dans la duree, ou dans le ton des lyllabes
& des mots dont le difcours eft compofé; ce qui
montre un rapport très-exaâ entre les deux ufages
des accens, & les deux parties de la mélodie , fa-
vo ir , le rhythme & l’intonation. Accentus, dit le
grammairien Sergius dans Donat, quafi ad cantus.
Il y a autant à?accens différens, qu’il y a de manières
de modifier ainfi la voix; & il y a autant de
genres d’accens, qu’il y a de caufes générales de ces
modifications.
Ondiftingue trois de ces genres dans le fimple
difcours-, fav ovc f i accent grammatical qui renferme
la réglé des accens proprement dits par lefquels le
fon des fyllabes eft grave ou aigu, & celle d e là
quantité, par laquelle chaque fyllabe eft breve ou
longue. L’<zcce/2? logique ou rationnel, que plufieurs
confondent mal-à-propos avec le précédent, cette
fécondé forte d* accent indiquant le rapport, la connexion
plus ou moins grande que les propofitions
& les idees ont entr elles, fe marque en partie par
la pon&uation: enfin Vaccent pathétique bu oratoire
, qui, par diverfes inflexions de voix, par un
ton plus ou moins élevé, par un parler plus v if où
plus lent, exprime les fentimens dont celui qui parle
eft agité, & les communique à ceux qui l’écoutent
; l’étude de ces divers accens & de leurs effets
dans la langue, doit être la grande affaire du mufi-
cien ; & Denis d’Halicarnaffe regarde avec raifon
Vaccent en général comme la femence de toute mu-
fique; aufli devons- nous admettre pour une maxime
inconteftable , que le plus ou moins d'accent eft la
vraie caufe qui rend les langues plus ou moins mu-
ficales ; car quel feroit le rapport de la mufique
au difcours , fi les tons de la voix chantante
n’imitoient les accens de la parole ? D ’où il fuit que >
moins une langue a de pareils accens , plus la mélodie
y doit être monotone, languiffante & fade, à
moins qu’elle ne cherche dans le bruit & la forcé
des fon s, le charme qu’elle ne peut trouver dans
leur variété.
Quant à l ’accent pathétique & oratoire, qui eÆ
l’objet le plus immédiat de la mufique imitative du
théâtre , on ne doit pas oppofer à la maxime que
je viens d’établir, que tous les hommes étant fujets
aux mêmes pallions, doivent en avoir également
l*e langage ; car autre chofe eft 1*accent univerfel de
la nature, qui arrache à tout homme des cris inarticulés
, & autre chofe Vaccent de la langue qui en*
gendre la mélodie particulière à une nation. La
feule différence du plus ou moins d’imagination 8c
de fenfibilité qu’on remarque d’un peuple à l’autre
, en doit introduire une infinie dans l’idiome ac*
centué, fi j’ofe parler ainfi. L ’Allemand , par exemple
, hauffe également & fortement la voix dans la
colere , il crie toujours fur le même ton : l’Italien ,
que mille mouvemens divers agitent rapidement 8c
fucceflîvement dans le même cas, modifie fa voix
de mille maniérés; Le même fond de paflion régné
dans fon ame ; mais quelle variété d’expreflions
dans les accens 8c dans fon langage 1 O r , c’eft à cette
feule variété, quand le muficien fait l’imiter, qu’il
doit l’énergie & la grâce de fon chant.
Malheureufement tous ces accens divers , qui s’accordent
parfaitement dans la bouche de l’orateur ^
ne font pas fi faciles à concilier fous la plume du
muficien, déjà fi gêné par les réglés particulières
üe fon art. On ne peut douter que la mufique la
plus parfaite, ou du moins la plus expreflive , .ne
foit celle où tous les accens font le plus exàéie-
ment obfervés ; mais ce qui rend ce concô'urs fi
difficile, eft que trop de réglés dans cet art font fusettes
à fe contrarier mutuellement, 8c fe contrarient
d’autant plus que la langue eft moins mufi-
cale, car nulle ne l’eft parfaitement, autrement ceux
qui s’en fervent chanteroient au lieu de parler.
Cette extrême difficulté de fuivre à la fois les1
réglés de tous les accens, oblige donc fouvent le
compofiteur à donner la préférence à l’une ou à
l’autre, félon les divers genres de mufique qu’il
traite ; ainfi, les airs de danfe exigent fur-tout un
accent rhythmique 8c cadencé, dont en chaque nation
le caraâere eft déterminé par la langue. U accent grammatical
doit être le premier confulté dans le récitatif,
pour rendre plus fenfible l’articulation des
mots, fujette à fe perdre par la rapidité du débit»
dans la refonnance harmonique ; mais Yaccent paf-
fionné l’emporte à fon tour dans les airs dramatiques,
8c tous deux font fubordonnés, fur-tout dans la fym-
phonie, à une troifieme forte d’accent, qu’ôn pourvoit
appeller muflcal, 8c qui eft en quelque forte déterminée
par l’efpece de mélodie que le muficien
Veut approprier aux paroles» fl-b
En effet, le premier 8cle principal objet-de toute
mufique eft de plaire à l’oreille ; ainfi tout air doit
avoir un chant agréable : voilà.la première loi qu’il
n’eft jamais permis d’enfreindre. L’on doit donc
premièrement confulter la mélodie 8c Vaccent mufi-
cal dans le deffein d’un air quelconque ; enfuite, s’il
eft queftion d’un chant dramatique 8c imitatif, il faut
chercher Faccent pathétique qui donne au fentiment
fon expreflïon-, & F<zece/z£ rationnel, par léquel le
muficien rend avec jufteflé les idées du poëte ; car;
pour infpirer aux autres la chaleur dont nous forri-
mes animés en leur parlant, il faut leur faire entendre
ce que nous difons-. \J accent grammatical eft
néceffaire par la même raifon, 8c cette réglé , pour
être ici la derniere en ordre, n’eft pas moins indifpen-
fable que lès deux précédentes » puifque le fens des
propofitions 8c des phrafes dépend abfolument de
celui des mots ; mais lé muficien qui fait fa langue
a rarement befoin de fonger à cet accent : il ne fauroit
chanter fôn air fans s’appereevoir s’il parle bien
pu mal, 8c il lui fuffit dé favoir qu’il doit toujours
bien parler. Heureux toutefois , quand une mélodie
flexible & coulante né ceffe jamais de fé prêter
a ce qu’exige la langue.- Les Muficièns François-Ont
en particulier des fecours qui rendent fur ce point
leurs erreurs impardonnables , 8c fur-tout le traité
de la P rofodie françoife de M. i’a-bbé d’O liv e t , qu’ils'
devraient tous confulter : ceux qui feront en état
de s’élever plus haut , pourront étudier la Grammaire
de Port-Royal 8c les favantes notes du Philo-
Fophe qui l’a commentée ; alors en appuyant l’iïïage
ïiir les réglés» 8c les regles-fur les principes, ilsîeront
toujours sûrs de ce qu’ils doivent faire dans l’emploi
de de Vaccent grammatical dé toute efpeee.
Quant aux deux autres fortes d’accens-, on peut
moins les réduire en réglés-', 8c la- pratique en demande
moins d’étude » 8c plus de talent ; on ne
trouve point de fang-froid le langage des paffibns ;
8c c’eft .une vérité rebattue , qu’il faut être ému foi-
même pour émouvoir les autres. Rien ne peut'
donc fuppléer^ dans la recherche de Yaccentpathétique
à ée génie qui réveille à volonté tous les fentimens
, 8c il n’y a d’autre art dans cette partie que
d’allumer en fon propre coeur le feu qu’on veut
porter dans celui des autres. Voyez Génie- (Muflq.)
Suppl. Eft-il queftion de Vaccent rationnel, l’art a
tout aufli peu de pri-fe- pour le faifir » par la raifon
tjû’on n’apprend point à entendre à des-'fourds. Il
faut avouer aufli que cet accent eft moins que les
autres du reffort de là! mufique; parce qu’elle eft
bien plus le langage des fens que celui de l’efprit:
. dortnez donc au muficien beaucoup d’images ou de
fentiment & peu de Amples idées à rendre , car il
n’y a que les paffions qui chantent, l’entendenient
ne fait que parler; (£.)•
Accent musical , (Muflq.) Dans i’articlë précèdent,
M. Rouffeau indique Y accent mufleai, dont
on n’avoit pas parlé encore (dans le fens dont je
1 entends). Encouragé par lé peu qu’il en dit, je
veux tâcher- d’en donner quèlqu’idée qui, fans doute;
au“deffous H celle qu’en aiirbit donnée
M. Roufleaii ’ s’il avoit voulu.
1,. ~^ans ta-mufique, l’intonation de ia- voix Ou cîe
1 mitrum^nt étant déterminée , ce n’eft pas là qu’il
' *aut cFercher Yaccent, mais dans la maniéré de faire
eette intonation. Je m’explique : fur lès inftrumens
à cordes & à archet ( le violon, par exemple), où
peut donner un coup d’archet fec 8c détaché, où
un coup d’archet long 8c traînant fur la même note ;
pn peut même , fans tenir la note plus long-tems ;
faire toucher une plus grande partie d’archet à là
- > en *e hrant avec plus de vélocité. Dans les
inftrumens à vent , les coups de langue font le même
eîtet, 8c les différens coups d’archet Sc de langue
eonftituent en partie Yaccent muflcal.
On peut commencer une note piano 8c la finir
forte , en enflant graduellement le ton ; on peut au
contraire la commencerforte 8c la Mtr piano en diminuant
le ton : autre partie de Yaccent muflcal.
Enfin on peut détacher certaines notes dans urt
trait de chant, 8c lier les autres ; ce qui achève dé
completter Yaccent muflcal.
La phrafe (fig. 8 , planche I. de Muflq. Suppl. )
prendra des expreflîons différentes » fuivant qu’on y
appliquera Y accent muflcal. Remarquez que les marques
par lefquelles j’ai tâché d’indiquer les différens
accens y ne les expriment que très-imparfaitement.
C ’eft au choix de Yaccent muflcal propre à la piecé
qu’ôn exécute , qu’on reconnôît le bon muficien 4
l’homme de goût ; c’eft de ce choix que dépend
toute Fexpreflion : c’eft ce choix qu’un bon maître
peut donrfer jufqu’à un certain point ; mais qu’où
fent mieux qu’on ne peut l’indiquer, 8c qu’il faut
tenir de la nature pour le bien pófféder.
C ’eft Yaccent muflcal qui fait qu’iïnè mufiqué
expreflive pour un Allemand, ne l’eft point pour uli
François. Je nie fouviens à cette oecafion d’avoir
entendu raconter à un compofiteur diftingué, que
Hafe eut peine à reconnoître fes airs exécutés à
Paris par des François.
Outre cet accent muflcal indéterminé , lorfque îé
compofiteur ne l’a pas marqué expreflemènt » il y à
un accent déterminé, 8c à quoi le compofiteur à
droit de s’attendre fans le marquer.
Pour les inftrumeiis à corde, cet accent cbnfiftè
à marquer d’un nouveau coup d’archet chaque note;
à moins qu’elles ne foiènt d’une valeur trop courte
pour que cela fe puiffe ; ainfi on paffera fous lé
même coup d’archet les doubles croches dans uù
alla breve ; les'triples Croches dans uli allegro à 21
à 3 ou à 4 fems dans un vivace ou dans un preflô
de mêmes mefures ; mais dans un vivace ou dans
lin allegretto à f , les triples croches, demandent chacune
un nouveau coup d’archet : il en eft de même
de Y allegretto à 2 ou à 4 tenis. Dans les pièces où
il y a des trois pour deux, chaque hôte demandé
ordinairement un nouveau coup d’àrchet: Quant
aux fleiliennes» dont la mefure eft--|,-;le tems lent;
& la première de trois notes , uiîe croche pointée *
la fecoride ; une double croche ; & la troifieme 4
une croche , on donne un nouveau coup d’archet à
chaque note;.
Je ne parlerai point ici du tèms de la mefurè ÔÙ
l’archet doit deféeridre ou monter , quoique cela
faffe une partie ednfidéràble dé Yaccent muflcal ;
parce qiie c’eft un de ces principes fondamentaux
que tout exécuteur connoït.
Quant aux irtftriimétis à vent ; ils ne donnent îe
Coup de- langue qu’à là première de deux notes*
vîte s, & Coulent; l’autre, en obfervànt de faire là
première plus'lôtïguë plus forte que la féconde *
i°. parce que cela facilite l’exécution, & la rend
beaucoup plus moHieufe : 20. parce que la premieredes
deux notes eft celle qui eft effectivement
dans l’hârmonie , & que l’autre n’èft qu’une noté
dégoû t; cette fécondé raifori dëvroit porter tous-
lés inftrumens à obferver cette réglé. Dans' les flei*
liennès , .on donne un coup de langue, comme lé
coup d’archet.