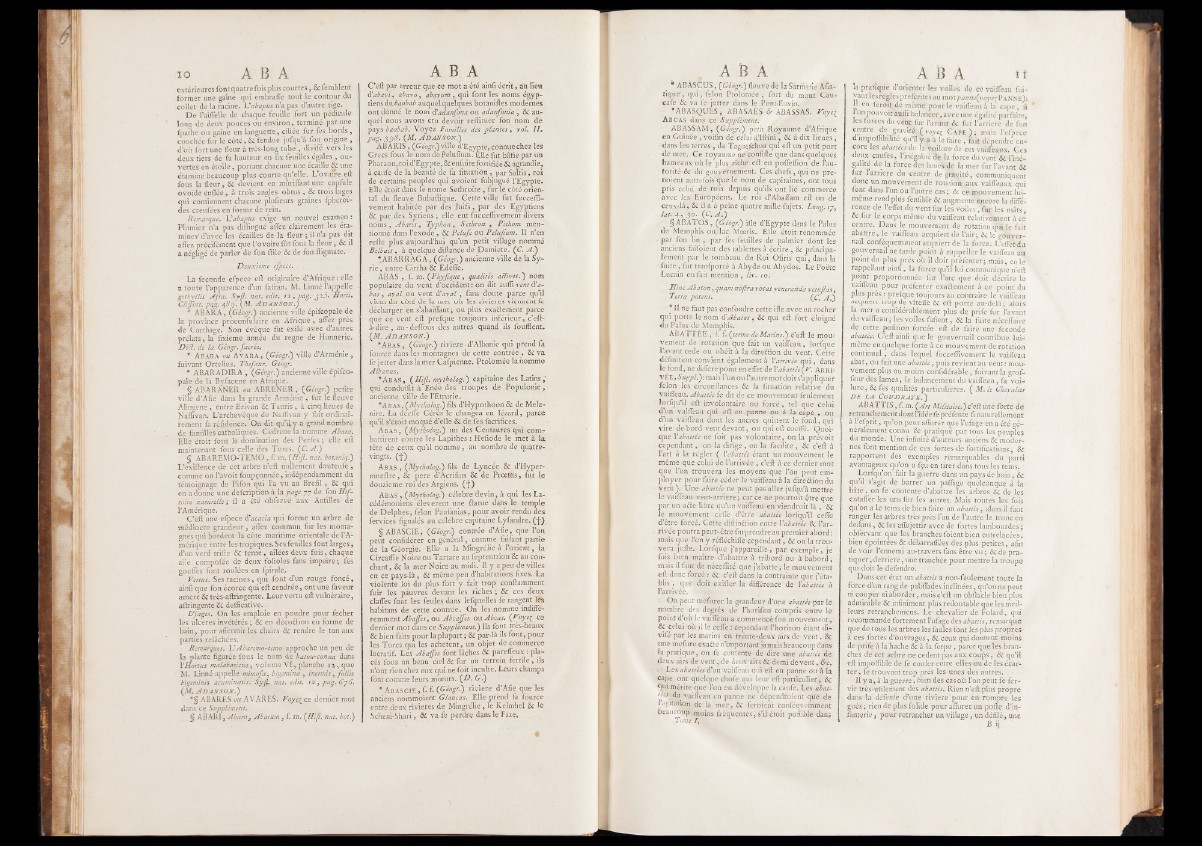
. A*JÊÊà*aÈk?Êè.
extérieures font quatre fois plus courtes, 8c femblent
former une gaîne qui embraffe tout le contour du
collet de la racine. Uabapus n’a pas d’autre tige.
De l’aiffelle de chaque feuille fort un pédicule
long de deux pouces ou environ, terminé par une
fpathe ou gaîne en languette, ciliée fur fes, bords,
couchée fur le côté, 8c fendue jufqu’à fon^ origine ,
d’oîi fort une fleur à très-long tube, divifé vers les
deux tiers de fa hauteur en fix feuilles égales , ouvertes
en étoile, portant chacune une écaille 8c line
étamine beaucoup plus courte qu’elle. L’ovaire eft
fous la fleur,, Sc devient en mûriffant une capfule
ovoïde enflée, à trois angles obtus , 8c trois loges
qui contiennent chacune plufieurs graines fpherôï-
des creufées en forme de rein.
Remarque. Uabapus exige urt nouvel examen :
Plumier n’a pas diftingué affez clairement les étamines1
d’avec les écailles de la fleur ; il n’a pas dit
affez précifément que l’ovaire fïit fous la fleur, 8c il
a négligé de parler de fon ftile 8c de fon ftigmate.
Deuxieme efpece. ■
La fécondé efpece eft originaire d’Afrique : elle
a toute l’apparence d’un fafran. M. Linné l’appelle
gethyllis Afra. Syß. nat. edit. 12 , pag.- 30.5. Sorti.
Cliff'ort.pug. 489. (M. A d AN SON.') _ .
* AB ARA , (Géogr.) ancienne ville épifcopale de
la province proconfulaire en Afrique , affez près
de Carthage. Son évêque fut exilé avec d’autres
prélats , la fixieme année du regne de Hunneric.
D i ci. de la Géogr. facrée.
* A bar a ou Av a rà , (Géogr.) ville d’Arménie,
fuivant Ortelius. Tkefaur. Geogr.
* ABARADIRA , (Géogr.') ancienne ville épifcopale
de la Byfacene en Afrique.
§ ABARANER ou ÄBRENER, (Géogr.") petite
ville d’Afie dans la grande Arménie , fur le fleuve
Alingené, entre Erivan & Tauris -, à cinq lieues de
Naffivan. L’archevêque de Nalîîvan y fait ordinairement
faréfidence. On dit qu’il y a grand nombre
de'familles catholiques. Cedrenela nomme Ab ara.
Elle étoit fous la domination dès Perfes ; elle eft
maintenant fous celle des Turcs. (C. A.)
§ ABAREMO-TEMO, f. m. (Hiß. nat, botaniq.)
L’éxiftence de cet arbre n’eft nullement douteufe,
comme on l’ayoit foupçonnée, indépendamment du
témoignage de Pifon qui l’a vu au Brefil, & qui
en a donné une defcription à la page 77 de fon Hif-
toire naturelle ; il a été obfervé aux Antilles de
l’Amérique.
C ’eft une efpece d’acacia qui forme un arbre de
médiocre grandeur, affez commun fur les montagnes
qui bordent la côte maritime orientale de l’Amérique
entre les tropiques. Ses feuilles font larges,
d’un verd trifte 8c terne, ailées deux fois, chaque
aîle compofée de deux folioles fans impaire ; fes
gouffes font roulées en fpirale.
Vertus. Ses racines, qui font d’un rouge foncé,
ainfi que fon écorce qui eft cendrée, ont une faveur
amere 8c très-aftringente. Leur vertu eft vulnéraire,
aftringente 8c defficative. .
Ufages. On les emploie en poudre pour fecher
les ulcérés invétérés ; 8c en décoôion en forme de
bain, pour affermir les chairs 8c rendre le tonaux
parties -relâchées.
Remarques. L’Abaremo-temo approche un peu de
la plante figurée fous le nom de katou-conna dans
YHortus malabaricus, volume V I , planche i z , que
M. Linné appelle mimofa, bigemina , inermis, foliis
bigeminis acuminatis. Syß. nat. edit. i z f pag. 6 j6 .
(M. A d a n s o n .)
* § AB ARES ou AVARES. Voye^ ce dernier mot
dans ce Supplément.
§ ABARI, Abaro 9 Ab arum, f. m. (Hiß. nat. bot.)
%
C ’eft par erreur que ce mot a été ainfi écrit, au lieu
d'abavi, abavo, àbavum, qui font les noms égyptiens
du baobab auquel quelques botaniftes modernes
ont donné le nom d'adanfona ou adanfonia , 8c auquel
nous avons cru devoir reftituer fon nom de
pays baobab. Voyez Familles dès plantes, vol. I I .
pag. 398. (M. A d a n so n .)
ABARIS, (Géogr?) ville d’Egypte, connue chez les
Grecs fous le nom de Pelufium. Elle fut bâtie par un
Pharaon, roi d’Egypte, 8c enfuite fortifiée 8c agrandie,
à caufe de la beauté de fa fituation , par Saltis, roi
de certains peuples qui avoient fubjugué l’Egypte.
Elle étoit dans le nome Sethroïte , fur lé côté oriental
du fleuve Bubaftique. Cette ville fut fuccefli-
vement habitée par des Juifs, par des Egyptiens
8c par des Syriens ; elle eut fucceflivement divers
noms , Abaris, Typhon, Sethron , Pithom mentionné
dans l’exode, 8c Pelufe ou Pelufium. Il n’en
refte plus aujourd’hui qu’un petit village nommé
Belbais, à quelque diftancè de Damiete. (C. A.)
*ABARRAGA, (Géogr.) ancienne ville de la Syrie
, entre Cirrha 8c Edeffe.
ABAS , f. m. (Phyfique , qualités actives. ) nom
populaire du vent d’occident : on dit àuffi vent à’a-
bas, aval ou vent d'a v a l, fans doute parce qu’il
vient du côté de.la mer où les rivières viennent fe
décharger en s’abaiffant ; ou plus exa&ement parce
que ce vent eft prefque toujours inférieur, c’eft-
à-dire , au - deffous des autres quand ils foufflent.
(M. A d a n s o n .)
*Abas , (Géogr.) riviere- d’Albanie qui prend fa
fource dans les montagnes de cette contrée , & va
fe jetter dans la mer Cafpienne. Ptolomée la homme
Albanus.
*A b a s , ( Hifi. mytholog.) capitaine des Latins;
qui conduifit à Enée des troupes de Populonie,
ancienne ville de l’Etrurie.
*Aba s , (Mytholog?) fils d’Hypothoon & de Mela-
nire. La déeffe Cérès le changea en lézard, parce
qu’il s’étoit moqué d’elle 8c de fes facrifices.
Abas , (Mytholog.) un des Centaures qui conir
battirent contre les Lapithes : Hefiode le met à la
tête de ceux qu’il nomme, au nombre de quatre-
TOlgtS. ( f )
Abas , (Mytholog.) fils de Lyncée. 8c d’Hyper-
mneftre, 8c pere d’Acrifius 8c de Proettis, fut le
douzième roi des Argiens. (*{*)
Abas , (Mytholog.) célébré devin, à qui les Lacédémoniens
éleverent une ftatue dans le temple
de Delphes, félon Paufanias, pour avoir rendu des
ferviees fignalés au célébré capitaine Lyfandre. ( f )
§ ABASCIE, (Géogr.) contrée d’Afie , que l’on
peut cônfidérer en général, comme faifant partie
de la Géorgie. Elle a la Mingrélie à l’orient, la
Circaflie Noire ou Tartare au feptentrion & au couchant
, 8c la mer Noire au midi. Il y a peu de villes
en ce pays-là, 8c même peu d’habitations fixes. La
violente loi du plus fort y fait trop conftamment
fuir les pauvres devant les riches ; 8c ces deux
claffes font les feules dans lefquelles fe rangent les
habitans de cette contrée. On les nomme indifféremment
Abaffes, ou Abcaffes ou Abcas. ( ffoye^ ce
dernier mot dans ce Supplément?) Ils font tres-beaux
8c bien faits pour la plupart ; 8c par-là ils font, pour
les Turcs qui les achètent, un objet de commerce
lucratif. Les Abaffes font lâches 8i pareffeux : placés
fous un beau ciel 8c fur un terrein fertile, ils
n’ont rien chez eux qui ne foit inculte. Leurs champs
font comme leurs moeurs. (D . G.)
* Abascie, f. f. (Géogr.) riviere d’Afie que les
anciens nommoient Glaucus. Elle prend fa fource
entre deux rivières de Mingrélie, le Kelmhel 8c le
Scheni-Shari, & va fe perdre dans le Faze,
& ABÀSCUS, (Géogr.) fleuve dé la Sàrmktié Afia-
tîqueVquiVfelôn Ptolomée , fort du mo'nt Cau-
eafe & va fe jetter dans le Pont-Euxin.,
*ABASQUES , -ABASAES & ABASSAS. Kôyei
Abcas dans ce Supplément.
AB ASSAM, (Géogr.) petit Royaume d’Afriqué
en Guinée j vôifin de'èélui d’Ifrini, 8c à dix lieues ;
dans-les'terres , de Taguefchua qui eft un petit port
de mer. Ce royaume ne confifte que dans quelques
hameaux où le plus riche eft en poffeflidn de l’autorité
& du gouvernement. Ces Chefs, qui ne pre-
noient autrefois que le nom de capitaines, Ont tous
pris celui de rois depuis qu’ils ont; lié commerce
■ avec les- Européens; Le roi d’Abaffam eft un de
ceux-là, & il a à peiné quatre mille fujèts. Long, i j 3
lati 4 , 50. (C. A .)
§ A BA TO S, (Géogr.) ifle d’Egypte dans le Palus
de Memphis OïL-lâc Mceris. Elle -étoit-renommée
■ par fon lin , par fes feuilles de palmier dont les
anciens faifoient des tablettes à écrire, & principalement
par le tombeau du Roi Ofiris qui, dans la
• fuite, fut tr-anfpofté à Abyde ou Abydos. Le Poète
Lucain en fait mention , liv. io.
. Hinc A bâton, quant nôfira vocat venerahda vetufias,
Terra pôtens■. (C. A .)
* Il rte faut pas Confondre cette ifle avec un rocher
qui porté le nom d'Abatos , & qui eft fort éloigné
du-Palus de Memphis.
AB A T T É Ë , f. f. (terme de Marthe.) c’eft le mouvement
de rotation- que fait un -vaiffeaü, lorfque
l ’avant cede ou obéit à la direâion du vent. Cette
définition convient également à l’arrivée qui-, dans
,1e fond, né différé point en effet de 1’abattée(V. Arrivée
, Suppl.):mais l’un ou l’autremot doit s’appliquer
félon les circonftances•& la fituation relative du
vaiflèaû. Abdttéè fe dit de ce mouvement feulement
ïorfqu’il eft involontaire ou forcé , tel que celui
d’un vaiffeaü qui.eft en panne ou à la cape , ou
d’un vaiffeaü dont les ancres quittent le-fond, qui
vire de bord vent devant, ou qui eft eoeffé. Quoique
Yabattée ne foit pas volontaire, On là prévoit
Cependant , > on la dirige, on la facilite , & c’eft à
l’art à la régler ( Yabattée étant un mouvement le
même que celui de l’arrivée , c’eft à ce dernier mot
que l’on trouvera les moyens que l’on peut employer
pour faire céder le vaiffeaü à la direction du
vent ).- Une abaitée ne peut pas aller jufqu’à mettre
le vaiffeaü vent-arriere ; car ce ne pOurroit être que
par un a&e-libre qu’un vaiffeaü en viendroit là -, &
le mouvement ceffe, d’être abattit lôrfqu’il ceffe
d’être forcé. Cette diftinôion entre Yabattée & l’arrivée
pourra peut-être furprendre au premier abord:
mais que l’on y réfléchiflè cependant, & ofi la trouvera
jufte. Lorfque j’appareillé, par exemple, je
fuis bien maître d’abattre à tribord ou à bâbord *
mais il faut de néceffité que j’abatte ; le mouvement
eft donc forcé : & c’eft dans la contrainte que j’éta-
blis , que doit exifter la différence de Yabattée à
l’arrivée. ■
! On peut meftirér la grandeur d’une abattit par le
nombre des degrés- de l’horifon compris -entre lé
Jjoint d’où le Vaiffeaü a commencé fon mouvement,
& celui où il le ceffe : Cependant l ’horizon étant divifé
par les marins- en t-rente-déùx airs de- vent, &
une mefure exafte n’importànt jamais beaucoup dans
la pratique, on fe contente de dire une dbattée dè
deux airs de vent, de deux airs & demi dé vent, &c.
Les a buttées â\m Vaiffeaü qui éft èn panne ou à lâ
cape ont quelque chofe qui leur eft partieulier-, &
qm mérite que l’on en développe là caufe. Lés abat-
tces du vaiffeaü en panne ne - dépendfoient que- de
1 agitation de là mer, & feroient conféqueinment
beaucoup moins fréquentés, s ’il étoit poflible dans
- Torrifil,
la pratiqué d’orienter les voiles dè cè vaiffeaü fuivant
les réglés preforitesau mot panne(voyeçPANNE)i
Il en feroi.t de même pour le vaiffeaü à la cape , fi
I onjp ou voit aufli balancer, avec une égalité parfaite^
les forces du vent fur l’avant & fur l ’arriere de fon
centre de gravité ( voye{ Cape ) ; mais l’efpece
d împoffibilite^ qu’il y a à. le faire , fait dépendre encore
les abattées de là voilure de ces vaiffeaux. Ces
deux caufes, l’inégalité de la force du vent & l’iné-
galite de la force des lames de la mer fur l’avànt &
fur 1 arriéré du centre de gravité', communiquent
donc un mouvement de rotation aux vaifféâux qui
font dans l’un ou l’autre cas ; & ce mouvement lui—
meme rend plus fënfiblè & augmente encore la différence
de l’effet du vent fur les voiles, fur les mâts,
&.fur le corps même du vaiffeaü relativement à ce
centre. Dans le mouvement de rotation qui le fait
abattre, le vaiffeaü acquiert de l’air; & le gouvernail
conféquemment acquiert de la force. L’effet dit
gouvernail ne tarde point à rappeller le vaiffeaü au
point du plus près où il doit préfenter; mais, en le
rappellant ainfi, lâ force qu’il lui communique n’eft
point proportionnée fur l’arc que doit décrire lé
vaiffeaü pour préfenter exaftemenf à ce point du
plus près : prefquë toujours au contraire le-vaiffeaü
acquiert.trop de vîteffe 8c eft porté au-delà; -alors
lâ mer a confidérablement plus de prife fur l’avant
du vaiffeâu ; les voiles fafient ; & la fuite néeeffairé
de cette pofition forcée eft de faire une fécondé
abattèei C’eft ainfi que le gouvernail contribue, lui-
meme en quelque forte à ce mouvement de rotation
- continuel, dans lequel fucceflivement le vaiffeaü
abat, ou fait une abattit, puis revient au vent : mouvement
plus ou moins confidérable, fuivântla groï-
feur des lames, le balancement du vaiffeaü, fa voilure,
8c fés qualités particulières. ( M. le Chevalier.
D E L A Co u d R A Y E . )
AB A T T IS , f. m. (Art Militaire?) c’eft une forte dé
retranchement dont l’idée fe préfente fi naturellement
à l’efprit, qu’on peut affurer que l’ufage en a été généralement
connu & pratiqué par tous les peuples
du nionde. Une infinité d’auteurs anciens 8c modernes
font mention de ces fortes de fortifications, 8c
rapportent des exemples remarquables du parti
avantageux qu’on a fçu ën tirer dans tous les tems.
Lorlqu’on fait la guerre dans un pays de bois, 8c
qu’il s’agit de barrer un pafîàge quelconque à lâ
hâté', on fe contente d’abattre les arbres 8c de les
entaffer les uns fur les autres. Mais toutes les fois
qu’ort a le terns dé biën faire un abattis, alors il faut
rangèr les arbres très près lun de l’autre le tronc en
dedans, 8c les âffujettir avec de fortes lambourdes ;
obfervant que les branches fôient bien entrelacées j
bien épointées 8c débarraffées des plus petites, afin
de voir l’ennemi au-travers fans être vu; 8cde pratiquer
, derrière, une tranchée pour mettre la troupe
qui doit le défendre.
Dans cet état un dbàttis à non-feulement toute la
force d’un rang de paliffades inclinées, qu’on ne peut
ni coüpèr ni abordër, mais e’eft un obftacle bien.plus
admirable 8c infiniment plus redoutable que les meilleurs
retranchemens. Le chevalier de Folard, qui
recommande fortement l’ufage des abattis, remarque
que de; tous les arbres les failles font les plus propres
à ces fortes d’ouvrages, 8c ceux qui donnent moins
de prife à la hache 8c à la ferpe , parce que les branches
dé cet arbre ne cèdent pas aux coups, 8c qu’il
eft impoflib’le de fe couler entre elles ou de les écarter
, fé trouvant trop près les unes des autrès.
II y a , à la guerre, bien des cas où l’on peut fe fer-
vir très-utilement des abattis. Rien n’eft plus propre
dans la défeflfe d’une riviere pour èn rompre les
gués ; rien de plus folide pour affurer un pofte d’infanterie
j pour retrancher un village, un défilé, une
B ij