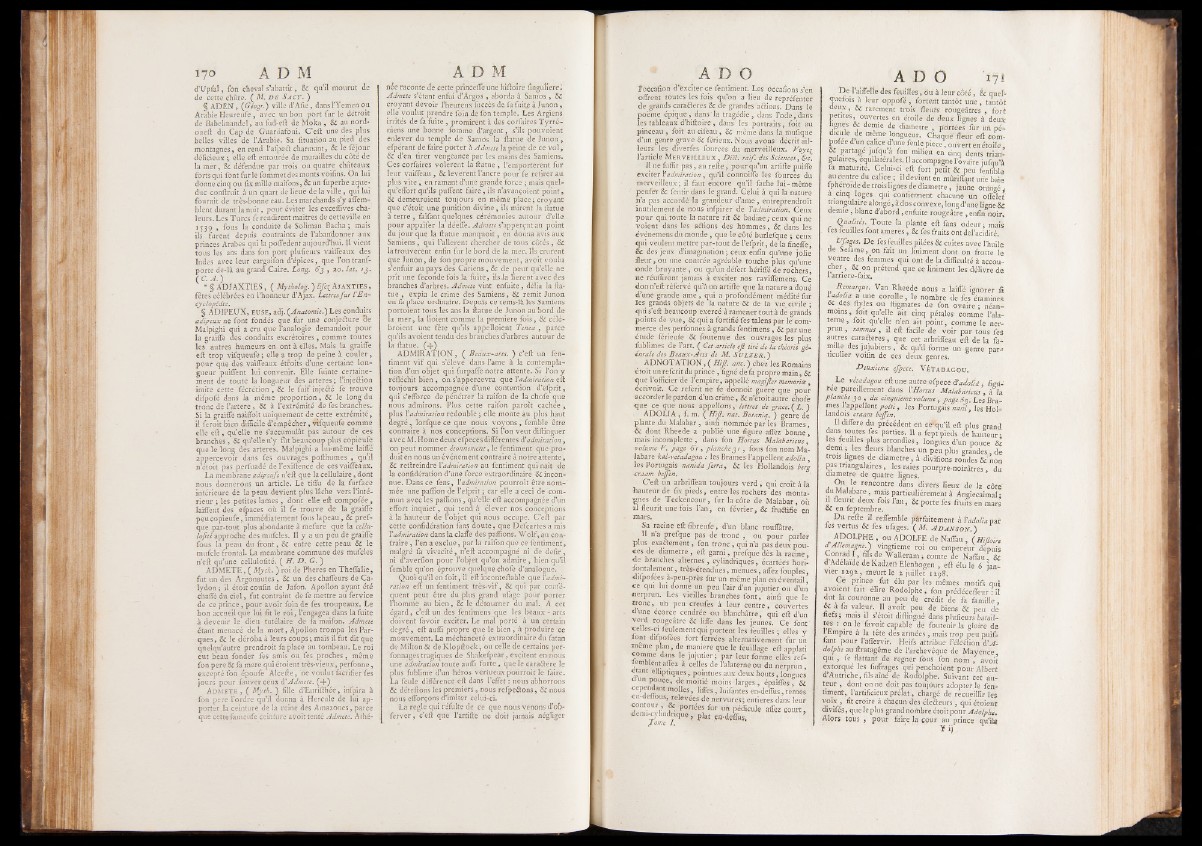
d’Upfal, fon cheval s’abattit, & qu’il mourut de
de cette chute. ( M. d e S a c y . )
§ ADEN, (’Giogr.) ville d’Afie, clans l’Yemen ou
Arabie Heureufe, avec un bon port fur le détroit
de Babelmandel, au fud-eft de Moka , & au nord-
oueft du Cap de Guardafoui. C ’eft une des plus
belles villes de l’Arabie. Sa fituation au pied des
montagnes, en rend l’afpeû charmant, Oc le fejour
délicieux ; elle eft entourée de murailles du côté de
la mer, Oc défendue par trois ou quatre châteaux
forts qui font furie fommetdes monts voifins. On lui
donne cinq ou fix mille maifons, ÔC un- fuperbe aqueduc
conftruit à un quart de lieue de la v ille , qui lui
fournit de très-bonne eau. Les marchands s’y affemblent
durant la nuit, pour éviter les exceflives chaleurs.
Les Turcs fe rendirent maîtres de cetteville en
1539 , fous la conduite de Soliman Bacha ; mais
ils furent depuis contraints de l’abandonner aux
princes Arabes qui la poffedent aujourd’hui. Il vient
tous les ans dans fon port plufieurs vaiffeaux des
Indes avec leur cargaifon d’épices, que l’on tranf-
porte de-là au grand Caire. Long. 6 3 , 20. lat. 13.
( 'C .A .)
* § ADJAXT1E S , ( Mytkolog. ) lifei Ajaxties ,
fêtes célébrées en l’honneur d’Ajax. Lettres fur L'Encyclopédie.
§ ADIPEUX, euse, adj. (Anatomie.') Les conduits
adipeux ne font fondés que fur une conje&ure ae
Malpighi qui a cru que l’analogie demandoit pour
la graiffe des conduits excrétoires, comme toutes
les autres humeurs en ont à elles. Mais la graille
eft trop vifqueufe ; elle a trop de peine à couler,
pour que des vaiffeaux étroits d’une certaine longueur
puiffent lui convenir. Elle fuinte certainement
de toute la longueur des arteres ; l’injeftion
imite cette fécrétion , Oc le fuif injeété fe trouve
difpofé dans la même proportion, & le long du
tronc de l’artere , & à l’extrémité de fes branches.-
Si la graiffé naiffoit uniquement de cette extrémité,
il feroit bien difficile d’empêcher, vifqueufe comme
elle e f t , qu’elle ne s’accumulât pas autour de ces
branches, & qu’elle n'y fut beaucoup plus copiëufe
que le long des arteres. Malpighi a lui-même laiffé
appercevoir dans fes ouvrages pofthumes , qu’il
n’étoit pas perfuadé de l’exiftence de ces vaiffeaux.
La membrane adipeufe n’èft que la cellulaire, dont
nous donnerons un article. Le tiffu de la furface
intérieure dè la peau devient plus lâche vers l’intérieur
; les petites lames , dont elle eft compofée ,
laiffent des efpaces ou il fe trouve de la graiffe
peucopieufe, immédiatement fous lapeau, & pref-
que par-tout plus abondante à mefure que la cülu-
lofitè approche des mufcles. Il y a un peu de graiffe
fous la peau du front, & entre cette peau Oc le
mufcle frontal. La membrane commune des mufcles
n’eft qu’une cellulofité. (H . D. G. )
ADMETE, ( Myth. ) roi de Pheres en Theffalie,
fut un des Argonautes, Oc un des chaffeurs de Ca-
lydon ; il étoit coufin de Jafon. Apollon ayant été
chaffé du c ie l, fut contraint de fe mettre au fer vice
de ce prince, pour avoir foin de fes troupeaux. Le
bon accueil que lui fit le ro i, l’engagea dans la fuite
à devenir le dieu tutélaire de fa maifon. Admete
étant menacé de la mort, Apollon trompa les Parques,
& le déroba à leurs coups ; mais il fut dit que
quelqu’autre prendroit fa place au tombeau. Le roi
eut beau fonder fes amis ou fes proches, même
fon pere 8c fa mere qui étoient très-vieux, perfonne,
excepté fon époufe Alcefte, ne voulut facrifier fes
jours pour fauver ceux à!Admete. (-{-)
Admete , ( Myth. ) fille d’Eurifthée, infpira à
fon pere l’ordre qu’il donna à Hercule de lui apporter
la ceinture de la reine des Amazones, parce
que cettefameufe ceinture avoit tenté Admete. Athénée
raconte de cette princeffe une hiftoire lîngulierei
Admete s’étant enfui d’Àrgos , aborda à Samos , 8C
croyant devoir l’heureux fuccès de fa fuite à Junon ,
elle voulut prendre foin dé fon temple. Les Argiens
irrités de fa fuite, promirent à des corfaires T yrré-
niens une bonne fomme d’argent, s’ils pouvoient
enlever du temple de Samos la ftatue de Junon,
efpérant de faire porter à Admete la peine de ce v o l,
8c d’en tirer vengeance par les mains des Samiens.
Ces corfaires volèrent la ftatue , l’emportèrent fur
leur vaiffeau , 8c levèrent l’ancre pour fe retirer au
plus vite ,. en ramant d’une grande force ; mais quel-
qu’effort qu’ils puffent faire , ils n’avânçoient point,
8c demeuroient toujours en même place ; croyant
que c’étoit une punition divine , ils mirent la ftatue
à terre , faifant quelques cérémonies autour d’elle
pour appaifer la déeffe. Admete s’apperçutaü point
du jour que la ftatue manquoit, en donna avis aux
Samiens , qui l’allerent chercher de tous côtés , 8c
la trouvèrent enfin fur le bord de la, mer. Ils crurent
que Junon, de fon propre mouvement, avoit voulu
s’enfuir au pays des Cariens , 8c de peur qu’elle ne
prît une fécondé fois la fuite, ils la lièrent aVec des
branches d’arl^res. Admete vint enfuite, délia la ftatue
, expia le crime des Samiens, & remit Junon
en fa place ordinaire. Depuis ce tems-là les Samiens
portoient tous les ans la ftatue de Junon au bord de
la mer, la lioient comme la première fois , 8c célé-
broient une fête qu’ils appelloient Tenea , parce
qu’ils avoient tendu des branches d’arbres autour de
la ftatue. (-{-)
ADMIRATION, ( Beaux-arts. ) c’eft un fen-
timent v i f qui s’élevë dans l’ame à la contemplation
d’un objet qui furpâffe notre attente. Si l’on y
réfléchit bien , on s’âppercevra que l'admiration eft
toujours accompagnée d’une Contention d’efprit,
qui s’efforce de pénétrer la raifon de la chofe que
nous admirons. Plus cette raifon paroît cachée ,
plus l'admiration redoublé ; elle monte au plus haut
degré, lôrfque ce que nous voyon s , femble être
contraire à nos conceptions. Si l’on veut diftinguer
avec M. Home deux efpecesdifférentes d'admiration ,
on peut nommer étonnement, le fentiment que produit
en nous un événement contraire à notre attente,
8c reftréindre l’admiration au fentiment qui naît de
la confidération d’une force extraordinaire Sc inconnue.
Dans ce fèns, Yadmiration pourroit être nom-'
mée une paflîon de l’efprit ; car elle a'ceci de commun
avec les pallions, qu’elle eft accompagnée d’un
. effort inquiet, qui tend à élever nos conceptions
à la hauteur de l’objet qui nous occupe. C’eft par
cette confidération fans doute, que Defcartes a mis
Yadmiration dans la claue des pallions. "Wolf, au contraire
, l’en a exclue, par la raifon que ce fentiment,
malgré fa vivacité, n’eft accompagné ni de defir,
ni d’averfion pour l’objet qu’on admire, bien qu’il
femble qu’on éprouve quelque chofe d’analogue.
Quoi qu’il en foit, il eft inconteftable que Y admiration
eft un fentiment très-vif , 8c qui par confé-
quent peut être du plus grand ufage pour porter
l’hommë au bien, & le détourner du mal. A cet
égard, c’eft un des fentimens que les beaux - arts
doivent favoir exciter. Le mal porté à un certain
degré, eft auflï propre que le bien, à produire ce
mouvement. La méchanceté extraordinaire du fatan
de Milton & de Klopftock, ou celle de certains per-
fonnagës tragiques de Shakefpear, excitent en nous
une admiration toute aufli forte , que le caraéfere le
plus fublime d’un héros vertueux pourroit le faire.
La feule différence eft dans l’effet : nous abhorrons
& dételions les premiers, nous refpedons, 8c nous
nous efforçons d’imiter celui-ci.
La réglé qui réfulte de ce que nous venons d’ob-
ferver, c’eft que l’artifte ne doit jamais négliger
Poècafion d’èxciter ce fentiment. Les occafioris s’en
offrent toutes les fois qu’on a lieu de repréfenter
de grands earaétéres 8c de grandes aélions. Dans le
poème épique, dans’ la tragédie, dans l’ode,dans
les tableaux d’hiftoire, dans les portraits, foit au
pinceau, foit aucifeau, 8c même dans la.mufique
d’un genre grave 8c férieux. Nous avons décrit ailleurs
les diverfes fources du merveilleux. Voyeç
l’article Merveilleux , Diel. raif. des Sciences, &c.
Il ne fuffit pas, au relie, pour qu’un artifte pujffe
exciter Y admiration, qu’il connoiffe les fources du
merveilleux; il faut encore qu’il fache lui-même
P enfer 8c fentir dans le grand. Celui à qui la nature
n’a pas accordé la grandeur d’ame, entreprendrôit
inutilement de nous infpirer de Y admiration. Ceux
pour qui toute la nature rit 8c badine; ceux qui ne
voient dans les aftions des hommes, 8c dans les
événemens du monde, que le côté burlefque ; ceux
qui veulent mettre par-tout de l’efprit, de la fineffe,
& des jeux d’imagination ; ceux enfin qu’une jolie
fleur, ou une contrée agréable touche plus qu’une
onde bruyante , ou qu’un défert hériffé de rochers,
ne réulïïront jamais à exciter nos raviffemens. Ce
don n’eft réfervé qu’à un artifte que la nature a doué
d’une grande ame, qui a profondément médité fur
les grands objets de la nature 8c de la vie_ civile ;
qui s’eft beaucoup exercé à ramener tout à de grands
points de vue, & qui a fortifié fes talens par le- com*
merce des perfonnes à grands fentimens , & par une
étude férieufe 8c foutenue des ouvrages les plus
fublimes de l’art. ( Cet article efi tiré de ta théorie gé-
énrale des Beaux-Arts de M. SULZER. )
ADN OTA T ION , ( Hiß. ant. ) chez les Romains
étoit un refcrit du prince , ligné de fa propre main, 8c
que l’officier de l’empire, àppellé magißer memoria ,
ecrivoit. Ce refcrit ne fe donnoit guere que pour
•accorder le pardon d’un-crime, & n’étoit autre chofe
que ce que nous appelions, lettres de grâce. ( L . )
ADOLIA , f. m. ( Hiß, nat. Botaniej. ) genre de
plante du Malabar , ainfi nommée par les Brames,
8c dont Rheede a publié une figure affez bonne,
mais incomplette , dans fon Hortus Malabaricus,
volume V. page C i , planche 31 , fous fon nom Ma-
labare kal-vetadagou .- les Brames l’appellent adolia ,
les Portugais nanida ferra, 8c les Hollandois berg
>craam beffen.
C’eft un arbriffeaa toujours v e rd , qui croît à la
hauteur de fix pieds, entre les rochers des montagnes
de Teckencour, fur la côte de Malabar, où
i l fleurit une fois l’an, en février, & fruétifie en
mars.
Sa racine eft fibreufê, d’un blanc rouffâtre.
Il n’a prefque pas de tronc , ou pour parler
plus exactement, fon tronc , qui n’a pas deux pouces
de diamètre , eft garni, prefque dès la racine,
<le branches alternes , cylindriques, écartées horizontalement,
très-étendues, menues, affez foupleS,
difpofees à-peu-près fur un même plan en éventail,
ce qui lui donne un peu l’air d’un jujutier ou d’un
«erprun. Les vieilles branches font, ainfi que le
tronc, un peu creufes à leur centre, couvertes
dune écorce cendrée ou blanchâtre, qui eft d’un
verd rougeâtre 8c liffe dans les jeunes. Ce font'
celles-ci feulement qui portent les feuilles ; elles y
font difpofees fort ferrées alternativement fur un
meme plan, de maniéré que le feuillage eft applati
comme dans le jujutier ; par leur forme elles ref-
lemblent affez à celles de l’alaterne ou du nerprun ,
ctant elliptiques, pointues aux deux bouts, longues
un pouce, de moitié moins larges, épaiffes 8c
c eP,eV nt ni0^es» liftes, luifantes en-deffus, ternes 1
en e ous, relevées de nervures; entières dans leur
con our , & portées fur un pédicule affez court,
demi-cylindrique, pla t . çn-deffus.
De Paiffeile des feuilles, du à leur cô té, & quelquefois
à leur oppofé , fortent tantôt une, tantôt
deux, & rarement t ro is f le u r s rougeâtres , fort
petites, ouvertes ert étoile de deux lignes à deux
lignes & demie de diamètre , portées fùr Un pé-
dicule de meme longueur. C h a q u e f le u r eft comp
t é e d un calice d’une feule p ièce, ouvert en étoile,
partage jufqu à fon milieu en cinq dents triangulaires,
équilatérales. Il accompagne l’ovaire jufqu’à
la maturité. Celui-ci eft fort petit & peu fenfible
au centre du calice ; il devient en muriffant une baie
Ipheroide de trois lignes de diamètre j jaune oràngé *
à cinq loges qui co n tien n e n t chacune un offelef
triangulaire alongé, à dos convexe, long d’une ligne &
demie, blanc d’abord, enfuite rougeâtre , enfin noir.
Qualités. Toute la plante eft fans odeur; mais
fes feuilles font ameres, & fes fruits ôntdel’acidité.
V f âges. De fes feuilles pilées & cuites avec l’huile
de Sefame, on fait un Uniment dont on frotte le
ventre des femmes qui ont de la difficulté à accoucher,
& on prétend que ce Uniment les délivre de
I arriere-faix.
Remarque. Van Rheéde rtôüs a laiffé ignorer fi
\ adolia a une corolle, le nombre de fes étamines
oc des ftyles ou ftigmates de fon ovaire ; néanmoins
, foit qu’elle ait cinq pétales comme l’alaterne,
foit qu’elle n’en ait point, comme le nerprun
, ramnus , il eft facile de voir par tous feâ
autres carafteres, que cet arbriffeau eft de la famille
des jujubiers , & qu’il forme un genre par-=
ticulier voifin de ces deux genres.
Deuxiefne efpece. V É T A D A G O U .
, Le vétadagou eft une autre efpece à’adolîd ; fimi-
ree pareillement dans Y Hortus Malabaricus, à l a
planche 30 , du cinquième volume, page J à. Les Brames
l’appellent polti, les Portugais nani, les Hol-
iandois craam beffen<
Il différa du précédent en ce^u ’il eft plus «and
dans toutes fes parties. U a fept pieds de hauteur •
les teuilles plus arrondies, longues d’un pouce &
demi ; les fleurs blanches un peu plus grandes, de
trois lignes de diamètre, à divifions rondes & ‘ non
pas triangulaires, les raies pourpre-noirâtres, du
diamètre de quatre lignes,
j ?„n , I,é rencontre dans divefs lieux de la côte
du Malabare , mais particuliérement à Angiecaimal;
II fleurit deux fois l’an, & porte fes fruits en mars
oc en ieptembre.
Du refte il reffembie parfaitement à Y adolia par
les vertus & fes ufages. ( M. A d a n s o n . )
ADOLPHE , ou ADOLFE de Naffau, (Hiftoire
d Allemagne d) vingtième r o i ou em p e r e u r depuis
Conrad I , fils de Wallëfâm j comte de Naffau &
d Adélaïde de Kadzeii Elenbogert , eft élu le 6 janvier
1292 j me'urt le 2 juillet 1298.
Ce prince fut élu par les mêmes motifs qui
àvôient fait élire Rodolphe, fon prédéceffeur i il
dut la couronne au peu de crédit de fa famille,
oc à fa valeur. l\ avoit peu de biens & peu de
nefs ; mais il s’etoit diftingué dans plufieurs bafail-
tes : on le favoit capable de foutenir la gloire de
1 Empire a la tête des armées , mais trop peu puif-
fant pour l’affervir. Heifs attribue l’élèélion d’^ -
dolphe au ftratagême de l’archevêque de Mayence
qui , fe flattant de regner fous fon nom , avoit
extorqué les fuffrages qui penchôient pour Albert
d’Autriche, fils aîné de Rocfolphe. Suivant cet auteur
, dont on ne doit pas toujours adopter le fentiment,
l’artificieux prélat, chargé de recueillir les
voix , fit croire à chacun des électeurs , qui étoienf
divifés, que le plus grand noihbre étoit pour Adolphe.
Alors tous j pour faire la cour au prince qu’ila
Y i j