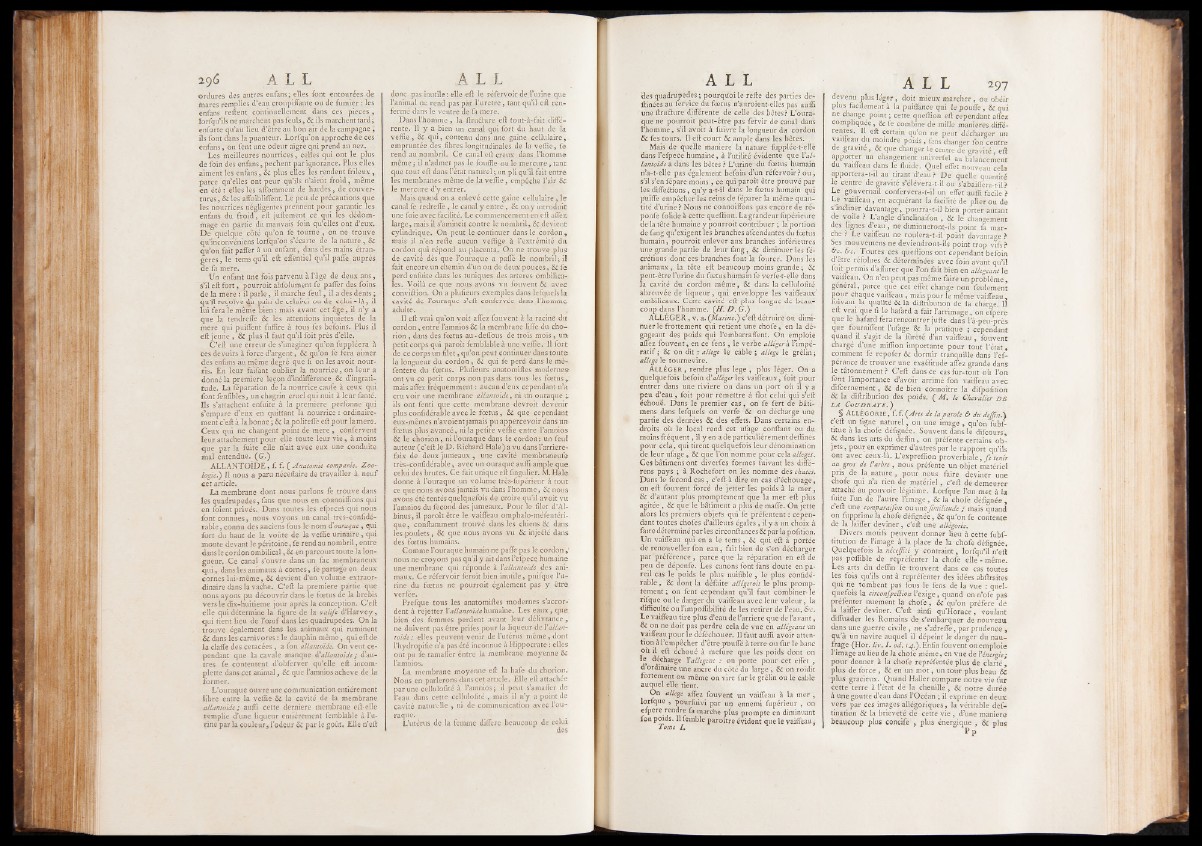
ordures des autres enfans; elles {ont entourées de
tnares remplies d’eau croupiflante ou de fumier : les
enfans relient continuellement dans ces pièces ,
lorfqu’ils ne marchent pas feuls, & ils marchent tard;
enforte qu’au lieu d’être au bon air de la campagne ;
ils font dans la puanteur. Lorfqu’on approche de ces '
enfans, on fent une odeur aigre qui prend au nez.
Les meilleures nourrices, celles qui ont le plus
de foin des enfans, pechent par ignorance. Plus elles
aiment les enfans, plus elles les rendent frileux,
parce qu’ elles ont peur qu’ils n’aient froid, même
en été: elles les affomment de hardes, de couvertures,
& les affoibliffent. Le peu de précautions que
les nourrices négligentes prennent pour garantir les
enfans du froid, eft juftement ce qui les dédommage
en partie du mauvais foin qu’elles ont d’eux.
D e quelque côté qu’on fe tourne , on ne trouve
qu’inconvéniens lorfqu’on s’écarte de la nature, &
qu’on fait paffer à un enfant, dans des mains étrangères,
le tems qu’il eft effentiel qu’il paffè auprès
de fa mère.
Un enfant une fois parvenu à l’âge de deux ans,
s’ il eft fort, pourroit abfolument fe paffer des foins
de la mere : il parle, il marche feu l, il a des dents ;
qu’il reçoive du pain de celui-ci ou de celui - là , il
lui fera le même bien: mais avant cet âge, il n’y a
que la tendreffe & les attentions inquiétés de la
mere qui puiffent fuffire à tous fes befoins. Plus il
eft jeune , & plus il faut qu’il foit près d’elle.
C ’eft une erreur de s’imaginer qu’on fuppléera à
ces devoirs à force d’argent, & qu’on fe fera aimer
des enfans au même degré que fi on les avoit nourris.
En leur faifant oublier la nourrice, on leur a
donné la première leçon d’indifférence & d’ingratitude.
La féparation de la nourrice caufe à ceux qui
font fenfibles, un chagrin cruel qui nuit à leur fanté.
Ils s’attachent enfuite à la première perfonné qui
s’empare d’eux en quittant la nourrice : ordinairement
c’eft à la bonne ; & la politeffe eft pour la mere.
Ceux qui ne changent point de mere , confervent
leur attachement pour elle toute leur v ie , à moins
que par la fuite elle n’ait avec eux une conduite
mal entendue. (G.)
ALLAN TO ÏDE, f. f. ( Anatomie comparée. Zoologie.')
Il nous a paru néceflaire de travailler -à- neuf
cet article.
La membrane dont nous parlons fe trouve dans
les quadrupèdes, fans que nous en connoiffions qui
en foïent privés. Dans toutes les efpeceS qui nous
font connues, nous voyons - un canal très-confidé-
rable, connu des anciens fous le nom d'ouraque , qui
fort du haut de la voûte de la veflie urinaire, qui
monte devant le péritoine, fe rend au nombril, entre
dans le cordon ombilical ,& en parcourt toute la longueur.
Ce canal s’ouvre dans un fac membraneux
q u i, dans les animaux à cornes, fe partage en deux
cornes lui-même, & devient d’un volume extraordinaire
dans la vache. C’eft la première partie que
nous ayons pu découvrir dans le foetus de la brebis
vers le dix-huitieme jour après la conception. C’eft
elle qui détermine la figure de la valife d’Harvey,
qui tient lieu de l’oeuf dans les quadrupèdes. On la
trouve également dans les- animaux qui ruminent
& dans les carnivores : le dauphin même, qui eft de
la claffe des cetacées, a fon allantoïde. On veut cependant
que la cavale manque à?allantoïde ; d’autres
fe contentent d’obferver qu’elle eft incom-
plette dans cet animal, & que l’amnios achevé de la
former.
. L’ouraque ouvre une communication entièrement
libre entre la veflie & la cavité de la membrane
allantoïde ; auflî cette derniere membrane eft-elle
remplie d’une liqueur entièrement femblable à l’u-
tine par la couleur, l’odeur & par le goût, Elle n’eft
donc pas inutile : elle eft le réfervoir de l’urine que
l’animal ne rend pas par l ’uretre, tant qu’il eft renfermé
dans le ventre de fa mere.
Dans l’homme , la ftrutture eft tout-à-fait différente.
Il y a bien un canal qui fort du haut de la
veflie , & qui, contenu dans une gaine, cellulaire,
empruntée des fibres longitudinales de la veflie, fe
rend au nombril. Ce canal eft creux dans l’homme
même ; il n’admet pas le fouffle ou le mercure, tant
que tout eft dans l’état naturel ; un pli qu’il fait entre
les membranes même de la veflie, empêche l’air &c
le mercure d’y entrer.
Mais quand on a enlevé cette gaine cellulaire, le
canal fe redreffe , le canal y entre, & on y introduit
une foie avec facilité.. Le commencement en eft affez
large, mais il s’amincit contre le nombril, & devient
cylindrique. On peut le continuer dans le,cordon,
mais il n’en refte aucun veftige à l’extrémité dit
cordon qui répond au placenta. On ne trouve plus
de cavité dès que l’ouraque a paffé le nombril; il
fait encore un chemin d’un ou de deux pouces, & fe
perd enfuite dans les tuniques des arteres ombilicales.
Voilà ce que nous avons vu fouvent & avec
conviâion. On a plufieurs exemples dans lefquels la
cavité de l’ouraque s’eft confervée dans l’homme
adulte.
.11 eft vrai qu’on voit affez fouvent. à la racine du
cordon, entre l’amnios & la membrane lifle du cho-
rion , dans des foetus au- deffous de trois mois , un-
petit corps qui paroît femblable à une veflie. Il fort
de ce corps un filet, qu’on peut continuer dans toute
là longueur du cordon, & qui fe perd dans le mé-
fentere du foetus.' Plùfiéurs anatomiftes moderne»
ont vu ce petit corps non pas dans tous les foetus ,.
mais affez fréquemment : aucun d’eux cependant n’a
cru voir une membrane allantoïde, ni Un ouraque
ils ont fenti que cette membrane devroit devenir
plus confidérable avec le foetus, & que cependant
eux-mêmes n’avoient jamais pu apperce.voir dans un-
foetus plus avancé, ni la petite veflie entre l’amnios
& le chorion, ni l’ouraque dans le cordon: un feul
auteur (c’eft le D. Richard Haie) a vu dans l’arriere-
faix de deux jumeaux , une cavité membraneufe
très-confidérable -, avec un ouraque aufli ample que
celui des brutes. Ce fait unique eft fingiilier. M. Haie
donne à l’ouraque un volume très-fupérieur à tout
ce que nous avons jamais vu dans l’homme, & nous
avons été tentés quelquefois de croire qu’il avoit vu
l’amnios du fécond des jumeaux. Pour le filet d’Al-
binus, il paroît être lé. vaiffeau omphalo-méfentéri-
que, conftamment trouvé dans les chiens & dans
les poulets, & que nous avons vu & injeélé dans
des foetus humains. ,
Comme l’ouraque humain ne paffe pas le cordon ,'
nous ne croyons pas qu’il y ait dans l’efpece humaine
une membrane qui réponde à l’allantoïde des animaux.
Ce réfervoir feroit bien inutile, puifque l’urine
du foetus ne pourroit également pas y être,
verfée.
Prefque tous les anatomiftes modernes s’accordent
à rejetter l'allantoïde humaine. Les eaux , que
bien des femmes perdent avant leur délivrance ,
ne doivent pas être prifes pour la liqueur de \allantoïde
: elles peuvent venir de l’utérus même, dont
l’hydropifie n’a pas été inconnue à Hippocrate : elles
ont pu fe ramaffer entre la membrane moyenne &
l’amnios. § ; 1
La membrane moyenne eft la bafe du chorion.
Nous, en parlerons dans cet article. Elle eft attachée
par une cellulofité à l’amnios ; il peut s’amafler de
l’eau dans cette cellulofité , mais il n’y a point de
cavité naturelle , ni de communication avec l’ou-
ràque. •
L’utérus de la femme différé beaucoup de celui
des
des quadrupèdes ; pourquoi le refte des parties dè-
ftinées au fervice du foetus n’auroient-elles pas aufli
une ftruélure différente de celle des bêtes P .L’oura-
qué ne pourroit peut-être pas fètvir de canal dans
l’homme, s’il avoit à fuivre la longueur du cordon
& fes tours. Il eft court & ample dans les bêtes,
Mais de quelle maniéré la nature fupplée-t-ellë
dans l’efpece humaine, à l’utilité évidente que Y allantoïde
a dans les bêtes ? L’urine du foetus humain
n’a-t-elle pas également befoin d’un réfervoir ? o u ,
s’il.s’en fépare moins , ce qui paroît être prouvé par
les diffeclions, qu’y a-t-il dans le foetus humain qui
pïiiffe empêcher les reins de féparer la même quantité
d’urine ? Nous ne connoiffons pas encore de ré-
ponfe folideà cette queftion. La grandeur fupérieurè
tle la tête humaine y pourroit contribuer ; la portion
de fang qu’exigent les branches afcendantes du foetus
humain, pourroit enlever aux branches inférieures
une grande partie de leur fang, & diminuer les fé-
crétions dont ces branches font la fourpé. Dans les
animaux, la tête eft beaucoup moins grande; &
peut-être l’urine du foetus humain fe verfe-t-elle dans
la cavité du cordon même, & dans la cellulofité
abreuvée de liqueur, qui enveloppe les vâiffeaux/
ombilicaux. Cette cavité eft plus longue de beaucoup
dans l’homme. (.H D . G.)
ALLEGER, v. a. (Marine.) c’eft détruire ou diminuer
le frottement qui retient une chofe, en la dégageant
des poids qui l’embarraffent. On emploie
affez fouvent, en ce fens , le verbe alléger à l’impératif
; & on dit : allégé le cable ; allégé le grelin ;
allégé le tournevire.
Alléger , rendre plus lege , plus léger. On a
quelquefois befoin d’alléger les vaiffeaux, foit pour
entrer dans une riviere ou dans- 'un port oii il ÿ a
peu d’eau, foit pour remettre à flot celui qui s’eft
échoué. Dans le premier ca s, on fe fert de bâti—
mens dans lefquels on verfe & on décharge une
partie des denrées & des effets. Dans certains endroits
où le local rend cet ufage confiant ou du
moins fréquent, il y en a de particuliérement deftinés
pour cela, qui tirent quelquefois leur dénomination
de leur ufage , & que l’on nomme pour cela allégés.
Ces bâtimens ont diverfes formes fuivant les différeras
pays ; à Rochefort on les nomme des chutes.
Dans le fécond cas , c’eft-à dire en cas d’échouage,
on eft fouvent forcé de jetter les poids à la mer,
& d’autant plus promptement que la mer eft plus
agitée , & que le bâtiment a plus de maffe. On jette
alors les premiers objets qui fe préfentent : cependant
toutes chofes d’ailleurs égales , il y a un choix à
faire déterminé par les circonftances & par la pofition.
Un vaiffeau qui en a le tems, & qui eft à portée
de renouveller fon eau, fait bien de s’en décharger
par préférence, parce que la réparation en eft de
peu de dépenfe. Les canons font fans doute en pareil
cas le poids le plus nuifible, le plus confidérable
, & dont la défaite allégeroit le plus promptement
; on fent cependant qu’il faut combiner- le
rifque ou le danger du vaiffeau avec leur valeur, la
difficulté ou l’impoffibilité de les retirer de l’eau, &c.
Le vaiffeau tire plus d’eau de l’arriere que de l’avant,
& on ne doit pas perdre cela de vue en allégeant un
Vaiffeau pour le déféchouer. Il faut aufli avoir attention
à l’empêcher d’être pouffé à terre ou fur le banc
ou il eft échoué à mefure que les poids dont on
le déchargé Yallegent : on porte pour cet effet ,
d ordinaire une ancre du côté du large , & on roidit
fortement ou même on vire fur le grêlin ou le cable
auquel elle tient.
On allégé affez fouvent un vaiffeau à la m e r ,
lorfque , pourfuivi par un ennemi fupérieur , on
«efpere rendre fa marche plus prompte en diminuant
fon poids. Il femble paroître évident que le vaiffeau.
Tome I.
devenu plus lég er, doit mieux marcher, ou obéir
plus facilement à la puiflànce qui le pouffe , & qui
ne change^ point ; cette queftion eft cependant affez
compliquée, & fe combine de mille maniérés diffé-
rentes. Il eft certain qu’on ne peut décharger un
vaiffeau du moindre poids , fans changer fon centre
de gravite, & que changer le centre de gravité,. eft
apporter un changement univerfel au balancement
du vaiffeau dans le fluide. Quel effet nouveau cela
apportera-t-il au tirant d’eau ? De quelle quantité
le centre de gravité s’élévera-t-il ou s’abâiffera-t-il ?
Le gouvernail confervera-t-;il un effet aufli facile ?
Le vaiffeau, en acquérant la facilité de plier ou de
s’incliner davantage, pourra-t-il bien porter autant
de voile ? L’angle d’inclinaifon , & le changement
des lignes d’eau, ne diminueront-ils point fa marche
? Le vaiffeau ne roulera-t-il point davantage?
Ses mouvemens ne deviendront-ils point trop vifs?
| | H | Toutes ces queftions ont cependant befoin
d’être réfolues & déterminées avec foin avant qu’il
foit permis d’affurer que l’on fait bien en allégeant le
vaiffeau. On n’en peut pas même faire un problème,
général, parce que cet effet change non feulement
pour chaque vaiffeau , mais pour le même vaiffeau ,
fuivant la qualité & la diftribution de fa charge. Il
eft vrai que fi le hafard a fait l’arrimage , on efpere
que le hafard fera rencontrer jufie dans l’à-peu-près
que fourniffent l’ufage & la pratique ; cependant
quand il s’agit de la fûrèté d’un vaiffeau, fouvent
chargé d’une million importante pour tout l’état,
comment fe repofer & dormir tranquille dans l’ef-
pérance dé trouver une exaftitude affez grande dans
le tâtonnement? C’eft dans ce cas fur-tout où l’on
fent l’importance d’avoir arrimé fon vaiffeau avec
difcernement, & de bien connoître la difpofition
& la diftribution des poids. ( M. U Chevalier D E
L A C o U D R A Y E . )
} § Allégorie, f. f. (Arts de la parole & du dejjin.)
c’eft un ligne naturel, ou une image, qu’on fubf-
titue a la chofe défignée.. Souvent dans le difcours,
& dans les arts du deflin , on préfente certains objets,
pour en exprimer d’autres par le rapport qu’ils
ont avec ceux-là. L’exprefîion proverbiale, fe tenir
au gros de l'arbre, nous préfente un objet matériel
pris de la nature, pour nous faire deviner une
chofe qui n’a rien de matériel, c’eft de demeurer
attaché au pouvoir légitime. Lorfque l’on met à la
fuite l’un de l’autre l’image, & la chofe défignée ,
c’eft une comparaison ou uneJimilitude ; mais quand
on fupprime la chofe défignée, & qu’on fe contente
de la laiffer deviner, c’eft une allégorie.
Divers motifs peuvent donner lieu à cette fubf-
titution de l’image à la place de la chofe défignée.
Quelquefois la nècejjité y contraint, lorfqu’il n’eft
pas poffible de repréfenter la chofe elle - même.
Les arts du deflin fe trouvent dans ce cas toutes
les fois qu’ils ont à repréfenter des idées abftraites
qui ne tombent pas fous le fens de la vue : quelquefois
la circonfpectioh l’exige, quand on n’ofe pas
préfenter nuement la ch ofe, & qu’on préféré dé
la laiffer deviner. C’eft ainfi qu’Horace, voulant
diffuader les Romains de s’embarquer de nouveau
dans une guerre civile, ne s’adreffe, par prudence ,
qu’à un navire auquel il dépeint le danger du nau-
frage (Hor. liv. I. od. 14.). Enfin fouvent on emploie
l’image au lieu de la chofe même, en vue de Y énergie *
pour donner à la chofe repréfentée plus de clarté ,
plus de force , & en un mot, un tour plus beau &
plus gracieux. Quand Haller compare notre vie fur
cette terre à l’état de la chenille, & notre durée
à une goutte d’eau dans l’Océan ; il exprime en deux
vers par ces images allégoriques, la véritable def-
tination & la brièveté de cette vie , d’une maniéré
beaucoup plus concife , plus énergique , & plus