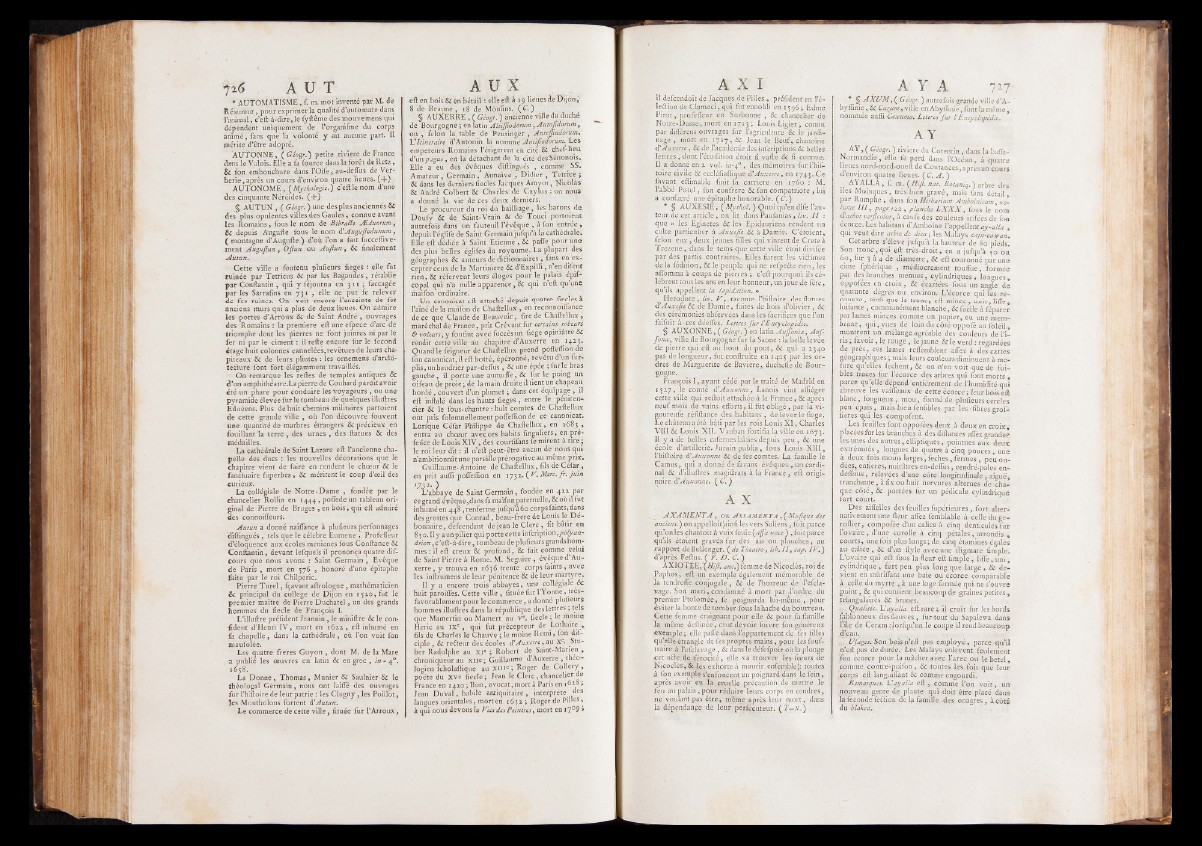
72.6 . A U T
* AUTOMATISME, f. m. mot inventé par M. de
Réaumur, pour exprimer la qualité d’automate dans
l’animal, c’eft-à-dire,le fyftême desmouvemens qui
dépendent uniquement de l’organifme du corps
animé, fans que la volonté y ait aucune part. Il
mérite d’être adopté.
AUTONNE, ( Géogr.) petite riviere^de France
dans le Valois. Elle a fa fource dans la forêt de Retz,
& fon embouchure dans l’Oife, au-deflus de Ver-
berie, après un cours d’environ quatre lieues. (+ )
AUTONOME, ( Mythologie.) c’eftlenom d’une
des cinquante Néréides. (+ )
§ AUTUN , ( Géogr. ) une des plus anciennes &
des plus opulentes villes des Gaules, connue avant
les Romains, fous le nom de Bibracle Æduorum,
& depuis Augufte fous le nom d'Auguflodunum,
( montagne d’Augufte ) d’où l’on a fait lucceffiveinent
Augujlun, OJiun ou Auftun, 8c finalement
Autun.
Cette ville a fouteftu plufieurs fieges : elle fut
ruinée par Tetricus & par les Bagaudes, rétablie
par Conftantin , qui y féjourna en 311 ; faccagée
par les Sarrafins en 731 , elle ne put fe relever
de fes ruines. On voit encore l’enceinte de fes
anciens murs qui a plus de deux lieues. On admire
les portes d’Arroûx & de Saint André , ouvrages
des Romains : la première eft une efpece d’arc de
triomphe dont les pierres ne font jointes ni par le
fer ni par le ciment : il refte encore fur le fécond
étage huit colonnes cannelées, revêtues de leurs chapiteaux
& de leurs plintes : les ornemens d’archi-
tefture font fort élégamment travaillés.
On remarque les reftes de temples antiques &
d ’un amphithéarre.La pierre de Couhard paroît avoir
été un phare pour conduire les voyageurs , ou une
pyramide élevée fur le tombeau de quelques illuftres
Eduéens. Plus de huit chemins militaires partoient
de cette grande Ville , où l’on découvre fouvent
une quantité de marbres étrangers & précieux^ en
fouillant la terre, des urnes , des ftatues & des
médailles.
La cathédrale de Saint Lazare eft l’ancienne chapelle
des ducs : les nouvelles décorations que le
chapitre vient de faire en rendent le choeur & le
fanfluaire fuperbes , & méritent le coup d’oeil des
curieux.
La collégiale de Notre-Dame , fondée par le
chancelier Rollin en 1444, poffede un tableau original
de Pierre de Bruges , en bois, qui eft admiré
«les connoiffeurs.
Autun a donné naiffance à plufieurs perfonnages
diftingués , tels que le célébré Eumene , Profeffeur
d’éloquence aux écoles menienes fous Confiance &
Conftantin, devant lefquels il prononça quatre discours
que nous avons : Saint Germain , Evêque
de Paris , mort en 576 , honoré d’une épitaphe
faite par le-roi Chilperic.
Pierre T u re l, fçavant aftrologue, mathématicien
& principal du college de Dijon en 1520, fut le
premier maître de Pierre Duchatel, un des grands
hommes du fiecle de François I.
L’illuftre préfident Jeannin, le miniftre & le confident
d’Henri IV , mort en 1622 , eft inhumé en
fa chapelle, dans la cathédrale, où l’on voit fon
maufolée.
Les auatre freres Guyon , dont M. de la Mare J a publie les oeuvres en latin & en grec , i/2-40.
1658.
La Donne, Thomas, Munier & Saulnier & le
théologal Germain, nous ont laiffé des ouvrages
fur l’hiftoire de leur patrie : les Clugny, les Poillot,
les Montholons fortent d'Autun.
Le commerce de cette ville, fituée fur l’Arroux,
AUX
eft en bois & en bétail i elle eft à 19 liéues de Dijon ^
8 de Beaune , 18 de Moulins. ( G ) ..
§ AUXERRE ; ( Géogf-. ) ancienne ville du duché
de Bourgogne ; en latin AItiJJiddôrum, Autofdoriiih ,
où , félon la table de Peutingér , Annjjiodçnim.
Uîcinefaire d’Antonin la nomme Aniijiodbfùm. Les
empereurs Romains l’érigerent en cité 8t chef-lieu
d’un pagus, en la détachant de la cité desSénonois.
Elle a eu dés évêques diftingués', comme SS.
Amateur, Gèrmain , Aunaive , Didier , Tetrice ;
& dans les derniers fieclès Jacqués Amyot, Nic'olàs
& André Colbert 8c Charles de Caylus.; on nous
a donné la vie de ces deux derniers.
Le procureur du roi du bailliage, les barons de
Doufy & de Saint-Vrain & de Touci portôient»
autrefois dans un fauteuil l’évêque , à fon entree ,
depuis l’églife de Saint Germain jufqu’à la cathédrale.
Elle eft dédiée à Saint Etienne , & paffe pour une
• des plus belles églifes du royaume. La plupart des
géographes 8c auteurs de dictionnaires , fans en excepter
ceux de la Martiniere & d’Expilli, n’ en dilent
rien, 8c .réfervent leurs éloges pbur le palais epif-
copal qui n’a nulle apparence, 8c qui n’eft qu une
ihaifon ordinaire. _ -
Un canonicat eft attaché depuis quatre fiecles à
l’aîné de la maifon de Chaftellux , en reconnoiflance
de ce que Claude de Beauvoir, lire de Chaftellux ,
maréchal de France, prit Crévant fur certains robeurs
& voleurs-, y foutint avec fuccèsun fiege opiniâtre 8c
rendit cette ville au chapitre d’Auxerre en 14I3.
Quand le feigneur de Chaftellux prend pofleflion de
fon canonicat,il eft botté, épéronrté, revêtu d un fur-
plis, un baudrier par-deffus , &utte épée ; furie bras
gauche, il porte une aumuffe, 8c fur le poing un
oifeau de proie; de lamain droite il tient un chapeau
bordé, couvert d’un plumet ; dans cet équipage , il
eft inftalé dans les hauts fieges , entre le pénitencier
& le fous-chantre : huit comtes de Chaftellux
ont pris folemnellement pofleflion de ce canonicat.
Lorfque Céfar Philippe de Chaftellux , en 1683 ,
entra au choeur avec ces habits finguliers, e,n pre-
fence de Louis X IV , de$ courtifans fe mirent à rire ;
le roi leur dit : il n’eft peut-être aucun de^nous qui
n’ambitionnât une pareille prérogative au meme prix.
Guillaume-Antoine de Chaftellux, fils de Cefar,
en prit aufli pofleflion én 173 2. ( ^. Merc. fr. juin
1732- ) I ,
L’abbaye de Saint Germain, fondée en 422 par
ce grand evêque,,dans fa maifon paternelle, & où il fut
inhumé en 448, renferme jufqu’àôo corps faints,dans
des grottes que Conrad, beau-frere de Louis le Débonnaire,
defcendant 'de jean le Clerc , fit bâtir en
850. I ly aunpilierqui porte cette infer i ption, pàlyan-
drion, c ’eft-à-dire, tombeau de plufieurs grands hommes
: il eft creux 8c profond, & fait comme celui
de Saint Pierre à Rome. M. Seguier , évêque d Auxerre,
y trouva en 1636. trente corps faints , avec
les inftrumens de leur pénitence 8c de leur martyre.
Il y a encore trois abbayes, une collégiale &
■ huit paroiffes. Cette ville , fituée fur l’Yonne, tres-
favorablement pour le commerce, a donné plufieurs
hommes illuftres dans la république des lettres ; tels
que Mamertin ou Mamert au Ve. fiecle ; le moine
Heric au ix e , qui fut précepteur de Lothaire *
fils de Charles le Chauve ; le moine Remi, fon dif-
ciple , & refleur des écoles Auxerre, au Xe. Stu-
ber Radulphe au XIe ; Robert de Saint-Marien ,
chroniqueur au x iie ; Guillaume d’Auxerre , theo-
l'ogien fcholaftique au xm e ; Roger de Collery,
poète du xv e fiecle ; Jean le Clerc, chancelier de
France en 1420; Bon, avocat \ mort à Paris en 1628;
Jean Duval, habile anîiquitaire , interprète des
langues orientales, mort en 1632 ; Roger de PiUeS > à qui nous devons la Fies des Peintres, mort en I7°9 *
A X I
il defeendoit de Jacques dé Pilles , préfident en l’é-
leflion de Clameci, qui fut ennobli en 1596 ; Edme
Pirot, profeffeur en Sorbonne , & chancelier de.
Notre-Dame, mort en 1713 ; Louis Ligier ; connu
par différens ouvrages fur l’agriculture & le jardinage
, mort-en 17 17 , & Jean le Beuf, chanoine
d’Auxerre , 8c de l’académie des iafcriptions.& belles
lettres, dont l’érudition étoit fi vafte 8c fi connue.
Il a donné en 2 vol. in-40', des mémoires fur l’hi'Ç*
toire civile & eccléfiaftique àl Auxerre-, en Ï743. Ce
favant eftimable finit fa carrière en ' 1760 : M .
l’abbé Potel, fon confrère & fon compatriote , lui
a confacré une épitaphe honorable. (£?.)
* § AUXESIE, ( Mythol.') Quoi qu’en dife l’auteur
de cet article, on lit dans Paufànias, Liv. I l :
que « les Eginetes & les Epidauriens rendent un
culte particulier à Auxejie & à Damie. C ’étoient,
félon eux, deux jeunes filles qui vinrent de Crete à
Trezene , dans le tems que cette ville étoit divifée
par des partis contraires. Elles furent les viftimes
de la fedition, & le peuple qui ne refpefle rien, les
affomma à coups, de pierres ; c’eft pourquoi ils célèbrent
tous les ans en leur honneur, un jour de fête,
qu’ils appellent la lapidation. »
Hérodote , liv. F , raconte l’hiftoire des ftatues
d’Auxejie & de Damie, faites de bois d’olivier , &
des cérémonies obfervées dans les facrifices que l’on
faifoit à-ces déeffes. Lettres fur l'Encyclopédie.
§ AUXONNE, ( Géogr. ) en latin Aujfonia, Auf-
Jona, ville de Bourgogne fur la Saône : la belle levée
de pierre qui eft au bout du pont, & qui a 2340
pas de longueur, fut conftruite en 1405 par les ordres
de Marguerite de Bavière, duchefle de Bour-
gogne.,- 7
François I , ayant cédé par le traité de Madrid en
1527, le comté # Aux on ne, Lanois vint aflïéger
cette ville qui reftoit attachée à la France, & après
neuf mois de vains, efforts, il fut obligé., par la vi-
goureufe réfiftance des habitans , de lever le fiege.
Le château a été bâti par les rois Louis X I , Charles
VIII & Louis XII. Vauban fortifia la ville en 1673.
Il y a de belles cafernes bâties depuis peu , & une
école d’artillerie. Jurain publia, fous Louis XIII,
l’hiftoire à'Auxonne & de fes comtes. La famille le
Camus, qui a donné de favans évêques;, un cardinal
& d’iuuftres magiftrats à la France, eft originaire
-d'Auxonne. ( C. )
A X
A X AM EN T A , ou A s samEn t a , ( Mujique des
anciens.) on appelloit.jainfi les vers Saliens, foit parce
qu’on les c-hantoit à voix feule (affa voce ) , foit parce
qu’ils étoient gravés fur des ais ou planches, au
rapport deBullenger. ( de Theatro, lib. I l , cap, IF.')
d’après Feftus. ( F . D. C. )
AXIOTÉE,*ffif//Z. anc.) femme de Nicoclès, roi de
Paphos, eft -un exemple également mémorable de
la tendreffe conjugale, & de l’horreur, de -l’efcla-
vage. Son mari, condamné à mort par,.l’ordre du
premier Ptolomée, fe poignarda lui-même , pour
éviter la honte de tomber fous la hache du bourreau.
Cette femme craignant pour elle & pour fa famille
la même deftinée, crut devoir fuivre fon-généreux
exemple ; elle paflé dans l’appartement de fes filles
qu’elle étrangle de fes propres mains, pour les fouf-
traire à l’efclavage , & dans le défefpoir où la-plonge
cet afte de férocité, elle va trouver les- ioeurs de
Nicoclès,& les exhorreà mourir enfemblej: toutes
à fon exemple s’enfoncent un poignard dans le fein,
après avoir eu la cruelle précaution de mettre le
feu au palais, pour réduire leurs corps en cendres,
ne voulant pas être, même après leur mort, dans
la dépendance de leur perfécuteur. ( T —n .)
A Y A 727
* § A X UM , ( Géogr. ) autrefois grande ville d’A-
byflînie, & Cuçiim,ville en Abyflinie, font la même,
nommee auflz Caxittno. Lettres fur LEncyclopédie.
A Y
A Y , ( Géogr. ) riviere du Cotentin , dans la baffe-
Normandie , elle fe perd dans l’Océan, à quatre
lieues, nord-nord-oueft de Coutances, après un cours
d’environ quatre lieues. (C. A . )
A AYALLA', f. m. ( Ri fl. nat. Botaniq.) arbre des
îles Moluques, très-bien gravé, mais fans détail,,
par Rumphe , dans fon HerbariuiF Amboinicum, volume
I I I , page 112., planche L X X X , fous le nom
aarbor verjicQlor-, à caufe des couleurs irifées de fon
écorce. Les habitans d’Amboine l’appellent ay-alla ,
qui veut dire arbre de dieu ; les Malays caju-cawan.
Cet arbre s’élève jufqu’à la hauteur de 80 pieds.
Son tronc, qui eft très-droit,'en a jufqu’à 50 ou
60, fur 3 à 4 de diamètre, & eft couronné par une
cime fphérique , médiocrement touffue, formée
par.des branches menues, cylindriques, longues,
oppofees en croix , & écartées fous un angle de
quarante degres ou environ. L’écorce qui les.recouvre,
ainfi que le tronc,'eft mince, unie,lifte,
luifante , communément blanche, & facile à féparer
par lames îninces comme un papier , ou une membrane,
qui, vues de loin du côté oppoîe au foleil,
montrent un mélange agréable des couleurs de l’iris
; favoir, le rouge, le jaune & le verd : regardées
de près, ces lames reflemblent ■ affez à des cartes
géographiques ; mais leurs couleurs diminuent à me*
fure qu’elles fechent, & on n’en voit que de foi-
bles traces fur l’écorce des arbres qui font morts ,
parce qu’elle dépend entièrement de l ’humidité qui
abreuve les vaiffeaux de cette ecorce ; leur bois eft
blanc, fongueux , mou, formé de plufieurs cercles
peu épais , mais bien f^nfibles par les -fibres grof-
fieres qui les coçnpofent.
Les feuilles font oppofées deux à deux en croix ;
placées furies branches, à des diftances affez grande?,
les unes des autres, elliptiques, pointues aux deux
extrémités , longues de quatre à cinq pouces, une
à deux fois moins larges, fech.es, fermes , peu ondées,
entières, noirâtres en-deffus, cendré-pales en-
deffous, relevée? d’une côte longitudinale, aime
tranchante, à fix ou huit nervures alternes de chaque.
côté, & portées fur un pédicule cylindrique
fort court.
Des aiffelles des feuilles fupérieures, fort alternativement
une fleur affez femblable à celle du.ge-
roflier, compofée d’un calice à cinq denticules fur
l’ovaire, d’une corolle à cinq pétales, arrondis *
courts , une fois plus longs ; de cinq étamines égales
au calice., & d’un ftyle avec.une ftigmate fimple.
L’ovaire qui eft fous la fleur eft fimple , liffe, uni,
cylindrique , fort peu plus long que large, & devient
en mûriffant une baie ou écorce comparable
à celle du myrte , à une loge fermée qui ne s’ouvre
point, & qui contient beaucoup de graines petites ,
triangulaires &; brunes.
j; Qualités. L'ayalla eft. rare;-.il croît fur les bords
fablonneux des fleuves , fur-tout fiu Sapalewa dans
laie de Ceram riorfqu’on le coupe il rend beaucoup
d’eau.
Ufages, Son bois n’eft pas employé, parce qu’il
n’eft pas de durée. Les Malays enlevent feulement
fon écorce pour ia mâcher avec l’arec ou leb etel,
comme contre-.poifon, & toutes .les,-fois que leur
;corps eft languiffant & comrqe engourdi.
y ’ Remarques. Lïayqlla -eft, comme l’on voit, un
nouveau genre de plante qui-doit être placé dans
la fécondéfieftion de la famille -des onagres, à côté
du blaked.