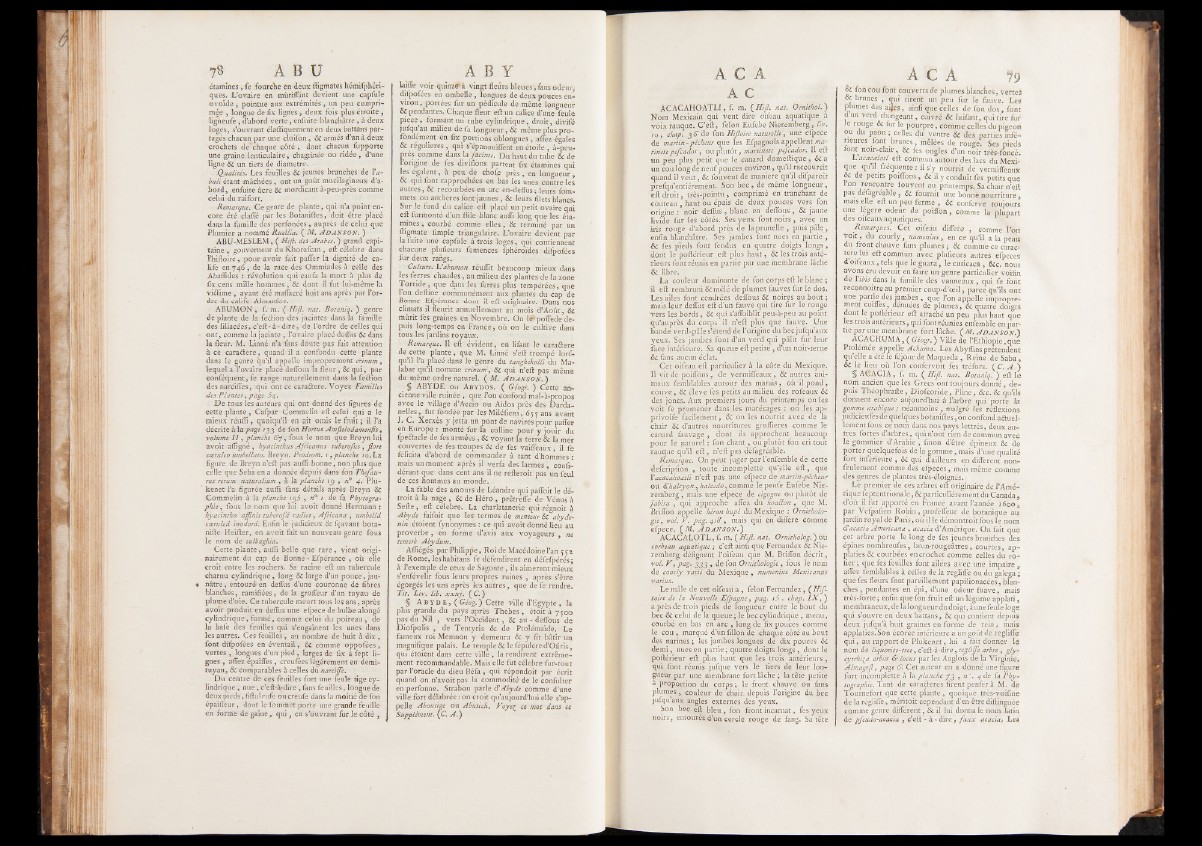
78 A B U
étamines, fe fourche èn deux ftigmates hémifphéri-
ques. L’ovaire en mûriflant devient une capfule
ovoïde , pointue aux extrémités, un peu comprimée
, longue de fix lignes, deux fois plus étroite,
Kgneufe, d’abord verte, enfuite blanchâtre, à deux
loges, s’ouvrant élaftiquement en deux battans partagés
chacun par une cloifon, & armés d’un à deux
crochets de chaque côté , dont chacun fupporte
une graine .lenticulaire, chagrinée ou ridée, d’une
ligne & un tiers de diamètre.
Qualités. Les feuilles & jeunes branches de Va-
■ bulc étant mâchées , ont un goût mucilagineux d’abord
, enfuite âcre & mordicant à-peu-près comme
celui du raifort.
Remarque. Ce genre de plante, qui n’a point encore
été claffé par les Botaniftes, doit être placé
dans la famille des perfonées, auprès de celui que
Plumier a nommé Ruettia. ( M. A d a n s o n . )
ABU-MESLEM, ( Hiß. des Arabes. ) grand capitaine
, gouverneur du Khorafcan, eft célébré dans
l’hiftoire, pour avoir fait paffer là dignité de calife
en 74 6 , de la race des Ommiades à celle des
Abaflides •: révolution qui caufa la mort à plus de
fix cens mille hommes , & dont il fut lui-même la
viérime, ayant été maffacré huit ans après par Tordre
du calife Almanfor.
ABUMON, f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) genre
de plante de la feétion des- jacintes dans la famille
des liliacées, c’eff-à -d ire, dë.l’ordre de celles qui
• ont, comme la jacinte , l’ovaire placé deffus & dans
la fleur. M. Linné n’a 'fans doute pas fait attention
à cé caraâere, quand il a confondu cette plante
dans le genre qu’il appelle improprement crinum,
lequel a l’ovaire placé deffous la fleur, & qui, par
conféquent, fe range naturellement dans la fe&ion
desnarc'iffes, qui ont ce caraftere. V oyez Familles
des Plantes, page 5q.
D e tous les auteurs qui ont donné des figures de
cette plante, Cafpar Commelin eff celui qui a le
mieux réuffi, quoiqu’il en ait omis le fruit ; il l’a
décrite à la page *33 de fon Hortus Amßelodamenß's,
volume I I , planche 67 , fous le nom que Breynlui
avoit affigné-, hydcintküs Africanus tuberofus, flore
coeruleo iunbellato. Breyn. Prodrom. / , planche '10. La
figure de Breyn n’eff pas aufii bonne, non plus que
celle que Seba en a donnée depuis dans fon Thefauras
rerum naturalium , à la planche ic/ , n° 4. Plu-
' kenetTa figurée aufii fans détails après Breyn &
Commelin à la planche igS , n°-1 de fa Phytogra-
phie, fous le nom que lui avoit donné Hermann :
hyacintho ajßnis tuberofa radice, Africana , umbellâ
coeruleâ inodorâ. Enfin le judicieux & fçavant bota-
nifte Heifter, en avoit fait un nouveau genre fous
le nom de tulbaghia.
Cette plante, aiiflî belle que rare, vient originairement
du cap de Bonne - Efpérance , oh elle
croît entre les rochers. Sa racine eft un tubercule
charnu cylindrique, long & large d’un pouce, jau-
• nâtre, èntouré en deffus d’une couronne de fibres
blanches, ramifiées, de la groffeur d’un tuyau de
plume d’oie. Ce tubercule meurt tous les ans, après
avoir produit en deffus une efpece de bulbe alongé
cylindrique, formé, Comme celui du poireau, de
la bafe des feuilles qui s’engaînent les unes dans
les autres. Ces feuilles, atï nombre de huit à dix ,
font difpofées en éventail, & comme oppofées,
vertes » longues d’un pied, larges de fix à fept lignes
, affez épaiffes, creufées légèrement en demi-
tuyau, & comparables à celles du narciße.
Du centre de ces feuilles fort une feule tige cylindrique
, nue, C’eft-à:diré-, fans feuilles ,- longue de
deux pieds, fiftufoufe ou creufe dans la moitié de fon
épaiffeur, dont le fommet porte une grande feuille
en forme de gaîne, q u i, en s’ouvrant fur le côté ,
A B Y
kpjfo voir quinze- à vingt fleurs bleues', fans odeur,
difpofées en ombelle, longues de deux pouces environ,
portées fur un pédicule de même longueur
& pendantes. Chaque fleur eft un calice d’une feule
piece, formant un tube cylindrique, droit, divifé
jufqu’au milieu de fa longueur, & même pl us profondément
en fix portions oblongues , affez égales
& régulières, qui s’épanouiffent en étoile , à-peu-
près comme dans lafacinte. Du haut du tube & d e
1 origine de fes divifions partent fix étamines qui
les égalent, à peu de chofe près, en longueur,
& qui font rapprochées en bas les unes contre les
autres, & recourbées en arc en-deffus; leurs fom-
mets ou anthères font jaunes , & fours filets blancs.
Sur le fond dit calice eft placé un petit ovaire qui
eft furmonté d’un ftile blanc aufii long que les étanches
, courbé comme elles , & terminé par un
fiigmate fimple triangulaire. L’ovaire devient par
la fuite une capfule à trois loges, qui contiennent
chacune plufieurs femences fphéroïdes difpofées
fur deux rangs.
Culture. Vabumon réuflït beaucoup mieux dans
les ferres chaudes, au milieu des plantes de la zone
Torride, que dans les ferres plus tempérées, que
l’on deftine^ communément aux plantes du cap de
Bonne - Efperance dont il eft originaire. Dans nos
climats il fleurit annuellement au mois d’Août, &
mûrit fes graines en Novembre. On l#poffede depuis
long-temps en France ? où on le cultive dans
tous les jardins royaux.
Remarque. Il eft évident, en lifant le caraâere
de cette plante, que M. Linné s’eft trompé lorf-
qu’il l’a placé dans îe genre du tanghskolli du Malabar
qu’il nomme crinum, & qui ■ n’eft pas même
du même ordre naturel. ( M . A d a n s o n . )
§ ABYDE ou Abydos, ( Géogr. ) Cette ancienne
ville ruinée , que Ton confond mal-à-propos
avec le village d’Accio ou Aidos près des Dardanelles
, fut fondée par les Miléfiens, 655 ans avant
J. C. Xerxès y jetta un pont de navires pour paffer
eh Europe : monté fur la colline pour y jouir du
fpe&acle de fes armées-, & voyant la terre & la mer
couvertes- de fes troupes & de fes vaiffeaux, il fe
félicita d’abord de commander à tant d’hommes :
mais un moment après il verfa des larmes , confi-
dérant que dans cent ans il ne refteroit pas un feul
de ces hommes au monde.
La fable des amours de Léandre qui paffoit le détroit
à la nage , & de Héro , prêtre ffe de Vénus à
Sefte, eft célébré. La charlatanerie qui régnoit à
Abyde faifoit que les termes de menteur & abyde-
niri étoient fynonymes : ce qui avoit donné lieu au
proverbe, en forme d’avis aux voyageurs-, ne
temerê Abydum.
Afliégés par Philippe, Roi de Macédoine Tan 5:52
de Rome, leshabitans fe défendirent en défefpérés;
à l’exemple de ceux de Sagonte, ils aimèrent mieux
s’enfévelir fous leurs propres ruines , après s’être
égorgés les uns après les autres, que de fe rendre.
Tu. Liv. lib. x x x j. ( C. )
§ A b y d e , ( Gèog.) Cette ville d’Egypte , la
plus grande du pays après Thebes , étoit à 7500
pas du Nil , vers l’Occident, & au - deffous de
Diofpolis , de Tentyris & ae Ptolémaïde. Le
fameux roi Memnon y demeura & y fit bâtir un
magnifique palais. Le temple & le fépulcre d’Ofiris ,
qui étoient dans cette ville , la rendirent extrêmement
recommandable. Mais elle fut célébré fur-tout
par l’oracle du dieu Béfa , qui répondoit par écrit
quand on n’avoit pas là commodité de le confulter
en perfonne. Strabon parle d'Abyde comme d’une
ville fort délabrée : on croit qu’aujourd’hui elle s’appelle
Aboutige ou Abutich. Voye£ ce mot dans ce
Supplément, {C, A.')
A C A
A C
À CA C AHO A T LI, f. m. (Hiß . nat. Ornithol. )
Nom Mexicain qui veut dire oifeau aquatique à
voix rauque. C’eftj félon Eufebe Nieremberg, liv.
to i chapi de fon Hifioire naturelle, une efpece
de martin - pêcheur que les Efpagnols appellent ma-
rinete pefcador * ou p lutôt, martinete pefcador. Il eft
un peu plus petit que le canard domeftique, & a
un cou long de neiif pouces environ, qu’il raccourcit
quand il veu t, & fouvent de maniéré qu’il difparoît
prefqu’entiérement. Son b e c , de même longueur,
eft droit, très-pointu, comprimé en tranchant de
couteau , haut ou épais dé deux pouces vers fon
origine : noir deffus , blanc en deffous , & jaune
livide fur les côtési Ses yeux font noirs, avec un
iris rouge d’abord près de la prunelle , puis pâle ,
enfin blanchâtre. Ses jambes font nues en partie 3
& fes pieds font fendus en quatre doigts longs,
dont le poftérieur eft plus haut j & les trois antérieurs
font réunis en partie par une membrane lâche
& libre.
La couleur dominante de fon Corps eft le blanc 5
il eft rembruni &mêlé de plumes fauves fur le dos.
Les ailes font cendrées deffous & noires au bout ;
mais leur deffus eft d’un fauve qui tire fur le rouge
vers les bords, & qui s’affoiblit peu-à-peü au point
qu’auprès dit corps il n’eft plus que fauve. Une
bande verd-pâle s’étend de l’origine du bec jufqu’aux
yeux. Ses jambes font d’un verd qui pâlit fur leur
face intérieure. Sa queue eft petite, d’un noir-terne
& fans aucun éclat.
Cet oifeau eft particulier à la côte du Mexique*
Il vit de poiffons,- de vermiffeaux, & autres animaux
femblables autour des marais, où il pond,
couve , & éleve fes. petits au milieu des rofeaux &
des jonès. Aux premiers jours du printemps on les
Voit fe promener dans les marécages : on les ap-
privoife facilement, & on les nourrit avec de la
chair & d’autres nourritures groflieres comme le
canard fauvage , dont ils approchent beaucoup
pour le naturel : fon chant , ou plutôt fon cri tout
rauque qu’il e f t , n’eft pas défagréàble*
Remarque. On peut juger par l’enfemble de cette
defcription , toute ineomplette qu’,elle e f t , que
l’acacahoatli n’eft pas une efpece d<f martin-pêcheur
ou àlhalcyon, halcedo^ comme le penfe Eufebe Nieremberg
, mais une efpece de cigogne ou plutôt de
jabiru , qui approche affez du hoacton , que M.
Briffon appelle héron hupé du Mexique : Ornithologie,
vol V. pag. 4 18 , mais qui èn différé comme
efpece. ( M. A d a n s o n . )
A C A C A LO T L , f. m. ( Hiß. nat. Ornitholog. ) ôti
corbeau aquatique ; c’eft ainfi que Fernandez & Nieremberg
défignent l’oifeau que M. Briffon décrit,
v o l T , pag. 333 , de fon Ornithologie , fous le nom
dt courly varié du Mexique, numenius Mexicanas
varius.
Le mâle de cet oifeau a , félon Fernandez, (Hif-
toire de la Nouvelle Efpagne, pag. iS . chap. I X , )
a près de trois pieds de longueur entre le bout du
bec & celui de la queue; le bec cylindrique , menu,
courbé en bas en arc , long de fix pouces comme
le cou , marqué d’un fillon de chaque côté au bout
des narines ; les jambes longues de dix pouces &c
demi, nues en partie ; quatre doigts longs , dont le
poftérieur eft plus haut que les trois antérieurs,
qui font réunis jufque vers le tiers de leur longueur
par une membrane fort lâche ; la tête petite
à proportion du corps; le front chauve Ou fans
plumes, couleur de chair, depuis l’origine du bec
jufqu’aux angles externes des yeux.
Son bec eft b leu , fon front incarnat, fes yeux
noirs, entourés d’un cercle rouge de fang* Sa tête
À C À 99
& fon èoii font couverts de plumes blanches, vertes
& brunes , qui tirent un peu fur le fauve. Les
plumes des aijes, ainfi que celles de fon dos, font
d un verd changeant, cuivré & luifarit, qui tire fur
le rouge & fur le pourpre, comme celles du pigeon
ou du paon ; celles du ventre & des parties inférieures
font brunes, mêlées de rouge. Ses pieds
font noir-clair, & fes ongles d’un noir très-foncé.
L acacalotl' eft com.mun autour des lacs du Mexique
qu’il fréquente : il s’y nourrit de vermiffeaux
& de petits poiffons , & il y conduit fes petits qué
Ion rencontre fouvent au printemps. Sa chair n’eft
pas défagréable , & fournit une bonne nourriture 4
mais elle eft un peu ferme , &c conferve toujours
une legere odeur de poiffon, comme la plupart
des oifeaux aquatiques.
Remarques. Cet oifeau différé , comme l ’on
Voit j du courly, numenius, en ce qu’il a la peau
du front chauve fans plumes ; & comme ce caractère
lui eft commun avec plufieurs autres efpeces
d’oifeaux, tels que le guarà, le cuticaca , & c . nous
avons cru devoir en faire un genre particulier voifin
de Vibis dans la famille des vanneaux, qui fe font
reconnoitre au premier coup-d’oeil f parce qu’ils ont
une partie des jambes , que Ton appelle improprement
cuiffes, dénuées de plumes, & quatre doigts
dont le poftérieur eft attaché un peu plus haut que
les trois antérieurs, qui fontréunies enfemble en partie
par une membrane fort lâche. ( AL A d a n s o n .')
A C A C H U M A , ( Géogr. ) Ville de l’Ethiopie ,que
Ptolemée^ appelle Achuma. Les Abyffms prétendent
qu’elle a été le féjour de Maqueda, Reine de Saba *
& le lieu où Ton confervoit fes tréfors; (C . A )
S A C A C I A , f. m. ( Hiß, nat, Botaniq. ) eft le
nom ancien que les Grecs ont toujours donné, depuis
Théophrafte, Diofcoride, Pline, &c. & qu’ils
donnent encore aujourd’hui à l’àrbre qui porte la
gomme arabique ; néanmoins , malgré les réflexions
judicieufes de quelques botaniftes, On confond actuellement
fous ce nom dans nos pays lettrés, deux autres
fortçs d’arbres , qui n’ont rien de commun avec
le gommier d’Arabie , finon d’être épineux & de
porter quelquefois de la gomme, mais d’une qualité
fort inférieure , & qui d’ailleurs en different non-
feulement comme des efpeces, mais même comme
des genres de plantes très-éloignés.
Le premier de ces arbres eft originaire de l’Amérique
Septentrionale, & particuliérement du Canada ,
d’où il fut apporté en France avant Tannée 16001
par Vefpafien Robin, pröfefleur de botanique au
jardin royal de Paris, où il le démontroitfous ie nom
d'acacia Americana , acacia d’Amérique. Qn fait qué
cet arbre porte le long de fes jeunes branches des
épines nombreufes, brun-rougeâtres, courtes, ap-
platies & courbées en crochet comme celles du ro-
fier; que fes feuilles font ailées avec une impaire ô
affez femblables à celles de la regliffe ou du galega ;
que fes fleurs font pareillement papilionacées, blanches,
pendantes en épi, d’une odeur fùave, mais
très-forte ; enfin que fon fruit eft Un légume applati,
membraneux, de la longueur du doigt, à une feule loge
qui s’ouvre en deux battans, & qui contient depuis
deux jufqu’à huit graines en forme de rein, mais
applaties. Son écorce intérieure a un goût de regliffe
q ui, au rapport de Plukenet j lui a fait donner lé
nom de liquorice-tree, e’eft-à-dire, regliße arbre , gly-
cyrrhiça arbor & locus par les Aoglois de la Virginie.
Almageß, page 6) Cét auteur en a donné une figuré
fort ineomplette à la planche 73 , n ‘ . 4 de. fa Phy-
tographie. Tant de cara&eres firent penfer à M. de
Tôurnefort que cette plante, quoique très-voifine
de la regliffe, méritoit cependant d’en être diftinguée
comme genre différent, & il lui donna le nom .latin
de pfeudo-acacia 9 ç’eft - à - d ire, faux acacia* Lei