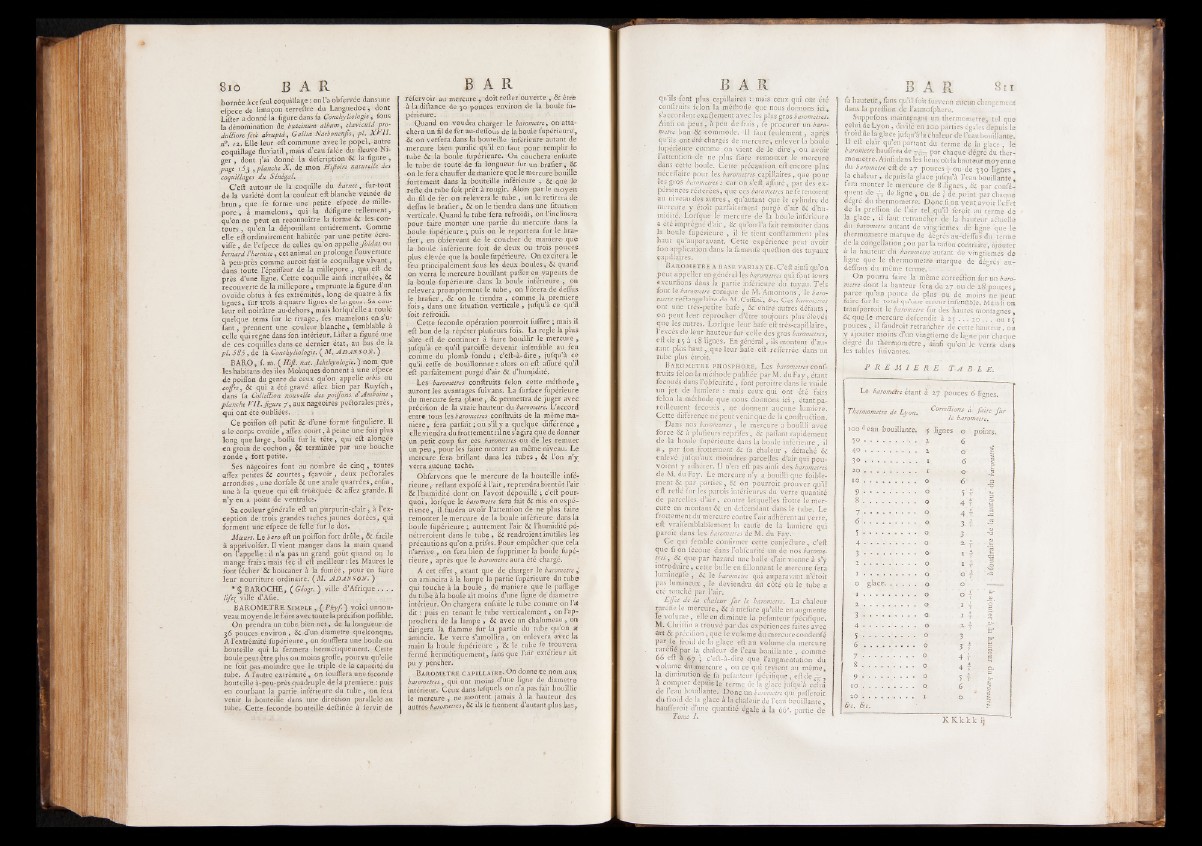
bornée àcefeul coquillage : on l’a obfervée dans une
efpece de limaçon terreftre du Languedoc, dont
Lifter a donné la figure dans fa Conchyliologie ^ fous
la dénomination àebuccinum album, claviculd production
ferè abrupto. , G alliez Narbonenfis, pl. X V II.
n°. 12. Elle leur eft commune avec le popel, autre
coquillage fluviatil, mais d’eau falée du fleuve Niger
, dont j’ai donné la defeription & la figure,
page 163 , planche X . de mon Hifloin naturelle, des
coquillages du Sénégal.
C’eft autour de la coquille du barnet, fur-tout
de la variété dont la couleur eft blanche veinée de
brun, que fe forme une petite efpecé < de mille-
pore , à mamelons., qui la défiguré tellement,
qu’on ne peut en reconnoitre la forme & les-contours,
qu’en la dépouillant entièrement. Gomme
elle eft ordinairement habitée par une petite écre-
yifle, de l’efpece de celles qu’on appelle foldat, ou
bernard fhermite, cet animal en prolonge l’ouverture
à peu-près comme auroit fait le coquillage vivant,
dans toute l’épaifteur de la millepore , qui eft de
près d’une ligne. Cette coquille ainfi incruftée, &
recouverte de la millepore., emprunte la figure d’un
ovoïde obtus .à fes extrémités, long de quatre à fix
lignes, fur trois à quatre lignes de largeur. Sa couleur
eft noirâtre au-dehors, mais lorfqu’elle a roulé
quelque tems fur le rivage, fes mamelons en s’u-
fant, prennent une couleur blanche, femblable à
celle qui régné dans fon intérieur. Lifter a figuré une
de ces coquilles dans ce.dernier état, au bas de la
pl, 686, de fa Conchyliologie. ( M. A d a n s o n . )
BARO, f. m. ( Hift. nat. Ichthyologie. ) nom que
les habitans des îles Moliiques donnent à une efpece
de ppiffoin du genre de ceux qu’on appelle orbis ou
coffre, & qui a été gravé allez bien par Ruyfch,
dans fa Collection nouvelle des poiffons. d’Amboine ,
planche VU. figure 7 , aux nageoires pe&orales près,
qui ont été oubliées. ■ . i
Ce poiflon eft petit & d’une forme fingüliere. Il
a le corps ovoïde , affez court, à peine une fois plus
long que large, boflii fur là tête, qui eft alongée
en groin de cochon , & terminée par une bouche
rondeg fort petite.
Ses nageoires font au nombre de cinq , toutes
affez petites & courtes, fçavoir, deux peâoràles
arrondies, une dorfale & une anale quarrées, enfin,
une à la queue qui eft tronquée & affez grande. Il
n’y en a point de ventrales.
Sa couleur générale eft un purpurin-clair à l’exception
de'trois grandes taches jaunes dorées, qui
forment une efpece dé fellé" für le dos.
Moeurs. Le baro eft un poiffon fort drôle, &. facile
à apprivoifer. Il vient manger dans la main quand
on l’appelle :il n’a pas un grand goût quand on le
mange frais ; mais fec il eft meilleur : les Maures le
font fécher & boucaner à la fumée, pour en faire
leur nourriture ordinaire. ( M . A d a n s o n . ' )
* § BAROCHE, ( Gèogr. ) ville d’Afrique . . . .
life{ ville cFAfie.
BAROMETRE S im p l e , ( Phyf. ) voici unnou-
veau moyen de le faire avectoute la précifion pofiïfcle.
On prendra un tube, bien net, de la longueur de
36 pouces environ, & .d ’un diamètre quelconque.
A l’extrémité fupérieure , on foufflera une boule ou
bouteille qui la fermera hermétiquement. Cette
boule peut être plus ou moins groffe, pourvu qu’elle
ne foit pas -moindre que le triple de la capacité du
tube. A l’autre extrémité, .on, loufflera une fécondé
bouteille à-peu-près quadruple de la première : puis
en courbant la partie, inférieure du tube , on fera
venir la . bouteille dans une direôion parallèle au
tube. Cette, fécondé bouteille deftinée à fervir de
réfefvoir au mercure , doit refter ouverte , & être
à la.diftance de 30 pouces environ de la boule fupérieure.
Quand on voudra charger le baromètre, on attachera
un fil defecaurdeffous de la boule fupérieure,
& on verfera dans -la bouteille, inférieure autant de
mercure bien purifié.qù’il en faut pour remplir le
tube & „ la boule fupérièure. On côuehéra enfuite
le tube de toute de fa longueur, fur un brafier, &C
on le; fera chauffer de maniere que le mercurë bouille
fortement dans la bouteille inférieure , & que le
refte du tube foit prêt à rougir. Alors par le moyen
du fil de fer on releVerade tube , on le retirera de
deffus le brafier, & oh le tiendra dans une fituation
verticale. Quand le tube fera refroidi, on l’inclinera
pour faire monter une partiè du mercure dans la
boule fupérieure ; puis oh le reportera fur le brafier
, en ôbfervant de le coucher de maniéré que
la boule inférieure foit de deux ou trois pouces,
-plus élevée que la boule fupérieure. On excitera le
feu principalement.fous les deux.boules, & quand
on verra le mercure bouillant paffer en vapeurs de
la bqule fupérieure dans1 la boule inférieure , on
relevera promptement le tube, on l’ô.tera de deffus
le brafier, & on le tiendra , comme la première
fois , dans une fituation verticale , jufqu’à ce qu’il
foit refroidi.
Cette fécondé opération pourroit fuffire ; mais il
eft bon de la répéter plufieurs fois. La réglé la plus
sûre .eft de continuer à faire bouillir le mercure ,
jufqu’à ce qu’il paroiffe devenir infenfible au.feu
comme du plomb fondu ; c’eft-à-dire, jufqu’à ce
qu’ilcefle de bouillonner: alors on eft affuré qu’il
eft parfaitement purgé d’air & d’humidité.
Les baromètres conftruits félon cette méthode,
auront les avantages fuivans. La furface fupérieure
du mercure fera plane,. & permettra de juger avec
précifion de la vraie hauteur du baromètre. L’accord
entre tous les baromètres conftruits de la même maniéré,’
fera parfait ; ou s’il y a quelque différence,
elle viendra du frottement : ilné s’agira que de donner
lin petit coup fur ces .baromètres ou de.les remuer
un peu, pour les faire monter au même niveau. Le
mercure fera brillant dans les tubes, & l’on n’y
verra aucune tache.
Obfervons que le mercure de la bouteille inférieure
,- reftant expofé à l’air, reprendra bientôt l’air
& l’humidité dont ,on l’avoit dépouillé ; c’eft pourquoi,
iorfque le baromètre fera fait & mis en expérience,
il faudra avoir l’attention de ne plus faire
remonter le mercure de la boule inférieure dans la
boule fupérieure ; autrement l’air & l’humidité pé-
nëtreroient dans le tube , & rendroient inutiles les
précautions qu’on a prifes. Pour empêcher que cela
n’arrive , on fera bien, de fitpprimer la boule fupérieure
, après que le baromètre aura été chargé.
A cet effet, avant que de charger le baromètre ,'
on amincira à la lampe la partie fupérieure du tube
qui touche à la boule, de maniéré que le paffage
du tube, à la boule ait moins d’une ligne de diamètre
intérieur. On chargera enfuite le tube comme on Pat
dit : puis en tenant le tube verticalement, on rapprochera
de la lampe > & avec un chalumeau, on
dirigera la flamme fur la partie du tube qu’on se
amincie. Le verre s’amollira, on enlèvera avec la
main la boule fupérièure , & le tube fe trouvera
fermé hermétiquement, fans que l’air extérieur ait
pu y pencher.
B a r o ,m e t r e c a p i l l a i r e - On donne ce nom aujç
barometr.es, qui ont moins d une ligne de diamètre
intérieur. Ceux dans lefquels on n’a pas fait bouillir
jg mercure , ne montent jamais à la hauteur des
autres-baromètres, &C ils fe tiennent d’autant plus bas,
qn’iîs’ font plus capillaires : mais ceux qui ont été
conftruits félon la méthode que nous donnons ici,
s’accordent exa$emènt avec les plus gros.baromètres.
Ainfi on peut, à peu de frais, fe procûrèV un baro-
metré bon & commode. Il faut feulement, après
qu’ils ont été chargés de mercure, enlever la boule
iuperieure comme ; on vient de le dire , ou avoir
l’attention de. ne plus faire remonter le mercure
dans cette, boule. Cette précaution eft encore plus
neceffaire pour les baromètres ^capillaires,, que pour
les gros bdrome,tres : car on s’eft affuré par des expériences
réitérées, que ces baromètres ne fetenoient
■ au niveau des âlitres , qu’autant que le cylindre dé
mercure y était parfaitement purgé ‘ d’air & d’humidité.
Lorfque le mercure de la boule‘inférieure
a été imprégné d'air, & qu’on l’a fait re'mbriter dans
la boule fupérièure , il fe tient conftamment plus
haut qu’auparavant. Cette expérience peut- avoir
fon application dans la fameufe queftion des tuyaux
■ capillaires. - • 'j-, . \ \
Baromètre à base v a r ian t e . C’eft ainfi qu’on
.peut appeller en général les baromètres qui font leurs
excurfions dans la partie inférieure du, tuyau. Tels
font le farametré conique de M. Amontons, le baromètre
reftangulaire de M. Cafiîni', &c. Ces baromètres
ont une très-petite bafe , & entre autres 'défauts ,
pn peut leur reprocher d’-être toujoCirs plus élevés
que les, autres. Lorfque leur bafe eft très-capillaire,
l’excès de leur hauteur fur celle des gros baromètres,
eft de .1,5 a 18 lignes. En général ,• ils montent d’au-
•tant plus haut, .que leur bafe. eft .refferrée. dans un
tube plus étroit.
BAROMETRE PHOSPHORE, Les baromètres conftruits
félon la méthode publiée parM. duFay, étant
fecoués dans l’obfeurité, font paroître dans'le vuide
un jet-de lumière : mais ceux qui ont été faits
félon la méthode que nous donnons i c i , étant pa-
•reillément fecoués , ne donnent aucune lumière.
Cette différence ne peut venir que de la çpnftrucïion.
Dans nos baromètres , le mercure a bouilli avec
force & à plufieurs réprifes, & paffant rapidement
de la boule fupérieur.e dans la boule inférieure , il
a , par fon frottement & fa chaleur , détaché &
enlevé jufqu’aux moindres parcelles d’air qui pou-
vôient y adhérer. Il n’en eft pas ainfi des baromètres
de M. du Fay. Le mercure n’y .a bouilli que foible-
ment & par parties, & on pourroit prouver qu’il
eft refté fur les parois intérieures du verre quantité
de parcelles d’a ir , contre leiq’uelles frotte le mercure
en- montant & en defeendant dans lè tube. Le
frottement dtrmercure contre l’air adhérent au yerre,
eft vrailèmblablement la caufe de la lumière qui
paroît, clans les-baromètres de M. du Fay. •
Ce qui femble confirmer cette conjeâure, c’eft
que fi on fècoue dans l’obfcurité un de nos baromètres
, & que par hazard une bulle d’air vienne à s’y
introduire, cette bulle enfillonnant le mercure fera
lumineuse , & le baromètre qui auparavant.n’.étoit
pas lumineux , le deviendra dti côté oit le .tube a
été touché par l’air.
Effet de la chaleur fur le baromètre. La chaleur
raréfié le mercure, & à m'éfure qu’êlle eu augmente
le volume, elle en diminue la pefanteur ipécifîque.
M. Chriftm a trouvé par des expériences faites avec
àrt & précifion , que le volume du mercure eondenfé
Par/l | froid de la glace eft au volume du mercurë
raréfié par la chaleur de l’ eau bouillante comme
66 eft à 67 ; c’eft-à-dire que l’augmentation du
volume du mercure , ou ce qui revient ,au même,
la diminution de fa pefanteur fpéçifique, eft de ?
à compter depuis le terme delà glace jufqu’à celui
de 1 eau bouillante. Donc un baromètre qui pafleroit
du froid de la glace à la chaleur de l'eau bouillante,
haufleroit d’une quantité égale à la 66e. partie de
Totpe 1.
fit hautetff, fans qu’il foit fur venu aucun changement
dans la preflïon de l ’atmofphere.
Suppofpns maintenant un thermomètre, tel que
celui.de Ly on , divifé en ,100 parties égales depuis le
froid de la glace jufqn’à la chaleur de l’eau bouillante.
Il eft clair qu’en partant du terme de la glace-, le
baromètre haufiera de par chaque dégré du thermomètre.
Ainfi dans les lieuxoiiia hauteur moyenne
du baromètre eft de 27 pouces ± ou de 3 30 lignes ,
la chaleur, depuis la glace jufqu’à l’eau bouillante ,
fera monter le mercure de 8 .lignes, & par confé-
quent de ^ de ligne, ou.de | de.p.oint par chaque
. degre ,du thermpmetre. D(onc.fi/m ye.ut, avoit; l’effet
de la preftion de l’air tel ..qu’il feroit au’ terme de
la glace , il faut retrancher de la "hauteur aâuelle
du baromètre autant de vingtièmes dé ligne que le
thermpmetre marque de degrés au-deffus du terme
de la cohgellation j ou par la raifon contraire, à jouter
à la hauteur du baromètre autant de vingtièmes de
ligne que le thermomètre marque de dégrés àu-
deffoiis du même terme, c . . . .
On pourra faire la même corredion fur un baromètre
dont la hauteur fera de 2,7.011 de.28:pouces,
parce .qu’un pouce de plus ou dq mpips. ne peut
faire fur ie .-total qu’irne erre'ur infenfible, Mais fi on
tranfpprtoit îe baromètre fur des hautes montagnes ,
& que le mercure defeendît à 25 îd'.C . -ou 15
pouces-, il faudroit retrancher dé cette haiitéur, ou
y ajouter moins d’un vingtième de ligne par chaque
degre du thermomètre, ainfi qu’on'le verra dans
les tables fui vantes..
P R E M I E R E T A B L E.
L e bàrometère étant à 27 pouces 6 lig n e s , v
Thermomètre de Lyon. Corrections à. faire fur
le baromètre.
100 d eau bouillante. 5 lignes 0 . ]points.
5° .............................. 2, 6
40 . . . . . . . . 2 0 g
30 . . . . | I 6
20 . . . . . . . . . I ■ • •©•
10 :. . . . . '. . . . O 6 ’ * ■ ' =
9 • ............... O '5 f ' ^
8 ............................... 0 4 f
7 .............................. O ' . 4 .f: ?
6 !.............................. O .... .3 - 1
ï • • ■ .................... Q -3 * 1 .
4 .............................. O 2- ■ • Srti J i y «ri
2 .1. .*•............ O T -f'
1 ................................... O 11H
1 . . . . . . . . . O ° î-
2 .............................. O ,1. T 0 ; •
3 ................................... <X I i S
4 . . . . . . . . O •2. f - rtL:
5 ................................... O 3 ï
6 \ -. BR . . . . . . 6 3 j c
7 .................................. 0 4 f ' ■ g
8 ...................... 0 4 f 0-
; II! • • • . .. • • • 0 5.7 i l
• 1 0 '« • ' . ■ . . . . , J 0 6 1
X • • 0. * . 1 .
Pc. &c. ' K
K K k k k ij