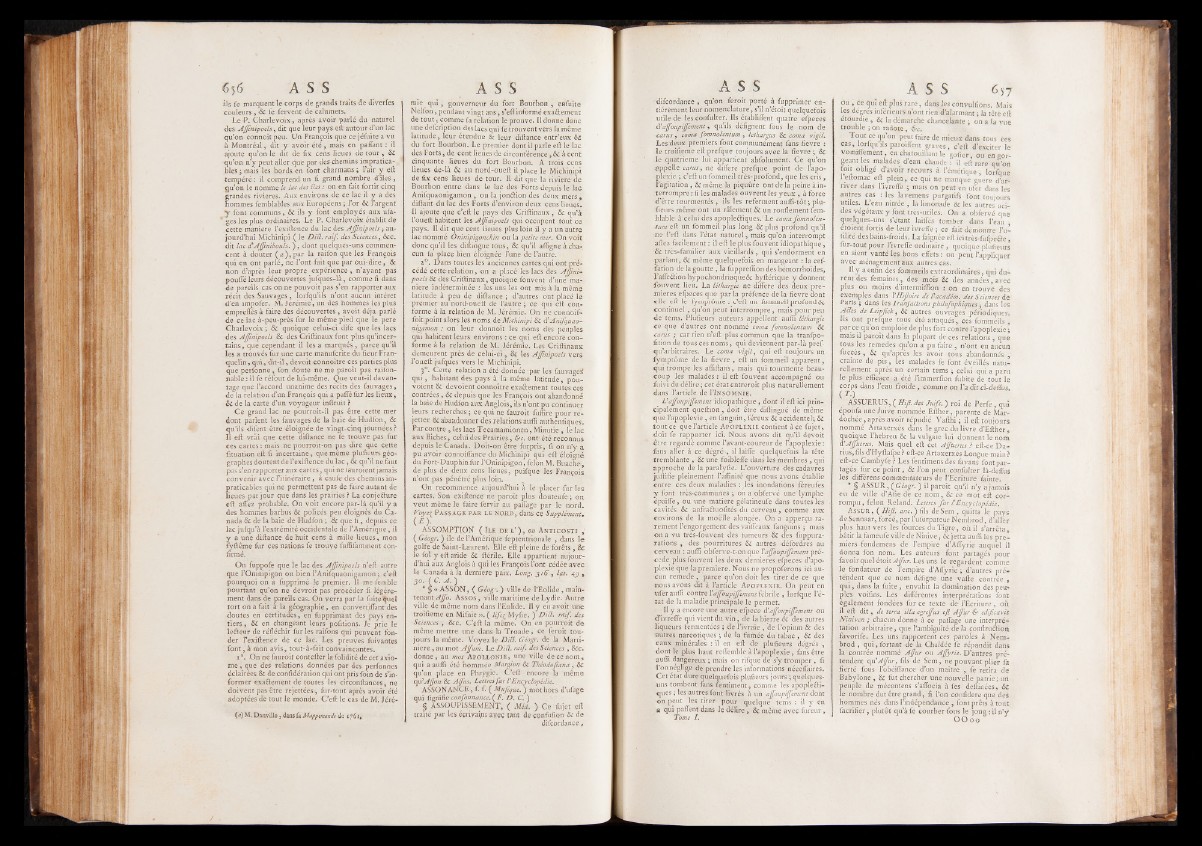
ils fe marquent le corps de grands traits de diverfes
couleurs, & fe fervent de calumets.
Le P. Charlevoix, après avoir parlé du naturel
des Ajjinipoels, dit que leur pays eft autour d’un lac
qu’on connoît peu. Un François que ce jéfuite a vu
à Montréal, dit y avoir é té , mais en paffant : il
ajoute qu’on le dit de lix cens lieues de tour , &
•qu’on n’y peut aller que par des chemins impratica-
blés ; mais les bords en font charmans ; l’air y eft
tempéré : il comprend un fi grand nombre d'îles ,
qu’on le nomme le lac des îles ; on en fait fortir cinq
grandes rivières. Aux environs de ce lac il y a des
hommes femblabies aux Européens ; l’or & l’argent
y font communs, & ils y font employés aux ufa-
r ges les plus ordinaires. Le P. Charlevoix établit de
cette; maniéré l’exiflence du lac des Ajjinipoels $ aujourd’hui
Michinipi ( le Dicl. raif. des Sciences, &c.
dit lac d’AJJinibouls. ) , dont quelques-uns commencent
à douter ( a ) , par la raifon que les François
qui en ont parlé, ne l’ont fait que par oui-dire, &
non d’après leur propre expérience, n’ayant pas
pouffé leurs découvertes jufques-là, comme fi dans
de pareils cas on ne pouvoit pas s’én rapporter aux
récit des Sauvages, lorfqu’ils n’ont aucun intérêt
d’en impofer. M. Jérémie, un des hommes les plus
empreffés à faire des découvertes, avoit déjà parlé
de ce lac à-peu-près fur le même pied que le pere
Charlevoix ; & quoique celui-ci dife que les lacs
des Ajjinipoels .& des Criftinaux font plus qu’incertains
, que cependant il les a marqués, parce qu’il
les a trouvés fur une carte manufcrite du fieurFran-
quelin, qui, dit-il, devoit connoître ces parties plus
que perfonne, fon doute ne me paroît pas railon-
nable: il.fe réfout de lui-même. Que veut-il davantage
que l’accord unanime des récits des fauvages,
de la relation d’un-François qui a paffé fur les lieux,
& de la carte d’un voyageur inftruit ?
Ce grand lac ne -pourroit-il pas être cette mer
dont parlent les fauvages de la baie de Hudfon, &
qu’ils difent être éloignée de vingt-cinq journées?
Il eft vrai, que cette diftance ne fe trouve pas fur
ces cartes : mais ne pourroit-on pas dire que cette
fituation eft fi incertaine, que même plufieurs géographes
doutent de Pexiftence du lac, & qu’il ne faut
pas s’enrapporter aux cartes, quine /auroient jamais
convenir avec l’itinéraire, à caufe des chemins impraticables
qui ne permettent pas de faire autant de
lieues par jour que dans les prairies? La conjecture
eft affez probable. On voit encore par-là qu’il y a
des hommes barbus & policés peu éloignés du Canada
& de la baie de Hudfon ; & que f i, depuis ce
lac jufqu’à l’extrémité occidentale de l’Amérique, il
y a une diftance de huit cens à mille lieues, mon
lyftême fur ces nations fe trouve fuffifamment confirmé.
On fuppofe que le lac des Ajjinipoels n’eft autre
que l’Oninipigon ou bien PAnifquaonigamon ; c’eft
pourquoi on a fupprimé le premier. Il me femble
pourtant qu'on ne dévroit pas procéder fi légèrement
dans de pareils cas. On verra par la fuite quel
tort on a fait à la géographie, en convertiffant des
doutes en certitudes, en fupprimant des pays entiers,
& en changeant leurs polirions. Je prie le
le&eur de réfléchir furies raifons qui peuvent fonder
Pexiftence de ce lac. Les preuves fuivafites
font, à mon avis, tout-à-fait convaincantes.
i°. On ne fauroit cohtefter la folidité de cet axiome
, que des relations données par des perfonnes
éclairées & de confidération qui ont pris foin de s’informer
exactement de toutes les circonftances, ne
doivent pas être rejettées-, fur-tout après avoir été
adoptées de tout le monde. C ’eft le cas de M, Jéré-
CO M. Danville, dans fa Mappemonde de 1761;
mie q u i, gouverneur du fort Bourbon , eafuite
Nelfon, pendant vingt ans, s’eft informé exactement
de tout, comme fa relation le prouve. Il donne donc
une defcription deslacs qui fe trouvent vers la même
latitude, leur étendue & leur diftance entr’eux 6z
du fort Bourbon. Le premier dont il parle eft le lac
des Forts, de cent lieues de circonférence, & à cent
cinquante lieues du- fort Bourbon. A trois cens
lieues dè-là & au nord-oueft il place le Michinipi
de fix cens lieues de tour. Il dit que la riviere de
Bourbon entre dans le lac des Forts depuis le lac
Anifquaonigamon , ou la jonCtion des deux mers ,
diftant du lac des Forts d’environ deux cens lieues.
Il ajoute que c’eft le pays des Criftinaux, & qu’à
l’oueft habitent les Ajjinipoels qui occupent tout ce
pays. Il dit que cent lieues plus loin il y a un autre
lac nommé Oninipigonckin ou la petite mer. On voit
donc qu’il les diltingue tous, &C qu’il afligne à chacun
la place bien éloignée l’une de l’autre.
20. Dans toutes les anciennes cartes qui ont précédé
cette relation, on a placé les lacs des A(Jîni~
poels & des Criftinaux, quoique fouvent d’une maniéré
indéterminée : les uns les ont mis à la même
latitude à peu de diftance ; d’autres ont placé le
premier au nord-oueft de l’autre; ce qui eft conforme
à la relation de M. Jérémie. On ne connoif-
foit.point alors les noms de Michinipi & d’Anifquaonigamon
: on" leur donnoit les noms des peuples
qui habitent leurs environs : ce qui eft encôrfe conforme
à la relation de M. Jérémie. Les Criftinaux
demeurent près de celui-ci, & les Ajjinipoels vers
l’oueft jufques vers lé Michinipi.
30. Cette relation a été donnée ;par les fauvageS
q ui, habitant des pays à la même latitude, pou-
voient & dévoient connoître exattement toutes ces
contrées, & depuis que les François ont abandonné
la baie de Hudfon aux Anglois, ils n’ont pu continuer
leurs recherches ; ce qui ne fauroit fuffire pour re-
jetter 6c abandonner des relations aulfi authentiques.
Par contre , les lacs Tecamamionen, Minutie , le lac
aux Biches, celui des Prairies, &c. ont- été reconnus
depuis le Canada. Doit-on être furpris, fi on n’y a
pu avoir connoiffance du Michinipi qui eft éloigné
du Fort-Dauphin fur l’Oninipigon, félon M. Buache,
de plus de deux cens lieues, puifque les François,
n’ont pas pénétré plus loin.
On recommence aujourd’hui à le placer fur les
cartes. Son exiftence ne paroît plus douteufe; on
veut même le faire fervir au paffage par le nord.
Voye{ P a s s a g e p a r l e NORD, dans ce Supplément.
(■ ^)*
ASSOMPTION ( I l e d e l’ ) , ou An t ico st ï
( Géogr. ) île de l’Amérique feptentrionale , dans le
golfe de Saint-Laurent. Elle eft pleine de forêts , &
le fol y eft aride & ftérile. Elle appartient aujourd’hui
aux Anglois à qui les François l’ont cédée avec
le Canada à la derniere paix. Long. 3 1 6 , lat. 4$ ,
3 ° - '(C- A. )
* § « ASSON, { Géog-, ) ville de l’Eolide , maintenant
Ajfo. A s s o s , ville maritime de Lydie. Autre
ville de même nom dansl’Eolide. Il y en avoit une
troifieme en Mifnie ». .( life^ Myfie. ) Dicl. raif. des
Sciences , &c. C’eft la même. On en pourroit de
même mettre une dans la Troade, ce feroit toujours
la même. Voyez le Dicl. Géogr. de la Marti-
niere ,au mot ÂJfum. Le Dicl. raif. des Sciences , &c.
donne, a u mot A p o l l o n i ë , une ville decénom,
qui a aulfi été nommée Margion & Théodojiana , &
qu’on place en Phrygie. C ’eft encore la même
opJAjfon 6c Ajj'os. Lettres fur l'Encyclopédie.
ASSONANCE', f. f. ( Mujîque. ) mot hors d’ufage
qui fxgniüeconfonnance.J F. D . C. )
§ ASSOUPISSEMENT, ( Méd. ) C e 1 fujet eft
traité par les écrivais avec tant de confufion & de
difcordance,
difcordance , qu’on feroit porté à fupprimer entièrement
leur nomenclature, s’il n’étoit quelquefois
utile de les confulter. Ils établiffent quatre efpeces
d'àjfoupijfement, qu’ils défignent fous le nom de
carus , coma Jomnolentum , lethargus & coma vigil.
Les deux premiers font communément fans fievre :
le troifieme eft prefque toujours avec la fievre ; &
le quatrième lui appartient abfolument. Ce qu’on
appelle carus, ne différé prefque point de l’apoplexie
; c’eft un fommeil très-profond, que les cris,
l’agitation , & même la piquûre ont de la peine à interrompre
: fi les malades ouvrent les yeux , à force
d’être tourmentés , ils les referment auffi-tôt ; plu-
fieurs même ont un râlement & un ronflement fem-
blable à celui des apopleûiques/Le cdma fomnolèn-
tum eft un fommeil plus long & plus profond qu’il
ne l’eft dans l’état naturel, mais qu’on interrompt
allez facilement : il eft le plus fouvent idiopathique,
& très-familier aux vieillards , qui s’endorment en
parlant, & même quelquefois en mangeant : la cef-
îation de la goutte , la fupprelfion des hémorrhoïdes,
ï ’affeftion hypochondriaque& hyftérique y donnent
•fouvent lieu. La léthargie ne différé des deux premières
efpeces que par la préfence de la fievre dont
elle eft le fymptôme : c’eft un fommeil profond &
continuel , qu’on peut interrompre, mais pour peu
de tems. Plufieurs auteurs appellent aulfi léthargie
ce que d’autres ont nommé coma Jomnolentum &
carus ; car rien n’eft plus commun que la tranfpo-
fition de tous ces noms, qui deviennent par-là pref-
qu’arbitraires. Le coma vigil, qui eft toujours un
fymptôme de la fievre , èft un fommeil apparent,
qui trompe les afliftans, mais qui tourmente beaucoup
les malades : il eft fouvent accompagné ou
fuivi du délire ; cet état entreroit plus naturellement
dans l’article de I’Insomnie.
Uàjfoupijfement idiopathique , dont il eft ici principalement
queftion, doit être diftingué de même
que l’apoplexie, en fanguin, féreux & accidentel; &
îout'ce que l’article A p o p l e x i e contient à ce fujet,
doit fe rapporter ici. Nous avons dit qu’il devoit
être regardé comme l’avant-coureur de l’apoplexie:
fans aller à ce dégré-, il laiffe quelquefois la tête
tremblante , & une foibleffe dans les membres , qui
approche de la paralyfie. L’ouverture des cadavres
juftifie pleinement l’affinité que nous avons établie
entre ces deux maladies : les inondations féreufes
y font très-communes ; on a obfervé une lymphe
ëpaiffe, ou une matière gélatineufe dans toutes les
cavités & anfraftuofités du cerveau, comme aux
environs de la moelle alongée. On a apperçu rarement
l’engorgement des vaiffeaux fanguins ; mais -
on a vu très-fouvent des tumeurs & des fuppura-
rations , des pourritures & autres défordres au
cerveau : aulfi obferve-t-onque Y àjfoupijfement précédé
plus fouvent lés deux dernieres efpeces d’apoplexie
que la première. Nous ne propoferons ici aucun
remede , parce- qu’on doit les tirer de ce que
nous avons dit à l’article A p o p l e x i e . On peut en
11 fer aulfi contre Y àjfoupijfement fébrile , lorfque l’état
de la maladie principale le permet.
Il y a encore une autre efpece dé àjfoupijfement ou
d’ivreffe qui vient du vin, de la bierre & des autres
liqueurs fermentées ; de l’ivraie , de l’opium & des
autres narcotiques ; de la fumée du tabac, & des
eaux minérales : il en eft de plufieurs degrés ,
dont le plus haut reffemble à l’apoplexie, fans être
•aulfi dangereux ; mais on rifque dé s’y tromper, fi
l’on néglige de prendre les informations néceffaires.
Get état dure quelquefois plufieurs jours ; quelques-
uns tombent fans fentiment, comme les apoplefti-
ques ; les autres font livrés à un àjfoupijfement dont
on peut les tirer pour quelque tems : il y en
a qui paffent dans le délire, & même avec fureur,
Tome 1.
où ; cë qui eft plus rare, dans les coftvulfiôns. Mais
les degrés inférieurs n’ont rien d’alarmant ; la tête eft
étourdie i & la démarche chancelante ; on a la vue
trouble ; on radote, &c.
Tout ce qu on peut faire de mieux dans tous ces
cas, lorfquils paroiffent graves, e’eft d’exciter le
vommement, en chatouillant le gofier, ou engorgeant
les malades d’eau chaude 2 il eft rare qii’on
foit obligé d’avoir recours à l’émétique, lorfque
l’eftomac eft plein, ce qui ne manque guère d’arriver
dans l’iyreffe ; mais on peut en ufer dans les
afitres cas : les lavemens purgatifs font toujours
utiles.^ L’eau nitrée , lalimoriade & les autres acides
végétaux y font très-utiles. On a obfervé que
quelques-uns s’étant laiffés tomber dans l’eau ,
etoient fortis de leur ivreffe ; ce fait démontre l’utilité
des bains-froids. La faignée eft icitrès-fufpeôe,
fur-tout pour l’ivreffe ordinaire * quoique plufieurs
en aient vanté les bons effets : on peut l’appliquer
avec ménagement aux autres cas.
Il y a enfin des fommeils extraordinaires, qui durent
des femaines, des inois & des années, avec
plus ou moins d intermilfion : on en trouve des
exemples dans l’Hijloire dé l'académ. des Sciences de
Paris ; dans les Tranjactions philofophiques -, dans les
Actes de Leipjîck, & autres ouvrages périodiques*
Ils ont prefque tous été attaqués, ces fommeils ,
par ce qu’on emploie de plus fort contre l’apoplexie ;
mais il paroît dans la plupart de ces relations , que
tous les remedes qu’on a pu faire , n’ont eu aücun
fuccès-, & qu’après les avoir tous abandonnés ,
crainte de pis, les malades fe font éveillés naturellement
après un certain tems ; celui qui a paru
le plus efficace a été l’immerfion fubite de tout le
corps dans l’eau froide, comme on l’a dit ci-dell’us
(T .)
ASSUERUS, ( Hiß. des Juifs. ) roi de Perfe , qui
époîifa une Juive nommée Efther, parente de Mar-
dochée, après avoir répudié Vafthi ; il eft toujours
nommé Artaxerxès dans le grec du livre d’Efther,
quoique l’hebreu & la vulgate lui donnent le nom
d'AJJuerus. Mais quel eft cet Affuerus ? eft-ce Darius,
fils d’Hyftafpe? eft-ce Artaxerxès Longue-main?
eft-ce Cambyfe ? Les fentimens des favans font partages
fur ce point, & l’on peut confulter là-delïiis
les différens commentateurs de l’Ecriture fainte.
* § ASSUR, (Ge'ogr. ) il paroît qu’il n’y a jamais
eu de ville d’Afie de ce nom, & ce mot eft corrompu,
félon Reland. Lettres fur ÜEncyclopédie.
A s s u r , ( Hiß. anc. ) fils de Sem , quitta le pays
deSennaar, forcé, par l’ufurpateur Nembrod, d’àlïèr
plus haut vers les fources du Tigre, où il s’arrêta
bâtit la fameufe ville de Ninive, & jetta aulfi les premiers
fondemèns de l’empire d’Aflyrie auquel il
donna fon nom. Les auteurs font partagés pour
favoir quel étoit Ajfur. Les uns le regardent comme
le fondateur de l’empire d’Afîyrie ; d’autres pré^
téndent que ce nom défigne une vafte contrée ,
qui, dans la fuite, envahit la domination des peu*
pies voifins. Les différentes interprétations font
également fondées fur ce texte de i’Ecriture, où
il eft d it , de terra ilia egrejfus eft Ajfur & edificavit
Niniven ; chacun donne à ce paffage une interprétation
arbitraire, que l’ambiguité de la conftruftion
favorife. Les uns rapportent ces paroles à Nembrod
, qui,Portant de la Chaldée fe répandit dans
la contrée nommé Ajjur ou Ajfyrie. D ’autres prétendent
qui Ajfur, fils de Sem, ne pouvant plier fa
fierté fous l’obéiffance d’un maître , fe retira de
Babylone , & fut chercher une nouvelle patrie; un
peuple de mécontens s’aflocia à fes deftinées, &
le nombre dut être grand , fi l’dn confidere que des
hommes nés dans l’indépendance , font prêts à tout
facrifier, plutôt qu’àfe courber fous le joug: il n’ÿ
O O 00