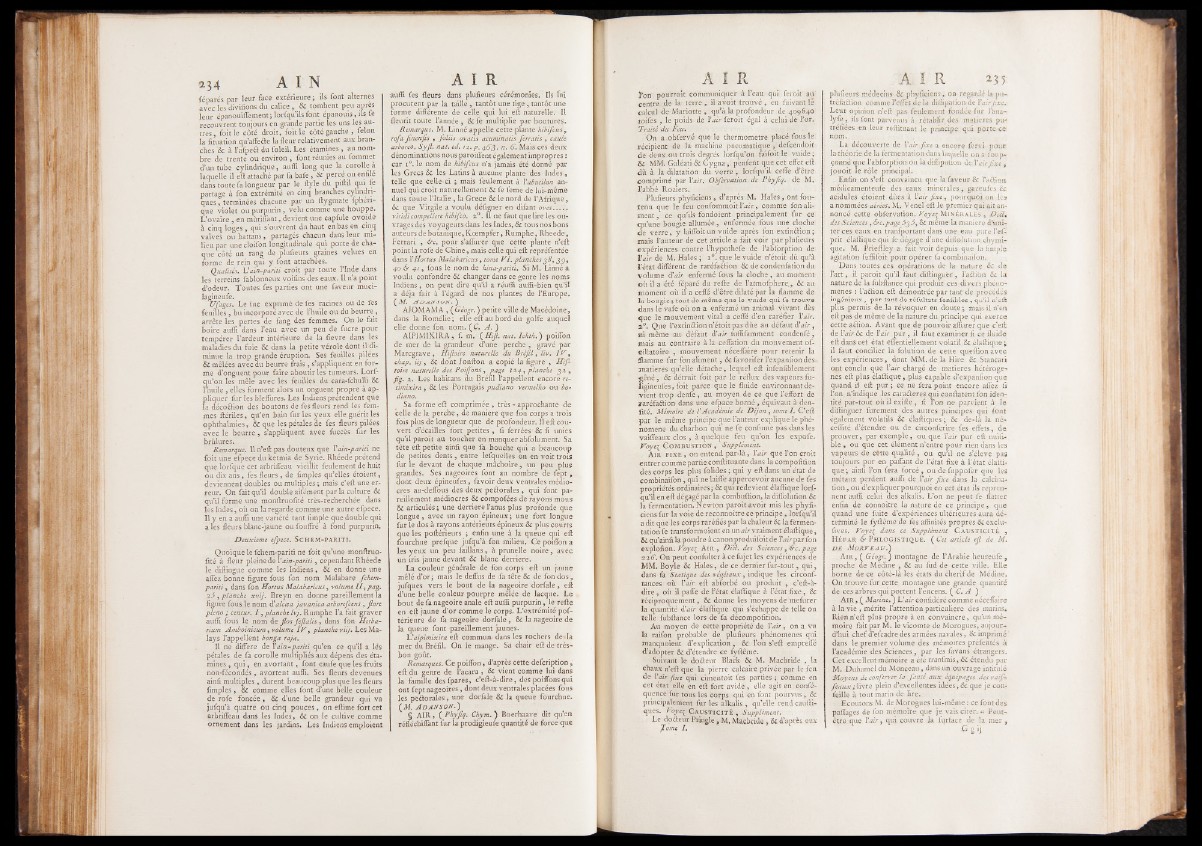
2 3 4 A I N
féparés par leur face extérieure ; ils font alternes
avec les divifions du calice , & tombent peu après
leur épanouiffement; lorfqu’ilsfont épanouis, ils fe
recouvrent toujours en grande partie les uns les autres,
foitle côté droit, foitle côté gauche, félon
la fituation qu’affeâe la fleur relativement aux branches
& à l’afp e â du foleil. Les étamines , au nombre
de trente ou environ , font réunies au fommet
d’un tube cylindrique, aufîi long que la^ corolle à
laquelle il eft attaché par fa bafe, & perce ou enfilé
dans toijte fa longueur par le ftyle du piftil qui fe
partage à fon extrémité en cinq branches cylindriques
, terminées chacune par un ftygmate fphéri- •
que violet ou purpurin , velu comme une houppe.
L’ovaire , en mûriffant, devient une capfule ovoïde
à cinq loges , qui s'ouvrent du haut en bas en cinq
valves ou battans, partagés chacun dans leur milieu
par une cloifon longitudinale qui porte de chaque
côté un rang de plufieurs graines velues en
forme de rein qui y font attachées.
Q u a lités . V a in -p a r it i croît par toute l’Inde dans
les terreins fablonneux voifins des eaux. Il n’a point
d’odeur. Toutes fes parties ont une faveur muci-
lagineufe.
U fa ge s. Le fuc exprimé de fes racines ou de fes
feuilles , bu incorporé avec de l’huile ou du beurre,
arrête les pertes de fang des femmes. On le fait
boire aufli dans l’eau avec un peu de fucre pour
tempérer l’ardeur intérieure de la fievre dans lès
maladies du foie & dans la petite vérole dont il diminue
la trop grande éruption. Ses feuilles pilées
& mêlées avec du beurre frais , s’appliquent en forme
d’onguent pour faire aboutir les tumeurs. Lorf-
qu’on les mêle avec les feuilles du cara-fchulli &
l’huile , elles forment alors un onguent propre à appliquer
fur les bleflixres. Les Indiens prétendent que
la décoétion des boutons de fes fleurs rend les femmes
flériles, qu’en bain fur les yeux elle, guérit les
ophthalmies, & que les pétales de fes fleurs pilées
avec, le beurre, s’appliquent avec fuccès fur les
brûlures.
Remarque. Il n’eft pas douteux que Vain-pariti ne
foit une efpece du ketmia de Syrie. Rhéede prétend
que lorfque cet arbriflëau vieillit feulement de huit
ou dix ans, fes fleurs , de Amples qu’elles étaient,
deviennent doubles ou multiples ; mais c’eft une erreur.
On fait qu’il double aifément par la culture &
qu’il forme une monftruofité très-recherchée dans
les Indes, oîi on la regarde comme une autre efpece.
Il y en a aufîi une variété tant Ample que double qui
a les fleurs blanc-jaune ou fouffré à fond purpurin.
D e u x iem e efpece. S c h e m - p a r i t i .
Quoique le fchem-pariti ne foit qu’une monftruo-
flté à fleur pleine dé V a in -p a r iti, cependant Rhéede
le diftingue comme les Indiens, & en donne une
affez bonne figure fous fon nom Malabare fchem -
p a r iti , dans fon Ho r tu s Ma la ba ricu s, volume U , p ag.
2.5 , pla nche x v i j . Breyn en donne pareillement la
figure fous le nom d’alcoea j avanie a arborefeens, flo r e
p len o ; centur. I , planche Iv j. Rumphe l’a fait graver
aufîi fous le nom de f io s f e f ia l i s , dans fon Herba-
rium Am b o in icum , volume IV t p la n ch e viij. Les Ma-
lays l’appellent bonga raja.
Il ne différé de Vain-pariti qu’ en ce qu’il a lés
pétales de fa corolle multipliés aux dépens des étamines
, q u i, en avortant, font caufe que les fruits
non-fécondés, avortent aufîi. Ses fleurs devenues
ainfi multiples , durent beaucoup plus que les fleurs
fimples, & comme elles font d’une belle couleur
de rofe foncée, & d’une belle grandeur qui va
jufqu’à quatre ou cinq pouces, on eftime fort cet
arbriflëau dans les Indes, & on le cultive comme
ornement dans les jardins. Les Indiens emploient
A I R
aufîi fes fleurs dans plufieurs cérémonies. Ils fui
procurent par la taille, tantôt une tig e, tantôt une
forme différente de celle qui lui eft naturelle. 11
fleurit toute l’année , & fe multiplie par boutures.
Remarque. M. Linné appelle cette plante hibifeus,
rofa finenfis , foliis oyatis acuminalis ferratis , caule
arboreo. Syfi. nat. ed. 12. p. 463. n. (f. Mais ces deux
dénominations nous paroiffent également impropres :
car i°. le nom de hibifeus n’a jamais été donné par
les Grecs & les Latins à aucune plante des Indes,
telle que Celle-ci ; mais feulement à Vabutilo.n annuel
qui croît naturellement & fe ferne de lui-même
dans toute l’Italie, la Grece & le nord de l’Afrique,
que Virgile a voulu défigner en difant o ves.....
viridi compellere kibifeà. z°. Il ne faut que lire les ouvrages
des voyageurs dans les Indes, & tous nos bons
auteurs de botanique, Koempfer, Rumphe, Rheede,
Ferrari , &c. pour s’affurer que cette plante n’eft
point la rofe de Chine, mais celle qui eft repréfentée
dans VHortus Malabaricus, tome VI. planches 3 8 ,3g ,
40 & 4/, fous le nom de hina-pariti. Si M. Linné a
voulu confondre & changer dans ce genre les noms
Indiens, on peut dire qu’il a réuffi aufli-bien qu’il
a déjà fait à l’égard de nos plantes de l’Europe.
( M. A d a n s o n . )
ÀJOMAMA , (Géogr.) petite ville de Macédoine,
dans la Romélie ; elle eft au bord du golfe auquel
elle donne fon nom. (Ç. A . )
AIP1MIXIRA , f. m. ( Hiß. nat. Ichth. ) poiffon
de mer de la grandeur d’une perche , gravé par
Marcgrave, Hifioire naturelle du B réfil, liv. 1 V 9
chap. i i j , & dont Jonfton a copié la figure , Hif-
toire naturelle des P oiß'ons, page 12.4, planche 3 2 ,
fig. 2. Les habitans du Bréfil l’appellent encore re-
timixira, & les Portugais pudiano vermelho ou bo-
diano.
Sa forme eft comprimée , très - approchante de
celle de la perche, de maniéré que fon corps a trois
fois plus de longueur que de profondeur. Il eft couvert
d’écailles fort petites , fi ferrées1 & fi unies
qu’il paroît au toucher en manquer abfolument. Sa
tête eft petite ainfi que fa bouche qui a beaucoup
de petites dents, entre lefquelles on en voit trois
fur le devant de chaque mâchoire, un peu plus
grandes. Ses nageoires font au nombre de fept ,
dont deux épineufes, favoir deux ventrales médiocres
au-deffous des deux peûorales, qui font pareillement
médiocres & compofées de rayons mous
& articulés ; une derrière l’anus plus profonde que
longue, avec un rayon épineux; une fort longue
fur le dos à rayons antérieurs épineux & plus courts
que les poftérieurs ; enfin une à la queue qui eft
fourchue prefque jufqu’à fon milieu. Ce poiffon a
les yeux un peu faillans, à prunelle noire, avec
un iris jaune devant & blanc derrière.
La couleur générale de fon corps eft un jaune
mêlé d’or; mais le deffus de fa tête & de fon dos ,
jufques vers le bout de la nageoire dorfale, eft
d’une belle couleur pourpre mêlée de lacque. Le
bout de fa nageoire anale eft aufîi purpurin, le refte
en eft jaune d’or comme le corps. L’extrémité postérieure
de fa nageoire dorfale, & la nageoire de
la queue font pareillement jaunes.
Vaipimixira eft commun-dans les rochers de la
mer du Bréfil. On le mange. Sâ chair eft de très-
bon goût.
Remarques. Ce poiffon, d’après cette defeription ,
eft du genre de l’acara , & vient comme lui dans
la famille desfpares, c’eft-à-dire, des poiffons qui
ont fept nageoires, dont deux ventrales placées fous
les péftorales, une dorfale & la queue fourchue.
(M. A d a n s o n . )
§ A IR , ( Bhyfiq. Chym. ) Boerhaave dit qu’en
réfléchiflànt fur la prodigieufe quantité de force que
A I R
l’on pourroit -communiquer à l’eau qui ferôit ait
centre de la- terre , il avoit trouvé , en fuivant lé
calcul de Mariotte , qu’à la profondeur de 409640
toiles , le poids de Vair feroit égal à celui, de l?or.
'Traité du Feu.,
"On a.obfetvé que le thermomètre placé-fous le
récipient de la machine pneumatique , defcendbit>
de deux ou trois degrés lorfqu’on faifoit le vuide ;
& M M . Galéati & Cygna,; penfent que cet effet eft
dû à la dilatation du v e r re , lorfqu’il, ceffe d’être
comprimé par l’air. Obferyatian.de Phyfiq. de M .
l ’abbé Roziers. ; ‘
Pkifieurs phyficiens , d’après M . Haies , ont fou-
tenu que le feu confommoit Pair, comme fon aliment
, ce qu’ils- fondoient principalement fur ce
qu’une bougie allumée,, enfermée fous une cloche
de verre, y laiflbit un vuide après fon extinction ;
mais l’auteur de cet article a fait voir par plufieurs
expériences contre l’hypothefe de l’abforption de
l ’air de M. Haies ; i° . que le vuide n’étoit dû qu’à
l ’état différent de raréfaction & de condenfation du
volume d'air enfermé fous la cloche, au moment
où il a été féparé du refte de l’atmofphere., & au
moment où il a ceffé d’être dilaté par la flamme de
la bougie ; tout de même que le vuide qui fe trouve
dans le vafe où on a enfermé un animal vivant dès
que le mouvement vital a ceffé d’en raréfier l’air.
i ° . Que l’extinétion n’étoit pas due au défaut d'air,
ni même au défaut d'air fuffifamment condenfé,
mais au contraire à la ceffation du mouvement of-
cillatoire , mouvement néeeffaire pour retenir la
flamme fur fon aliment, & favorifer l’expanfion des-
matières qu’elle détache, lequel eft infenfiblement
g ên é , & détruit foit par le reflux des vapeurs fu-
ligineufes, foit parce que le fluide environnant devient
trop denfe, au moyen de ce que l’effort de
jraréfaâion dans une efpace borné , équivaut à den-
fité. Mémoire de V Académie de Dijon, tome I. C’eft
par le même principe que l’auteur explique le phénomène
du charbon qui ne fe confumè pas dans les
vaiffeaux clos , à quelque feu qu’on les expofe.
Voyei Combustion , Supplément.
Air fixe , on entend par-là, Vair que l’on croit
entrer comme partie conftituante dans la compofition
des corps les plus folides ; qui y eft dans un état de
combinaifon, qui nelaiffe appercevoir aucune de fes
propriétés ordinaires; & qu i redevient élaftique lorfqu’il
en eft dégagé par la combuftion, la diflblution &
la fermentation. Newton paroît avoir mis les phyfi-
ciens fur la voie de reconnoître ce principe, lorfqu’il
a dit que les corps raréfiés par la chaleur & la fermentation
fe transformoient en un air vraiment élaftique,
& qu’ainfi la poudre à canon produifoit de Vair par fon
explofion. Voye£ Air , Dicl. des Sciences, &c. page
226. On peut confulter à ce fujet les expériences de
M M . Boyle & Haies, de ce dernier fur-tout, qui,
dans fa Statique des végétaux, indique les circonf-
tances où Vair eft abiorbé ou produit , c’eft-à-
dire , où il paffe de l’état élaftique à l’état fixe , &
réciproquement, & donne les moyens de mefurer
la quantité d'air élaftique qui s’échappe de telle ou
telle fubftance lors de fa décompofition.
Au moyen de cette propriété de Vair, on a vu
la raifon probable de plufieurs phénomènes qui
manquoient d’explication, & l’on s’eft empreffé
d’adopter & d’étendre ce fyftême.
Suivant le dofteur Black & M. Macbride , la
chaux n’eft que la pierre calcaire privée par le feu
de 1’ air fixe qui cimentoit fes parties ; comme en
cet état elle en eft fort avide, elle agit en confé-
quence fur tous les corps qui en font pourvus, &
principalement fur les alkalis , qu’elle rend caufti-
ques. Voye\ Causticité , Supplément.
Le dofteur Pringle, M, Macbride 2 & d’après eux
Tome I,
A I R 235
plufieurs médecins & phyfieiens, on regardé la pu-
tréfaélion comme l’effet de 1a- difîïpation de Vair fixe.
Leur opinion n’eft pas feulement fondée fur Pana—
ly fe , ils font parvenus à, rétablir, des matières pu-*
tréfiées en leur reftituant le principe qui porte ce
n,om..
La découverte de Vair fixe 2encore fervi pour
la théorie de la fermentation dans laquelle on a fou p-
çonné que l’abforptionou ladiflipation de. Vair fixe ,
jpuoit le rôle principal.
- Enfin on s’eft convaincu que la faveur & l’aélion
médicamenteufe des.eaux minérales * gazeufes èc
acidulés étoient dues à Vair f ix e , pourquoi on les
a nommées aérées. M. V enel eft le premier qui ait annoncé
cette obfervation.. Voye{ Minérales , Dicl.
dès Sciences, &c.page 5j 5 , & même la maniéré d’imiter
ces eaux en tranfportant dans une: eau pure l’ef-
p:rit élaftique qui fe dégage d'une diflolution chyrni-
que. M. Prieftley a; fait voir depuis que la Ample
agitation fuffifoit pour opérer fa combinaifon.
Dans toutes ces opérations de la nature & de
l’art, il paroît qu’il faut diftinguér, l’aélibn & la
nature de la fubftance qui produit ces . divers phénomènes
: l’aûion eft démontrée par tant de procédés
ingénieux, par tant de réfultats fenfibles , qu’il n’eft
plus permis de,la révoquer en doute ; mais il n’en
eft pas,de même de la nature du principe qui exerce
cette aétion. Avant que de pouvoir affurer que c’eft
de Vair & de Vair pur , il faut examiner fi ce fluide
eft dans cet état effentiellement volatil & élaftique ;
il faut concilier la folution de cette queftion avec
les expériences, dont MM. de la Hire & Stancari
ont conclu que Vair chargé de matières hétérogènes
eft plus élaftique,,plus capable d’expanfion que
quand ii eft pur ; c e ne fera point encore affez fi
Bon n’indique les caractères qui çonftatent fon identité
par-tout où il exifte , fi l’on ne parvient à le
diftinguér furement des autres .principes qui font
également volatils & élaftiques ; & de-là la né-
ceflité. d’étendre ou de cireonfcrire fes effets, de
prouver, par exemple, ou que Vair pur eft nuifi-
ble , ou que cet élément n’entre pour rien dans les
vapeurs de cètte qualité, ou qu’il ne s’élève pas
toujours pur en paffant de l’état fixe à l ’état élaftique;
ainfi l’on fera forcé, oudefuppofer que les
métaux perdent aufli de Vair fixe dans la calcination
, ou d’expliquer pourquoi en cet état ils reprennent
aufli celui des alkalis. L’on ne peut fe flatter
enfin de connoître la nature de ce principe, que
quand une fuite d’expériences ultérieures aura dé-,
tefminé le fyftême de fes affinités propres & exclu-
fives, Voye£ dans ce Supplément Causticité ,
HÉPAR & Phlog.istique, ( Cet article efi de M.
d e M o r t ea u .)
Air , ( Géogr. ) montagne de l’Arabie heureufe ,
proche de Médine , & au fud de cette ville. Elle
borne de ce côté-là les états du cherif de Médine.
On trouve fur cette montagne une grande quantité
de ces arbres qui portent l’encens. ( C. A )
Air , ( Marine. ) L'air confidéré comme néeeffaire
à la vie , mérite l’attention particulière des marins.
Rien n’eft plus propre à en convaincre, qu’un mémoire
fait par M. le vicomte de Morogues, aujourd’hui
chef d’efeadre des armées navales, & imprimé1
dans le premier volume des mémoires préfentés à
l’académie des Sciences, par les favans étrangers.
Cet excellent mémoire a été tranfmis, étendu par
M. Duhamel du Monceau, dans un ouvrage intitulé
Moyens fie conferver la feinté aux équipages des vaiffeaux;
livre plein d’excellentes idées, & que je con-
feille à tout marin de lire..
Ecoutons M . de Morogues luirmême : ce font des
paffages de fon mémoire que je vais citer. « Peut-,
être que Vair, qui couvre la furface de la mer ,
i g n