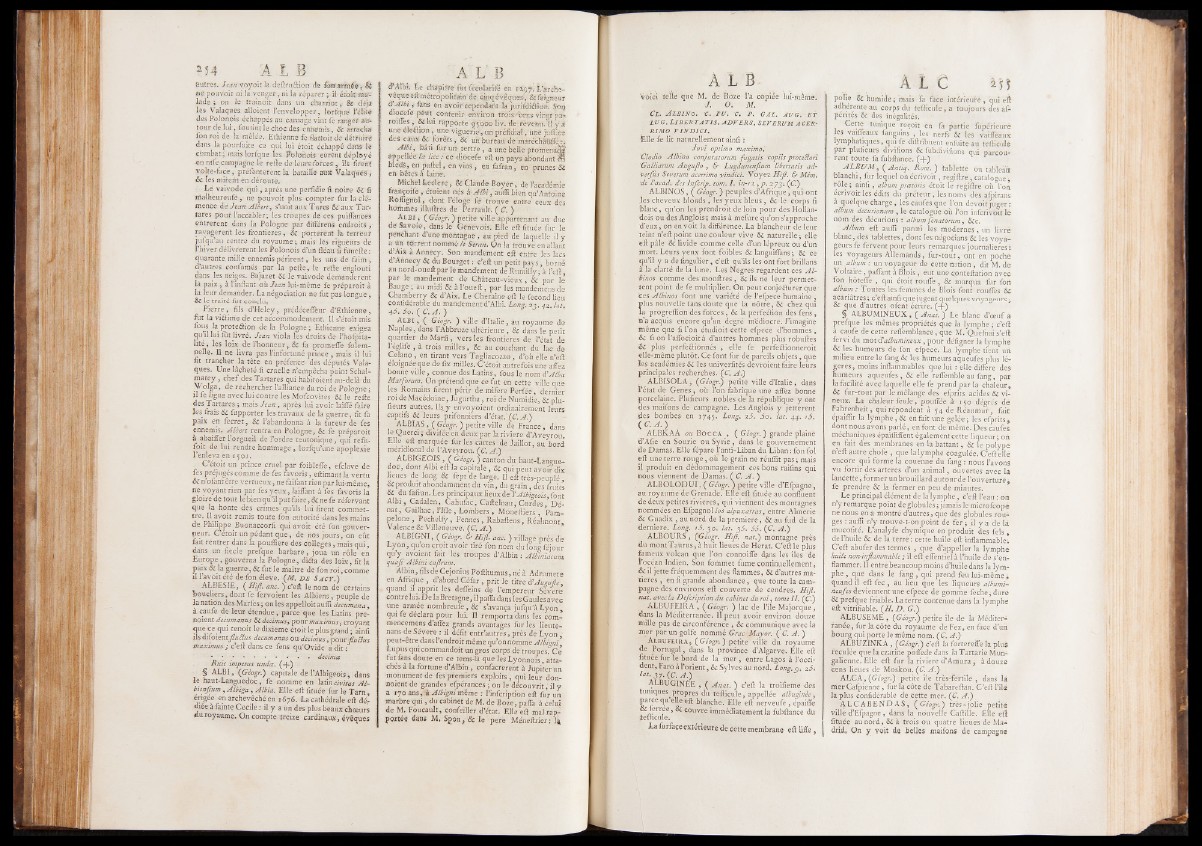
* 5 4 A
autres. Jeanvoyoh la deftmétion ch fo*f armée, 82 :
pouvoir- ni la venger,, ni la réparer ; il- étoit Malade
; on le traînoi't dans un charriot, & déjà
les Valaques alloient l’envelopper, l'oHctue1 Pélitè
des Polonois échappés au carnage vint fe ranger air- j
tour de lui,;foutinî le choc des ennemis, arracha ‘
fôn roi de la mélee. Ethienne feflàtîoit de déîÉùirè !
dans la pou Huit e ce qui lui étoit échappé dans le
eômbat-, mais lorfque les Pbhsùais-' eurent déployé !
■ en ra'fe campagne le refte de leurs forces, ils firent
volte-face, préfènterènt la bataillé aîîJt Va laqués $
& les mirent èn déroute.
Le vaiyode q u i, après une perfidie fi noire & fi
iûalheureufé, ne pouvoir plus compter fiir la clémence
dé Jean Albert ^ s’unit aux Turcs & aux Tartares
pouf Paceàblér; les troupes dé ces puiffancéS
entrèrent dans la Pologne par différens endroits >■
ravagèrent lès frontières , & portèrent la. terrëur
jufqu’aii centre du royaume ; mais1 lés rigueurs de
l’hiver délivrèrent les Polonois d’un fléau fi fùnefte :
quarante, mille ennemis périrent, lés uns de faim,
d’autres eqnfiiraés par la pefte, le réfie é-ngloiiti
dans les neiges. Bajazet & le vaivode demandèrent
}à paix , à l’inftant oîi Jean lui-même fe préparoit à
là leur demander. La négociation ne fut pas longue ,
& le traité fut conclu.
Pierre , fils d’He le y, prédéeeflëur d’Ethienne,
fut la viétime de cet accommodement. Il s’étoit mis
fous la protection de la Pologne ; Ethienne exigea
qu’il lui fût livré. Jean viola les droits de l’hôfpxta-
lité , les loix de l’honneur,.& fa promeffe folem-
pelle. Il ne livra pas l’infortuné p rince, mais il lui
fit trancher la tête en préfence des députés Valâ-
qites. Une lâcheté fi cruelle n’empêcha point Schal-
m a te y , chef des Tartares qui habitoiènt au-delà du
W olg a, de rechercher l’alliance du roi de Pologne ;
il fe ligua avec lui contre les Mofcovites & le refie
des Tartares ; mais Jean, après lui avoir laiffé faire
les frais & fupporter les travaux de la guerre, fit fa
paix en fecret, & l’abandonna à la fureur de fes
ennemis. Albert rentra en Pologne, & fe préparoit
à abaiffer l’orgueil de l’ordre teutonique, qui refu-
fpit de lui rendre hommage , lorfqu’une apoplexie
l ’enleva en 1 501.
C ’étoit un prince cruel par foiblefle, efclave de
fes préjugés comme de fes favoris, eftimantla vertu
& n’ofant êtr,e vertueux, ne faifant rien par lui-même,
ne voyant rien par fes y eux , Iaiflant à fes favoris la
gloire de tout le bien qu’il put faire, & ne fe réfervant
que la honte des crimes qu’ils lui firent commettre.
Il avoit remis toute fon autorité dans les mains
de Philippe Buonaccorfi qui avoit été fon gouverneur.
G’étoit un pédant que, dé nos jours, on eut
fait rentrer dans la poufiiere des colleges, mais q ui,
dans un fiecle prefque barbare, joua un rôle en
Europe , gouverna la Pologne, diâa des lo ix , fit la
paix & la ^guerre, & fut le maître de fon ro i, comme
il l’a-voit été de fon éleve. (M. d e S a c y .)
sj ALBESIE, ( Hijl. anc. ) c’eft le nom de certains
boucliers, dont fe fervoient les Albiens, peuple de |
la nation des Marfes ; on les appelloit auflx decumana, à caufe de leur étendue, parce que les Latins pre-
noient decumanus & decimus, pour maximus, croyant
que ce qui tenoit le dixième étoit le plus grand ; ainfi
ils difoientfiuctus decumanus ou dicimus, pour fiuctus
maximus ; c’efi dans ce fens qu’Ovide a dit :
* • • • • • • • . . décimai
Ruit impetus undce. (-f-)
§ ALBI, (Géogr.) capitale de l’Albigeois, dans
le haut-Languèdoc, fë nomme en latin civitas A l-
bitnfium, Albiga, Albia. Elle eft fituée fur le Tarn,
érigée en archevêché en 1676. La cathédrale eft déT ■
diée à fainte Cecile : il y a un des plus beaux choeurs
4 u royaume. On compte treize cardinaux, évêques :
A L
d’Atbî. Le chàp'itfe fut féeitlarifé en 12,97. L’atehe-
vêqite eftmétropoîifaùi dé cinqév.êques, Scfeigneur
à9Albi , fans- en avoir cependant la jurifdiélioii. Soq
dioééfé pëut • contenir environ tröis-^cens vingt par
roiffes, & lui rapporte 9 5000 liv. de revenu. Il y à
line éleftion, une viguerie, un prélidial, une juftiee
des eaux- forets -, & un bureau de maréchâEîfcfiéé.i
Albi', bâti fur un tertre , a une belle promenàlâ'
appeîleè la lice : ce diocefe efi un pays abondanten
bleds, en paftel, én v ins, en fafran, en prunes &
en bêtes à laine.
Michel L eclerc, & Claude B o y e r , de l’académie
fraftçoife , étoient nés k-Albi, auflî bien qu’Antoine
Roflignol , dont l’éloge fë trouve entre ceux des
hommes illuftres de Pêrraiilt. ( G. )
Aï-Bl j ( Géogr. y petite ville appartenant au duc
dé Savoie , dans le Gëtfévois. Elle eft fituée fur le
penchant d’une montagné, au pied de laquelle il y
a llfi tôrrent nomme Je S cran. On la' trouve en allant
d’Aix à Annecy. Son mandement efi entre les lacs
d’AMecy & du Bourget : c’eft un petit pa ys, borné
au nord-omeft par le mandement de Rumilly; à l’eft ,
par le mandement de Château-vieux, & par le
Bauge ; au midi & à l ’oueft, par les mandemens de
Chamberry & d’Aix. Le Cheraine eft le fécond lieu
confidérable du mandement d’Albi. Long. 21.42.. lut.
46. 60. ( C. A . ) • .
Alb i , ( Géogr. ) ville d’Italie, au royaume de
Naples, dans l’Abbruze ultérieure, & dans le petit
quartier de Marli, vers les frontières de l’état dé
l’églife , à trois milles, & au couchant du lac de
Celano, en tirant vers Tagliacozzo, d’oh elle n’ eft
éloignée que de fix milles. C ’étoit autrefois une allez
bonne v ille , connue des Latins, fous le nomd’Â
Mat forum. On prétend que ce fut en cette ville que
les Romains firent périr de mifere Perfée, dernier
roi de Macédoine, Jugurtha, roi de Numidie, & plu-
fieurs autres. I L y envqyoient ordinairement leurs
captifs & leurs prifonniers d’état.’(C.A.')
ALBIAS, ( Géogr. ) petite ville de France, dans
le Querci ; diviféë en deux par la riviere d’Aveyrou.
EUe eft marquée fur les cartes de Jaillot, au bord*
méridional de l’Aveyrou. (C. A.)
ALBIGEOIS, ( j canton du haut-Languedoc,
dont A lbi eft la capitale, & qui peut avoir dix
lieues de long & fept de large. Il eft très-peuplé ,
& produit abondamment du vin, du grain , des fruits
& du fafran. Les principaux lieux de l’Albigeois, font
A lb i, Cadalen, Cahufac, Caftelnau, Cordes, Dé-
nat, Gailhac, l’Iile , Lombers , Moneftiers ", Pam-
pelone , Pechelfy , Pennes, Rabaftens, Réalmont.
Valence & Villeneuve. (C. A.)
ALBIGNI, ( Géogr, & Hiß. anc. ) village près de
Ly on , qu’on croit avoir tiré fon nom du long fpiour
q uV avoient fait les troupes d'Albin : Albinldcum
quafi Albini caflrum.
Albin, fils de Cejonius Pofthumus, né à Adrumete
en Afrique , d’abord Géfar, prit le titre tfAugufie,
. quand il apprit les deffeins de l’empereur Sévëre
contre lui. D e la Bretagne, ilpafla dans les Gaules avec
une armee nombreufe, & s’avança jufqu’à Lyon ,
qui fé déclara pour lui. Il remporta dans les com-
mencemens d’affez grands avantages fur les lieute-
nans de Sévere : il défît entr’atitres, près de Lyon
peut-etre dansl’endroit même qu’onnômme Albigni
Lupus quicommandoit un gros corps de rroupes. Ce
fut fans doute en ce tems-là que les L yonnois, attachés
à la fortune d’Albin, confacrerent à Jupiter un
monument de fes premiers exploits , qui leur don-
noient de grandes efpérances ; on le découvrit, il y
a 170 ans, à Albigni même ; l’infcription eft fur un
marbre q u i, du cabinet de M. de Boze, pafla à celui
de M. Foucault, confeiller d’état. Elle eft mal tap-
portéç dans M. Sppn* & le pere Méneftrier: 1%
À L B
'Vôîci telle que M. de Boze l’à copiée lui-mêmé.
ƒ. O. M.
Cl . A l b i n o . :c . f u . g . p . g a l . ä u g . e t
l u G. L l B E R T A T l S . A D F E R S . S E F E R UM ACERR
IMO F IN D I CI.
feile fe lit natuïellenlënt ainfi :
Jovi optimo maxitîiôi
Clodià Albino cönjuratorüm fugatis copiis proteclori
'Galliarum Augußo , & Lugdunenfium lîbettàtis ad-
yerfùs Severum acerrimo vindici. Voyez Hiß. & Mhn.
de l'acad\ des lnfçrip. loin. I . in-12 , p . 2 J y . (Cf)
ALBINOS, ( Géogr. ) peuples d’Afrique, qui ont
les cheveux blonds , les yeux bleus, & le corps fi
blanc, qu’on les prendroit de loin pour des Hollan-
dois ou des Ànglois ; mais à mefure qu’on s’approche
d’eux, on en.voit la différence. La blancheur de leur
teint n’eft point Une couleur vive & naturelle ; elle
eft pâle & livide comme celle d’un lépreux ou d’un
mort. Leurs yeux font foibles & languiffans ; & ce
qu’il y a de fingulier, c’eft qu’ils les ont fort brillans
à la clarté de la lune. Les Negres regardent ces A l binos
comme des monftres , Se ils ne leur permettent
point de fe multiplier. On peut conjecturer que.
ces Albinos font une variété de l’efpece humaine ,
plus nouvelle fans doute que la nôtfé, & chez qui
la progrefîîôn des forces;, & la perfection des fens,
h’a acquis en’core qu’un degré médiocre. J’imagine
meme que fi l’on étudioit cette efpece d’hommes ,
& fi on l’aflocioità d’autres hommes plus robuftés
& plus perfectionnés j elle fe perfeCtionneroit
elle^même plutôt. Ce font fur de pareils objets, que
les académies & les uniyerfitës devroient faire leurs
principales recherches. (C. A.)
ALBISOLA, (Géogr.) petite ville dTtaiie, dans
l ’état de Genes, où l’on fabrique une affez bonne
porcelaine. Plufieurs nobles de la république y ont
des maifons de campagne-. Les Anglois y jetterent
îles bombes en 1745. Long. 2$. So. lat. 44, iâ.
{ C .A . )
ALBKAA ou Bocca , (Géogr.) grande plaine
d’Afie en Sourie oit S y r ie , dans le gouvernement
'de Damas. Elle fépare l ’anti-Liban du Liban: fön fol
eft une terre rouge, où ie grain ne réufîît pas ; mais
il produit en dédommagement ces bons raifins qui
hous viennent de Damas. (C . A . )
, A LBO LOD U I, ( Géogr.) petite ville d’Efpagne,
au royaume de Grenade. Elle eft fituée au confluent
de deux petites rivières, qui viennent des montagnes
nommées en Efpagnol/oi alpuxarras, entre Almerie
& Guadix , au nord de la première, & au fud de la
derniere; Long. 16.30. lat. ^5. 55. (C. A .)
ALBOURS, (Géogr. Hiß. nat.) montagne près
du montTaurus, à huit lieues de Herat. Ç’eft le plus
fameüx volcan que l’On connoiffe dans les îles dé
l’océan Indien. Son fomtriet fume continuellement,
& i l jette fréquemment des flammes, & d’autres matières
, en fi grande abondance, que toute la campagne
des environs eft couverte de cendres. Hiß.
nat. avec la Defcription du cabinet du roi, tome II. (C.)
ÀLBUFÈIRA , ( Géogr; ) lac dë l’île Majorque,
dans la Méditerranée* Il peut avoir environ douze
mille pas de circonférence , & communique avec la
mer par un golfe nommé Grac Mayor. (C . A . )
Albufeira, ( Géogr-. ) petite ville du royaumè
de Portugal, dans la province d’Algarve. Elle eft
fituée fur le bord de la mer , entre Lagos à l’occident,
Farô à l’orient, & Syives au nord. Long, q-, z5;
lat. 37. (C. A .)
ALBUGINÊE , ( Anat. ) c’eft la troifieme dès
tuniques ptopres du tefticule, appellée aibuginée,
parce qu elle eft blanche. Elle eft nerveufe , épaiffe
& ferree, & couvre immédiatement la fubftance du
jelticule.
La furface extérieure de eette membrane eft liflë,
L C 2 5 5
polie & humide ; mais fa face intérieure, qui eft
adhérente au corps du tefticule, a toujours des af-
perités & des inégalités.
^ ette tunique reçoit en fa partie fupérieurè
les vaifleaux fanguins , les nerfs & les vaifleaux
lymphatiques, qui fe diftribuent enfuite au tefticule
par plufieurs divifiôns & fubdivifions qui parcou-
- rent toute fà fubftance. ( -f)
A L B U M , ( Antiq. Rom\ ) tablette ou tableau
blanchi, fur lequel ort é crivoït, regîftre, catalogue\
rôle ; ainfi , album proetoris étoit le regiftre où l’on
écrivoit les édits du préteur, les noms des afpirans
à quélque charge, les câufes que l’on devôit juger:
album deturioTium , le catalogue Où l’on inferivoît lé
nom dès décurions: albumfenatôrum, &c.
Album eft âuffi parmi les modernes, un livré
blanc, des tablettes, dont les riégocians & les voyageurs
fe fervent pour leurs remarques journalières i
les voyageurs Allemands, fur-tout, ont en poché
un album : un voyageur de cette nation, dit M. -de
Voltaire, paffant à Blois, eut une cpnteftation avec
fon hôtefle , qui étoit rôufle , & marqua fur fon
album-: Toutes lés femmes de Blois-font roufles &
acariâtres ; c’eft ainfi que jugent quelques voyageurs 9
& qué d’autres, ofent écrire, (-p)
§ ALBUMINEUX, ( Anat. ) Le blanc d’oeuf a
prefque les mêmes propriétés que la lymphe ; c’eft
à caufe de cette reflemblancë, qlie M. Quefnai s’efl:
fervi du mot à’albumineux, pour défigner la lymphe
& les humeurs de fon éfpece. La lymphe tient un
milièu entre le fang & les humeurs aqueufes plus légères
, moins inflammables que lui : elle diffère des
humeurs aqueufes , elle reflemble au farig, par
la facilité avec laquelle elle fe prend par la chaleur,
& fur-tout par le mélange des efprits acides & vineux.
La chaleur feule, pqufîee à 150 dégrés dé
Fahrenheit, qui répondent à 54 de Réaumur, fait
épaiflir la lymphe, & en Fait une gelée ; les efprits j
dont nous avons parlé, en font de même. Des califes
méchaniques épaifliffent également cette liqueur ; on
en fait des membranes en la battant, Sc le polype
n’eft autre chofe , que la lymphe coagulée. C’eft elle
encore qui forme là couenne du fang : nous l’avons
vu fortir des arteres d’un animal, ouvertes avec la
iancette, former un brouillard autour de l’ouverture i
fe prendre & la fermer en peu de minutes.
Le principal élément de la lymphe, c’eft l’eau : on
n’y remarque point de globules ; jamais le microfcopé
ne nous en à montré d’autres, que dés globules rouges
: auflî n’y trouvé-t-on point de fer ; il y a de là
mucofité. L’analyfe chymique en produit des f e ls ,
del’hüiie & de ia terre : cette huile eft inflammable;
C’eft abufer des termes , que d’ap.peller la lymphe
huile non-inflammable ; il eft eflentiel à l’huile de s’enflammer*
Il entre beaucoup moins d’huile dans la lymphe
, que dans le fang, qui prend feu lui-même ;
quand il eft f e c , au lieu que les liqueurs albumi-
neufes deviennent une efpece de gomme feche j dure
& prefque friable. La terre contenue dans la lymphe
eft vitrifiable. (H. D . G.)
ALBUSEMÈ , (Géogr.) petite île de la Méditerranée,
fur la côté du royaume de Fez, en face d’un
bourg qui porte ie même nom. (Ç. A.)
ALBUZINKÀ, (Géogr.) c’eft la fortereffe la plus
reculée que la czàririe pôflede dans la Tartârie Mun-
galienrte. Elle eft fur la riviere d’Artiura ^ à douze
éens lieues de Moskou. (C. A .) .
ALCA., (Géogr.) petite île très-fertile , dans là
mer Cafpienne , Tur la côte de Tabareftân. C ’eft i’îlé
la plus confidérable de cette mer. (C. A.)
A L C A B E N D A S , (Géogr.) très-joiie petite
ville d’Efpagne, dans la nouvelle CaAille. Elle eft
fituée au nord, & à trois ou quatre lieues de Madrid,
On y voit de belles maifons de campagne