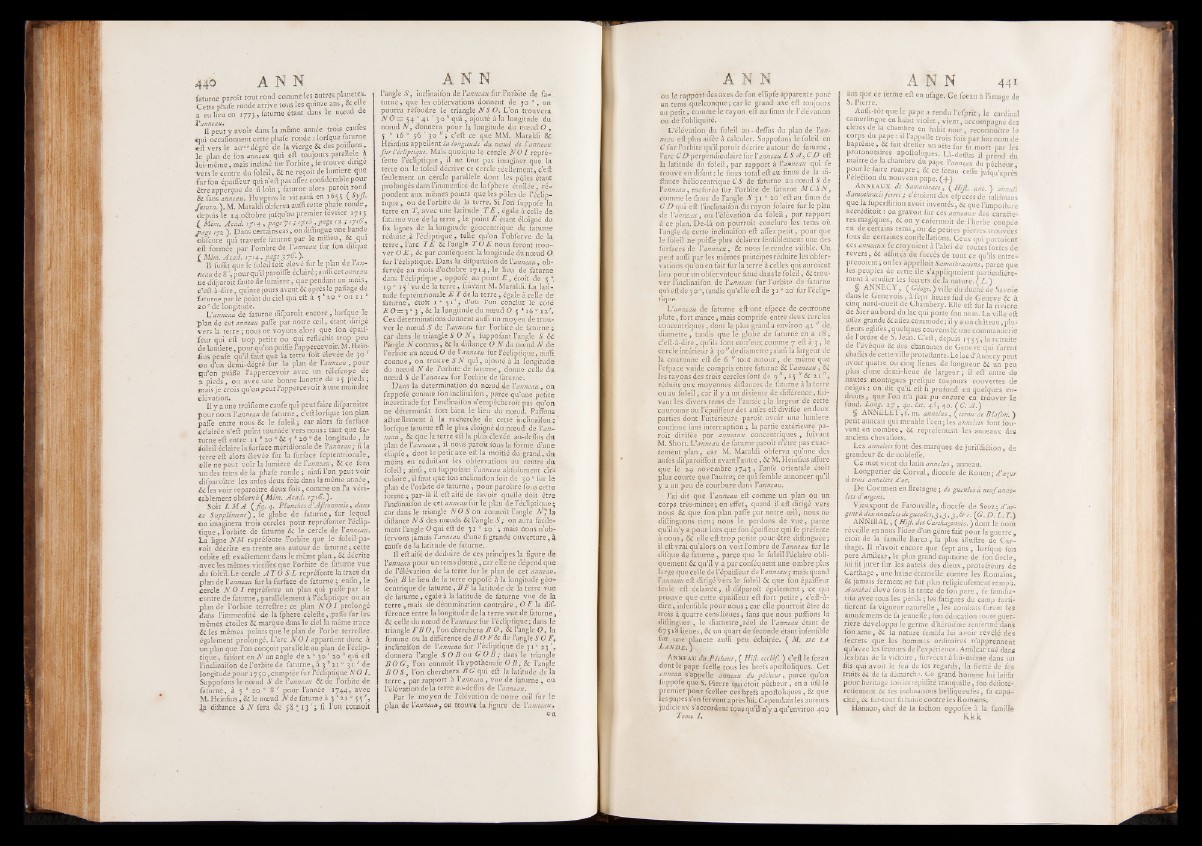
faturne paroit tout rond comme les autres p k “ et*s‘
Cette phafe ronde arrive tous les quinze ans, U eue
a eu lieu en 1773 , faturne étant dans le noeud de
Vanneau. ■ . , ' • r •
Il peut y avoir dans la meme annee trois cauies
•qui occafionnent cette phafe ronde : lorfque fa tu rne
cèft vers le z o me d e g r é de la vierge & des poiffons,
le plan de fon anneau, qui e ft toujours parallèle a
lui-même, mais incliné fur l’orbite, fe trouve dirige
-Vers le centre du foleil, & ne reçoit de lumière que
fur fon épaiffeur qui n’eft pas a lle z confidérable pour
êtreapperçue de fi loin ; faturne alors paroit rond
& fans anneau. Huygens le vit ainfi en 1655 ( Xr‘
fatum. ). M. Maraldi obferva aufli cette phale ronde,
depuis le 14 o f to b r e jufqu’au premier février 1715
( Mém. Acad. 1714 , page 71 ; '7 lâ , page iz ; y iC ,
j,âge /7z ). Dans certains cas, ondiftingue une bande
dbfcure qui traverfe faturne par le milieu, ôç qui
eft formée par l’ombre de Vanneau fur fon difqiïe
( Mém. Acad. 1714, page )• - , •
11 fuffit que le foleil foit eleve fu r le plan de 1 an-
fieau de 8 ', pour qu’il paroiffe éclairé ; aulfi cet anneau
ne difparoît faute de lumière, que pendant un mois,
c’eft-à-dire, quinze jours avant & après le paflage de
faturne parle point du ciel qui eft à 5 * zo 0 ou 11 s
ao 0 de longitude.
L'antleau de faturne difparoît encore , lorfque le
■ J)lan de cet anneau paffe par notre oeil, étant dirigé
vers la terre ; nous ne voyons, alors que fon epaif-
feur qui eft trop petite ou qui réfléchit trop peu
de lumière, pour qu’on puifle l’appercevoir. M. Hein-
fius penfe qu’il faut que la terre foit élevée de 30
ou d’un demi-dégré fur le plan de Vanneau ., pour
qu’on puifle l’appercevoir avec un télefcope de
2, pieds, ou avec une bonne lunette de 15 pieds ;
înais je crois qu’on peut l’appercevoir à une moindre
•élévation. . v . . ... . / ; . ,nA ;;
Il y a une troifieme caufe qui peut faire difparoitre
pour nous Vanneau de faturne, c’eft lorfque fon plan
paffe entre nous & le foleil ; car alors fa furface
éclairée n’ eft point tournée vers nous : tant que faturne
eft entre ,11 ! 10 0 & 5 * 0 de longitude, le
foleil éclaire la furface méridionale de Vanneau; fi la
terre eft alors élevée fur la furface feptentrionale,
elle ne peut voir la lumière de Vanneau, & ce fera
un des teins de la phafe ronde ; ainfi 1 on peut voir
difparoître les anfes deux fois dans la même année,
& les voir reparoîtrè deux fois, comme on l’a véritablement
obfervé(Mém. Acad. 1716.').
Soit LM A (-fig. 4. Planches d'Agronomie, dans
te Supplément;) , le globe de faturne, fur lequel
on imaginera trois cercles pour repréfehter l’écliptique
, l ’orbite de faturne, & le cercle de Vanneau.
ILa ligne NM repréfente l’orbite que le foleil paroît
décrire en trente ans autour de faturne ; cette
orbite eft exactement dans le même p l a n & décrite
•avec les mêmes vîteffes’ que l’orbite de faturne vue -
du foleil. Le-cercle A T O S L représente la trace du
plandeV anneau fur la furface de faturne ; enfin, le
cercle N O I repréfente un plan qui paffe par le
centre de faturne, parallèlement à l’écliptique ou au
plan de l’orbite terreftre : ce plan N 0 I prolongé
dans l’immenfité de la fphere célefte, tpaffe fur les
mêmes étoiles & marque dans le ciel la même trace
& les mêmes points que le plan de l’orbe terreftre.
également prolongé. L’arc N O I appartient donc à
un plan que Ton conçoit parallele.au plan del’éclip-
tique, faifant en N un angle de i ° 307 20 " qui eft
l ’inclinaifon de l’orbite de faturne , à 3 * 21 0 31 ' de
longitude jpour 1750,comptée fur l’ écliptique NO I.
Suppofons le noeud S de Vanneau & de l’orbite de
faturne, à 5 s 20 0 8 ' pour l’année 1744, avec
M. Heinfius, & le noeud # de faturne à 3 * 21 0 5 5 ' ,
la diftance S N fera -de 58 ° 13 fi l’on connoît
l’angle S , inclinaifon de Vanneau fur l’orbite de fa-
turne, que les obfervations donnent de 30 0, on
pourra réfoudre le triangle N S O. L’on trouvera
N O — 54 0 41 f o " q ui, ajouté à la longitude du
noeud N , donnera pour la longitude du noeud O ,
5 s 1 6 0 3 6 ''3 0 " ; c’eft ce que MM. Maraldi &
Heinfius appellent la longitude du noeud de Vanneau
fur l'écliptique. Mais quoique le cercle NO I repré-?
fente l’écliptique, il ne faut pas imaginer que la
terre ou le foleil décrive ce Cercle réellement, c’eft
feulement un cercle parallèle dont les pôles étant
prolongés dans l’immenfité de la fphere étoilée, ré-1
pondent aux mêmes points que les pôles de l’écliptique
, ou de l’orbite de la terre. Si l’on' fuppofe la
terre en T, avec une latitude T E , égale à celle de
faturne vue de la terre , le point E étant éloigné de
fix lignes de la longitude géocentrique de faturne
réduite,à l’écliptique, telle qu’on l’obferve de la
terre, l’arc T E l’angle T O E nous feront trouver
O E , & par conféquent la longitude du noeud O.
fur l’écliptique. Dans la dilparition de Vanneau, ob-
fervée au mois d’oûobre 17 14 , le lieu de faturne
dans l’écliptique , oppofé au point E , étoit de 5 s.
19 0 15 1 vu de la terre, fuivant M. Maraldi. La latitude
leptentrionale E T de la terre, égale à celle de
faturne, étoit 1 0 5 1 '; d’où l’on conclut le côté
E O = 3 0 3 & la longitude du noeud 0 5 *16 0 12'.
Ces déterminations donnent aufli un moyen de trouver
le noeud S de Vanneau fur. l’orbite de faturne ;
car dans le triangle S O N , fuppofant l’angle S &C
l’angle N connus, & la diftance O N du noeud N de
l’orbite au noeud O de Vanneau fur l’écliptique, aufli
connue, on trouve S N qui, ajouté à la longitude
du noeud N de l’orbite de faturne, donne celle du
noeud S de Vanneau fur l’orbite de faturne. - ‘
Dans la détermination du noeud de Vanneau , on
fuppofe connue fon inclinaifon, parce qu’une petite
incertitude fur l’inclinaifon n’empêcheroit pas qu’on
ne déterminât fort bien, le lieu du noeud. Paffons
actuellement à la recherche de cette inclinaifon : ’
lorfque faturne eft le plus éloigné du noeud de Vanneau
, &fque la terre eft la plus élevée au-deffus dit
plan de Vanneau, il nous paroit fous la forme d’une
eliipfe, dont le petit axe eft la moitié du grand, du
moins en réduilant les obfervations au centre du
foleil ; ainfi , en fuppofant Vanneau abfolument cir*
culaire, il faut que fon inclinaifon foit de 30 0 fur le
plan de l’orbite de faturne, pour paroître fous cette
forme ; par-là il eft ailé de lavoir quelle doit être
l’inclinàifon de cet anneau fur le plan de l'écliptique ;
car dans le triangle N O S on connoît l’angle iV^la
diftance N S des noeuds & l’angle S ; on aura facilement
l’angle O qui eft de 31 0 20 ' ; mais nous n’ob-
fer.vons jamais Vanneau d’une fi grande ouverture, à
caufe de la latitude de faturne..
Il eft aifé de déduire de ces principes la figure de
Vanneau pour un tems donné, car elle rie dépend que
de l’élévation de la terre fur le plan de cet anneau.
Soit B le lieu de la terre oppofé à la longitude géo-
centrique de faturne, B F la latitude de la terre vue
de faturne , égale à la latitude de faturne vue de la
terre , mais de dénomination contraire, O F la dif-
j férence entre la longitude de la terre vue de faturne,
& celle du noeud de Vanneau fur l’écliptique; dans le
triangle F B O , l’on cherchera B O , & l’angle O, la
fomme ou la différence de B O F fk. de l’angle S O F ,
inclinaifon de Vanneau fur l’écliptique de 3 10 23
donnera l’angle S O B ou G O B ; dans le triangle
B O G , l’on connoît l’hypothenufe O B , & l’angle
B O S , l’on cherchera B G qui eft la latitude de la
terre , par rapport à Vanneau, vue de faturne , bu
l’élévation de la terre au-deffus de Vanneau.
Par le moyen de l’élévation de notre oeil fur le
plan de l 'anneau, on trouve la figure de Vanneau,
o«
bu le rapport des axes de fon eliipfe apparente pdiif
un tems quélconque ; car le grand axe eft toujours
au petit, comme le rayon eft au finus de l’élévation
ou de l’obliquité.
L’élévation du foleil au - deffus du plan de Vanneau
eft plus aifée à calculer. Suppofons le foleil en
C fur l’orbite qu’il paroît décrire autour de faturne,
l’arc C D perpendiculaire fur Vanneau L S A , C D eft
la latitude du foleil, par rapport à Vanneau qui fe
trouve en difant à le finus total eft au finus de la diftance
héliocentrique CS de faturne au noeud S de
Vanneau, mefurée fur l’orbite de faturne M C SN ,
comme le finus de l’angle S 31 0 201 eft au finus de
C D qui eft l’inclinaifon du rayon folaire fur le plan
de Vanneau ; ou l’élévation du foleil, par rapport
à ce plan. De-là on pourroit conclure les tems où
l'angle de cette inclinaifon eft affez petit, pour que
le foleil ne puifle plus éclairer fenfiblement une des
furfaces de Vanneau, & nous le rendre vifible. On
peut âufli par les mêmes principes réduire les obfervations
qu’on en fait fur la terre à celles qui auroient
lieu pour un obfervateur fitué dans le foleil, & trouver
l’inclinaifon de Vanneau fur l’orbite de faturne
qui eft de 30 °, tandis qu’eilé eft de 3 1 0 20' fur l’éclip*
tiqué.
L'ahh 'eau de faturne eft une efpece de couronne
plate, fort mince, mais comprife entre deux cercles
concentriques, dont le plus grand a environ 42 " de,
diamètre, tandis que le globe de faturne en a 18,
c’eft-à-dirë, qu’ils font entr’eux comme 7 eft à 3 , le
cercle intérieur à 30 " de diamètre ; ainfi la largeur dé
la couronne eft de 6 " tout autour, de même que
l’efpacë vuide compris entre faturne & Vanneau, &
les rayons des trois cercles font de 9 " , 1 5 " & 21 " 9
réduits aux moyennes diftanées de faturne à la terré
pu au foleil, Car il y a un dixième de différence, fuivant
les divers teins de l’année ; la largeur de cette
couronne Ou l’ëpaiffeur des anfes eft divifée en deux
parties dont l’intérieuire paroît avoir une lumière
continue fans interruption ; la partie extérieure pa-
roît divifée par anneaux concentriques , fuivant
M . Short. Vanneau de faturne paroît n’être pas exactement
plan, car M. Maraldi obferva qu’une des
anfes difparoiffoit avant l’autre, & M. Heinfius affure
que le 29 novembre 1743 , l’anfe orientale étoit
plus courte que l’autre; ce qui femble annoncer qu’il
y a un peu de courbure dans Vanneau.
J’ai dit que Vanneau eft comme un plan ou un
corps très-mince; en effet, quand il eft dirigé vers
nous & que fon plan paffe par notre oeii, nous ne
diftinguons rien ; nous le perdons de vu e , parce
qu’il n’y a pour lors que fon épaiffeur qui fe préfente
à nous, & elle eft trop petite pour être diftinguée;
il eft vrai qu’alors on voit l’ombre de Vanneau fur le
difque de faturne, parce que le foleil l’éclaire obliquement
& qu’il y a par conféquent une ombre plus
large que celle de l’épaifleur de Vanneau ; mais quand
Vanneau eft dirigé Vers le foleil & que fon épaiffeur
lèule eft éclairée > il difparoît également ; ce qui
prouve que cette épaiffeur eft fort petite, e’eft-à-
dire, infenfible pour nous ; car elle pourroit être de
trois à quatre cens lieues, fans que nous puflions la
diftinguer , le diamètre.réel de Vanneau étant de
67518 lieues, & un quart de fecônde étant infenfible
fur une planete aulfi peu éclairée. ( M. U E l a
L a n d e . ) ^
A n n e a u dit Pêcheur, ( H ifi. ecctêf. ) c’eft le fceau
dont le pape fcelle tous les brefs apoftoliques. Cet
anneau^ ’appelle anneau du pêcheur, parce qu’on
■ fuppofe que S. Pierre qui étoit pêcheur, en a ufé le
premier pour fceller ces brefs apoftoliques , & que
les papes s’en fervent après lui. Cependant lés auteurs
judicieux s’accordent tous qu’il n’y a qu’enyiron 400
Tome ƒ*
A u f f i - t ô t q u e l e p a p e a r e n d u l ’ e f p r i t , l e c a r d i n a l
C a m e r l i n g u e e n h a b i t v i o l e t , v i e n t , a c c o m p a g n é d e s
c l e r c s d e l a c h a m b r e e n h a b i t n o i r , r e c o n n o î t r e l e
c o r p s d u p a p e : m ’ a p p e l l e t r o i s f o i s p a r f o n n o m d e
b a p t ê m e , & f a t t d r e l l e r u n a û e f u r f a m o r t p a r l e s
p r o t o n o t a i r e s a p o f t o l i q u e s . U - d e f f u s i l p r e n d d u
m a u r e d e l a c h a m b r e d u p a p e l ’ , M „ M B d u p ê c h é h r •
p o u r l e f a i r e r o m p r e ; & c e f c e a u c e l t e j u f q u ’ a p r t e
1 é l e c t i o n d u n o u v e a u p a p e . ( + )
A n n e a u x de Samothrace, ( Hiß. anc. ) a'nnuli
Samothracuferrei ; c ’ é t o i e n t d e s e f p e c e s d e t a l i f m a n s
q u e l a f u p e r f t i t i o n a v o i t i n v e n t é s , & q u e l ’ i m p o f t u r e
a c c r e d i t o i t ; o n g r a v o i t f u r c e s anneaux d e s c a r a c t è r
e s m a g i q u e s , & o n y e n f e r m o i t d e l ’ h e r b e c o u p é é
e n d e c e r t a i n s t e m s , o u d e p e t i t e s p i e r r e s t r o u v é e s
f o u s d e c e r t a i n e s c o n f t e l l a t i o n s . C e u x q u i p o r t o i e n t
e e s anneaux f e e r o y o i e n t à l ’ a b r i d e t o u t e s f o r t e s d é
r e v e r s j & a f f u r é s d u f u c c è s d e t o u t c e q u ’ i l s ë n t r e -
p r e n o i e n t ; o n l e s a p p e l l o i t Samothraciens, p a r c e q u e
l e s p e u p l e s d e c e t t e î l e s ’ a p p l i q u o i e n t p a r t i c u l i é r e m
e n t à é t u d i e r l e s f e c r e t s d e l a n a t u r e . ( L . )
§ A N N E C Y , ( Géogr. ) v i l l e d u d u c h é d e S â v o i e
d a n s l e G e n e v o i s , à f e p t l i e u e s f u d d e G e n e v e & à
c i n q n o r d - o u e f t d e C h a m b é r y . E l l e e f t f u r l a r i v i e r e
d e S i e r a u b o r d d u l a c q u i p o r t e f o n n o m . L a v i l l e e f t
a f f e z g r a n d e & a f f e z c o m m o d e ; i l y a u n c h â t e a u , p l u -
f i e u r s é g l i f e s , q u e l q u e s c o u v e n s & u n e c o m m a n d e r i e
^ o r < ^ r e J e a n < C ’ e f t j d e p u i s 1 5 3 $ ! , l a r e t r a i t e
d e l e v e q u ë & d e s c h a n o i n e s d e G e n e v e q u i f u r e n t
. c h a f f é s d e c e t t e v i l l e p r o t e f t a n t e . L e l a c d ’ A n n e c y p e u t
a v o i r q u a t r e o u c i n q l i e u e s d e l o n g u e u r & u n p e u
p l u s d ’ u n e d e m i - l i e u e d e l a r g e u r ; i l e f t e n t r e d e
h a u t e s m o n t a g n e s p r e f q u e t o u j o u r s c o u v e r t e s d e
n e i g e s : o n . d i t q u ’ i l e f t f i p r o f o n d e n q u e l q u e s e n d
r o i t s , q u e l ’ o n n ’ a p a s p u e n c o r e e n t r o u v e r l e
f o n d . Long. 2 .7 , 40. lat. 4 J , 40. ( C. A . )
§ A N N E L E T , f . m . annelus, ( terme de Blafon. )
p e t i t a n n e a u q u i m e u b l e l ’ é c u ; l e s annelets f o n t f o u -
v e n t e n n o m b r e , & r e p r é f e n t e n t l e s a n n e a u x d e s
a n c i e n s c h e v a l i e r s ;
L e s annelets f o n t d e s m a r q u e s d e j u r i f d i & i p n , d e
g r a n d e u r & d e n o b l e f f e .
C e m o t v i e n t d u l a t i n annelus, a n n e a u .
L o n g p e r i e r d e C o r v a l , d i o c e f e d e R o u e n ; d'azur
a trois annelets d'or.
D e C o e t m e n e n B r e t a g n e ; de gueules à neuf anne—
iets dé argent.
V i e u x p o n t d e F a t o u v i l l e , d i o c e f e d e S e e z ; d'argent
à d ix annelets de gueules, g , g , b 1. (G .D .L .T . )
t A N N I B A L , ( Hijl. des Carthaginois. ) d o n t l e n o m
r é v e i l l e e n n o u s l ’i d é e , d ’ u n g é n i e f a i t p o u r l a g u e r r e ,
é t o i t d e l a f a m i l l e B a r c a ; l a p l u s i l l u f t r e d e C a r t
h a g e . Ü n ’ a v o i t e n c o r e q u e f é p t a n s , l o r f q u e f o r t
p e r e A m i l e a r , l e p l u s g r a n d c a p i t a i n e d e f o n f i e c l e ,
l u i f i t j u r e r f u r l e s a u t e l s d e s d i e u x , p r o t e c t e u r s d é
C a r t h a g e , u n e h a i n e é t e r n e l l e c o n t r e l e s R o m a i n s ,
& j a m a i s f e r m e n t n é f u t p l u s r e l i g i e u f e m e n t r e m p l i .
Annibal é l e v é f o u s l a t e n t e d e f o n p e r e , f e f a m i l i a -
r i f a a v e c t o u s l e s p é r i l s ; l e s f a t i g u é s d u c a m p f o r t i f
i è r e n t f a v i g u e u r n a t u r e l l e , l e s c o m b a t s f u r e n t l e s
a m u f e m e n s d e f a j e u n e f f e ; f o n é d u c a t i o n t o u t e g u e r r
i è r e d é v e l o p p a l e g e r m e d ’ h é r o ï f m e r e n f e r m é d a n s
f o n a m e , & l a n a t u r e f e m b l a l u i a v o i r r é v é l é d e s
f e c r e t s q u e l e s h o m m e s o r d i n a i r e s n ’ a p p r e n n e n t
q u ’ a v e c l e s f e c o u r s d e l ’ e x p é r i e n c e ; A m i l e a r t u é d a n s
l e s b r a s d e l a v i c t o i r e , f u r v é c u t à l u i - m ê m e d a n s u r t
f i l s q u i a v o i t l e f e u d e f e s r e g a r d s , l a f i e r t é d e f e s
t r a i t s & d e f a d é m a r c h e . C e g r a n d h o m m e l u i l a i i l k
p o u r h é r i t a g e f o n i n t r é p i d i t é t r a n q u i l l e , f o n d é f i n t é - ;
r e f f e m e n t àc f e s i n c l i n a t i o n s b e l l i q u e u f e s , f a c a p a c
i t é , &c f u r - t o u t f a h a i n e c o n t r e l e s R o m a i n s .
Jrianncn, chef de la faétion oppofée à la famille
mil