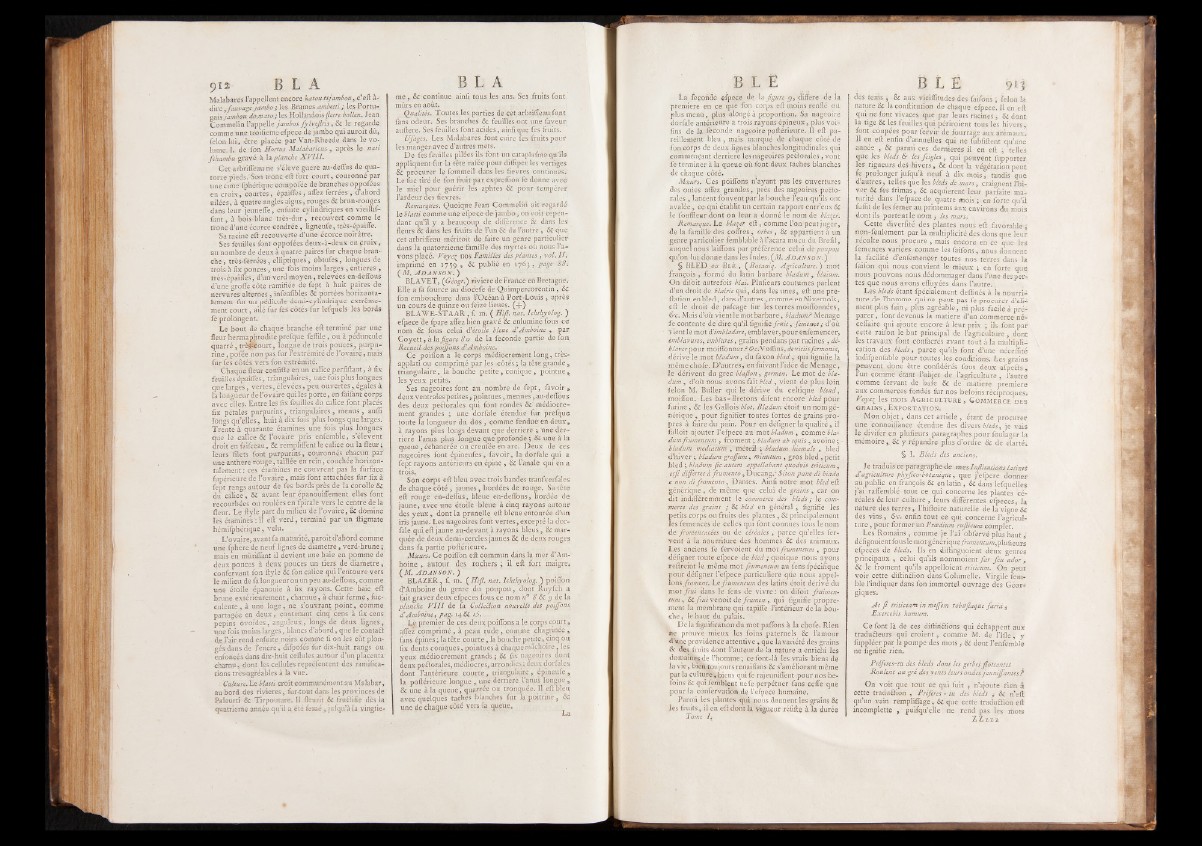
Malabares l’appellent encore katou tsjâmhouyc'enà.-
dire .fauvagejambo ; les Brames ambuti ; les Portu-
gais JamJiQu doimato ; les Hollandois ferre bóllen. Jean
Commelin l’appelle jambos fylveftris, & le regarde
comme une troilieme efpece de jambo qui auroit du,
félon lui, être placée par VanrRheede dans le volume;
I; de fon Hortus Malabarious , après le nati
fchambu gravé; à la planche X VUL
Cet arbriffeau ne s’élève guere au-deffus de quatorze
pieds. Son tronc eft fort court, couronné par
une cime fphérique COmpofée de branches oppofées
en croix, courtes., épaiffes, affez ferrées , d’abord
ailées, à quatre-angles aigus, rouges & brun-rouges
dans leur jeuneffe, enfuite cylindriques en vieillif-
fant, à bois'blanc très-dur, recouvert comme lé
tronc d’une écorce cendrée , ligneùfe, tcès-épaiffe.
Sa racine eft recouverte d’une écorce noirâtre.
Ses feuilles font oppofées deiîx-à-deux en croix,
au nombre de deux à quatre paires fur chaque branche,
très-ferrées, elliptiques, obtufes, longues de
trois à fix pouces, une fois moins larges , entières ,
très-épaiffes, d’un verd moyen, relevées en-deflbus
d’une groffe côte ramifiée de fept à huit paires de
nervures alternes , infenfibles & portées horizontalement
fur un pédicule demi-cylindrique extrêmement
court, ailé fur fes côtés fur lefquels les bords
fè prolongent.
Le bout de chaque branche eft terminé par une
fleur hermaphrodite prefque feflile, ou à péduncule
quarré, trèfSçoûrt, longue de trois pouces, purpurine
, pofée non pas. fur l’extrémité de l’ovaire, mais
fur fes côtés vers fon extrémité.
Chaque fleur confifte en un calice perfiftant, à fix
feuilles épaifles, triangulaires, une fois plus longues
que larges, vertes, élevées, peu ouvertes ^égales à
l'a longueur de l’ovaire qui les porte, en faifant corps
avec elles. Entre les fix feuilles du calice, font placés
fix pétales purpurins, triangulaires , menus , auffi
longs qu'elles, huit à dix fois plus longs que larges.
Trente à quarante étamines une fois plus longues
que le calice & l’ovaire pris enfemble, s’élèvent
droit en faifcèau, & rempliffent le calice ou la fleur ;
leurs filets font purpurins, couronnés chacun par
une antheré rouge, taillée en rein, couchée horizontalement:
ces étamines ne couvrent pas la furface
fupérieure de l’ovaire, mais font attachées fur fix à
fept rangs autour de fes bords près de la corolle &
du calice, & avant leur épanouiffement elles font
recourbées o,u roulées en fpirale vers le centre de la
fleur. Le ftyle part du miliéu de l’ovaire, oc domine
les étamines : il eft verd, terminé par un ftigmate
hémifphérique, velu.
L’ovaire, avant fa maturité, paroît d’abord comme
une fphere de neuf lignes de diamètre, verd-brune ;
mais en mûriffant il devient une baie en pomme de
deux pouces à deux pouces un tiers de.diamètre,
confervant fon ftyle & fon calice qui l’entoure vers
le miiieu de fa longueur ou un peu au-deffous, comme,
une étoile épanouie à fix rayons. Gette baie eft
brune extérieurement, charnue, à chair ferme, fuc-
culente, à une loge, ne s’ouvrant point, comme
partagée en deux, contenant cinq cens à fix cens
pépins Ovoïdes, anguleux,,'longs de deux lignes,
une fois moins larges, blancs d’abord, que le contaCt
4,e l’air rend enfuite noirs comme fi on les eut plongés
dans de i’encre, difpofés'fur dix-huit rangs ou
enfoncés dans dix-huit cellules autour d’un placenta
charnu, dont les cellules repréfentent des ramifications
très-agréables à la vue.
- Culture. Le blaiù croît communément au Malabar,
au bord des rivières, fur-tout dans les provinces de
Paleurti & Tirpoutare. 11 fleurit & fruCtifie dès la
quatrième année qu’il a été femé , jufqu’à la vingtieme,
8c continue ainfi tous les ans. Ses fruits font
mûrs en août.
Qiialités. Toutes les parties de cet; arbriffeau. font
fans odeur; Ses branches & feuilles ont une faveur
auftere. Ses feuilles fontacides, ainfi que fes fruits.
U f âges. Les Malabares font cuire fes fruits pour
les manger.avec d’autres mets.
De fes feuilles pilées ils font un cataplafrrie qu'il»
appliquent fur la tête rafée pour diffiper, les vertiges
& procurer le fommeil dans les fievres continues;
Lefuc tiré de fon fruit par exprefïion fè donne avec
le miel pour guérir les-aphtes & pour tempérer
Fardeur des fievres.
Remarques. Quoique Jean Commelin ait regardé-
1e blatti comme une efpece de jambo , oh voit cependant
qu’il y a beaucoup, de, différence & dans les-
fleurs & dans les fruits de l’un &- de l’autre , & que
cet arbriffeau méritoit de Taire un genre particulier
dans la quatorzième famille des myrtes ou nous l’avons
placé. Voyei(_ nos Ramilles des plantes , vol. U.
imprimé en 1759 ■> Pù^hé en 1763 -, page 8 81
( A f. A d a n s o n . )
BLAVET, (Gèogr.) riviere de France eri Bretagne.
Elle a la fource au diocefe de Quimpercorentin , 8ç
fon embouchure dans l’Océan à Port-Louis , après
un cours de quinze ou feize lieues. (T ) •
BLAWE-STAAR , f. m. ( Hifi. nat. Ichthyolog. )
efpece de fpare affez bien gravé & enluminé fous ce'
nom & fous celui à?étoile bleue d'Amboine , par
Coyett , à la figure 8 0 de la fécondé partie de fon.
Recueil des poijfons £Amboine.
Ce poilfon a le corps médiocrement long, très-
applati ou comprimé par les côtés; la tête grande,
triangulaire, la bouche petite, conique, pointue,
les yeux petits.
Ses nageoires font au. nombre de fept, favoir %
deux ventrales petites, pointues, menues, au-deffous
des deux peCtorales qui font rondes 8c médiocrement
grandes ; une dorfale étendue fur prefque
toute la longueur du dos, comme fendue en deux,
à rayons .plus longs devant que derrière ; Une derrière
l’anus plus longue que profonde ; & une à la
queue, échancree Ou creufée en arc. Deux de ces
nageoires font épineufes,-fa voir, la dorfale qui a
fept rayons antérieurs en épine , & l’anale qui en a
trois.
Son corps eft bleu avec trois bandes tranfverfales
de chaque cô té, jaunes, bordées de rouge. Sa tête
eft rouge en-deffus, bleue en-deflbus, bordée de
jaune, avec une étoile bleue à cinq rayons autour
des veu x, dont la prunelle eft bleue entourée d’un
iris jaune. Les nageoires font vertes, excepté la dorfale
qui eft jaune au-devant à rayons, bleus, & marquée
de deux demi-cercles jaunes 8c de deux rouges
dans fa partie poftérieure.
Moeurst Ce poiflon eft commun dans la mer d’Amboine
,. autour des rochers ; il eft fort maigre;
(A f . A d an so n . )
BLAZER, f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog) poiflon
d’Amboine du genre du poupou, dont Ruyfch a
fait graver deux efpeces fous ce nom n° 8 8c <) de la
planche VIII de fa Collection nouvelle des poijjons
£Amboinç, pag. 14 8ç iS,
Lé premier de ces deux poiffons. a le corps court,
affez comprimé, à peau rude, comme chagrinée,
fans épines ; la tête courte, la bouche petite, cinq ou
fix dents coniques, pointues à chaque mâchoire, les
yeux médiocrement grands ; & fix nageoires dont
deux peCtorales, médiocres, arrondies.; deux çlorfales
dont l’antérieure courte, triangulaire , épineufe ,
la poftérieure longue , une derrière l’anus longue ,
& une à la queue, quarrée ou tronquée. Il eft bleu
avec quelques taches blanches fur la poitrine , 8c
une de chaque côte vers la queue,
La
La fécondé efpece de la figure J |f différé de la
première en ce que fon corps eft moins renflé où
plus menu, plus alongé à proportion. Sa nageoire
dorfale antérieure a trois rayons épineux, plus voi-
fins de là fécondé nageoire poftérieure. Il eft pareillement
bleu, mais marqué de chaque côté de
fon corps de deux lignes blanches longitudinales qui
commençant derrière les nageoires peCtorales, vont
fe terminer à la:queue où font deux taches blanches
de chaque côté.
Moeurs. Ces pôiflblis n’ayant pas les ouvertures
des ouies affez grandes, près des nageoires pectorales
, lancent fouvent par la bouche l’eau qu’ils ont
avalée, ce-qui établit un certain rapport entr’euxôc
le foufflewr dont on leur a donné le nom de blaser.
Remarque. Le blaser eft, comme Fon peut juger,
de la famille des coffres, orbes -, 8c appartient à un
genre particulier femblable à Facara mu cm du Brefil,
auquel nous laiflons par préférence celui de poupon
qu’on lui donne dans les Indes. (Af. A d an s o n .)
§ BLED .ou Bl é , ( Botaniq. Agriculture. ) mot
François , formé du latin barbare bladum,. blaïum.
On difoit autrefois b lai. Plufieurs coutumes parlent
d’un droit Je blairie qui, dans les unes, eft une pre-
ftation en bled, dans d’autres, comme en Nivernois,
eft le droit de pafçage fur les terres moiffonnées,
&c. Mais d’où vient le mot barbare, bladum? Ménagé
fe contente de dire qu’il fignifie fruit, femence ; d’où
Vient le mot iïimbladare, emblaver, pour enfemencer,
èmblavures, emblures, grains pendans par racines , dé-
blaver pour moiffonner/* <5’e;Voffi.us, devitiisfermonis,
dérive le mot bladum, du faxon blad., qui fignifie la
mêmeehofe. D ’autres, enfuivantl’idée de Ménagé,
le dérivent du grec blafion, germèn. Le mot de bladum
, d’où nous avons fait bled, vient de plus loin
félon M* Buller qui le dérive du celtique blead,
moiffon. Les bas-Bretons difent encore bled pour
farine , & les Gallois Æ/o*. Bladum étoit un nom générique
, pour lignifier toutes fortes de grains propres
à faire du pain. Pour en défigner la qualité, il
falloit ajouter l’efpece au mot bladum , comme bladum
frumentum , froment ; bladum ab equis, avoine ; -
bladum mediatum , méteil ; bladum hiemale , bled
d’hiver ; bladum grojfum, minutum, gros bled , petit
bled ; bladum fie autem appellabant quodvis triticum,
etjî difftrret à frumento , Ducang.“ Siton pane di biado
e non di fromento, Dantes. Ainfi notre mot bled eft
générique, de même que celui de grains, car on
dit indifféremment le commerce des bleds ; le commerce
des graine ; 8c bled en général, fignifie les
petits corps ou fruits des plantes, & principalement
les fomencès de celles qui font connues fous le nom
de fromehtacées ou de céréales , parce qu’elles fervent
à la nourriture des hommes & des animaux.
Les anciens fe fervoient du mot frumentum , pour
défigner toute efpece de bled ; quoique nous ayons
reftreint le même mot frumentum au fensSpécifique
pour défigner l’efpece particulière que nous appelions
froment. Le frumentum des latins étoit dérivé du
mot frui dans le fens de vivre : on difoit firuimen-
tum, & frui venoit de frumen, qui fignifie proprement
la membrane qui tapiffe l’intérieur de la bouche
, le haut du palais.
k De la lignification du mot paffons à .la chofe; Rien
he prouve mieux les foins paternels & l’amour
d’une providence attentive , que la variété des grains
& des fruits dont1 Fauteur de-la nature a enrichi les
domaines de l’homme; ce font-là les vrais biens de
la vie, bien.toujours renaiflans 8c s’améliorant même
par la culture^ biens quife rajeuniffent pour' nos be-
îbins & qui femblent ne fe perpétuer fans eeffe que
pour la confervation de l’efpece humaine.
Parmi les plantes qui nous donnent les grains &
les fruits, il en eft dont la vigueur réfifte à la durée
Tome h
dés fems j 8c aux viciflitùdes des faifons ; leloh lâ
nature 8c la conftitution de chaque efpece. Il en eft
qui ne font vivaces que par leurs racines ; & dont
la tige & les feuilles qui périroient tous les hivers;
font coupées pour fervir de fourrage aux animaux..
Il en eft enfin d’annuelles qui ne iubfiftent qu’une
année , & parmi ces dernieres il en eft , telles
que les bleds & les feigles, qui peuvent fupporter
les rigueurs des hivers, 8c dont la végétation peut
fe prolonger jufqu’à neuf à dix mois ; tandis que
d’autres, telles que lés bleds de mars, craignent l’hiver
& fes frimas, & acquièrent leur parfaite ma,
turité dans l’efpace de quatre mois ; en forte qu’il
fufiît de les femer au printems aux environs du mois
dont ils portent le nom 3 Les mars;
Cette diveriïté des plantes nous eft favorable ;
non-feulement par la multiplicité des dons que leur
récolte nous procure , mais encore eri ce que les
femences variées. comme les faifons , nous donnent
la facilité d’enfemencer toutes nos terres dans la
faifon qui nous convient le mieux ; eh forte que
nous pouvons nous dédommager dans l’une des pertes
que nous avons effuyées dans l’autre:
Les bleds étant fpéeialement deftinés à la hourri-
ture de l’homme qui ne peut pas fe procurer d’aliment
plus fain, plus agréable, ni plus facile à préparer
, font devenus la matière d’un commerce né-
ceflaire qui ajoute encore à leur prix ; ils font par
cette raif'on le but principal de l’agricuitiirè , dont
les travaux font confacrés avant tout à la multiplication
des bleds, parce qu’ils font d’une néceflité
indifpenfable pour toutes les conditions. Les grains
peuvent Jqnc être confidérés fous deux afpects ,
l’un comme étant l’objet de l’agriculture, Fautré
comme fervant de bafe & de matière première
aux commerces fondés fur nos befoins réciproques;
Voye^ les mots A g r ic u l t u r e , C o m m e r c e d e s
g r a in s , Ex p o r t a t io n .
Mon o bjet, dans cet article , étant de procurer
une connoiflànce étendue des divers bleds, je vais
le divifer en plufieurs paragraphes pour foulager la
mémoire,. & y répandre plus d’ordre 8c de clarté;
§ I. Bleds des anciens ;
Je traduis ce paragraphe de mes Inftnations latines
£ agriculture phyjîco-botanique, que j’efpere donner
au public en françois 8c en latin, 8c dans lefquelles
j’ai raffemblé tout ce qui concerne les plantes céréales
& leur culture , leurs différentes efpeces 3 la
nature des terres, l’hiftoire naturelle de la vigne 8c
des vins , 6*c< enfin tout ce qui concerne l’agriculture
, pour former un Proedium rufiieum complet.
Les Romains , comme je l’ai obfervé plus haut ;
défignoient fous le mot générique frumentum,plufieurs
efpeces de bleds. Ils en diftinguoient deux genres
principaux , celui qu’ils nommoient far feu ador ,
8c le froment qu’ils appelloient triticum. On peut
voir cette diftinâlion dans Columelle. Virgile fem-
bie l’indiquer dans fon immortel ouvrage des Géor-
giques.
At f i Iriiicèam in Ttiefiim tobüfiaqùe farrd 4
Exercebis humum.
Ce font là de ces diftiriéfiôns qui échappent aux
traducteurs qui croient, comme M. de Fl fie , y
fuppléer par la pompe des mots, 8c dont l’enfemblë
ne fignifie rien;
P référés-tu des bleds dont les gerbesflottantes
Roulent au gré des vents leurs ondes jaunififantes?
On voit que tout ce qui fuit # n’ajoute rien à
Cette traduction , Préférés - tu des bleds & n’eft
qu’un vain rempliffage, & que cette traduction eft
incomplette , puifqu’çlle ne rend pas les mots
Z Z z z z