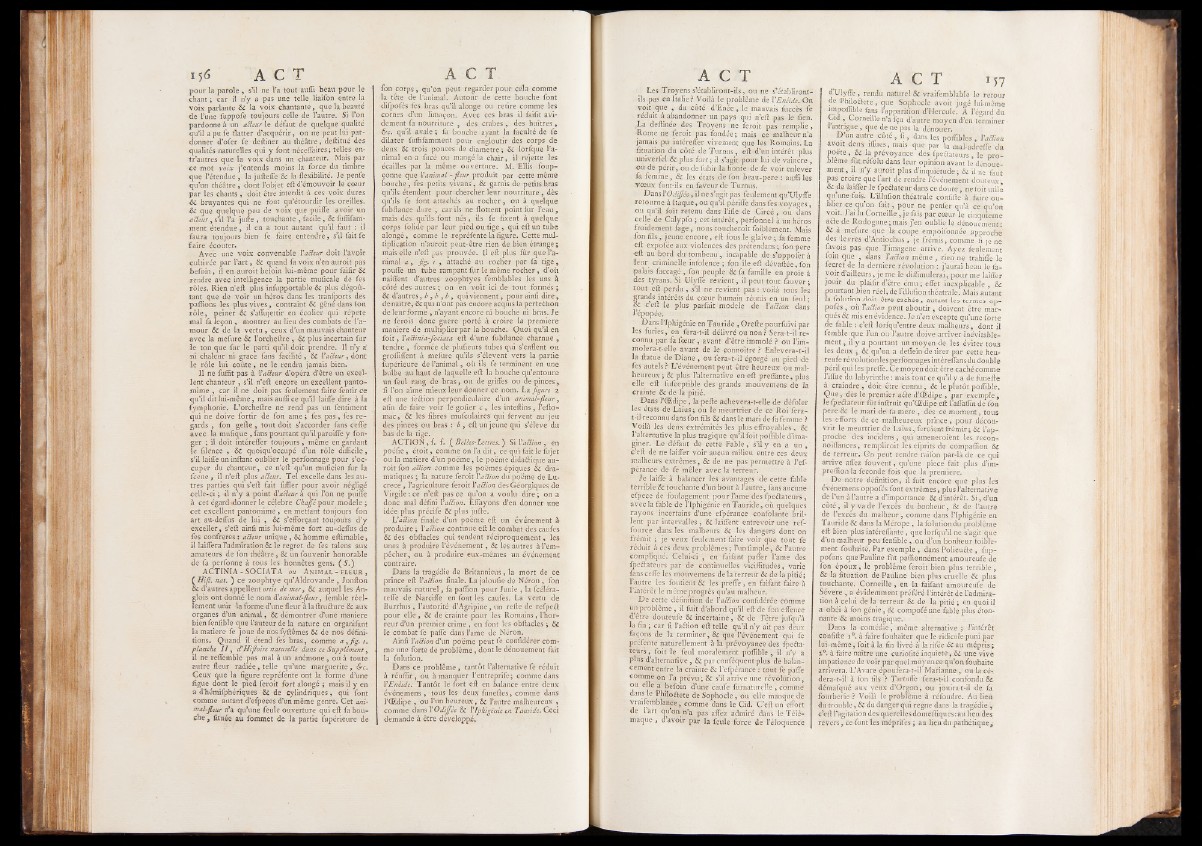
pour la. parole , s’il ne l’a tout auffi beau pour le
chant ; car il n’y a pas une telle liaifon entre la
voix parlante & la voix chantante, que la beauté
de l’une fuppofe toujours celle de l’autre. Si l’on
pardonne à un acteur le défaut de quelque qualité
qu’il a pu fe flatter d’acquérir, on ne peut lui pardonner
d’ofer fe deftiner au théâtre, deftitué des
qualités naturelles qui y font néceffaires ; telles en-
t r ’aiitres que la voix dans un chanteur. Mais par
ce mot voix j’entends moins la force du timbre
que l’étendue , la jufteffe & la flexibilité. Je penfe
qu’un théâtre , dont l’objet eft d’émouvoir le coeur
par les chants , doit être interdit à ces voix dures
& bruyantes qui ne font qu’étourdir les oreilles.
& que quelque peu de voix que puiffe avoir un
acteur, s’il l’a jufte , touchante , facile, & fuffifam-
ment étendue, il en a tout autant qu’il faut : il
faura toujours bien fe faire entendre, s’il fait fe
faire écouter.
Avec une voix convenable l'acteur doit-l’avoir
cultivée par l’a r t , & quand fa voix n’en auroit pas
befoin, il en auroit befoin lui-même pour faifir &
rendre avec intelligence la partie muficale de fes
rôles. Rien n’eft plus infupportable & plus dégoûtant
que de voir un héros dans les tranfports des
pallions les plus viv es , contraint & gêné dans fon
rô le , peiner & s’affujettir en écolier qui répété
mal fa leçon , montrer au lieu des combats de l’amour
& de la vertu , ceux d’un mauvais chanteur
avec la mefure & l’orcheftre , & plus incertain fur
le ton que fur le parti qu’il doit prendre. Il n’y a!
ni chaleur ni grâce fans facilité , & Y acteur, dont
le rôle lui coû te, ne le rendra jamais bien.
Il ne fuffit pas à l'acteur d’opéra d’être un excellent
chanteur , s’il n’efl: encore un excellent pantomime
, car il ne doit pas feulement faire fentir ce
qu’il dit lui-même, mais aufli ce qu’il laifle dire à la
fymphonie. L’orcheftre ne rend pas un fentiment
qui ne doive fortir de fon ame ; fes p a s, fes regards
, fon gefte , tout doit s’accorder fans ceffe
a v ec la mufique , fans pourtant qu’il paroiflfe y fon-
ger ; il doit intéreffer toujours, même en gardant
le filence , & quoiqu’occupé d’un rôle difficile,
s’il laifle un inftant oublier 'le perfonnage pour s’occuper
du chanteur, ce n’eft qu’un muficien fur la
fcene, il n’eft plus acteur. T e l excelle dans les autres
parties qui s’eft fait fiffler pour avoir négligé
celle-ci ; il n’y a point d’acteur à qui l’on ne puiffe
à cet égard «donner le célébré Ckajfé pour modele ;
cet excellent pantomime, en mettant toujours fon
art au-deffus de lui , & s’efforçant toujours d’y
exceller, s’eft ainfi mis lui-même fort au-deffus de
fes confrères : acteur unique , & homme eftimable,
il laiffera l’admiration & le regret de fes talens aux
amateurs de fon théâtre, 8c un fouvenir honorable
de fa perfonne à tous les honnêtes gens.' ( 5\)
ACTINIA - SOCIATA ou Animal - fleur ,
( Hiß. nat. ) ce zoophtye qu’Aldrovande, Jonfton
& d’autres appellent ortie de mer, 8c auquel les An-
glois ont donné le nom d’animal-fleur, femble réellement
unir la forme d’une fleur à la ftruriure 8c aux
organes d’un animal, & démontrer d’une maniéré
bien fenfible que l’auteur de la nature en organifant
la matière fe joue de nos fyftêmes 8c de nos définitions.
Quand il étend fes bras, comme a.,fig. i.
planche I I , <£Hifioire naturelle dans ce Supplément,
il ne reffemble pas mal à un anémone , ou à toute
autre fleur radiée, telle qu’une marguerite , &c.
Ceux que la figure repréfente ont la forme d’une
figue dont le pied feroit fort alongé ; mais il y en
a d’hémifphériques & de cylindriques, qui font
comme autant d’elpeces d’un même genre. Cet animal
fleur n’a qu’une feule ouverture qui eft fa bouche
, fituée au fommet de la partie fupérieure de
fon corps, qu’on peut regarder pour cëla comme
la tête de l’animal. Autour de cette bouche font
difpofés fes bras qu’il alonge ou retire comme les
cornes d’un limaçon. Avec ces bras il faifit avidement
fa nourriture , des crabes , des huîtres ,
&c. qu’il avale ; fa bouche ayant la faculté de fe
dilater fuffifamment pour engloutir des corps de
deux & trois pouces de diamètre ; 8c lorfque l’animal
en a fucé ou mangé la chair, il rejette les
écailles par la même ouverture. M. Ellis foup-
çonne que Y animal - fleur produit par cette même
bouche, fes petits vivans, fk garnis de petits bras
qu’ils étendent pour chercher leur nourriture , dès
qu’ils fe font attachés au rocher, ou à quelque
fubftance dure , car ils ne flottent point fur l’eau,
mais dès qu’ils font nés , ils fe fixent à quelque
corps folide par leur pied pu tige , qui eft un tube
alongé, comme le repréfente la figure. Cette multiplication
n’auroit peut-être rien de bien étrange;
mais elle n’eft pas prouvée. Il eft plus fûr que l’animal
a , fig, i , attaché au rocher par fa tig e,
pouffe un tube rampant fur le même rocher, d’oîi
naiffent d’autres zoophtyes femblables les uns à
. côté des autres ; on en voit ici de tout formés ;
& d’autres, b , b , b , qui viennent, pour ainfi dire,
de naître, 8c qui n’ont pas encore acquis la perferiion
de leur forme , n’ayant encore ni bouche ni bras. Je
ne ferois donc guère porté à. croire la première
maniéré de multiplier par la bouche. Quoi qu’il en
fo i t , l’dciinia-fociata eft d’une fubftance charnue ,
tendre , formée de plufieurs tubes qui s’enflent ou
grofliflënt à mefure qu’ils s’élèvent vers la partie
lupérieure de l’animal, où ils fe terminent en une
bulbe au haut de laquelle eft la bouche qu’entoure
un feul rang de bras, ou de griffes ou de pinces,
fi l’on aime mieux leur donner ce nom. La figure x
eft une feriion perpendiculaire d’un animal-fleur,
afin de faire voir le gofier c , les intèftins , l’efto-
mac, & les fibres mufculaires qui fervent au jeu
des pinces ou bras : b , eft un jeune qui s’élève du
bas de la tige.
A C T IO N , f. f. ( Belles-heures. ) Si Vaction , en
poéfie ; étoit, comme on l’a dit, ce qui fait le fujet
ou la matière d’un poëme, le poëme didactique auroit
fon action -comme -les poëmes épiques & dramatiques
; la nature feroit Y action du poëme de Lucrèce
, l’agriculture feroit Y action des Géorgiques de
Virgile : ce n’eft pas ce qu’on a voulu dire ; on a
donc mal défini Y action. Effayons d’en donner une
idée, plus précife 8c plus jufte.
L’aSion finale d’un poëme eft un événement à
produire ; Y action continue eft le combat des caufes
& des obftacles qui tendent réciproquement, les
unes à produire l’événement, 8c les autres à l’empêcher,
ou à produire eux-mêmes un événement
contraire.
Dans la tragédie de Britannicus, la mort de ce
prince eft Y action finale. La jaloufie de Néron , fon
mauvais naturel, fa paflion pour Junie , la feéléra-
teffe de Narciffe en font les caufes. La vertu de
Burrhus , l’autorité d’Agripine, un refte de refperi
pour e lle , & de crainte pour les Romains , l’horreur
d’un premier crime , en font les obftacles ; 8c
le combat fe paffe dans l’ame de Néron.
Ainfi Yaltion d’un poëme peut fe confidérer comme
une forte de problème, dont le dénouement fait
la folution.
Dans ce problème, tantôt l’alternative fe réduit
à réuflïr, ou à manquer l’entreprife; comme dans
Y Enéide. Tantôt le fort eft en balance entre deux
événemens , tous les deux funeftes, comme dans
l’CEdipe , ou l’un heureux, 8c l’autre malheureux ,
comme dans YOdiJfée & YIphi génie en Tauride. Ceci
demande à être développé.
Les Troyens s’établiront-ils, ou ne s’établiront-
-ils pas en Italie ? Voilà le problème de Y Enéide.^ On
voit que , du .côté d’Enée, le mauvais fuccès fe
réduit à abandonner un pays qui n’eft pas le fien.
La deftinee des Troyens ne feroit pas remplie,
Rome ne feroit pas fondée ; mais ce malheur n’a
jamais pu intéreffer vivement que les Romains. La
fituation du côté de Turnus, eft d’un intérêt plus
univerfel 8c plus fort ; il s’agit pour lui de vaincre ,
;ou de périr, ou de fubir la.honte de fe voir enlever
fa femme, & les états de fon beau-pere : aufli les
voeux font-ils en faveur de Turnus.
Dans YOdijJée, il ne s’agit pas feulement qu’Ulyffe
retourne à Itaque, ou qu’il périffe dans fes vo yag es,
ou qu’il foit retenu dansTifle de C irc é , ou dans
.celle de Caiypfo ; cet intérêt, perfonnel à un héros
froidement, fage-, nous toucheroit foiblement. Mais
fon.fils , jeune -encore , eft fous le glaive ; fa femme
eft expofée aux violences des prétendans;; fon pere
•eft au bord du tombeau , incapable de s’oppofer à
leur criminelle infolence ; fon île eft dévaftée, fon
palais faccagé, fon peuple & fa famille ;én proie à
des tyrans. Si Ulyffe revient, il peut tout fauver ;
tout eft p e r d u s ’il né revient pas: voilà toits les
grands intérêts du coeur humain réunis en un feul;
& c’eft le plus parfait modèle de Y action dans
l ’épopée;
Dans l ’Iphigénie en Tauride , Orefte pourfuivi par
les furies, en fêra-t-il délivré ou non? Sera-t-il reconnu
par fa foeü r, avant d’être immolé ? ou l’im-
molera-t-elle avant de le connoître ? Enlevera-t-il
la ftatue de Diane , ou fera-t-il égorgé au pied de
les autels ? L’événement peut être heureux ou malheureux
; & plus l’alternative en eft preffante, plus
elle eft fufceptible des grands mouvemens de la
crainte & de la pitié.
Dans l’OEdipe, la pefte achevera-t-elle de défoler
les états de Laïus; ou le meurtrier de ce Roi fera- i
t il reconnu dans fon fils & dans le mari de fa femme ?
Voilà les deux extrémités les plus effroyables, 8c
l ’alternative la plus tragique qu’il foit poffible d’imaginer.
Le défaut de cette Fable, s’il y en a un ,
c’eft de ne laiffer voir aucun milieu entre ces deux
malheurs extrêmes, & de ne pas permettre à l’ef-
pérance de fe mêler avec la terreur.
Je Iaiffe à balancer les avantages de cette fable
terrible & touchante d’un bout à l’autre, fans aucune
efpece de foulagement pour l’ame des fpeélateurs ,
avec la fable de T’Iphigénie en Tauride, où quelques.
rayons incertains d’une efpérance confolante brillent
par intervalles; & laiffent entrevoir une ref-
fource dans les malheurs & les dangers dont on
frémit ; je veux feulement faire voir que tout fé
réduit à ces deux problèmes ; l’unfimple, & l’autre
compliqué. Celui-ci , en faifant paffer l’ame des
fpeâàteurs par de continuelles viciflitudes, varie
fans cefle les mouvemens de la terreur & de la pitié;
l’autre les foutiènt Sc les preffe , en faifant faire à
l ’intérêt le même progrès qu’au malheur.
De cette définition de Yaçlion confidérée comme
un problème , il fuit d’abord qu’il eft de fon effence
d’être douteufe & incertaine, & de l’être jufqu’à
la fin ; car. fi l’aftion eft telle qu’il n’y ait pas deux
façons de la terminer, & que l’événement qui fe
préfente naturellement à la prévbyance des fpefta- :
teurs, foit lé feul moralèment -poflible , il n’y a
plus d’alternative , & par conséquent plus de balancement
entre la crainte & l’efpérance : tout fe paffe
comme on l’a prévu ; & s’il arrive une révolution,
ou elle a befoin d’une caufe furnaturelle , Comme
dans le Philo rie te de Sophocle, ou elle manque de
vranemblan.ee, comme dans le Cid. 'C’eft un effort
de lart qu’on n’a pas affez admiré dans le Télémaque
, d avoir par la feule force de l’éloquencè
d’Ulyffe, rendu naturel & vraifemblable le retour
de Philoriete, que Sophocle avoit jugé lui-même
nnpoflible fans l’apparition d’Hercule. A l’égard du
Cid , Corneille n’a fçu d’autre moyen d’en terminer
1 intrigue , que de ne pas la dénouer.
D ’un autre co té, f i , dans les poflibles , Y action
avoit deux îffues, mais que par la mal-adreffe du
P°Aete » & ia prévoyance des fperiateurs , le problème
fût.réfolu dans leur opinion avant le dénouement,
il n’y auroit plus d’inquiétude; 8c il ne faut
; pas croire que l’art de rendre l’événement douteux,
& de laiffer le fperiateur dans ce doute, ne foit utile
qu’une-fois. L’illufion théâtrale confifte à , faire oublier
ce^qu’on fa it, pour ne penfer qu’à ce qu’on
! voit. J’ai lu Corneille , je fais par coeur le cinquième
; -arie de Rodogune ; mais.j’en oublie le dénouement :
& ,à mefure que la coupe empôifonnée approche
des levres d’Antiochus , je frémis, comme fi je ne
; fayoîs pas . que Timagene arrive. Ayez feulement
foin que , dans faction même, rien ne trahiffe le
fecret de la derniere révolution : j’aiirai beau le fa-
voird’ailleurs, je me.le diflimulerai, pour me laiffer
jouir du plaifir d’être ému ; effet inexplicable , &
pourtant bien réel, de l’illufion théâtrale. Mais autant
la folution doit être cachée, autant les termes op-
pofés, où f action peut aboutir, doivent être marques
& mis en évidence. Je n’en excepte qu’une forte
de fable : c’eft lorfqu’entre deux malheurs, dont il
femble que l’un ou l ’autre doive arriver inévitablement,
il y a pourtant un moyen de les .éyitër tous
les deux , & qu’on .a deffein de tirer par cette heu-
reufe révolution les perfonnages intéreffans du double
péril qui les preffe. .Ce moyen doit être, caché comme
ï’ifliie du labyrinthe : mais tout ce qu’il y a de funefte
à craindre , doit être connu , & le plutôt poflible.
Qu e, dès le premier arie d’CÉdipe., par exemple,
le fperiateur rûtinftruit qu’OEdipe eft l’affaffin de fon
pere & le mari de fa mere , dès ce moment, tous
les efforts de ce malheureux prince i, ..pour découvrir
le meurtrier de Laïus, feroientfrémir; & l’approche
des ineidens , qui ameneroiènt les, recon-
noiffances, rempliroit les efprits de compaflion &
de terreur. On peut rendre raifon par-là de ce qui
arrive aflèz fouvent, qu’une piece fait plus d’im-
preflion la fécondé fois que la première.
De notre définition, il fuit encore que plus les
événemens oppofés font extrêmes, plus l’alternative
de l’un à l’autre a d’importance & d’intérêt. Si, d’un
cô té, il y va de l’excès du bonheur, & de l’autre
de l’excès du malheur, comme dans l’Iphigénie en
Tauride & dans la Mérope , la folution du problème
eft bien plus intéreffante, quelorfqu’il ne s’agit que
d’un malheur peu fenfible ,.ou d’un bonheur foiblement
fouhaité. Par exemple, dans Polieurie , fup-
pofons quePauline fût paflionnément amoureufe de
fon époux, le problème feroit bien plus terrible ,
& la fituation de Pauline bien plus cruelle & plus
touchante. Corneille, en la faifant amoureufe de
Sévere , a évidemment préféré l’intérêt de L’admiration
à celui de la terreur & de la pitié; en quoi il
a obéi à fon génie , 8c compoféune fable plus étonnante
& moins tragique.
Dans la comédie, même alternative ; l’intérêt
confifte i° . à faire fouhaiter que le ridiccïle puni par
lui-même, foit à la fin livré à la rifée & au mépris ;
i° . à faire naître une curiofité inquiété, & une vive
impatience dë voir par quel moyence qu’on fouhaité
arrivera. L’Avare époülera-t-il Marianne ,' oula cé-,
dera-^t-il à fon fils ? Tartuffe fera-t-il confondu Sz
démafqué aux yeux d’O rgon, ou jouira-t-il de fa
fourberie ? Voilà le problème à réfoudre. Au lien
du trouble * & du danger qui régné dans la tragédie ,
c’eft l’agitation des querelles domeftiquesrau lieu des
revers, Ce font les méprifes ; au lieti du pathétique,-