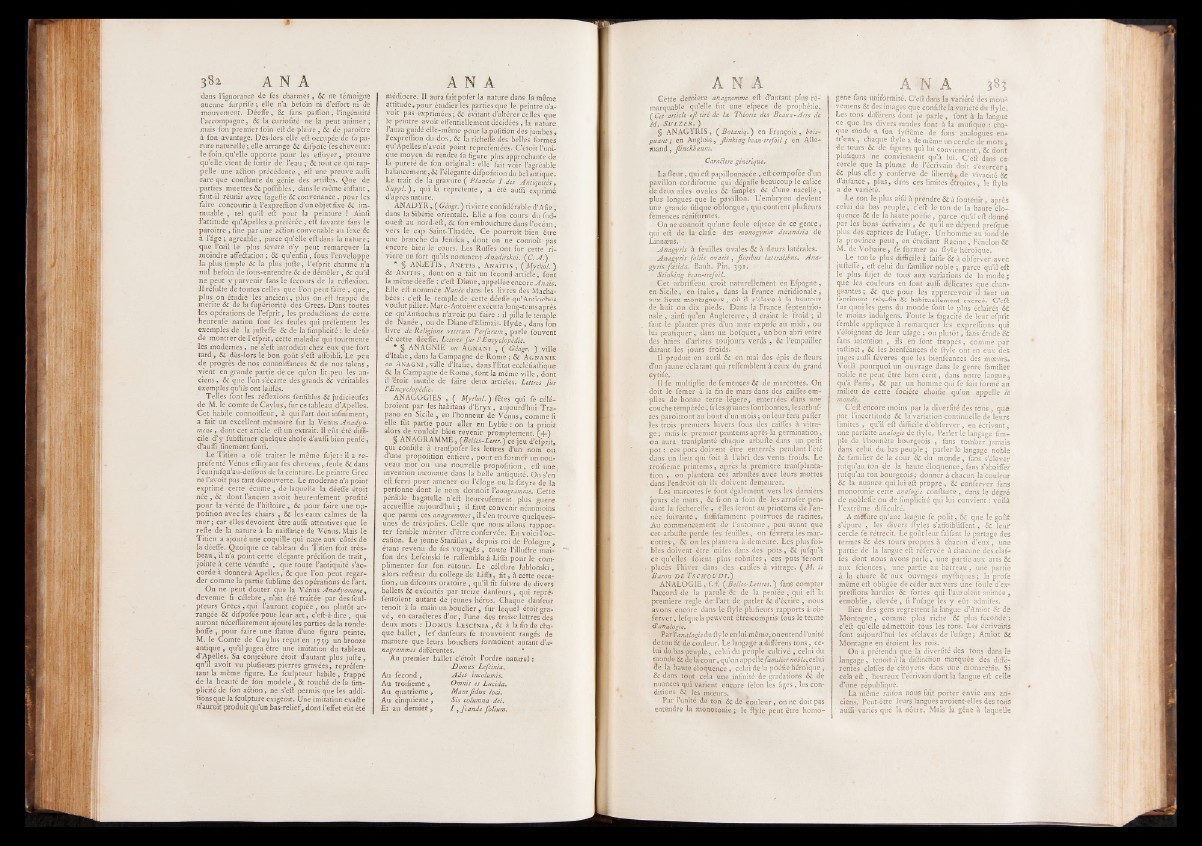
s
■ dans l’ignorance de fes charmes, & ne témoigne
aucune furprife ; elle n’a befoin ni d’effort ni de
mouvement. Déeffe, & fans paffion, l’ingénuité
l’accompagne, & la curiofité ne la peut animer ;
mais ion premier foin eft de plaire , & de paroître
à fon avantage. Dès-lors elle eft occupée de fa parure
naturelle ; elle arrange & difpo'fe fes cheveux:
le foin, qu’elle apporte pour les effuyer, prouve
^qu’elle vient de fortir de l’eau ; & tout ce qui rappelle
une aâion précédente , eft une preuve aulïi
rare que confiante du génie des artiftes. Que de
I parties muettes & poffibles, dans le même inftant,
faut-il réunir avec fageffe & convenance, pour les
faire concourir à l’expreffion d’un objet fixe & immuable
, tel qu’il eft pour la peinture ! Ainfi
l’attitude qu’Apelles a préférée , eft favante fans le
paroître , fine par une a&ion convenable au fexe & à l’âge ; agréable , parce qu’elle eft dans la nature ;
■ que l’oeil le plus lever e n’y peut remarquer la
moindre affeâation ; & qu’enfin , fous l’enveloppe
•la plus fimple & la plus jufte, l’efprit charmé n’a
nul befoin de fous-entendre & de demêler, & qu’il
ne peut y parvenir fans le fecours de la réflexion.
II réfulte de toutes celles que l’on peut faire , que,
plus on étudie les anciens, plus on eft frappé du
mérite & de la fupériorité des Grecs. Dans toutes
les opérations de l’efprit, les produftions de cette
heureufe nation font les feules qui préfentent les
exemples de la jufteffe & de la fimplicité : le delir
de montrer de l’efprit, cette maladie qui tourmente
les modernes , ne s’eft introduit chez eux que fort
tard, & dès-lors le bon goût s’eft affoibli. Le peu
de progrès de nos connoiffances & de nos talens ,
vient en grande partie de ce qu’on lit,peu les anciens
, & que l’on s’écarte des grands & véritables
exemples qu’ils ont laiffés.
Telles font les réflexions fenfibles & judicieitfes
de M. le comte de Caylus, fur ce tableau d’Apelles.
Cet habile connoiffeur, à qui l’art doit infiniment,
a fait un excellent mémoire fur la Vénus Anadyo-
mene , dont cet article eft un extrait. Il eût été difficile
d’ y fubftituer quelque chofe d’aufli bien penfé,
d’aufli finement fenti.
Le Titien a ofé traiter le même fujet : il a re-
préfenté Vénus effuyant fes cheveux, feule & dans
l ’eau jufqu’au-deffous de la ceinture. Le peintre Grec ,
ne l’avoit pas tant découverte. Le moderne n’a point
exprimé cette écume, de laquelle la déeffe étoit
née , & dont l’ancien avoit heureufement profité
pour la vérité de l’hiftoire, & pour faire une op-
pofition avec les chairs , & les eaux calmes de la
mer ; car elles dévoient être auffi attentives que le
refte de la nature à la naiffance de Vénus. Mais le
Titien a ajouté une coquille qui nage aux côtés de
la déeffe. Quoique ce tableau du Titien foit très-
beau , il n’a point cette élégante précifion de trait,
jointe à cette vénufté , que toute l’antiquité s’accorde
à donner à Apelles, & que l’on peut regarder
comme la partie fublime des opérations de l’art.
On ne peut douter que la Vénus Anadyomene,
devenue fi célébré, n’ait été traitée par des fcul-
pteurs Grecs , qui l’auront copiée , ou plutôt arrangée
& difpofée pour leur art, c’eft-à-dire , qui
auront néceffairement ajouté les parties de la ronde-
boffe , pour faire une ftàtue d’une figure peinte.
M. le Comte de Caylus reçut en 1759 un bronze
antique , qu’il jugea être une imitation du tableau
d’Apelles. Sa conjecture étoit d’autant plus jufte ,
qu’il avoit vu plufieurs pierres gravées, repréfen-
tant la même figure. Le fculpteur habile, frappé
de la beauté de fon modèle , & touché de l’a fimplicité
de fon aâion, ne s’eft permis que les additions
que la fculptureiexigeoit. Une imitation exa&e
n’auroit produit qu’un bas-relief, dont l’effet eût été
médiocre. Il aura fait pofer la nature dans la même
attitude, pour étudier les parties que le peintre n’a-
voit pas exprimées ; & évitant d’altérer celles que
le peintre avoit effentiellement décidées, la nature
l’aura guidé elle-même pour la pofition des jambes,
lexpreflïon du dos, & larichefle des belles formes
qu’Apelles n’avoit point repréfentées. C’étoit l’unique
moyen de rendre fa figure plus approchante de
la pureté de fon original : elle fait voir l’agréable
balancement, & l’élégante difpofition du bel antique.
Le trait de la gravure ( Planche I des Antiquités,
Suppl. ) , qui la repréfente, a été auffi exprimé
d’après nature.
ANADYR,.( Géogr. ) riviere confidérable d’Afie,
dans la Sibérie orientale. Elle a fon cours du fud-
oueft au nord-eft, & fon embouchure dans l’océan,
vers le cap Saint-Thadée. Ce pourroit bien être
urte branche du Jenifca , dont on ne connoît pas
encore bien le cours. Les Ruffes ont fur cette rivière
un fort qu’ils nomment Anadirskoi.. (£7. A .) '
* § ANÆTIS, A n e t i s , A n a ï t i s , ( Mythol. )
& A n i t i s , dont on a fait un fécond article , font
la même déeffe : c’eft Diane, appellée encore Anaïs.
Elle eft nommée Nanéè dans les livres des Macha-
bées : c’eft le temple de cette déeffe qu’Antiochus
voulut piller. Marc-Antoine exécuta long-tems après
ce qu’Ântiochus n’avoit pu faire : il pilla le temple
de Nanée , ou de Diane d’Elimaïs. Hyde , dans fon
livre de Religione veterum Perfarum , parle. fouvent
, de cette déeffe. Lettres fur ÜEncyclopédie.
* § ANAGNIE ou A g n a n i , ( Géogr. ) ville
d’Italie, dans la Campagnè de Rome ; & A g n a n i e
ou A n a g n i , ville d’Italie, dans l’État eccléfiaftique
& la Campagne de Rome , font la même ville, dont
il ‘étoit inutile de faire deux articles. Lettres fur
V Encyclopédie.
ANAGOGIES , ( Mythol. ') fêtes qui fe célé-
broient par les habitans d’Eryx , aujourd’hui Tra-
pano en Sicile , en l’honneur de Vénus, comme fi
elle fut partie pour aller en Lybie : on la prioit
alors de vouloir bien revenir promptement. (4-)
§ ANAGRAMME, (Belles-Leur.) ce jeu d’efprit,
qui confifte à tranfpofer les lettres d’un nom ou
d’une propofition entière, pour én formef un nouveau
mot ou une nouvelle propofition , eft une,
invention inconnue dans la belle antiquité. On s’en'
eft.fervi pour amener ou l’éloge ou la fatyre de la
perfonne dont le nom donnoit 1’'anagramme. Cette
pénible bagatelle n’eft heureufement plus guere
accueillie aujourd’hui ; il faut convenir néanmoins
unes de très-jolies. Celle que nous allons rapporter
femble mériter d’être confervée. En voici l ’oc-
cafion. Le jeune Staniflas, depuis roi de Pologne ,
étant revenu de fes voyagês, toute l’illuftre mai-
fon des Lefcinski fe raffembla à Liffa pour lè complimenter
fur fon retour. Le célébré Jablonski,
alors reâeur du college de Liffa, f it , à cette occa-
fion, un difcours oratoire , qu’il fit fuivre de divers
ballets & exécutés par treize danfeurs, qui repré-
fentoient autant de jeunes héros. • Chaque danfeur
tenoit à la main un bouclier , fur lequel étoit grav
é , en caraâeres d’o r , l’une des treize lettres des
deux mots : Domus LescInia , & à la fin de chaque
ballet, leS* danfeurs fe trouvoient rangés de
maniéré que leurs boucliers formoient autant d’a-
nagrammes différentes. *
Au premier ballet c’étoit l’ordre naturel :
Domus Lefcinia.
A des incolumis.
Omnis es Lucida.
Mane Jîdus loci.
Sis columna dei.
/ , fcande folium.
Au fécond,
Au troifieme,
Au quatrième,
Au cinquième,
Et au dernier,
Cette derniere anagramme eft d’autant plus remarquable
qu’elle fut une efpece de prophétie*
Ç Cet article ejl tiré de la Théorie des Beaux-Arts de
M . SULZER. )
§ ANAGYRIS, ( Botaniq. ) en François , bois-
puant ; en Anglois, fiinking bean-trefoil ? en Allemand
, ftinckbaum*
Caractère générique.
La fleur, qui eft papillonnacée , eft compofée d’un
pavillon cordiforme qui dépaffe beaucoup le calice
de deux ailes ovales & fimples & d’une nacelle , •
plus longues que le pavillon. L’embryon devient
une grande filique oblongùe , qui contient plufieurs
femences réniformes.
On ne connoît qu’une feule efpece de ce genre ;
qui eft de la claffe des monogynia decàndria de
Linnæus.
Anagyris à feuilles Ovales & à fleurs latérales;
Anagyris foliis ovatis , floribus lateralibus. Anagyris.
foetida. Bauh. Pin. 391.
Stinking bean-trefoil.,
Get arbrifféau croît naturellement én Èfpagne ,
en S i c i l e e n Italie, dans, la France méridionale ,
aux lieux montagneux, où il s’élève à la hauteur
de huit ou dix pieds. Dans la France, feptentriô-
nale , ainfi qu’en Angleterre, il craint le froid ; il
faut le planter près d’un mur expofé au midi, ou
lui pratiquer, dans Un bôfquet, un bon abri entre
des haies d’arbres toujours verds , & l’empailler
■ durant les jours froids*
Il produit en avril & en mai des épis de fleurs
d’un jaune éclatant qui reffemblent à ceux du grand
cytife.
Il fe multiplie ae femences & de marcottes. On
doit le femer à la fin de mars dans des eaiffes emplies
de bonne terre légère, enterrées dans une
couche tempérée ; fi les graines font bonnes, les arbuf-
îes paroîtront au bout d’un mois ; on leur fera paffer
les trois premiers hivers fous des eaiffes à vitrage
; mais le premier printëms,après la germination,
on aura tranfplanté chaque arbufte dans un petit
p o t : ces pots doivent être enterrés pendant l’été
dans un lieu qui foit à l’abri des vents froids. Le
troifieme printëms, après la première tranfplanta-
tion , on plantera ces arbuftes avec leurs mottes
. dans l’endroit où ils doivent demeurer.
Lés marcotes fe font également vers les derniers
jours de mars, & fi on a foin de’ les arrofer pendant
la féchereffe , elles feront au printëms de l’année
fuivante , fuffifamment pourvues de racines*
Au commencement de l’automne, peu avant que
cet arbufte perde fes feuilles, on févrera les marcottes
, & on les plantera à demeure. Les plus foi-
bles doivent être mifes dans des pôts, '& jufqu’à
ce qu’ elles foient plus robuftes, ces pots "feront
placés l’hiver dans des eaiffes à vitrage. M. le
Baron de Ts ch o u d t .)
ANALOGIE, f. f. ( Belles-Lettres. ) fans compter
l’accord de la parole & de la penfée , qui eft la
première réglé de~ l’art de parler & d’écrire , nous
avons encore dans le ftyle plufieurs rapports à ob-
ferver, lëfquels peuvent être«compris foüs le terme
d'analogie.
Par l'anàlogte du ftyle en lui-même, on entend l’unité
de ton& de couleur. Le langage a différens tons, celui
du bas peuple, celui du peuple cultivé , celui du
monde & de la cour, qu’on appelle familier noble, celui
de la haute éloquence , celui de la pôéfie héroïque,,
& dans tout cela une infinité de gradations & de
nuances qui varient encore félon les âges, les conditions
& les moeurs*
Par l’unité de ton & dé couleur , on ne doit pas
entendre la monotonie ; le ftyle peut être homogene
fans uniformité. C’eft dans la variété des niÔU*
vemens & des images que confifte la variété du ftyle;
Les tons différens dont je parle , font à la langue
ce que les divers modes font à la mufique : cha*
que mode a fon fyftême de fons analogues en-
tr eu x, chaque ftyle a de même un cercle de mots ;
de tours & de figures qui lui conviennent, & dont
plufieurs ne conviennent qu’à lui. C ’eft dans cé
cercle que la plume de l’écrivain doit s’exercer *
& plus elle y conferve de liberté de vivacité ôC
d’aifance , plus, dans ces limites étroites, le ftylé
a de variété.
Le ton le plus aifé à prendre & à foiiténir, après
celui du bas peuple, c’eft le ton de la haute éloquence
& de la haute poëfie, parce qu’il eft donné
par les bons écrivains , & qu’il ne dépend prefquê
plus des caprices de l’ufage. Un homme au fond dé
là province peut, en étudiant Racine, Fénélon &
M. de Voltaire , fe former au ftyle héroïqüe.
Le ton le plus difficile à faifir & à obferver avec
jufteffe, eft celui du familier noble ; parce qu’il eft
le plus fujet de tous' aux variations de la mode 5
que les couleurs en font auffi délicates que changeantes
; &. que pour les appercevoir il faut un
fentiment très-fin & habituellement exercé. C ’eft
fur quoi les gens du monde font le plus éclairés &
le moins indulgens. Toute la fagacité de leur efprit
femble appliquée à -remarquer Tes expreffions qui
s’éloignent de leur ufage ; ou plutôt, fans étude &£
fans intention , ils 'en font frappés, comme par
inftinâ, & les bienféanees de ftyle ont en eux des
juges auffi féveres que les bienféanees des moeurs.
Voilà pourquoi un ouvrage dans le genre familier
noble ne peut être bien écrit, dans notre langue $
qu’à Paris , & par un homme qui fe foit formé au
milieu de cette fociété choifie qu’on appelle le
monde,
C’eft encore moins par la dîverfité des tons, qué
par l’incertitude & là variation continuelle de leurs
limites , qu’il eft difficile d’ôbferver, en écrivant,
une parfaite analogie de ftyle. Parler le langage fimple
de l’honnête bourgeois , fans tomber- jamais
dans celui du bas peuple ; parler le langage noble
& familier de la cour & du monde, fans s’élever
jufqu’au ton de la haute éloquence, fans s’abaiffer
jufqu’au ton bourgeois ; donner à chacun la couleur
& la nuance qui lui eft propre, & conferver fans
monotonie cette analogie confiante , dans le dégré
de nobleffe ou de fimplicité qui lui convient : voilà
l ’extrême difficulté.
A m&fure qu’une langue fe polit, & que le goût
s’épure , lès divers ftyles s’affôibliffent, & leur
cercle fe rétrécit. Le goût leur faifant le partage des
termes & des tours propres à chacun d’eux, une
partie de la langue eft refervée à chacune des claf-
fes dont nous avons parlé, une partie aux arts &
aux feienees, une partie au barreau, une partié
à la chaire & aux ouvrages myftiques ; la prôfe
même eft obligée de céder aux vers une foule d’ex'*
prèffions hardies & fortes qui l’auroient animée ,
ennoblie, élevée , fi l’ufage les y eût àdmifes.
Bien des gens regrettent la langue d’Amiot & de
Montagne, comme plus riche & plus féconde :
c’ eft qu’elle admettoit tous les tons. Les écrivains
font aujourd’hui les éfclaves de l’ufàge ; Affiiot &
Montagne en étoient les fois;
On a prétendu que la diverfité des tons dans le
langage, teiioit à la diftin&ion marquée des diffé*
rentes claffes de citoyens dans une monarchie. Si
cela e f t , heureux l’écrivain dont la langue eft celle
d’une république.
La même raifon nous fait porter envie aux anciens.
Peut-être leurs langues avoierit-elles des tons
‘ âuffi variés que la nôtre. Mais la gêné à laquelle