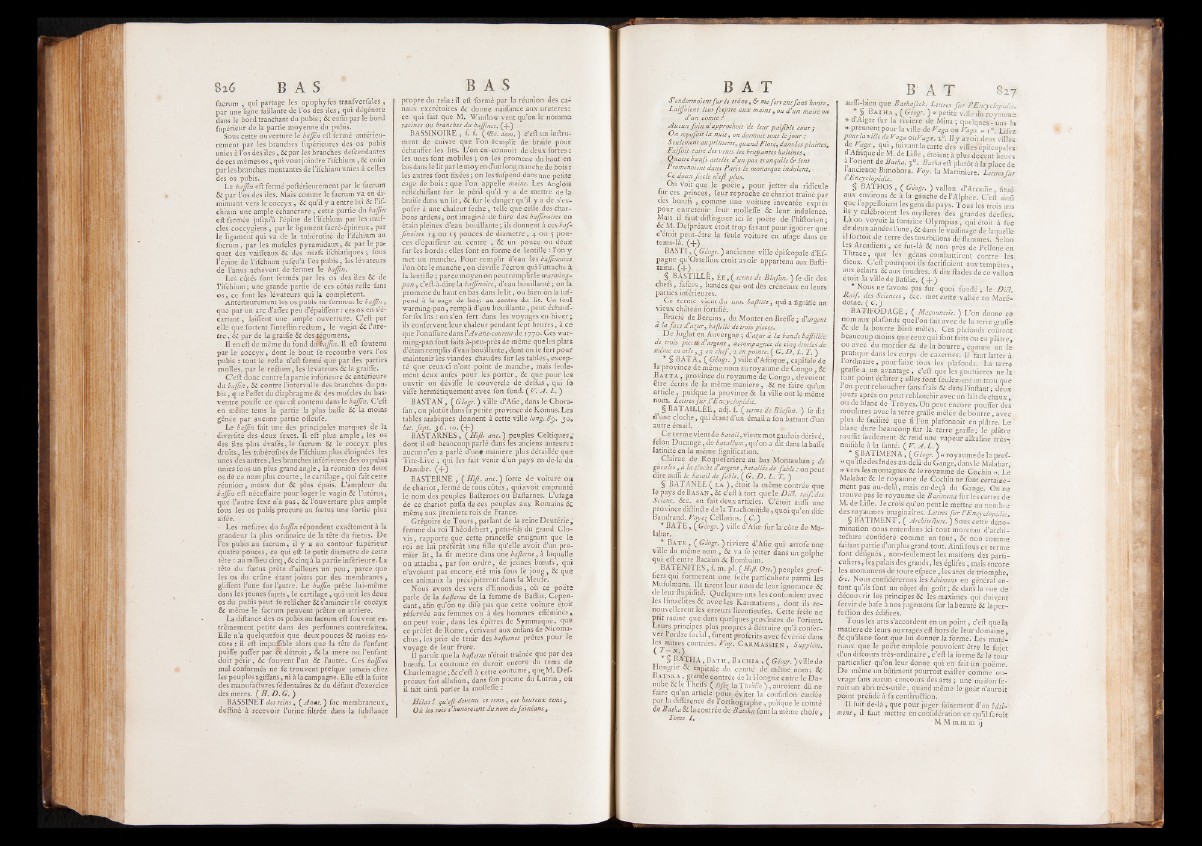
facrum , qui partage les apophyfes tranfverfales
p a r une ligne faillante de l’os des île s , qui dégénéré
dans le bord tranchant du pubis ; & enfin par le bord
fupérieur de la partie moyenne du pubis.
Sous cette ouverture le baßin eft fermé antérieurement
par les branches fupérieüres des os pubis
unies à l’os des île s , & par les branches defcendantes
de ces mêmes o s , qui vont joindre l’ifchium ,& enfin
par les branches montantes de l’ifchium unies à celles
des os pubis;
Le baßin eft fermé poftérieurement par le facrum
& par l’os des iles. Mais comme le facrum va en diminuant
vers le coc cyx, & qu’il y a entre lui & 1 if-
chium une ample échancrure , cette partie du baßin
eft fermée jufqu’à l’épine de l’ilchium par les muf-
cles coccygiens , par le ligament facré-épineux, par
le ligament qui va de la tubérofité de l’ifchium au
facrum, par les mufcles pyramidaux, & par le par.
quet des vaiffeaux & des nerfs ifchiatiques ; fous
l’épine de l’ifchium jufqu’à l’os pubis, leslevateurs
de l’anus achèvent de fermer le baßin.
Les côtés font fermés par les os des iles & de
l ’ifchium; une grande partie de ces côtés refte fans
o s , ce font les lévateurs qui la complètent.
Antérieurement les os pubis ne ferment le baßin,
que par un arc d’affez peu d’épaifleur : ces os en s’éc
a rta n t, laiffent une ample ouverture. C’eft par
elle' que fortent l’inteftin re d um , le vagin & l’ure-
t r e , par de la graiffe & des Jægumens.
Il en eft de même du fond dvÊbajfin. Il eft foutenu
p a r le co c cy x , dont le bout fe recourbe vers l’os
pubis : to u t le refte n’eft fermé que par des parties
molles, par le re d um , les levateurs & là graiffe.
C’eft donc contre la partie inférieure & antérieure
du baßin, & contre l’intervalle des branches du pubis
, que l’effet du diaphragme & des mufcles du bas-
ventre pouffe ce qui eft contenu dans le baßin. C ’eft
en même te ms la partie la plus baffe & la moins
gênée par aucune partie offeufe.
Le baßin fait une des principales marques de la
diverfité des deux fexes. Il eft plus am p le , les os
des iles plus évafés, le facrum & le coccyx plus
d ro its, les tubérofités de l’ifchium plus éloignées les
unes des a u tre s, les branches inférieures des os pubis
unies fous un plus grand angle, la réunion1 des deux
os dé ce nom plus c o u rte , le cartilage, qui fait cette
ré u n io n , moins dur & plus épais. L’ampleur du
baßin eft néceffaire pour loger le vagin & l’utérus,
que l’autre fexe n’a p a s , & l’ouverture plus ample
fous les os pubis procure au foetus une fortie plus
aifée.
Les mefures du baßin répondent exadement à la
grandeur la plus ordinaire de la tête du foetus. De
l’os pubis au facrum, il y a au contour fupérieur
quatre pouces, ce qui eft le petit diamètre de cette
tê te : au milieu c inq, & cinq à la partie inférieure. La
tête du foetus prête d’ailleurs un p e u , parce que
les os du crâne étant joints par des membranes,
gliffent l’une fur l’autre. Le baßin prête lui-même
dans les jeunes fujets, le cartilage, qui unit les deux
os du pubis peut fe relâcher & s’amincir : le coccyx
& même le facrum peuvent prê te r en arriéré.
La diftance des os pubis au lacrum eft fouvent extrêmement
petite dans des perfonnes contrefaites.
Elle n ’a quelquefois que deux pouces & moins encore
f il eft impoffible alors que la tête de l’enfant
puiffe paffer par ce d é tro it, & la mere ou l’enfant
do it p é rir, & fouvent l’un & l’autre. Ces baßins
mal conformés ne fe trouvent prefque jamais chez
les peuples agiffans, ni à la campagne. Elle eft la fuite
des manufadures fédentaires & du défaut d’exercice
des meres. ( H. D . G. )
BASSINET des reins, ( An* t. ) fac membraneux,
deftiné à recevoir l’urine filtrée dans la fubftance
p r o p r e d u r e i n : i l e f t f o r m é p a r l a r é u n i o n , d e s c a n
a u x e x c r é t o i r e s & d o n n e n a i f f a n c e a u x u r e t e r e s :
c e q u i f a i t q u e M . W i n f l o w v e u t q u ’ o n l e n o m m e
racines o u branches du baßinet. ( + )
B A S S I N O I R E , f . f . ( (Ec. dom. ) c ’ e f t u n i n f i n i m
e n t d , e c u i v r e q u e l ’ o n r e m p l i t d e b r a i f e p o u r
é c h a u f f e r l e s l i t s . L ’ o n e n - c o n n o î t d e d e u x f o r t e s :
l e s u n e s f o n t m o b i l e s ; o n l e s p r o m e n e d u . h a u t e n
b a s d a n s l e l i t p a r l e m o y e n d ’ u n l o n g m a n c h e d e b o i s :
l e s a u t r e s f o n t f i x é e s ; o n l e s f u f p e n d d a n s u n e p e t i t e
c a g e d e b o i s : q u e l ’ o n a p p e l l e moine. L e s A n g l o i s
r é f l é c h i f f a n t f u r l e p é r i l q u ’ i l y a d e m e t t r e d e l a
b r a i f e d a n s u n l i t , & f u r l e d a n g e r q u ’ i l y a d e s ’ e x -
p o f e r à u n e c h a l e u r f e c h e , t e l l e q u e c e l l e d e s c h a r b
o n s a r d e n s , o n t i m a g i n é d e f a i r e d e s baßinoires e n
é t a i n p l e i n e s d ’ e a u b o u i l l a n t e ; i l s d o n n e n t à c e s baf-
finoires 1 4 o u 1 5 p o u c e s d e d i a m è t r e , 4 o u 5 p o u c
e s d ’ é p a i f f e u r a u c e n t r e , & u n p o u c e o u d e u x :
f u r l e s b o r d s : e l l e s f o n t e n f o r m e d e l e n t i l l ç : l ’ o n y
m e t u n m a n c h e . P o u r r e m p l i r d ’ e a u l'es'baßinoires
l ’ o n ô t e l e m a n c h e , o n d é v i f f e l ’ é c r o u q u i l ’ a t t a c h e à
l a l e n t i l l e ; p a r c e m o y e n o n p e u t r e m p l i r l e warming-
p a n , c ’ e f t - à - d i r e l a baßinoire, d ’ e a u b o u i l l a n t è ; o n l a
p r o m e n e d u h a u t e n b a s d a n s l e l i t , o u b i e n ô n l a l u f -
p e n d à l a c a g e d e b o i s a u c e n t r e d u l i t . U n f e u l
w a r m i n g - p a n , r e m p l i d ’ e a u b o u i l l a n t e , p e u t é c h a u f f
e r f i x l i t s : o n s ’ e n f e r t d a n s l e s v o y a g e s e n h i v e r ;
i l s c o n f e r v e n t l e u r c h a l e u r p e n d a n t f e p t h e u r e s , à c e
q u e YonnSnxeàans]!Avant-coureuràe 1 7 7 0 . C e s w a r -
m i n g - p a n f o n t f a i t s à - p e u - p r è s d e m ê m e q u e l e s p l a t s
d ’ é t a i n r e m p l i s d ’ e a u b o u i l l a n t e , d o n t o n f e f e r t p o u r
m a i n t e n i r l e s v i a n d e s c h a u d e s f u r l e s t a b l e s , e x c e p t
é ‘ q u e c e u x - c i n ’ o n t p o i n t d e m a n c h e , m a i s f e u l e m
e n t d e u x a n f e s p o u r l e s p o r t e r , & q u e p o u r l e s
o u v r i r o n d é v i f f e l e c o u v e r c l e d e d e f f u s , q u i f a
v i f f e h e r m é t i q u e m e n t a v e c f o n f o n d . ( V. A . L. )
B A S T A N , ( Géogr. ) v i l l e d ’ A f i e , d a n s l e C h o r a -
f a n , o u p l u t ô t d a n s l a p e t i t e p r o v i n c e d e K o m u s . L e s
t a b l e ' s a r a b i q u e s d o n n e n t à c e t t e v i l l e Long. 89. 3 0 .
lat. fept. j S . i à . ( + )
B A S T A R N E S , ( Hiß. anc.') p e u p l e s C e l t i q u e s
d o n t i l e f t b e a u c o u p p a r l é d a n s l e s a n c i e n s a u t e u r s :
a u c u n n ’ e n a p a r l é d ’ u n « m a n i é r é p l u s d é t a i l l é e q u e
T i t e - L i v e , q u i l e s f a i t v e n i r d ’ u n p a y s e n d e - l à d u
D a n u b e . ( + )
B A S T E R N E , ( Hiß . anc. ) f o r t e d e v o i t u r e o u
d e c h a r i o t , f e r m é d e t o u s c ô t é s , q u i a v o i t e m p r u n t é
l e n o m d e s p e u p l e s B a f l e r n e s o u B a f t a r n e s . L ’ u f a g a
d e c e c h a r i o t p a f f a d e c e s p e u p l é s a u x R o m a i n s Ô c
m ê m e a u x p r e m i e r s r o i s d e F r a n c e .
G r é g o i r e d e T o u r s , p a r l a n t d e l a r e i n e D e u t ë r i e j
f e m m e d u r o i T h é o d e b e r t , p e t i t - f i l s d u g r a n d C l o v
i s , r a p p o r t e q u e c e t t e p r i n c e f f e c r a i g n a n t q u e l e
r o i n e l u i p r é f é r â t u n e f i l l e q u ’ e l l e a v o i t d ’ u n p r e m
i e r l i t , l a f i t m e t t r e d a n s u n e baßerne, à l a q u e l l e
o n a t t a c h a , p a r f o n o r d r e , d e j e u n e s b oe u f s , q u i
n ’ a v o i e n t p a s e n c o r e , , é t é m i s f o u s l e j o u g , & q u e
c e s a n i m a u x l a p r é c i p i t è r e n t d a n s l a M e u l e .
N o u s a v o n s d e s v e r s 7 d ’ E n n o d i u s , o ù c e p o ë t e
p a r l e d e l a baßerne d e l a f e m m e d e B a f f u s . C e p e n d
a n t , a f i n q u ’ o n n e d i f e p a s q u e c e t t e v o i t u r e é t o i t
r é f e r v é e a u x f e m m e s o u à d e s h o m m e s e f f é m i n é s ,
o n p e u t v o i r , d a n s l e s é p î t r e s d e S y m m a q u e , q u e
c e p r é f e t d e R o m e , é c r i v a n t a u x e n f a n s d e N i c o m a -
c h u s , l e s p r i e d e t e n i r d e s baßernes p r ê t e s p o u r l e
v o y a g e d e l e u r f r e r e .
I l p a r o î t q u e l a baßerne n ’ é t o i t t r a î n é e q u e p a r d e s
b oe u f s . L a c o u t u m e e n d u r o i t e n c o r e d u t e m s d e
C h a r l e m a g n e ; & c ’ e f t à c e t t e c o u t u m e , q u e , M . D é f i -
p r é a u x f a i t a l l u f i o n , d a n s f o n p o ë m e d u L u t r i n , o ù
i l f a i t a i n f i p a r l e r l a m ' o l l e f f e :
Hélas ! quef l devenu ce tems, cet heureux tems ,
Où Les rois s ’honoraient du nom de fainéans t
S 'éndormoient fu r le trône, & me fervdnt fans hortte,
Laijfoient leur feeptre aux mains , ou d ’un maire ou
. . . d’un comte ?
Aucun fo in n approchoit de leur paifible cour ;
On repofoit la nuit, on dorfrtoit tout le jour :
~ Seulement auprintems, quand Flore, dans Les plaines,
Faifo'ip taire des vents les bruyantes haleines,
Quatre boeufs attelés d’un pas tranquile & lent
Prornenoient dans Paris le monarque indolent.
Ce. doux fiecle défi plus.
On voit que le p o ë te ; po u r jetfer du ridicule
fiir ces princes, leur reproche ce chariot traîné par
des boeufs , .comme une v o itu re inventée exprès
p our entretenir leu r molleffe & leur indolence.
Mais il faut distinguer ici le poëte de Thiftorien;
, Defpréaux étoit trop favant pour ignorer que ■
c’etoit peut-être la feule voiture en ufage dans ce
temsTà. (-f),
BÂSTI, ( Géogr. ) ancienne ville épifeopalé d’Ef-
pagne qu’Ortellius croit avoir appartenu aux Bafti-
tainsj.;(+ ) ....
§ BASTILLÊ, ÉE, £ terme de Blafon. ) fë dit des
che fs, fafees., bandes qui ont des créneaux en leurs
parties inférieures.,
Ce terme vient dü mot bafliLLe, qui a lignifié un
vieux château fórtifié.
B rade 4 e Berçins , du M onfet en Breffe ; à!argent
a la face d’azur, bdfiillé de trois pièces.
■ D e Juglat en Auvergne ; d’attira la band'e bàfiillée
de ^ trois pièces d argent, accompagnée de cinq étoiles de
meme en orle ,3 en chef, x en pointe. ( G. D . L. T. )
* § BATA, ( Géogr. ) ville d’Afrique, capitale de
la provinçe de même nom au royaume de C o n g o , &
B a t t a ; province du royaume de Congo, dévoient
ê tre écrits dë la même manière, & ne faire qu’un
article , puifque la province & la ville ont le même
nom. Lettres fu r VEncyclopédie.
_ § B AT AILLÉE, adj. f. ( terme de Blafon. ) fe dit
^ ,ime cloche, qui étant d’un émail a fon battant d’un
autre émail.
Ce terme vient de £<z/d/, vieuxmot gaulois dérivé
félon Ducange, de batallum, qu’on a dit dans la baffe
latinité en la même lignification. ' •
Clairac de Roqueferiere au bas Montaubàn; de
gueules, a la cloche d’argent, batallée de fable : ôn peut
dire aufli le bataïl de fable. (G . D . L. T. )
§‘ BÀTANÉE ( LA ) ,..étoit la même contrée que
le pays de B a s a n , & c’eft à tort que le Dicl. raifdes
Scient. &c. en fait deux articles. C’étôit aufli une
province diftincîe de la Trachonitide, quoi qu’en dife
Baudrand. Voye^ Cellarius. ( à. )
* BATE, ( Géogr. ) ville d’Afie fur la7 côte de Malabar.
* B a t e , ( Géogr. ) riviere d’Afie qui arrofe une j
ville du même nom , & va fe jetter dans un golphe j
qui eft entre Bacaïm & Bombaïm.
Mufulmans. Ils tirent leur nom de leur ignorance &c
de leur ftupidité. Quelques-uns les confondent avec
les Ifmaelites & avec les Karmatiens , dont ils re-
nouvellerent les erreurs licentieu'fes. Cette feéfe ne
p rit racine que dans quelques provinces de l’orient.
Leurs principes plus propres à détruire qu’à confer-
v e r l’ordre focial, furent proferits avec févérité dans
les autres contrées. Voy. C a r m a s s i e n , Supplém.
(
§ BATHA, Ba t h , Bachia , ( Géogr. ) ville de
Hongrie & capitale du comté de même- nom; &
Bat,SK A , grande contrée de la Hongrie entre le D a nube
& le Theifs ( life^ la Theiffe ) , auroient dû ne
faire qu un article pour, éviter la confufiôn caufée
par la différence de l’orthographe , puifque le comté
de Batha & la contrée de-Bdtska font la même chofe,
Tome / .
— - - - - — — - - - - - » - u m i c i
» prennent pour la ville de Paga ou Vago. » j ° Lifez
pourld Ville de Vaga oixFagcc. Il y ayoitdeux villes
PA ? UI ’ ^u iv an tla carte des villes épifcopales
x ^ fr.1(î ue Bide , étoie’rit à plus decent lieues
a l orient de Batha. 30. Batha eft plutôt à la place de
1 ancienne Bunobora. Voy. la Martiniere. Lettres fur
§ BATHOS , ( Géogr. ) vallon d’Arcadie , fitué
aux environs & à la gauche de l’Alphée. C’eft ainfi
que l’appelloient les gens du pays. Tous les trois ans
ils, y célébroient les myfteres des grandes déeffes.
Là on voyoit la fontaine Olym p ias, qui étoit à fec
de deux années 1 une, & dans le voifinage de laquelle
il fortoit de terre des tourbillons dé flammes. Selon
les Arcadiens, ce fut-là & non près de Pellene en
T h ra c e , que les. géans combattirent contre les
dieux. C ’eft pourquoi ils facrifioient aux tempête s,
aux éclairs & aux foudres. A dix ftadës de ce vallon
e to it la ville de Bafilie. ( + )
* Nous ne favons pas fur quoi fondé , le Dic l.
Raif. des Sciences, &c. met cette vallée en Macédoine.
( G. )
BATIFODAGE, ( Maçonnerie. ) L’on donne ce
nom aux plafonds que l’ori fait avec de la terre graffe
& de la bourre bien mêlés., Ces plafonds coûtent
beaucoup m oins que ceux qui font faits ou en p lâtre ,
. ou avec du mortier & de br bourre , comme on le
pratique dans les corps de cazernesv II *faut latter à
1 ordinaire, pour Faire tbus les plafonds; La terre
graffe a un avantage, c’eft que les gouttières ne l a 1
font point éclater ; elles font feulement un trou que
1 on peut reboucher fans frais & dansl’inftant ; deux
jours après on peut reblanchir avec un lait de chaux,
oti de blanc de Troye s. On peut encore pouffer des
moulures avec la terre graffe mêlée de b o u rre , avec
plus de facilité que fi l’on plafonnoit en plâtre. Le
blanc dure beaucoup fur la terre graffe; le plâtre
rouflit facilement & rend une vapeur alkaline très*
nuifible à la fahté. ( V. A . L. )
* § BATIMENA, ( Géogr. ) « royaume de la p ref-
» qu’ifle des Indes au-delà du Gange, dans le Malabar,
» vers les montagnes & le royaume de Cochin ». Le
Malabar & le royaume de Cochin ne font certainement
pas au-delà, mais en-deçà du Gange. On ne
trouve pas le royaume de Batimena fur ies cartes de
M. de Lille. Je crois qu’on peut le mettre au nombre
des royaumes imaginaires. Lettres fu r Ü Encyclopédie.
§ BATIMENT, ( Architecture. ) Sous cette dénomination
nous entendons ici to u t morceau d’afehi--
tefture confideré comme un to u t, & non comme
faifant partie d’un plus grand tout. Ainfi foüs ce terme
font defignés , non-feulement les maifons des particuliers
, les palais des grands, les églifes, mais encore
les monumens de toute efpece, les arcs de triomphe,
&c. Nous confidererons les bâti mens en général entant
qu’ils font un objet du goût ; & dans la vue d e '
découvrir les principes & les maximes qui doivent
fervir de bafe à nos jugemens fur la beauté & la p e r-
fedion des édifice's.
Tous les arts s’accordent en un p o in t, c’eft que la
matière de leurs ouvrages eft hors de leur domaine,
& qu’ils ne font que lui donner la forme. Les matériaux
que le poëte emploie pouvoient' être le fujet
d ’un difeours très-ordinaire, c’eft là forme & lé tour
particulier qu’on leur donne qui en fait un poëme.
D e même un bâtiment p ourroit exiftér comme ouvrage
fans aucun concours des arts ; une maifon fe rait
un abri très-utile, quand même le goût n’auroit
point préfidë à fa conftrùdion.
Il fuit de-là y que pour jùgér fainement d’un bâtiment
, il faut mettre en confidération ce qu’il-feroit
M M m m m ij