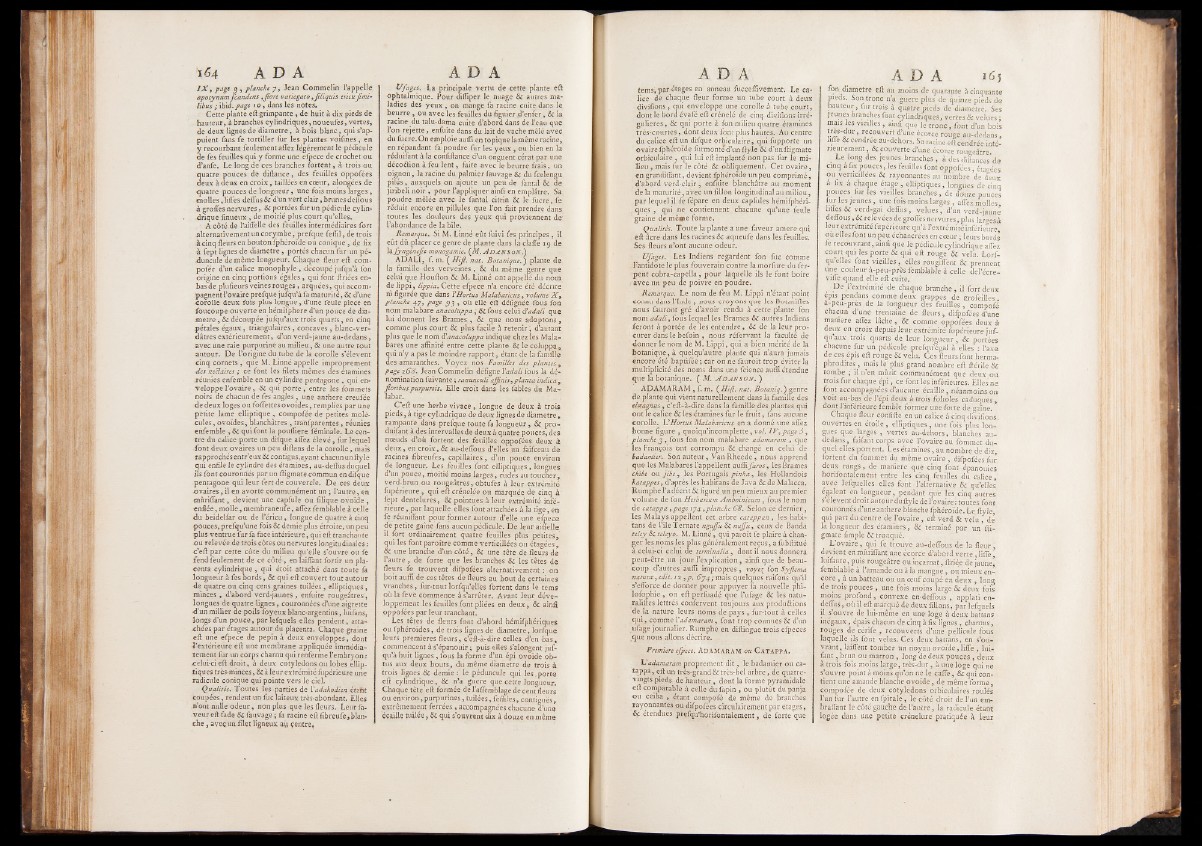
I X , page planche y , Jean Commelin l’appelle
apocynum fcandens,jlorc variegaeo 9Jiliquis ericu Jîmi-
libus } ibid. page i o , dans les notes.
Cette plante eft grimpante , de huit à dix pieds de
hauteur, à branches cylindriques, noueufes, vertes,
de deux lignes de diamètre, à bois blanc, qui s’appuient
fans fe tortiller fur les plantes voifines, en
y recourbant feulement aflez légèrement le pédicule
de fes feuilles qui y forme une efpece de crochet ou
d’anfe. Le long de ces branches fortent, à trois ou
quatre pouces dé diftance, des feuilles oppofées
deux à deux en c ro ix, taillées en coeur, alongées de
quatre pouces de longueur, une fois moins larges,
molles ,-liffes deffus& d’un vert c lair, brunes deffous
à groffes nervures, & portées fur un pédicule cylindrique
finueux , de moitié plus court qu’elles.
A côté de l’aiffelle des feuilles intermédiaires fort
alternativement un corymbe, prefque feflil, de trois
à cinq fleurs en bouton fphéroïde ou conique , de fix
à fept lignes de diamètre, portés chacun fur un pé-
duncule de même longueur. Chaque fleur eft com-
pofée d’un calice monophyle, découpé jufqn’à fon
origine en cinq portions égales, qui font ftriées en-
bas de plufieurs veines rouges, arquées, qui accompagnent
l’ovaire prefque jufqu’àfa maturité, & d’une
.corolle deux fois plus longue, d’une feule piece en
foucoupe ouverte en hémilphere d’un pouce de diamètre
, & découpée jufqu’aux trois quarts, en cinq
pétales égaux, triangulaires, concaves , blanc-verdâtres
extérieurement, d’un verd-jaune au-dedans,
avec une raie purpurine au milieu, & une autre tout
autour. De l’origine du tube de la corolle s’élèvent
cinq cornets , que M. Linné appelle improprement
des nectaires ; ce font les filets mêmes des étamines
réunies enfemble en un cylindre pentagone , qui enveloppe
l’ovaire, & qui porte, entre les fommets
noirs de chacun de fes angles, une anthere creufée
de deux loges ou follettes ovoïdes, remplies par une
petite lame elliptique, compofée de petites molécules,
ovoïdes, blanchâtres , tranfparentes, réunies
enfemble , & qui font la pouffiere féminale. Le centre
du calice porte un dilque aflez é le v é , fur lequel
.font deux ovaires un peu diftans de la corolle, mais
rapprochés entr’eux & contigus,ayant chacun un ftyle
qui enfile le cylindre des étamines, au-deffus duquel
ils font couronrfes par un ftigmate commun en difque
pentagone qui leur fert de couvercle. De ces deux
ovaires, il en avorte communément un ; l’autre, en
mûriffant, devient une capfule ou Clique ovoïde ,
«nflée, m olle, membraneufe, aflez femblable à celle
du beidelfar ou de l’éricu, longue de quatre à cinq
pouces, prefqu’une fois & demie plus étroite, un peu
plus ventrue fur fa face intérieure, qui eft tranchante
ou relevée de trois côtes ou nervures longitudinales :
c ’eft par ce^te côte du milieu qu’elle s’ouvre ou fe
fend feulement de ce cô té , en laiffant fortir un placenta
cylindrique , qui étoit attaché dans toute fa
longueur à fes bords, & qui eft couvert tout autour
de quatre ou cinq cens graines tuilées, elliptiques,
minces , d’abord verd-jaunes, enfuite rougeâtres,
longues de quatre lignes, couronnées d’une aigrette
d ’un millier de poils foyeux blanc-argentins, luifans,
longs d’un pouce, par lefquels elles pendent, attachées
par étages autour du placenta. Chaque graine
eft une efpece de pépin à deux enveloppes, dont
•l'extérieure éft une membrane appliquée immédiatement
fur un corps charnu qui renferme l’embryon :
celui-ci eft droit, à deux cotylédons ou lobes elliptiques
très-minces, & à leur extrémité fupérieure une
radicule conique qui pointe vers le ciel.
Qualités. Toutes les parties de Yadakodien étaht
coupées, rendent un fuc laiteux très-abondant. Elles
n’ont nulle odeur, non plus que les fleurs. Leur faveur
eft fade & fauvage ; fa racine eft fibreufe, blanche
, avec un filet ligneux aù çentre.
Ufâges, La principale vertu de cette plante eft
ophtalmique. Pour difliper le nuage & autres maladies
des yeux , on mange fa racine cuite dans le
beurre , ou avec les feuilles du figuier .d’enfer, & la
racine du talu-dama cuite d’abord dans de l’eau que
l’on rejette, enfuite dans du lait de vache mêlé avec
du fucre. On emploie aufîi en topique la même racine,
en répandant fa poudre fur les y e u x , ou bien en la
reduifant à la confiftance d’un onguent cérat par une
décoâion à feu len t, faite avec le beurre frais, un
oignon, la racine du palmier fauvage & du feelengu
pilés, auxquels on ajoute un peu de fantal & de
jiribeli noir , pour l’appliquer ainfi en emplâtre. Sa
poudre mêlée avec le fantal citrin & le fucre, fe
réduit encore en pillules que l’on fait prendre dans
toutes les douleurs des yeux qui proviennent de
l’abondance de la bile.
Remarque. Si M. Linné eût fuivi fes principes , il
eût dû placer ce genre de plante dans la claffe 19 de
la fy ngénejîe monogamie. (M .A d a n s oN?)
ADALI, f. m. ( kfijl. nat. Botanique. ) plante de
la famille des verveines, & du même genre que
celui que Houfton & M. Linné ontappellé du nom
de lippi, lippia. Cëtté efpece n’a encore été décrite
ni figurée que dans YHortus Malabaricus, volume X 9
planche 47, page 5)3 , oii elle eft défignée fous fon
nom malabare anacoluppa,' & fous celui 6 adali que
lui donnent les Brames , & que nous adoptons,
comme plus court & plus facile à retenir^ d’autant
plus que le nom d’anacoluppa indique chez les Mala-
bares une affinité entre cette plante & le coluppa ,
qui n’y a pas le moindre rapport, étant de la famille
des amaranthes. Voyez nos Familles des plantes ,
page a.68. Jean Commelin défigne Yadali fous la dénomination
fui vante ; ranunculi ajfnis, planta indien ,
floribuspurpureis. Elle croît dans les fables du Malabar.
C ’eft une herbe vivàce , longue de deux à trois
pieds, à tige cylindrique de deux lignes de diamètre ,
rampante dans prefque toute fa longueur, & pro-
duifant à des intervalles de deux à quatre pouces, des
noeuds d’où fortent des feuilles oppofées deux à
deux, en croix, & au-deffous d’elles un faifeeau de
racines fibreufes, capillaires, d’un pouce environ
de longueur. Les feuilles font elliptiques, longues
d’un pouce, moitié moins larges, rudes au toucher,
verd-brun ou rougeâtres, obtufes à leur extrémité
fupérieure , qui eft crénelée ou marquée de cinq à
fept dentelures, & pointues à leur extrémité inférieure
, par laquelle elles font attachées à la tige, en
fe réunifiant pour former autour d’elle une. efpece
de petite gaîne fans aucun pédicule. De leur aiffelle
il fort ordinairement quatre feuilles plus" petites,
qui les font paroître comme verticillées ou étagées,
& une branche d’un côté, & une tête de fleurs de
l’autre, de forte que les branches & les têtes de
fleurs fe trouvent difpofées alternativement : on
boit auffi de ces têtes de fleurs au bout de certaines
vranches, fur-tout lorfqu’elles fortent dans le tems
où la fevè commence à s’arrêter. Avant leur développement
les feuilles font pliées en deux, &c ainfi
oppofées par leur tranchant.
Les têtes de fleurs font d’abord hémifphériques
ou fphéroïdes, de trois lignes de diamètre, lorfque
leurs premières fleurs, c’eft-à-dire celles d’en bas,
commencent à s’épanouir ; puis elles s’alongent jufqu’à
huit lignes, fous la forme d’un épi ovoïde obtus
aux deux bouts, du même diamètre de trois à
trois lignes & demie : le péduncule qui le s . porte
eft cylindrique, & n’a guere que cette longueur.
Chaque tête eft formée de l’affemblage de cent fleurs
ou environ » purpurines, tuilées, fefliles, contiguës,
extrêmement ferrées , accompagnées chacune d’une
écaillé tuilee, ôc qui s’ouvrent dix à douze en même
temsi par étages en anneau fucceflivement. Le calice
de chaque fleur forme un tube court à deux
divifions , qui enveloppe une corolle à tube court,
dont le bord évafé eft crénelé de cinq divifions irrégulières,
& qui porte à fon milieu quatre étamines
très-courtes, dont deux font plus hautes. Au centre
du calice eft un difque orbieulaire, qui fupporte un
ovaire fphéroïde furmonte d’un ftyle & d’un ftigmate
orbieulaire , qui lui eft implanté non pas fur le milieu
, mais fur le côté & obliquement. Cet ovaire,
en grandiflant, devient fphéroïde un peu comprimé,
d’abord verd-clair, enfuite blanchâtre au moment
de la maturité, avec un fillon longitudinal au milieu,
par lequelil fe fépare en deux capfules hémifphéri-
, ques , qui ne contiennent chacune qu’une feule
graine de mêipe forme.
Qualités. Toute la plante a une faveur amere qui
eft âcre dans les racines & aqueufe dans les feuilles.
Ses fleurs ifont aucune odeur.
Ufages. Les Indiens regardent fon fuc comme
l’antidote le plus fouverain contre la morfure du fer-
pent cobra-capèlla, pour laquelle ils le font boire
, avec un peu de poivre en poudre.
Remarque. Le nom de feu M. Lippi n’étant point
connu dans flnde , nous croyons que les Botaniftes
nous fauront gré d’avoir rendu à cette plante fon
nom adali, fous lequel les Brames & autres Indiens
feront à portée de les entendre, & de la leur pro-
curer dans le befoin , nous réfervant la faculté de
donner le nom de M. Lippi, qui a bien mérité de la
botanique, à quelqu’autre plante qui n’aura jamais
encore été baptifée ; car on ne fauroit trop éviter la
multiplicité des noms dans une fcience aufli étendue
que la botanique. ( M. A d an s o n . )
ADAMARAM , f. m. ( Hi(l. nat. Botaniq.') genre
de plante qui vient naturellement dans la famille des
elçeagnus, c’eft-à-dire dans la famille des plantes qui
ont le calice & les étamines fur le fruit, fans aucune
corolle. UHortus Malabaricus en a donné une aflez
bonne figure , quoiqu’iricomplette, vol. IV, page 5 ,
planche 3 , fous fon nom malabare adamaram , que
les François ont corrompu &c changé en celui de
badarrtier. Son auteur, VanRheede , nous apprend
que les Malabares l’appellent aufli faros, lès Brames
chibe ou jibe9 les Portugais pinha, les Hollandois
katappes, d’après les habitans de Java & de Malacca.
Rumphe l’a décrit & figuré un peu mieux au premier
volume de fon Herbarium Amboinicum , fous le nom
de catappa, page t jq , planche 68. Selon ce dernier,
les Malays appellent cet arbre catappan, les habitans
de l’îleTernate ngujfu & nujfu, ceux de Banda
teley & teleyo. M. Linné, qui paroît fe plaire à changer
les noms les plus généralement reçus, a fubftitué
à celui-ci celui de ierminalia, dont il nous donnera
peut-être un jour l’explication, ainfi que de beaucoup
d’autres aufli impropres , voye{ fon Syjlema
natures, edit. 12 ,p. 674; mais quelques raifons qu’il
s’efforce de donner pour appuyer fa nouvelle phi-
lofophie, on eft perfuadé que l’ ufage & les natu-
raliûes lettrés confervent toujours aux pro du étions
de la nature leurs noms de pays , fur-tout à celles
qui, comme l’adamaram, font trop' connues & d’un
ufage journalier. Rumphe en diftingue trois efpeces
que nous allons décrire.
Première efpece. Adamaram ou C atappa.
L ’adamaram proprement d it , le badamipr ou ca- i
tappd, eft un très-grand & très-bel arbre, de quatre- ;
vingts pieds de hauteur, dont la forme pyramidale
eft comparable à celle dufapin , ou plutôt du.panja .
ou ceiba , étant compofé de même de branches .
rayonnantes ou difpofées circulairement par étages,
ôc étendues prefqu’horifontalement, de forte que
fon diamètre eft au moins de quarante à cinquante
pieds. Son tronc n’a guere plus de quinze pieds de
hauteur, fur trois à quatre pieds de diamètre. Ses
jeunes branches font cylindriques, vertes & velues ;
mais les vieilles , ainfi que le tronc, font d’un bois
tres-dur, recouvert d’une écorce rouge au-dedans,
. e OC cendree au-dehors. Sa racine eft cendrée intérieurement,
oc couverte d’une écorce rougeâtre.
Le long des jeunes branches , à des diltances de
cinq à fix pouces, les feuilles font oppofées, étapes
ou verticillées & rayonnantes au nombre de deux
à fix a chaque etage , elliptiques, longues de cinq
pouces fur les vieilles branches, de douze pouces
fur les jeunes , une fois moins larges , aflez molles
liffes & verd-gai deffus , velues, d’un verd-jaune
defîbus, & relevées de groffes nervures, plus larges à
leur extrémité fupérieure qu’à l’extrémité inférieure
oii elles font unpeuéchancrées en coeur; leurs bords
fe recouvrant, ainfi que le pédicule cylindrique aflez
court qui les porte & qui eft rouge & velu. Lorfqu’elles
font vieilles , elles rougiffent & prennent
une couleur à-peu-près femblable à celle del’écre-
viffe quand elle eft cuite.
De l’extrémité de chaque branche, il fort deux
épis pendans comme deux grappes de grofeilles,
à-peu-près de la longueur des feuilles, compofé
chacun d’une trentaine de fleurs -, difpofées d’une
maniéré aflez lâche, & comme oppofées deux à
deux en croix depuis leur extrémité fupérieure jufqu’aux
trois quarts de leur longueur, & portées
chacune fur un pédicule prefqu’égal à elles : l’axe
de ces épis eft rouge & veju. Ces fleurs font hermaphrodites,
mais le plus grand nombre eft ftérile &c
tombe ; il n’en mûrit communément que deux ou
trois fur chaque épi, ce font les inférieures. Elles ne
font accompagnées d’aucune écaille , néanmoins on
voit au-bas de l’épi deux à trois folioles caduques |
dont l ’inférieure femble former une forte de gaîne.
Chaque fleur confifte en un calice à cinq divifions.
ouvertes en étoile, elliptiques, une fois plus longues
que. larges , vertes au-dehors, blanches au-
dedans , faifant corps avec l’ovaire au fommet duquel
elles portent. Les étamines, au nombre de dix,
fortent du fommet du même ovaire , difpofées fur.
deux rangs, de maniéré que cinq font épanouies
horifontalement entre les cinq feuilles du calice,
avec lefquelles elles font l’alternative & qu’elles
égalent en longueur , pendant que les cinq autres
s’élèvent droit autour du ftyle de l’ovaire : toutes font
couronnés d’une anthere blanche fphéroïde. Le ftyle,
qui part du centre de l’ovaire, eft verd & velu , de
la longueur des étamines, & terminé par un ftigmate
fimple & tronqué.
L ovaire, ^qui fe trouve au-deffous de la fleur,
devienten mûriffant une écorce d’abord verte , liffe ,.
luifante, puis rougeâtre où incarnat, ftriée de jaune,
femblable à l’amande ou à la mangue, ou mieux encore
, à un batteàu ou un oeuf coupé en deux , long
de trois pouces , une fois moins large & deux fois
moins profond, convexe en-deffous , applati en-
deffus, où il eft marqué de deux filions, par lefquels
il s’ouvre de lui-même en une loge à deux battans
inégaux, épais chacun de cinq à fix lignes , charnus,
rouges de cérife , recouverts d’une pellicule fous
laquelle ils font velus. Ces deux battans, en s’ouvrant,
làiffent tomber un noyau ovoïde,liffe , lui-
fant, brun ou marron , long de deux pouces , deux
à trois fois moins large, très-dur, à une loge qui ne
s’ouvre, point à moins qu’on ne le caffe, & qui contient
une amande blanche ovoïde, de même forme,
compofée de deux, cotylédons orbiculaires roulés
l’un for l’autre en fpirale, le côté droit de l’un em-
braffant le côté gauche de l’autre, la radicule étant
logée dans une petite crénelure pratiquée à leur