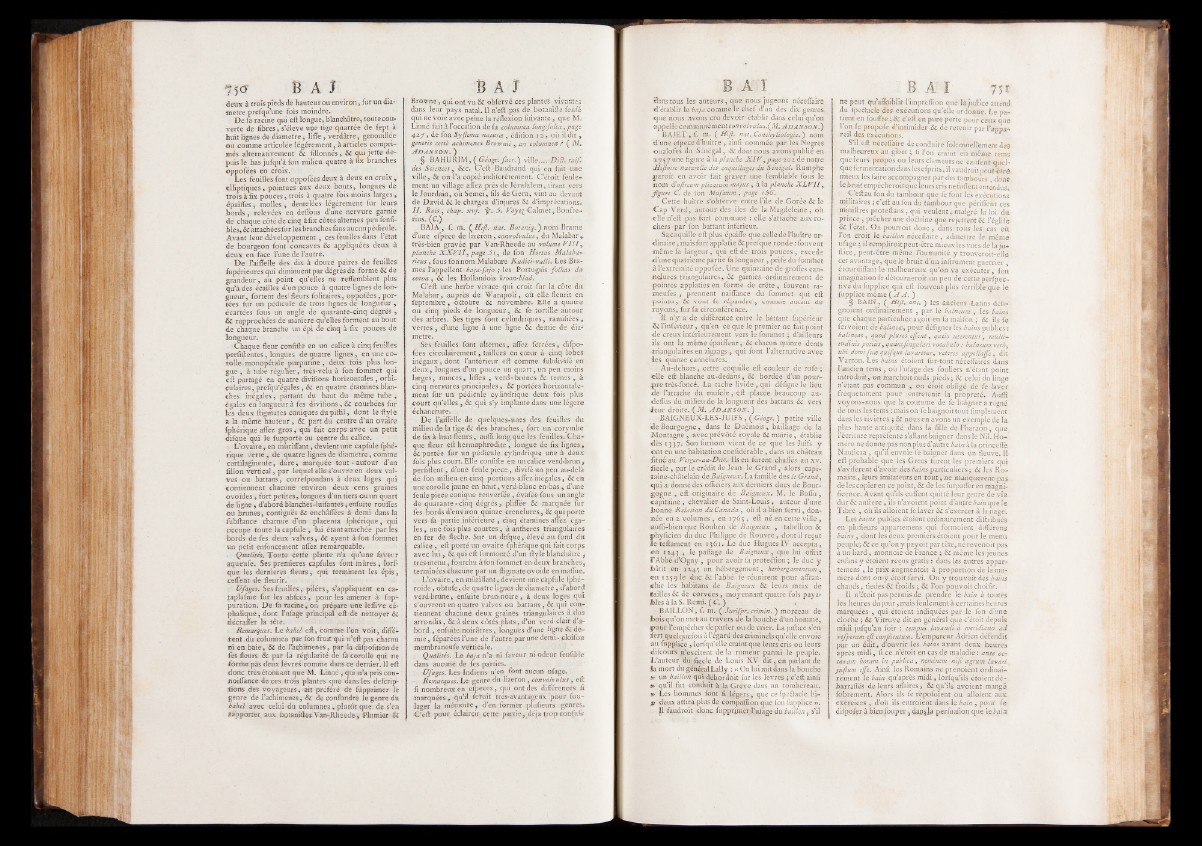
75 & Ë A î
deux à trois pieds de hauteur ou environ, fur un diamètre
prefqu’une fois moindre.
De fa racine qui eft longue, blanchâtre, toute couverte
de fibres, s’élève upe tige quarrée de fept à
huit lignes de diamètre , liffe , verdâtre, genouillée
ou comme articulée légèrement, à articles comprimés
alternativement & fillonnés, & qui jette depuis
le bas jufqu’à fon milieu quatre à fix branches
oppofées en croix/
Les feuilles font oppofées deux à deux en croix,
elliptiqùes, pointues'aux deux bouts, longues de
trois à fix pouces, trois à quatre fois moins larges»
épaiffes j molles , dentelées légèrement fur leurs
bords, relevées en deffous d’une nervure garnie
de chaque côté de cinq à fix côtes alternes peu fenfi-
bl.es, & attachées fur les branches fans aucun pédicule.
Avant leur développement , ces feuilles dans l’état
de bourgeon font concaves & appliquées deux à
deux en face l’une de l’autre.
De l’aiffelle des dix à douze paires de feuilles
fupérietires qui diminuent par dégrés de forme & de
grandeur, au point qu’elles ne reffemblent plus
qu’à des écailles d’un pouce à quatre lignes de longueur,
fortent des! fleurs folitaires, oppofées, portées
fur un pédicule de trois lignes de longueur ,
écartées fous un angle de quârante-cinq dégrés »
& rapprochées de maniéré qu’elles forment au bout
de chaque branche un épi de cinq à fix pouces de
longueur.
■ Chaque fleur confifte en un calice à cinq feuilles
perfiftentes, longues de quatre lignes, en une corolle
monopétale purpurine, deux fois plus longue
, à tube régulier, très-velu à fon fommei qui
eft partagé en quatre divifions horizontales , orbi-
cûlaires, prefqu’égales, & en quatre étamines blanches
inégales, partant du haut du même tube ,
égales en longueur à fes divifions , & courbées fur
les deux ftigmates COniques du piftil, dont le ftylë
a la même hauteur , & part du centre d’un ovaire
fphérique affez gros, qui fait corps avec un petit
difque qui le fuppqrte au centre du: calice.
-, L’ovaire, en mûriffant, d'evientune capfulefphérique
verte » de quatre lignes de diamètre, comme
cartilagineuse, dure, marquée »tout- autour d’un
fillon vertical, par lequel elle s’ouvre en deux valves
ou battans, correfpondans à deux loges qui
contiennent chacune environ deux cens graines
ovoïdes, fort petites, longues d’un tiers ouvra quart
de ligne-, d’abord blanches-luifantes enfui te rouffes
ou brunes , contiguës & enchâffées à demi dans la
fubftance charnue d’un placenta fphérique, qui
occupe toute la capfule , lui étant attachée par les
bords de fes deux .valves, & ayant à fon fommet
un petit enfoncement affez remarquable.
- Qualités. Toute cette plante n’a qu’une faveur
aqueufe. Ses premières capfules font.mûres, forf-
que. les dèrnieres fleurs, qui terminent les épis,
eeffent de fleurir.
Ufages. Ses feuilles, pilées, s’appliquent en ca-
îaplafme fur les abfcès, pour les amener à fup-
puration; De fa racine, bn prépare une leffive céphalique
, dont Pufagè principal eft de nettoyer &
nécraffer la tête.
Remarques. Le bahél eft, comme l’on voit, différent
-du columnea par fon fruit qui n’eft pas charnu
ni en baie, & de l’achimenes, par la dilpofition de
fes fleiirs & par la régularité de fâ corolle qui ne
forme pas deüx lèvres comme dans ce dernier. II eft
donc très-étonnant qué M. Linné , qui n’a pris con-
noiffance de ces trois plantes que dans les defcrip-
riions dés voyageurs, ait préféré de füpprimer lè
genre de J’achimenes » & de confondrè le genre du
bahel avec celui du columnea y plutôt que de s’en
rapporter aux botaniftes Van-Rheede-» Plumier &
B A f
Brownequi ont vu & obfervé ces plafitéS ■ vivantes
dans leur pays natal. 11 n’eft pas de botanifte fenfé
qui ne voie avec peine la réflexion fuiyante , que M.
Linné fait à l’occafion de fa columnea longifolia, page
4 2 7 , de fqn Syflerna naturce , édition 1 2 , où il dit ,
generis certè achimenes Brownii, an columnea ? ( M.
A d a n so n . )
§ BAHURIM, ( Gèogr.facr.) ville.... Dut. raif.
des Sciences, &c. C’eft Baudrand qui en fait une
ville, & on l ’a copié indiferéterrtent. C’étoit feulement
un village affez près de Jérufalem, tirant vers
le Jourdain, où Semeï, fils de Géra, vint au devant
de David & le chargea d’injures & d’imprécations.-
II. Rois, chap. xvj. 'fir. 5. Voye^ Galmet, Bonfre-t
rius. (C.)
BAJA , f. rtï. ( tiift. liât. Botaniq. ) nom Bramé
d’une efpece de lizeron, convolvulus, du Malabar ».
très-bien gravée par Van-Rheede au -volume V I I I ,
planche X X V I I , page S i , de fon Hortus Malabà-
ricus, fous fort nom Malabare Kudici-valli. Les Brames
l’appellent baja-fajo ; -les Portugais folkas da
coroa, & les Hollandois hroon-blad.
C ’eft une herbe vivace qui croît fur là côte dit
Malabar, auprès de "Warapolï, où elle fleurit en
feptembre, octobre & novembre. Elle a -quatre
ou cinq pieds de longueur-, & fe tortille .autour
des arbres. Ses tiges font cylindriques, ramifiées ,
vertes , d’une ligne à une ligne & demie de diaJ
métré.
Ses feuilles font alternés, affez ferrées, difpo-
fées cireulairement, taillées en coeur à cinq lobes
inégaux, dont l’antérieur eft comme fubdivifé en’
deux, longues d’un pouce un quart, un peu moins
larges, minces, liffes » verd-brunes & ternes, à
cinq nervures principales, & portées horizontales
nient fur un pédicule cylindrique deux fois plus
.court qu’elles ,. & qui s’y implante dans une légère
"échancrure. 1
De l’aiffelle de quelques-unes des feuilles du
milieu de là tige & des branches, fort un .corymbe
de fix à huit fleurs, auffi long que les feuilles.- Chaque
fleur eft hermaphrodite , longue de fix lignes,
& portée fur un pédiculë cylindrique une à deux
fois plus court. Elle confifte en un calié'e vérd-brun ,
perfiftent, d’unè feule p ieeé, divifé un peu au-delà
de fon milieu en cinq portions affez iriégales, & en
une corolle jaune en haut,vërd-blanc én-bas , d’uné
feule piece conique renverfée, évaféè fous un angle
de quarante - cinq dégrés -, . pliffée & marquée fur
fes bords d’environ quinze crenelures, & qui porte
vers fa partie inférieure , cinq étamines affez égales,
une fois plus courtes , à anthères triangulaires
en fer de fléché. Sur un difque, élevé au fond du
calice , eft porté un ovaire fphériqùe qui fait corps
avec lu i, & qui eft furmonté d’un ftyle blanchâtre
très-menu, fourchu à fori fommet en deux branches-,
terminées chacune par un ftigmate ovoïde en maffue.
L’ovaire, en mûriffant, dévient une.capfule fphé-
roïde, obtufe, de quatre lignes dé diamètre » d’abord
vérd-brùne, enfuite brun-noire, à deux loges qui
s’ouvrent en quatre valves ou battans, & qui contiennent
chacune deux g rainés triangulaires à'dos
arrondis, &.àdeux côtés: plats» d’un verd-clair d’abord.
» enfuiteraoirâ-tres, longues d’une ligne & demie
, féparées l’une de l’autre, par une demi- eloifon
membraneùfe véïticale.
Qualités. Lé baja n’a ni faveur ni odeur fenfible
dans aucune, de fes parties.
■j Üfages. Les Indiens n’en font aucun nfage.
- Remarques. Le genre du -lizeron, convolvulus,, eft
fi nombreux en efpeces, qui ont des différences fi
ta arquée s , qu’il letoit très-avantagétlx pour fou-
lager la mémôire , d’en former plufieurs: genres.
■ C’eft pour éclaircir cette partie., déjà trop confufe
B A l
Sans tous les aüteurs , que nous jugeons néceffaire
S ’établir le baja comme le chef d’un des dix genres
que nous avons cru devoir,'établir dans celui qu’on
appelle communément convolvulus.QM. A d an so n .')
BAJET , £. m. ( Hiß. nat. Conchyliologie. ) nom
d ’une efpece d’huitre , ainfi nommée par les Negres
oualofes du Sénégal, & dont nous avons publié en
■ 37 ^yàirie figure à la planche• X IV , page 202 dé notre
JHifioirc naturelle des coquillages du Sénégal. Rumphe
^jaroît en avoir fait graver une femblable fous le
nom d'oflreum plicatum majus,, à là planche X L V I I ,
ßgure C. de Ion Mufoeum, page iSS. v .
Cette huître s’obferve entre l’île de Gorée & le
Cap Verd , autour des îles de la Magdeleine, où
elle n’eft pas fort commune : elle s’attache aux rochers
par fon battant inférieur.
Sa.coquille eft plus épaiffe que celle dé l’huître ordinaire
, mais fort applatie & prefque ronde : fouvent
même fa largeur, qui eft de trois pouces', excede
d ’une quatrième partie fa longueur, prife du fommet
à l’extrémité oppofée. Une quinzaine de groffes.eai>
nejures triangulaires, & garnies ordinairement de
•pointes applaties en forme de crête, fouvent ra-
meitfes , prennent naiffance du fommet qui eft
pointu , & vont fe répandre--, comme autant de-
rayons, fur fa circonférence.
Il n’y a: de différence entre le bâttant fiipérieur
& l’inférieur, qu’en ce que le premier ne fait point
de creux intérieurement vers le fommet ; d’ailleurs
Ils ont la même épaiffeur, & chacun quinze dents
-triangulaires en zigzags, qui font l’alternative avec
les quinze cannelures.
. Au-dehors, cette coquille eft couleur de rofe ;
elle eft blanche au-dedans, & bordée d’un pourpre
très-foncé. La tache livide , qui dêfigne le lieu
de l’attache du mufcl.e, eft placée beaucoup au-
deffus du milieu de la longueur des battans & vers
leur droite. ( M. A d a n s o n . )
• BAIGNEUX-LES-JUIFS , ( Géogr. ) petite ville
de Bourgogne, dans le Duêmois, bailliage de la
Montagne , avec prévôté royale & mairie, établie
dès 1337. Son furnom vient de ce que les Juifs y
ont eu une habitation confidérable, dans un château
litiié au Verger-au-Duc. Ils en furent chaffés au xv .
' ftéeie , par le-crédit de Jean le Grand , alors capitaine
châtelain deBaigneux. La famille des le Grand,
qui a donné des- officiers aux derniers ducs de Bourgogne
, eft originaire de Baigneux. M. le Boffu,
capitaine , chevalier de Saint-Louis, auteur d’une
bonne Relation du Canada, où il'a bien fervi, donnée
en 2 volumes , en 1765 , eft né en cette v ille ,
auffi-bien que Rouben Baigneux , tabellion &
phyficien du duc Philippe de Rouvre, dont il reçut
le teftament en 1361. Le duc Hugues IV accepta,
en 1243 i le paflage -de Baigneux, que lui offrit
l ’Abbé d’Ogn y, pour avoir fa proteûion ; le duc y
bâtit en 1245 un hébergement, herbergamentum,
en 1259 le duc & l’abbé fe réunirent pour affranchir
les habitans de Baigneux & leurs meix de
tailles & de corvées, moyennant quatre fols payables
à la S. Remi. ( C. ) ,
■ BAILLON, f. m. ( J.urijpr. crhnïn. ) morceau de
bois qu’on met au travers de la bouche d’un homme,
pour l’empêcher de parler ou de crier. La juftice s’en
fert quelquefois à l’égard des criminels qu’elle envoie
au fûpplice > lorfqu’elle craint que leurs cris ou leurs
difeours n’excitént de la rumeur parmi le peuple.
L ’auteur du- fiecle de Louis XV dit, en parlant de
la mort du généralLally : « On lui mit dans la bouche .
» un bâillon qui d'ébordoit fur les levres ; c’eft ainfi
*> qu’il fut conduit à la Grevé dans un tombereau.
»> Les hommes font fi légers, que ce fpeftacle hideux
attira plus de compaffion que fon fûpplice ».
|1 faudroit donc fupprjmer l’ufage àx baïUon, s’il
B A I 7; r
«« peut tju’ afïbiblir l’impreffion que la juftice attend
du fpeâacle dès exécutions qu’elle ordonné. Le patient
en louffi-e ; & c’eft en pure perte pour ceux que
- l’on fe propofe d’intimider & de retenir par l’appareil
des exécutions.
S’il eft neceffajre de conduire foiemnellënieftt des
malheureux au gibet ; fi l’on craint eh même tems
que leurs propos ou leurs clameurs ne caùfent quel-
" que fermentation dans les efprits, il vaudroit peu t-êtrô
mieux les faire accompagner par des tambours , dont
le bruit empêcheroit que leurs cris ne fuffent entendus*
■ ^Ç’éftau fon du tambour que fe font les exécutions
militaires ; c’eft au fon du tambour que périffent ces
miniftres proteftans, qui veulent, malgré la loi du
prince , prêcher une doéfrïne que rejettent & l’églife
& l’état. On pourrait donc , dans tous les cas oîi
l’on croit Je bâillon néceffaire, admettre le même
ufage ; il rempliroit peut-être mieux les vues de la juftice,
peut-être même l’humanité: y trouveroit-elle
cçt avantage, que. le bruit d’un infiniment guerrier ,
étourdiffant le malheureux qu’on va exécuter, fon
imagination fe détourneroit un peu de cette perfpécrive
du fûpplice qui eft fouvent plus terrible que le
fûpplice même ( A A . )
§ BAIN , ( Hifl, anc. ) les anciens Latins défi-'
gnoient ordinairement , par le ba ln eum les baini
que chaque particulier av.oit en fa maifon ; & ils fe
fervoient de b alinéa, pour, défigner les bains publics:
b alineas , quod plures.ejfent, quels uterentur, multi-
tudinis potïùs, quàmfingulari voc.abulo : balneum verd,
ubi domi fuæ. quif que Lavaretur, veteres appellajje, dit
-Varron. Les bains étoient fur-tout néceffaires dans
l ’ancien tems , où l’ufage des fouliérs n’étant point
introduit, on marchoitnuds pieds; & celui du linge
n’étant pas commun » on étoit obligé de fe laver
fréquemment pour ^entretenir la propreté. Auflî
voyons-nous. .que la coutume de fe baigner a régné
de tous les tems : maison febaignoit tout Amplement
dans les rivières ; & nous en avons un exemple de la
plus haute antiquité dans la fille de Pharaon, que
l’écriture repréCente s’allant baigner dans le Nil. Homère
ne donne pasrion.plus d’autre bain à la prinçeffe
Nauficaa, qu’il envoie fe baigner dans un fleuve. Il
eft probable que les Grecs furent les premiers qui
s’aviferent d’avoir des bains particuliers ; & les Romains.
» leurs imitateurs en tout, ne mariquerent.pas
dé les copier en ce point, & de les furpaffer en magnificence.
Avant qu’ils euffent quitté leur genre de vie
dur & auftere , ils h’avoient point d’autre bain que le
Tibre , où ils alloient fe laver & s’exercer à la nage.
Les bains publics étoient ordinairement diftribués
en plufieurs appartemens qui formoient différens
bains ,.dont les deux premiers étoient pour le menu
peuple; & ce qu’on y payoit par tête,nérevenoit pas
à un liard, monnoie de France ; & même les jeunes
enfans y étoient reçus gratis : dans les autres appar?
temens , le prix augmentoit à proportion de la maniéré
dont on*y étoit.fervi. On y trouvoit des bàins
chauds, tiedes & fr-oids ; & l’on pouvoit choifir.
Il n’étoit pas permis de prendre le bain à toutes
les heures du jour, mais feulement à certaines heures
marquées , qui étoient indiquées par le fon d’une
cloçhe ; & Vitruve dit en général que c’étoit depuis
midi jufqu’au foir : tempus lavandi à meridiano ad
vefperam eft conftitutum. L’empereur Adrien défendit
- par un édit, d’ouvrir les bains avant , deux heures
après-midi, fi ce n’étoit en cas de maladie : ante oc-
tavam horani in p u b lica , neminem n i ji cegrum lavari
ju ftu in ejfe. Ainfi les Romains ne prenoient ordinairement
le bain qu’après midi, lorfqu’ils étoient dé-
barraffés de leurs affaires, & qu’ils avoient -mangé
fobrement. Alors ils fe repofoient ou alloient aux
exercices , d’où ils entroient dans le bain , pour fe
difpofçr à bien jfouper 3 la perfuaiion que le bain