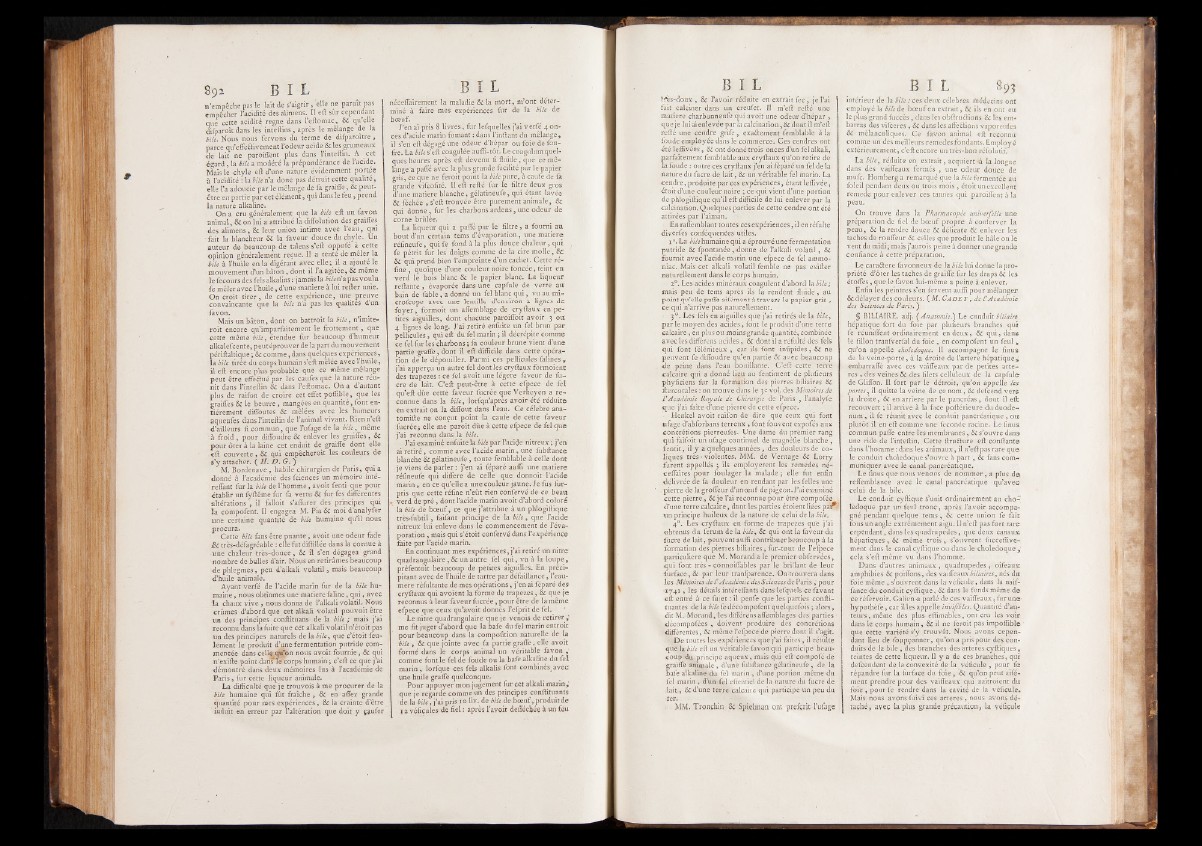
n’empêche pas le lait de s’aigrir , elle ne paroît pas
empêcher l’acidité des alimens. Il eft sûr cependant
que cette acidité régné dans l’eftomae, & qu’elle
difparoît dans les inteftins , après le mélange de la
bile. Nous nous fervons du terme de difparoître ,
parce qii’effe&ivement l’odeur acide & les grumeaux
de lait ne parôiffent plus dans l’inteftin. A cet
égard, la bile, a modéré la prépondérance de l’acide.
Mais le chyle eft d’une nature évidemment portée
à l’acidité : la bile n’a donc pas détruit cette qualité,
elle l’a adoucie par le mélange de fa graiffe, & peut-
être en partie par cet élément, qui dans le feu, prend
la nature alkaline.
On a cru généralement que la bile eft un favon
animal, & on lui a attribué la diffolution des graiffes
des alimens , & leur union intime avec l’eau, qui
■ fait la blancheur & la faveur douce du chyle. Un
auteur de beaucoup de talens s’eft oppofe cette
opinion généralement reçue. Il a tenté de meler la
bile à l’huile en la digérant avec elle; il a ajouté le
mouvement d’un bâton, dont il 1 a agitee, & meme
le fecours des fels alkalins : jamais la bile n a pas voulu
fe mêler avec l’huile, d’une maniéré à lui refter unie.
On croit tirer, de cette expérience, une preuve
convaincante que la bile n’a pas les qualités d’un
favon. # ; . .
Mais un bâton, dont on battroit la bile, n’imite-
roit encore qu’imparfaitement le frottement, que
cette même bile, étendue fur beaucoup d’humeur
alkalefcente, peut éprouver de la part du mouvement
périftaltique ; & comme, dans quelques expériences,
la bile tirée du corps humain s’eft mêlée avec l’huile,
il eft encore plus probable que ce même mélange
peut être effeélué par les caufes que la nature réunit
dans l’inteftin & dans l’eftomac. On a d’autant
plus de raifon de croire cet effet poffible, que les
graiffes & le beurre, mangées en quantité, font entièrement
diffoutes & mêlées avec les humeurs
aqueufes dans l’inteftin de l’animal vivant. Rienn’eft
d’ailleurs ii commun, que l’ufage de la bile, même
à froid, pour diffoudre & enlever les graiffes, &
pour ôter à la laine cet enduit de graiffe dont elle
eft couverte, & qui empêcheroit les couleurs de
s’y attacher. ( H. D . G. )
M. Bordenave, habile chirurgien de Paris, qui a
donné à l’académie des fciences un mémoire inté-
reffant fur la-bile de l’homme, avoit fenti que pour
établir un fyftême fur fa vertu & fur fes différentes
altérations , il falloit s’affurer des principes qui
la compofent. Il engagea M. Pia & moi d’analyler
une certaine quantité de bile humaine qu’il nous
procura.
Cette bile fans être puante, avoit une odeur fade
& très-défagréable : elle fut diftillée dans la cornue à-
une chaleur très-douce, & il s’en dégagea grand
nombre de bulles d’air. Nous en retirâmes beaucoup
de phlegmes, peu d’alkali volatil, mais beaucoup
d’huile animale.
Ayant verfé de l’acide marin fur de la bile humaine
, nous obtînmes une matière faline, qui, avec
la chaux vive , nous donna de l’alkali volatil. Nous
crûmes d’abord que cet alkali volatil pouvoit être
un des principes conftituans de la bile ; mais j’ai
reconnu dans la fuite que Ce't alkali volatil n’étoit pas
un des principes naturels de la bile, que c’étoit feulement
le produit d’une fermentation putride commencée
dans celle qu’on nous avoit fournie, & qui
n’exifte point dans lexorps humain ; c’eft ce que j’ai
démontré dans deux mémoires lus à l’académie de
Paris, fur cette liqueur animale.
La difficulté que je trouvois à me procurer de la
bile humaine qui fût fraîche , & en affez grande
quantité pour mes expériences, & la crainte d’être
induit en erreur par l’altération que doit y çaufer
néceflairement la maladie & la mort, m’ont déterminé
à faire mes expériences fur de la bile de
boeuf.
J’en ai pris 8 livres, fur lefquelles j’ai verfé 4 onces
d’acide marin fumant : dans l’inftant du mélange,
il s’en eft dégagé une odeur d’hépar ou foie de fou-
fre. La bile s’eft coagulée auflî-tôt. Le coagulum quelques
heures après eft devenu fi fluide, que ce mélange'a
paffé avec la plus grande facilité par le papier
gris, ce que ne feroit point la bile pure, à caufe de fa
grande vifeofité. Il eft refté fur le filtre deux gros
d’une matière blanche, gélatineufe, qui étant lavée
& féchée , s’eft trouvée être purement animale, &
qui donne, fur les charbons ardens, une odeur de
corne brûlée.
La liqueur qui a paffé par le filtre, a fourni au
bout d’un certain tems d’évaporation, une matière
réfineufe, qui fe fond à la plus douce chaleur, qui
fe pétrit fur les’ doigts comme de la cire molle, 8c
& qui prend bien l’empreinte d’un cachet. Cette réfine
, quoique d’une couleur noire foncée, teint en
verd le bois blanc & le papier blanc. La liqueur
reliante, évaporée dans une capfule de verre au'
bain de fable, a donné un fel blanc qui, vu au mi-
crofcope avec une lentille d’environ 2 lignes de
fo y e r , formoit un affemblage de cryftaux. en petites
aiguilles, dont chacune paroiffoit avoir 3 oit
4 lignes de long. J’ai retiré enfuite un fel brun par
pellicules, qui eft du fel marin ; il décrépite comme
ce fel fur les charbons ; fa couleur brune vient d’une
partie graffe ,'dont il eft difficile dans cette opération
de le dépouiller. Parmi ces pellicules falines ,
j’ai apperçu un autre fel dont les cryftaux formoient
des trapèzes : ce fel avoit une légère faveur de fu-
cre de lait. C’eft peut-être à cette efpece de fel
qu’eft dûe cette faveur fucrée que Verheyen a reconnue
dans la bile, lorfqu’après avoir été réduite
en extrait on la diffout dans l’eau. Ce célébré ana-
tomifte ne conçut point la caufe de cette faveur
fucrée; elle me paroît dûe à cette efpece de fel que
j’ai reconnu dans la bile.
J’ai examiné enfuite la bile par l’acide nitreux ; j’en
ai retiré, comme avec l’acide marin, une fubftance
blanche & gélatineufe, toute femblable à celle dont
je viens de parler : j’en ai féparé aufli une matière
réfineufe qui différé de celle que donnoit l’acid©
marin, en ce qu’elle a une couleur jaune. Je fus fur-
pris que cette réfine n’eût rien confervé de ce beau
♦ verd de p ré, dont l’acide marin avoit d’abord colore
la bile de boeuf, ce que j’attribue à un phlogiftique
très-fubtil, faifant principe de la bile, que l’acide
nitreux lui enleve dans le commencement de l’évaporation
, mais qui s’étoit confervé dans l’expérience
faite par l’acide marin.
En continuant mes expériences, j’ai retiré un nitre
quadrangulaire, 8c un autre fel qui, vu à la loupe,
préfentoit beaucoup de petites aiguilles. En précipitant
avec de l’huile de tartre par défaillance, l’eau-
mere réfultante de mes opérations, j’en ai féparé des
cryftaux qui avoient la forme de trapèzes, & que je
reconnus à leur faveur fucrée, pour être de la même
efpece que ceux qu’avoit donnés l’efprit de fel.
Le nitre quadrangulaire que je venois de retirer ^
me fit juger d’abord que la bafe du fel marin entroit
pour beaucoup dans la compofition naturelle de la
bile , 8c que jointe avec fa partie graffe, elle avoit
formé dans le corps animal un véritable favon ,
comme font le fel de foude ou la bafe alkaline du fel
marin, lorfque ces fels alkalis font combinés^àvec
une huile graffe quelconque.
Pour appuyer mon jugement fur cet alkali marin,'
que je regarde comme un des principes conftituants
de la bile, j’ai pris io liv. de bile de boeuf, produit de
I 1 a véficules de fiel : après l’avoir defféebée à un feu
très-doux , 8c l’avoir réduite en extrait fec, je l’ai
fait calciner dans un creufet. Il m’eft refté une
matière charbonneufe Oui avoit une odeur d’hépar ,
que je lui ai enlevée par la calcination, 8c dont il m’eft
refté une cendre grife, exactement femblable à la
foude employée dans le commerce. Ces cendres ont
été leflivées, & ont donné trois onces d’un fel alkali,
parfaitement femblable aux cryftaux qu’on retire de
la foude : outre ces cryftaux j’en ai féparé un fel de la
nature du fucre de, lait, & un véritable fel marin. La
cendre, produite par-ces expériences, étantleflivëe,
étoit d’une couleur noire ; ce qui vient d’une portion
de phlogiftique qu’il eft difficile de lui enlever par la
calcination. Quelques parties de cette cendre ont été
attirées par l’aiman. -!
En raffemblant toutes ces expériences, il en réfulte
diverfes conféquences utiles.
i°. La bile humaine qui a éprouvé une fermçntation
putride 8c fpontanée, donne de l’alkali volatil , &
fournit avec l’acide marin une efpece de fel ammoniac.
Mais cet alkali volatil femble ne pas exifter
naturellement dans le corps humain.
z°. Les acides minéraux coagulent d’abord la bile;
mais peu dé tems après ils la rendent fluide, au
point qu’elle paffe aifément à travers le papier gris ,
cé qui n’arrive pas naturellement.
30. Les fels en aiguilles que j’ai retirés de la bile,
par le moyen des acides, font le produit d’une terre
calcaire, en plus ou moins grande quantité; combinée
avec les différens acides, 8c dont il a réfulté des fels
qui font féléniteux , .car ils font infipides, 8c ne
peuvent fe diffoudre qu’en partie & avec beaucoup
de peine dans l’eau bouillante. C ’eft cette terre
.calcaire qui a donné lieu au fentiment de plufieurs
phyficiens fur la formation des pierres biliaires 8c
ftercorales : on trouve dans le 3 e vol. des Mémoires de
l'Académie Royale de Chirurgie de Paris , Fanalyfe
que j’ai faite d’une pierre de cette efpece. r,
Henkel avoit raifon de dire que ceux qui font
tifage d’abforbans terreux , font fouvent expofés aux
concrétions pierreufes. Une dame du premier rang
qui faifoit un ufage continuel de magnéfie blanche ,
fentit, il y a quelques années , des douleurs de coliques
très - violentes. MM. de Vernage 8c Lorry
furent appellés ; ils employèrent les remedes né-
ceffaires pour foulager la malade ; elle fut enfin
délivrée de fa douleur en rendant par les felles une
pierre de la groffeur d’un oeuf de pigeon. J’ai examiné
cette pierre, & je l’ai reconnue pour être compoféè
d’une terre calcaire , dont les parties étoient liées pat^'
un principe huileux de la nature de celui de la bile.
40. Les cryftaux en forme de trapèzes que j’ai
obtenus du ferum de la bile, & qui ont la faveur du
fucre de lait, peuvent aufli contribuer beaucoup à la
formation des pierres biliaires , fur-tout de l’efpece
particulière que M. Morand a le premier obfervées,
qui font très - connoiffables par le brillant de leur
furface, & par leur tranfparence. On-trouvera dans
les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris , pour
•1741, les détails intéreffants dans lefquels ce (avant
eft entré à ce fujet : il penfe que les parties confti-
tuantes de la bile fe décompofent quelquefois ; alors,
dit M. Morand, les différens affemblages des parties 1
■ déconapofées , doivent produire des concrétions
différentes, 8c même l’efpece de pierre dont il s’agit.
De toutes les expériences que j’ai faites, il réfulte
que-la bile eft un véritable favon qui participe beaucoup
du principe aqueux, mais qui eft' compofé de
graiffe animale , d’une fubftance gélatineufe, de la
bafe alkaline du fel marin , d’une portion même du
fel marin , d’un, fel-effentiel de la nature du fucre de
la it , & d’une terre calcaire qui participe un peu du
•fer.. •
MM. Tronchin 8c Spiçlman ont prefçrit l’ufage
intérieur de là bile : ces deux célébrés médecins ont
employé la bile de boeuf en extrait, & ils en ont eu
le plus grand fuecès, dans les obftruclions 8c les em-*
bai rras des vifeerés , 8c dans les affe étions vaporeufes
8c- mélancoliques. Ce favon animal eft reconnu-
comme-un des meilleurs remedes fondants. Employé
extérieurement, c’eft encore un très-bon réfolutif.
La b ile , réduite en extrait, acquiert-*à la longue
dans dès vaiffeaux fermés , une odeur douce de
mufe.- Homberg a remarque que la bile fermentée ait
foleil pendant deux ou' trois mois , étoit un excellent
remede pour enlever ces tannes qui parôiffent à la
peau.
On trouve dans la Pharmacopée unlverfelte une
préparation de fiel de boeuf propre à conferver la
peau, 8c la rendre douce & délicate & enlever les
taches de rouffeur & celles que produit le haie ou le
vent du midi; mais j’aurois peine à donner une grande
confiance à cette préparation.
Le caraétere favonneux de la bile lui donne la propriété
d’ôter les taches de graiffe. fur les draps 8c les
étoffes, que le favon lui-même a peine à enlever.
Enfin les peintres s’en fervent aufli pour mélanger
& délayer des couleurs. ( M. Ca d e t , de l 'Académie
des Sciences de Paris. )
§ BILIAIRE, adj. ( Anatomie?) Le conduit biliaire
hépatique fort du foie par plufieurs branches qui
fe réunifient ordinairement en deux, 8c qui, dans
le fiilon tranfverfal dû foie , en compofent un feul ,
qu’on appelle cholédoque. Il accompagne le finus
de la veine-porte, à la droite de l’artere hépatique*
embarraffé avec ces vaiffeaux par de petites artères
, des veines 8c des filets celluleux de la capfule
de Gliffon. Il fort par le détroit, qu’on appelle les
■ portes, il quitte la veine de ce nom, 8c defeend vers
: la droite, 8c en arriéré par le pancréas, dont il eft
I recouvert ; il arrive, à la face poftérieure du duodénum
, il fe réunit avec le conduit pancréatique-, oit
plutôt il en eft comme une fécondé racine. Le finus
commun paffe entre les membranes, & s’ouvre dans
une ride de l’inteftin..'Cette ftruélure eft confiante
dans l’homme : dans les animaux, il n’eftpas rare que
le conduit cholédoque s’ouvre à part , & fans communiquer
avec le canal pancréatique,.
Le finus que nous venons de nommer, a plus des
reffemblance avec le canal pancréatique qu’avec-
- celui, de la bile.
Le conduit cyftique S’unit ordinairement au cholédoque
par un feul tronc, après l’avoir accompagné
pendant quelque tems, & cette union fe fait
fous un angle extrêmement aigu. 11 n’eft pas fort rare
cependant, dans les quadrupèdes, que deux canaux
hépatiques , & même trois,- s’ouvrent fucceflive-;
ment dans le canal cyftique ou dans le cholédoque
Cela s’eft même vu dans l’homme.
Dans d’autres animaux, quadrupèdes, oifeaux
amphibies & poiffons, des vaiffeaux biliaires, nés du
foie même , s’oiivrent dans la véficule, dans la naif-
fance du conduit cyftique, & dans le fonds même de
ce réfervoir. Galien-a parlé de ces vaiffeaux, fur une-
hypothèfe, car il les appelle invijibles. Quantité d’auteurs
, même des plus eftimables, ont cru les voir
dans le corps humain, & il ne feroit pas impoflible
que cette variété s’y trouvât. Nous avons cependant
lieu de foupçonner, qu’on a pris pour des conduits
de la bile, des branches des arteres cyftiques ,
teintes de cette liqueur. Il y a de ces branches, qui
defeendent de la convexité de la véficule , pour fe
répandre fur la furface du foie, & qu’on peut aifément
prendre pour des vaiffeaux qui naîtroient du
fo ie , pour fe rendre dans la cavité de la véficule*
Mais nous avons fuivi Ces arteres, nous avons détaché,
avec la plus grande précaution, la véficule