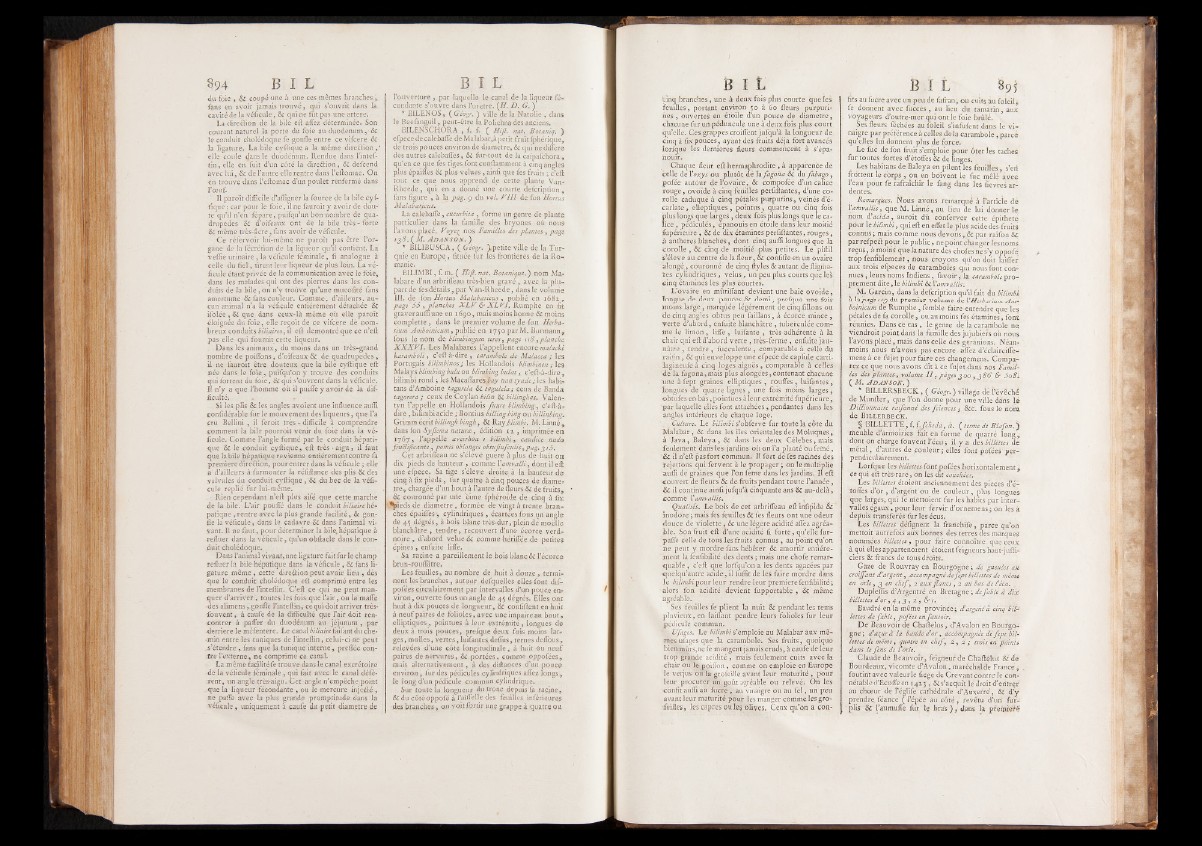
894 B I L
du foie , & coupé une à une ces mêmes branches *
fans en avoir jamais trouvé, qui s’ouvrît dans la
cavité de la véficule, & qui ne fut pas une artere.
La direction de la bile eft affez déterminée. Son
courant naturel la porte du foie au duodénum , &
le conduit cholédoque fe gonfle entre ce vifcere &
la ligature. La bile cyftiquea la même direftïon,/
elle coule dans le duodénum. Rendue dans l’intef-
tin, elle en fuit d’un côté la direction, & defcend
avec lui, & de l’autre elle rentre dans l’eftomac. On
én trouve dans l’eftomac d’un poulet renfermé dans
l’oeuf.
Il parôît difficile d’aflignér la fource de la bile cy f-
fiquc ; car pour le foie, il ne fauroit y avoir de doute
qu’il n’en fépare, puifqu’un bon nombre de quadrupèdes
& d’oifeaux ont de la bile très-forte
& même très-âcre, fans avoir de véficule.
Ce réfervoir lui-même ne paroît pas être l’organe
de la fécrétion de la liqueur qu’il contient. La
veffie urinaire , la véficule féminale, fi analogue à'
celle du fiel, tirent leur liqueur de plus loin. La véficule
étant privée de la communication avec le foie,
dans les malades qui ont des pierres dans les conduits
de la bile, on n’y troüve qu’une mucofité fans
amertume & fans couleur. Comme, d’ailleurs, aucun
animal n’a la véficule entièrement détachée &
ifolée , & que dans ceux-là même où elle paroît
éloignée du foie, elle reçoit de ce vifcère dé nombreux
conduits biliaires, il eft démontré que ce n’eft
pas elle qui fournit cette liqueur.
Dans les animaux, du moins dans un très-grand
nombre de poiflons, d’oifeaux & de quadrupèdes ,
il ne fauroit être douteux que la bile cyftique eft
née dans le foie, puifqu’on y trouve des conduits
qui fortent du foie, & qui s’ouvrent dans la véficule.
Il n’y a que l’homme où il puifle y avoir de la difficulté,
. .
Si les plis & les angles avoient une influence aufli
eonfidérable fur le mouvement des liqueurs, que l’a
cru Bellini , il feroit très - difficile à comprendre
comment la bile pourroit venir du foie dans la véficule.
Comme l’angle formé par le conduit hépatique
& le conduit cyftique, eft très-aigu, il faut
que labile hépatique revienne entièrement contre fa
première direction, pour entrer dans la véficule ; elle
a d’ailleurs à furmpnter la réfiftanee des plis & des
valvules du conduit cyftique, &c du bec de la véficule
replié fur lui-meme.
Rien cependant n’eft plus aifé que cette marche
de la bile. L’air poüflé dans le conduit biliaire hépatique
, rentre avec la plus grande facilité, & gonfle
la véficule, dans le cadavre & dans l’animal vivant.
Il ne faut , pour déterminer la bile, hépatique à
■ refluer dans la véficule, qu’un obftaçle dans le conduit
cholédoque.
Dans l’animal vivant,une ligature fait fur le champ
refluer la bile hépatique dans la véficule , & fans ligature
même, cette direction peut avoir lieu , dès
-que le conduit- cholédoque eft comprimé entre les
membranes de l’inteftin. C’eft ce qui ne peut manquer
d’arriver , toutes les fois que l’air, ou la maffe
-des alimens, gonfle l’inteftin,- ce qui doit arriyer très-
-fouvent, à caufe de la difficulté que l’air doit rencontrer
à paffer du duodénum au jéjunum , par
-derrière le méfentere. Le canal biliaire faifant du che-
-min entre les tuniques. de l%.t eftin, celui-ci ne peut
„s’étendre, fans que la tunique interne, preflée coq-
fre l’externe, ne comprime ce-canal.
La même facilité.fe trouve dans le canal excrétoire
de la véficule féminale, qui fait avec le canal déférent,
un angle très-aigu. Cet angle n’empêche.point
que la liqueur fécondante , ou le mercure, ipjeâé y
ne paffe avec la plus grande promptitude dans la
véficule, uniquement à eaufe du petit diamètre de
B I L
l’ouverture , par laquelle le canal de la liqueur fécondante
s.’ouvre dans l’uretre. (H. D. G. )
* BILENOS, ( Géogr. ) ville de la Natolie , dans
le Beefanguil, peut-être la Polichna des anciens,
BILENSCHORA , f. f. f Hiß- riat- Botaniq. )
efpece de calebaffe de Malabar,à petit fruit fphérique,
de trois pouces environ de diamètre, & qui ne différé
des autres calebaffes, & fur-tout,de la caïpafchora ,
qu’en ce que fes tiges, font çonftamment à cinq angles
plus épaifles & plus velues, ainfi que fes fruits ; c’eft
tout ce que nous apprend de cette plante Van-
Rheede, qui en a donné une courte defcriptio'n,
fans figure , à la pag-ç). du vol, VIII de fon Hortus
Malabancus.
La calebaffe, cucurbita , forme un genre de plante
particulier dans la famille des bryones où nous
l’avons placé. Voye%_ nos Familles des plantes, page
1 3 8 . ( M . A d a n s o n . )
* BILIBUSCA, ( Géogr. ^petite ville de la Turquie
en Europe, fituée fur les frontières de la R o-
manie.
BILIMBI, f. m. ( Hiß. nat. Botanique. ) nom Ma-
labare d’un arbriffeau très-bien gravé, avec la plupart
de fes détails, par Van-Rheede, dans le volume
III, de fon Hortus Malabaricus , publié en 1682 ,
page'55 , planches X L F & X L V l. Rumphe en fit
graveràuffiune en 1690, mais moins bonne ê? moins
complette, dans le premier volume de fon Herbarium
Amboinicum, publié en 1750 par M. Burmann ,
fous le nom de blimbinguin teros , page 118,planche.
X X X V 1. Les Malabar.es l’appellent encore malacki
karamboli , c’eft à-dire , carambole de Malaçça ; les
Portugais bilimbinos; les Hollandois blimbinen ; les
Malays blimbîng bulu ou blimbing bulat, c’eft-à-dire ,
bilimbi rond ; les Maçaffares&zy nan tyade; les habi-
tans d’Amboine tagurela & tagulela; ceux de Banda
tagorera j ceux de Ceylan bilin & billinghas. Valen-
tyn l’appelle en Hollandois faire blimbing, ç’eft-à-
dir e , bilimbi acide ; Bonîius billing bing qu bülinbing.
Grimm écrit billingh bingh, & fkayblimbi, M. Linné ,
dans fon Syfiema natura, édition 1 2 , imprimée en
1767, l’appelle averrhoa 1 bilimbi, caudice nudot
fruçlificante , pomis ôblongis obtußufculis, pag, 7 (5;
Cet arbriffeau ne s’élève guère à plus de huit ou
dix pieds de hauteur , comme Yamvalli, dont il eft
une efpece. Sa tige s’élev.e droite- à la hauteur de
cinq à fix pieds , fur quatre à cinq pQUf.es de diamer
tre, chargée d’un bout à l’autre de fleurs & de fruits,
& couronné par urie cime fphéroïde de cinq à fix
^ieds de diamètre, formée de vingt à trepje branches
épaifles*, cylindriques , écartées fous un angle
de 45 degrés, à bois blanc très-dur, plein de moelle
blanchâtre , tendre, re.couvert d’une écorce verd-r
poire , d’abord velue & comme hériflçe de petites
épines, enfuite liffje.
Sa racine a pareillemept le bois blanc & l’éf orce
brup-rouffâtre,
Les feuilles , au nombre de huit à douze 3 terminent
les branches., autour defquelles elles font dif-
pofées circulairement par intervalles d’un pouce enr
vir.op, ouverte fous un angle de 45 dégrés. Elles ont
huit à dix pouces de longueur, & confiftent en huit
à neuf paires de folioles, avec une impaire au bout,
elliptiques, pointues à leur extrémité, longues de
deux à trois pouces, prefque deux fois moins lai>
ges, molles, vertes, luifaptes. deffiis, ternes deftous ,
relevées d’une côte longitudinale, à huit ou neuf
paires de nervures, & portées, comme pppofées,
mais, alternativement, ;à ,des diftaoces d’un pouce
environ, fur des pédicules cylindriques affez longs ,
le long d’un pédicule commun cylindrique. ,
Sur tonte la longueur du tronc .depuis fa racine,'
& du côtéoppofé à l’aïflelle des feuilles inférieures
des branches, on voit fortir une grappe à quatre ou
Ë I L
cinq , branches , une à deux fois plus courte que les
feuilles, portant environ 50 à 60 fleurs purpurines
, ouvertes en étoile d’un pouce de diamètre,
chacune fur urt péduncule une à deux fois plus court
qu’elle. Ces grappes croiffent jufqu’à la longueur de
cinq à fix pouces, ayant des fruits déjà fort avancés
lorfque les dernieres fleurs commencent à s’épanouir.
Chaque fleur eft hermaphrodité, à apparence de
celle de Yoxys ou plutôt dé la fagoha & du fàbago,
pofée autour de l’ovaire, & compofée d’un calice
rouge, ovoïde à cinq feiiilles pèrfiftantes, d’une corolle
caduqùë à cinq pétales purpurins, veinés d’écarlate
, elleptiques, pointus, qiiatre ou cinq fois
jiliis longs que larges , deux fois plus longs que le calice
, pédiculés , épanouis en étoile dans leur moitié
fupérieure , & de dix étamines perfiftântës, rouges,
à anthères blanches, dont cinq aufli longues que la
corolle, & cinq de moitié plus petites. Le piftil
is’éleve au centre de la fleur, & confifte en un ovaire
àlongë , couronné de cinq ftyles & autant de ftigiha-
tes cylindriques, velus, un peu plus courts que le à
cinq étamines lès plus tourtes.
L’ovaire en mûriflant devient une baie ovoïde,
longue de deux pouces & demi, prefquè une fois
inôins large , marquée légèrement de cinq filions ou
de cinq angles obtus peu faillàns, à écorce mince ,
verte d’abord, enfuite blanchâtre , tuberculée comme
le limon, liffe , luifanre , très-adhérente à la
chair qui ëft d’abord verte , très-ferme , enfuite jau*-
nâtre , tendre , fucculente , comparable à celle du
raifin, & qui enveloppe urie efpece de capfule cardia
gineufé à cinq loges aiguës, comparable à celles
de la fagona, mais plus alongéès, contenant chacune
une à fept graines! elliptiques , rôuffes, luifantés,
longues de quatre lignes, une fois moins larges j
obtufes en bas,pointues àleur extrémité fupérieure,
par laquelle elles font attachées, pendantes dans lés
angles intérieurs de chaque loge.
Culture. Le bilimbi s’obferve fur toute la côté dû
Malabar, & dans les îles orientales des Molirqües.,
à Java, Baieya, & dans les deux Célebes, mais
feulement dans les jardins où on l’a planté bufemé,
•& il n’eft pas fort commun. Il fort dé fes racines des
rejettôriS qui fervent à le propager ; on le multiplie
aufli de graines que l’on feine dans les jardins. Il eft
couvert de fleurs & de fruits pendant toute l’année,
&.iL continue ainfi jufqu’à cinquante ans & au-delà,
comme Vamvalli§.
Qualités. Le bois de cet arbriffeau eft infipide &
inodore ; mais fes feuilles & fes fleurs ont une odeur
douce dé violette,- & urie légère acidité affez agréable.
Son fruit eft d’une acidité fi forte, qu’elle fur-
paflè celle de tous les fruits conrius, au point qu’on
ne peut y mordre fans hébéter Si amortir efttiérè-
xnent la fenfibilité des dents ; mais une chôfe remarquable
, e’eft que loffqu’on a les dents agacées par
quelqu’autre acide, il fuffit de les faire mordre dans
le bilimbi pour leur rendre leur première fenfibilité;
alors fon acidité devient fupportable , Sc même
agréable.
Ses feuilles fe plient la nuit & pendant les terris
pluvieux, en laiflant pendre leurs folioles fur leur
pédicule commun.
Ufâges. Le bilimbi s’emploie au Malabar aux mêmes
ufages que la carambole. Ses fruits, quoique
bien murs,ne fe mangent jamais cruds, à caiife de leur
trop grande acidité, mais feulement cuits avec la
chair ou le poiflon, comme on emploie en Europe
le verjus oii la grofeille avant leur maturité , p'our
leur procurer un goût agréable ou relevé. On le's
•confit aufli au fucre, au vinaigre ou àu fe l, un peu
avant leur maturité pour les manger comme les groseilles
, les câpres ou le$ olives. Ceux qu’on a cou-
B I L M
nts au fucre avec un peu de fafran, ou cuits àu foleil;
fç donnent avec fuccés , au lieu du tamarin, aux
voyageurs d’outre-mer qui ont le foie brûlé. ,
Ses fleurs fechées au foleil s’infufent .dans le vinaigre
par préférence à celles delà earamiîble , parce
qu’elles lui donnent plus de force;
Le lue de fon fruit s’emploie pour ôter les tachefi
fur toutes fortes d’étoffes & de linges.
. Les habitans de Baieya en pilent; les feuilles, s’eri
frottent le corps , pu en boivent le fuc mêlé avec
l’eau pour fe rafraîchir le fang dans ies fievires ardentes..
,
. Remarques. Noiis avons remarqué à l’article dé
Ÿamvallis, que M. Linné, au lieu de lui donner le
nom d’acida, auroit dû eonferver cette épithetè
pour le bilimbi, qui eft en effet le plus acide des-fruits
connus ; mais comme nous devons, & par raifon ôc
par refpeflt pour le public, ne point changer les noms
reçus, à moins que la nature des chofes ne s’y bppofe
trop fenfiblemerit, nous croypns qii’on doit faiflér
aux trois efpeces de caramboles qui nous font con‘
nues, leurs noms Ihdiens, favoir ,• la carambole proprement
dite , le bilimbi & Yamvallis.
, M. Garcin, dans la defeription qu’il fait du bilimbi
à Wpagkiic) du premier volume de YHerbarium Amboinicumdé
Rumphe, femble faire entendre que les
pétales de fa CProlle, ou au moiris fes étamines, font
réunies. Dans ce cas , le genre de la carambole ne
Viendroit point dans la famille des jujubiers où nous
l’avons placé, mais dans1 celle des gerânions. Néanmoins
nous n’avoris pas encore affez d’éclairciffe-
mens à ce filjèt pour faire cès changemens. Comparez
ce que nous avons dit à ce fujét dans nos Familles
des plantes, volume I I , pages 306, 38S & 5o8L
( M . A d a n s o n . )
* BILLERSBECÏC, ( Géogr. ) village dé l’évêché
de Munfter, que Ton donne pour une ville dans lé
Dictionnaire raifonné des fciencesj &C. fous le nom.
de Billerbe ck.
§ BILLETTE, f. f. fcheda, à. ( terme de Blafon. j
meuble d’àrriioiries fait en forme de quarré long ,
dbnt On chârge fouvërit l’écü ; il y a des billettes de
métal, d’autres de (couleur; elles font pofées perpendiculairement.
Lorfque les billettes font pofée,s horizontalement,
ce qui eft très-rare, on les dit couchées.
Lés billettes étoierit anciennement des pièces d’é-
.•toffes d’ôr , d’argent ou de côulëur, plus longues
que larges, qui fë nièttoient fur les habits par intervalles
égaux, pour leur fervir d’ornemens; on les à
depuis transférés -fur lêsécus.
Les billettes défîgnerit la frarichife, parce qu’on
mettoit autrefois aux bornes des terres des marques
nommées billettes, pour faire connbître que. ceux
à qui elles apparterioient étoierit feignêurs haut-juftï-
ciers & francs de tous droits.
Gaze dè Roùvrày en Bourgogriè ; dé gueules ait
croijfant d?argent, accompagné de fept billettes de même
éii orée, 3 en chef, 2 aux flancs ,2 au bas de Vécu.
Dupleflïs d’Argentré en Bretagne ; de fable à dix
billettes d’or, 4 3 3 , 2 , & 1.
Baudré en’la même province; Æargent à cinq bïU
lettes de fable, pofées en faiiioir.
De Beauvoir dé Chaftelüs, d’Àvàlon en Bourgogne
; d attira la bande (Cor , accompagnée de fept billettes
de même, quatre en chef, 2 , 2. ; trois en points
dans le fens de l orle.
. Claude de Beauvoir, feigrieuf de ChaftèltiS &: éê
Bourdeaux, vicomte d’Âvàlon, iriaréchalde France ,
foutirit avec valeur le fiege de Crevant contre" le connétable
d’EcofTe en 1423 , & s’acquît le droit d'entrer
au choeur de l’églife cathédrale d’Auxerre, Sé d’y
prendre, féance ( l’épée au Côté, f'eVetu d’un fur-1
plis ôi. l’aumuffe fur le bra's ) y dans la pfemièté