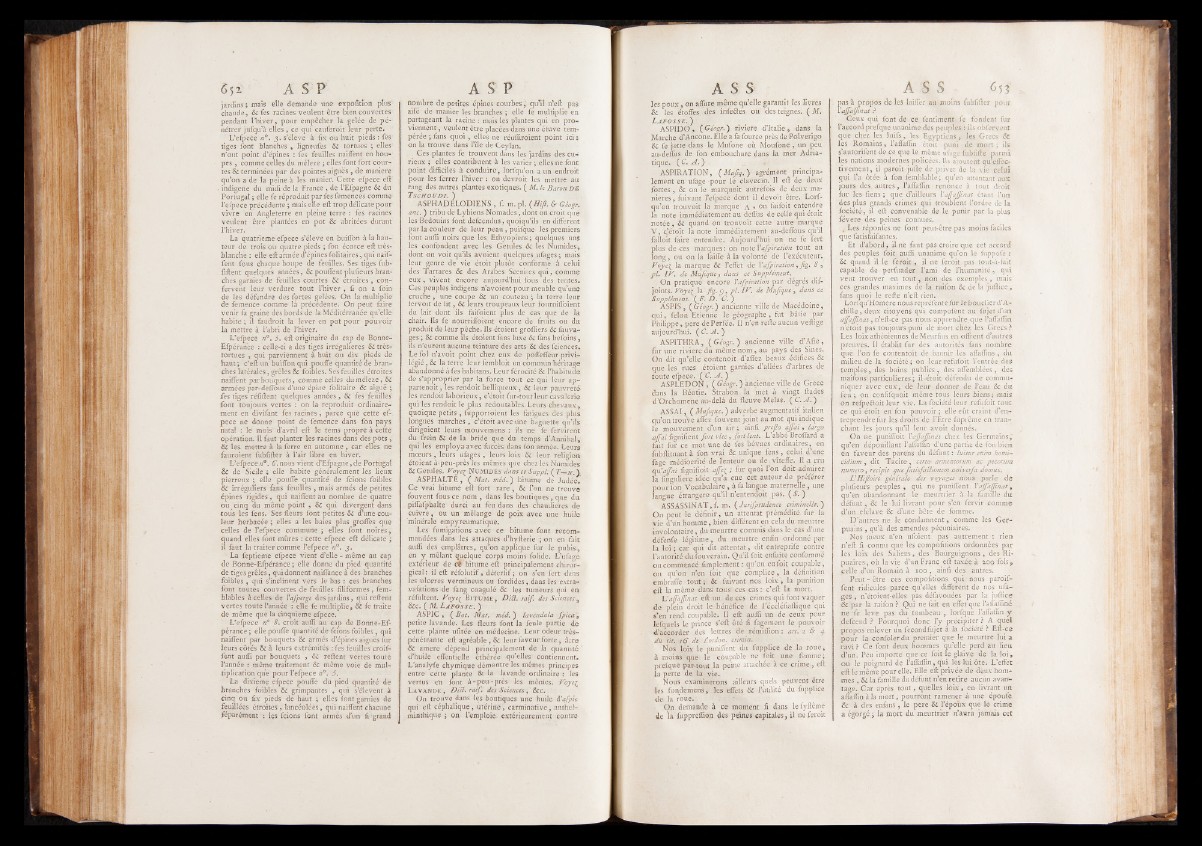
652 A S P
jardins; 'maïs elle demande une expofitiort plus
chaude, & fes racines veulent être bien couvertes
pendant l ’hiver, pour empêcher la. gelée de pénétrer
jufqu’à elles , ce qui caufêroit leur perte.
L’efpece n°. 3 . s’élève à fix ou huit pieds : fes
tiges font blanches , ligneufes & tortues ; elles
n’ont point d’épines : fes feuilles nailfent en hou-'
pes , comme celles du méleze ; elles font fort courtes
& terminées par des pointes aiguës , de maniéré
qu’on a de la peine à les manier. Cette efpece eft
indigène du midi de la France , de l’Efpagne & du
Portugal ; elle fe réproduit par fes femences comme
l’efpece précédente ; mais elle eft trop délicate pour
vivre en Angleterre en pleine terre : fes racines
veulent être plantées en pot & abritées durant
l’hiver.
La quatrième efpece s’élève en buiffon à la hauteur
de trois ou quatre pieds ; fon écorce eft très-
blanche : elle eft armée d’épines folitaires, qui naif-
fent fous chaque houpe de feuilles. Ses tiges fub-
liftent quelques années, & pouffent plulieurs branches
garnies de feuilles courtes & étroites, .con-
fervent leur verdure tout l’hiver , fi on a foin
• de les défendre des fortes gelées. On la multiplie
de femence comme- la précédente. On peut faire
venir fa graine des bords de la Méditérranée qu’elle
habite ; il faudroit la lever en pot pour pouvoir
la mettre à l’abri de l’hiver.
L’efpece n°. 6. éft originaire du cap de Bonne-
Efpérance : celle-ci a des tiges irrégulières & très-
tortues , qui parviennent à huit ou dix pieds de
haut ; c’ eft un buiffon qui pouffé quantité de branches
latérales, grêles & foibles. Ses feuilles étroites
naiffent par bouquets, comme celles du méleze, &
armées par-deffous d’uné épine folitaire & aiguë ;
fes tiges réfiftent quelques années, & fes feuilles'
font toujours vertes : on la reproduit ordinairement
en divifant fes racines, parce que cette efpece
ne donne point de femence dans fon pays
natal :’ le mois d’avril eft le téms propre à cette
opération. Il faut planter les racines dans des pots ,
& les mettre à la ferre en automne, car elles ne
fauroient fubfifter à l’air libre en hiver.
L’efpece«®. A. nous vient d’Efpagne,de Portugal
& de Sicile ; elle habite généralement les lieux
pierreux ; elle pouffe quantité de fcions foibles.
& irréguliers fans feuilles , mais armés de petites
épines rigides, qui naiffent au nombre de quatre
ou cinq du même point , & qui divergent dans
tous les fens. Ses fleurs font petites & d’une couleur
herbacée ; elles a les baies plus groffes que
celles de l’efpece commune ; elles fbnt noires,
quand elles font mûres : cette efpece eft délicate ;
il faut la traiter comme l’efpece n°. 3.
La feptieme efpece vient d’elle - même au cap
de Bonne-Efpérahce ; elle donne du pied quantité
de tiges grêles, qui donnent naiffance à des branches
foibles , qui s’inclinent vers le bas : ces branches
font toutes couvertes de feuilles filiformes, fem-
blables à celles de Yafperge des jardins, qui reftent
vertes toute l’année : elle fe multiplie, & fe traite
de même que la cinquième efpece.
L’efpece n° 8. croît aufli au cap de Bonne-Ef-
pérance ; elle pouffe quantité de fcions foibles, qui
naiffent par bouquets & armés d’épines aiguës fur
leurs côtés & à leurs extrémités ::fes feuilles croif-
fent aufli par bouquets , & reftent vertes toute
l’année : même traitement & même voie de multiplication
que pour l’efpece n°. 5 .
La dixième efpece pouffe du pied quantité de
branches foibles & grimpantes , qui s’élèvent à
cinq ou fix pieds de haut ; elles font garnies de
feuillées étroites , lancéolées, qui naiffent chacune
féparément : les fcions font armés d’un fi 'grand
A S P
nombre de petites épines courbes ^ qu’il n’eft pas
aifé de manier les branches ; elle fe multiplie en
partageant la racine : mais les plantes qui en proviennent
, veulent être placées dans une étuve tempérée
; fans q u o i, elles ne réufliroient point ic i;
on la trouve dans Pile de Ceylan.
Ces plantes fe trouvent dans les jardins des curieux
; elles contribuent à les varier ; elles ne font
point difficiles à conduire , lorfqu’on a un endroit
pour les ferrer l’hiver : on devroit les mettre au
rang des autres plantes exotiques. ( M. le Baron DE
Ts ch o u d i . )
ASPHADELODIENS , f. m. pl. (Hifi. & Géogr*
anc. ) tribu de Lybiens Nomades, dont on croit que
les Bédouins font defcendus, quoiqu’ils en different
par la couleur de leur peau, puifque les premiers
font aufli noirs que les, Ethyopiens ; quelques uns
les confondent avec les Getules & les Numides*
dont on voit qu’ils avoient quelques ufages ; mais
leur genre de vie étoit plutôt conforme à celui
des Tartares & des Arabes Scenites qui, comme
eu x , vivent encore aujourd’hui fous des tentes.
Ces peuples indigens n’avoient pour meuble qu’une
cruche, une coupe & un couteau ; la terre leur
fervoit de li t , & leurs troupeaux leur fournifioient
du lait dont ils faifoient plus de cas que de la
chair. Ils fe nourriffoient encore de fruits ou du
produit de leur pêche. Ils étoient grofliers & fauva-
ges ; & comme ils étoient fans luxe &c fans befoins ,
ils n’eurent aucune teinture dés arts & des fciences.
Le fol n’avoit point chez eux de pôffeffeur privilégié,
& la terre leurfembloit un commun héritage
abandonné à fes habitans. Leur férocité & l’habitude
de s’approprier par la force tout ce qui leur ap-
partenoit, les rendoit belliqueux, & leur pauvret©
les rendoit laborieux, c’étoit fur-tout leur cavalerie
qui les rendoit le plus redoutables. Leurs chevaux,
quoique petits , fifpportoient les fatigues des plus
longues marches , c’étoit avec fine baguette qu’ils
dirigoient leurs mouvemens : ils ne fe fervirent
du frein & dé la bride que du temps d’Annibal,
qui les employa avec fuccès dans fon armée. Leurs
moeurs, leurs ufages , leurs loix & leur religion
étoient à-peu-près les mêmes que chez les Numides
& Getules. Voye^ Num id e s^«* ce Suppl. (T —jv.)
ASPHALTE, ( Mat. mèd. ) bitume de Judée.
Ce vrai bitume eft fort rare , & fon ne trouve
fouvertt fous ce nom , dans les boutiques , que du
piffafpbalte durci au feu dans des chaudières de
cuivre, ou un mélange de poix avec une huile
minérale empyreumatique.
Les fumigations avec ce bitume font recommandées
dans les attaques d’hyfterie ; on en fait
aufli des emplâtres, qu’on applique fur le pubis,
en y mêlant quelque corps moins folide. L’ufage
extérieur de ré bitume eft principalement chirurgical:
il eft réfolutif, déterfif ; on s’en fert dans
les ulcérés vermineux ou fordides , dans les extra-
vafations de fang coagulé & les tumèurs qui en
réfultent. Voye^ Bitume, Dici. raif, des Sciences,
&c. ( M. L a f o s s e . )
ASPIC , (Bot. Mat. mèd. ) lavèndula fpica 'f
petite lavande. Les fleurs font la feule partie de
cette plante ufitée en médecine. Leur odeur très-
pénétrante eft agréable, & leur faveur forte, âcre
& amere dépend principalement de la quantité
d’huile effentielle éthérée qu’ elles contiennent.
L’analyfe ehymique démontre les mêmes principes
entre cette plante & la lavande ordinaire : les
vertus eh font à-peu-près les mêmes. Voye£
Lavande , Dicl. raif.' des Sciences, ' &cc.
On trouve dans les boutiques une huile d’afpic
qui eft céphalique , utérine, carminative, anthel-
minthique ; on l’emploie, extérieurement contre
A S S
les poux, on affure même qu’elle garantit les livrés
& les étoffes des infe&es ou des teignes. ( M.
L a f o s s e . )
ASPIDO, ( Géogr. ) riyiefe d’Italie, dans la
Marche d’Ancone. Elle a fa fource près de Polverigo
& fe jette dans le Mufone où Moufone, un peu
au-deflùs de fon embouchure dans la mer Adriatique.
( Ç. A . ) .
ASPIRATION, ( Mujîq.y agrément principalement
en ufage-pour le clavecin. Il eft de deux
fortes , & on le marquoit autrefois de ■ deux maniérés,
fuivant l’efpece dont il devoit être.. Lorfqu’on
trou voit la marque A > on faifoit entendre
la note immédiatement au defliîs de celle qui étoit
notée, & quand on trouvoit cette autre marque
V , c’étoit la note immédiatement au-deffous qu’il
falloit faire entendre. Aujourd’hui on ne fe fert
plus de ces marques : on note Yafpiratiôn tout au
long, ou on la laiffe à la volonté de l’exécuteur.
Foyei la marque & l’effet de V afp i rat ion, fig. 8 ,
pl. IV. de Mufîque ■, dans ce Supplément.
. On pratique ëncore Yafpiratiôn par dégrés dif-
ioints. Voyez la ./îg’. o , pl. IV. de Mufîquedans ce
Supplément. ( F. D . C. )
ASPIS , ( Géogr.) ancienne ville de Macédoine,
q ui, félon Etienne le géographe, fut bâtie par
Philippe , pere dePerfée. Il n’en refte aucun veftige
aujourd’hui. ( C. A . )
ASPITHRA, (Géogr, ) ancienne ville d’A fie ,
fur une riviere du même nom, au pays des Sines.
On dit qu’elle contenoit d’affez beaux édifices &
que les rues étoient garnies d’allées d’arbres de
toute efpece. ( C. A . )
ASPLEDON, ( Géogr. ’) ancienne ville de Grece
dans la Béotie. Strabon la met à vingt ftades
d’Orchomene au-delà du fleuve Mêlas. ( C .A .)
ASSAI, ( Mufîque. ) adverbe augmentatif italien
qu’on trouve affez fouvent joint au mot qui indique
le mouvement d’un air ; ainfi preflo affai, largo
ajfai fignifient fort vite, fort lent. L ’abbé Broffard a
fait fur ce mot une de fes bévues ordinaires, en
fubftituant à fon vrai & unique fens, celui d’une
fage médiocrité de lenteur ou de. vîteffe. Il a cru
qu''ajfai fignifioit ajfei ; fur quoi l’on doit admirer
la finguliere idée qu’a eue cet auteur de préférer
pour fon Vocabulaire, à fa langue maternelle, une
langue étrangère qu’il n’entendoit pas. (S .')
ASSASSINAT, f. m. ( Jurifprudence criminelle. )
On peut’ le définir, un attentat prémédit© fur la
vie d’un homme, bien différent en cela du meurtre
involontaire, du meurtre commis dans le cas d’une
défenfe légitime, du meurtre enfin ordonné par
la loi ; car qui dit attentat, dit entreprife contre
l’autorité du fouverain. Qu’il foit enfuite confomme
ou commencé Amplement : qu’on en foit coupable ,
ou qu’on n’en foit que complice, la définition
embraflê tout ; & fuivant nos loix * la punition
eft la même dans tous ces cas : c’eft la mort.
\Jaffaffinat eft un de ces crimes qui font vaquer
de plein droit le bénéfice de l ’éccléfiaftique qui
s’en rend, coupable. Il eft aufli un de ceux pour
lefquels le prince s’eft ôté fi fagement le pouvoir ;
d’accorder des lettres de rémiflion : art. 2. & 4 \
du tit. j 6 de l'ordon. crimin.
Nos lôix le puniffent du fupplice de la roue, ■
à moins,que le coupable ne foit une femme;. ;
prefque par-tout la peine attachée à ce crime, eft ]
la perte de la vie»
Nous examinerons ailleurs quels peuvent être
les fondemens, les effets & l’utilité du fupplice
de- la roue. - * V
Qn. demande à ce moment fi dans lefyftêmé
de la fuppreflion des peines capitales, il ne feroit
A S S 653
pas à propos de les laiffer au moins fubfifter pour
Yaffaffinat ?
Ceux qui font de ce fentiment fe fondent fur
l’accord prefque unanime des peuples : ils obfervent
que chez les Juifs, les Egyptiens, les Grecs &
les Romains, l’aflaflin étoit puni de mort ; ils
s’autorifent de ce que le même ufage fubfifte parmi
les nations modernes policées. Ils ajoutent qu’effec-
tivement, il paroît jufte de priver de la vie celui
qui l’a ôtée à fon femblable; qu’en attentant aux
jours ■ des, autres , Paffaflin ■ renonce à tout droit
fur les fiéris ; que d’ailleurs YaflaJJînat étant l’un
des plus grands crimes qui troublent l’ordre de la
fociété, il eft convenable de le punir par la plus
févere des peines connues.
, Les réponfes ne font peut-être pas moins faciles
que fatisfaifantes.
Et d’abord, il ne faut pas croire que cet accord
des peuples foit aufli unanime qu’on le fuppofe :
& quand il le fe ro it, il ne feroit pas tout-à-fait
capable de perfuader l’ami de l’humanité, qui
veut trouver en tou t, non des exemples, mais
ces grandes maximes de la raifon & de la juftice ,
fans quoi le refte n’eft rien.
Lorfqu’Homere nous repréfente fur le bouclier d’Achille,
deux citoyens qui compofent au fujet d’un
ajfajjinat, n’eft-ce pas nous apprendre, que l’affaflin
• n’étoit pas toujours puni de mort chez les Grecs ?
Les loix athéniennes de Meurfius en offrent d’autres
preuves. Il établit fur des autorités fans nombre
què l’on fe contentoit de bannir les affaflîns, du
milieu de la fociété ; on leur refufoit l’entrée, des
temples, des bains publics, des affemblées, des
maifons particulières; il.étoit défendu de communiquer
avec- eux, de leur donner de l’eau & du
feu ; on confifquôit même tous leurs biens; mais
on refpeâoit leur vie. La fociété leur refufoit tout
ce qui étoit en fon pouvoir ; elle eût craint d’entreprendre
fur les droits de l’Etre fuprême en tranchant
les jours qu’il leur avoit donnés.
On ne puniffoit YaJJiÆnat chez les Germains,-
qu’en dépouillant l’affalun d’une partie de fon bien
en faveur des parens du défunt : luitur enim homi-
cidium, dit Tac ite, certo- armentorum ac pecorum
numéro , recipit que fatisfaclionem univerfa domus.
UHïftoife générale des voyages nous parle de
plufieurs peuples , qui ne puniffent Yajfaffinat,
qu’en abandonnant le meurtrier à r la famille du
défunt, & le - lui livrant pour s’en fervir comme
d’un e.fclave & d’une bête de fomme. .
D ’autres ne le condamnent, comme les Ger-
puâins , qu’à des amendes pécuniaires.
Nos aïeux n’en ufoient pas autrement : rien
n’eft fi connu que les compofitions ordonnées par
les loix des Saliens, des Bourguignons, des Ri*
puaires, où la vie d’un Franc eft taxée à 200 fols,
celle d ’un Romain à 100 , ainfi des autres.
Peut-être ces compofitions qui:nous paroif-
fent ridicules parce qu’elles different de nos ufages
, n’étoient-elles pas défavouées par la juftice
:& par la raifon ? Qui ne fait en effet que l’affaflîné
•ne *fe leve pas du tombeau ,. lorfque l’affaflin y
defeend ? Pourquoi donc l’y précipiter ? A quel
propos enlever un fecondfujet à la fociété ? Eft-ce
pour la confolerdu premier que le meurtre lui a
ravi ? Ce font deux hommes qu’elle perd au lieu
d’un. Peu importe que ce foit le glaive de la lo i,
ou le poignard de l’affaflin, qui les lui ôte. L’effet
eft le même pour elle. Elle eft privée de deux hommes
& la famille du défunt n’en retire aucun avantage.
Car après tou t, quelles lôix , en livrant un
affaffip à la mort, pourront ramener à une époufe
& à des enfans , le pere & l’époux que le crime
a égorgé,; la mort du meurtrier n’aura jamais cet