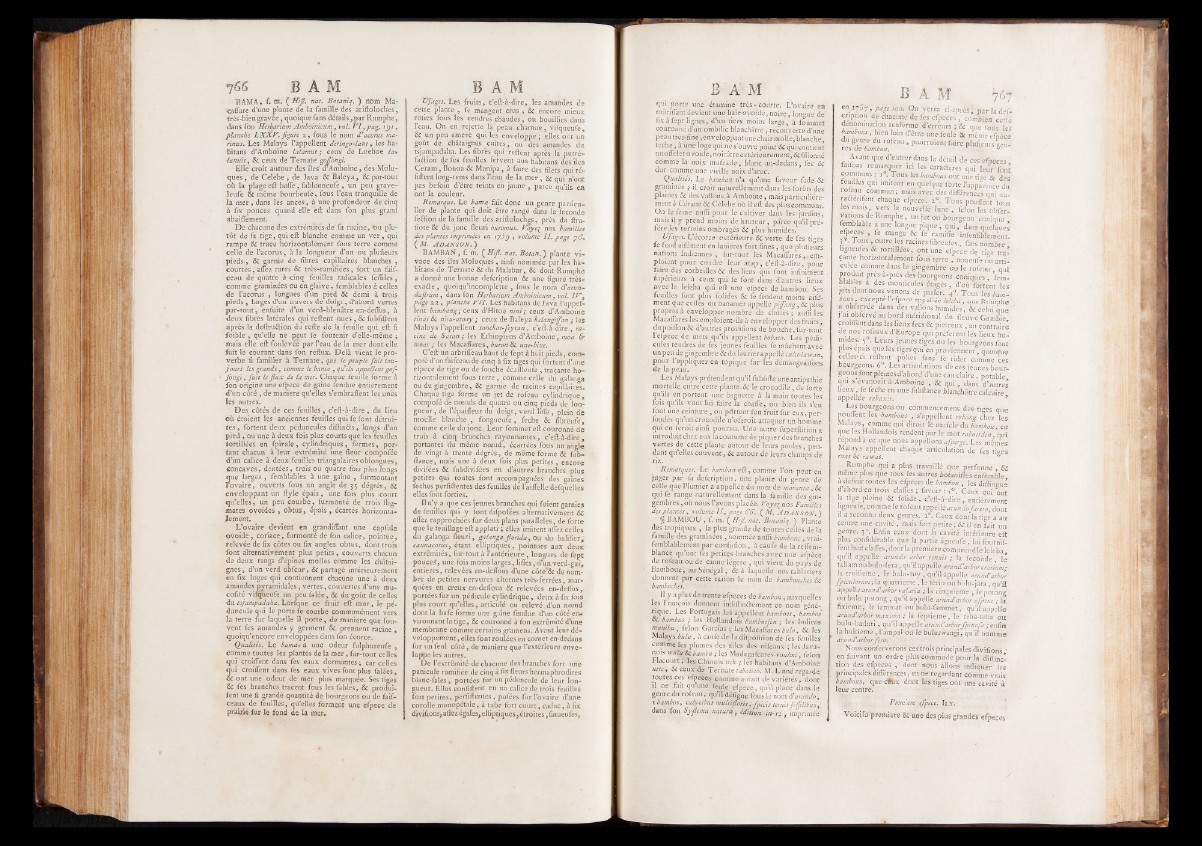
B A M
B AM A , î. m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) nô'm Ma-
■ Caffare d’ane plante de la famille des ariftoloches,
très-bien gravée, quoique fans détails, par Rumphe,
dans fo n Herbarium Amboinicum, vol. V I9pag, l ÿ i ,
planche LXXV. figure 2., fous le nom d‘acorus ma-
rinus. Les Malays l’appellent deringo-laut, les habitans
d’Amboine lalamut ; ceux de Loehoe la*
lanuit, & ceux de Ternate goflorigi.
Elle croît autour des îles' d’Amboine, des Molu-
ques, de Celebe , de Java & Baleya, & par-tout
où la plage eft baffe, fablonneufe , un peu grave-
leufe & même bourbeufe, fous l’eau tranquille de
la mer, dans les ances, à une profondeur de cinq
à fix pouces quand elle eft dans fon plus grand
abaiflèment.
De chacune des extrémités de fa racine, *ou plutô
t de fa tige, qui eft blanche comme un v e r , qui
rampe & trace horizontalement fous terre comme
celle de l’acorus, à la longueur d’un ou plufieurs
pieds-, & garnie de fibres capillaires blanches ,
courtes, affez rares & très-ramifiées, fort un faif-
ceau de quatre à -cinq feuilles radicales feffiles,
comme graminées ou en glaive, femblables à celles
de l’acorus , longues d’un pied & demi à trois
pieds , larges d’un travers de doigt, d’abord vertes
par-tout, enfuite d’un verd-bleuâtre en-deffus, à
deux fibres latérales qui reftent nues , & fubfiftent
après la deftruftion du refte de la feuille qui eft fi
foible , qu’elle ne peut fe foutenir d’elle-même ;
mais elle eft foulevee par l’eau de la mer dont elle
fuit le courant dans fon reflux. Delà vient le proverbe
fi familier à Ternaté, que le peuple fuit toujours
les grands, comme le bama , qu'ils appellent gof-
fongi, fuit le flu x de la mer. Chaque feuille forme à
fon origine une eipece de gaîne fendue entièrement
d’un cô té, de maniéré qù’elles s’embraffent les unes
les autres.
Des côtés de ces feuillës, c’eft-à-dire, du lieu
où étoient les anciennes feuilles qui fe font détruites
, fortent deux péduncules diftinâs, longs d’un
pied, ou une à deux fois plus courts que les feuilles
tortillées en fpirale, Cylindriques, fermes, portant
chacun à leur extrémité une fleur compofée
d’un calice à deux feuilles triangulaires oblongues,
concaves, dentées, trois ou quatre fois plus longs
que larges, femblables à une gaîne , furmontant
l’ovaire, ouverts fous un angle de 35 degrés, &
enveloppant un ftyle épais, une fois plus court
qu’elles, un peu courbe, furmonté de trois ftig-
riiates ovoïdes , obtus, épais , écartés horizontalement.
L’ovaire devient en grandiffant une capfule
ovoïde, coriace, furmonté de fon calice, pointue,
relevée de fix côtes ou fix angles obtus, dont trois
font alternativement plus petits, couverts chacun
de deux rangs d’épines molles comme les châtaignes,
d’un verd obfcur, & partagé intérieurement
en fix loges qui contiennent chacune une à deux
amandes pyramidales, vertes, couvertes d’une mu-
cofité vififùeufe un peu falée, & du goût de celles
du tsjàmpàdaha. Lorfque ce fruit eft mur, le pé-
duncule.qui le porte le courbe communément vers
la terre fur laquelle il porte, de maniéré que fou-
vent fes amandes y germent & prennent racine
quoiqu’encore enveloppées dans fon écorce.
Qualités. Le bama» a une odeur fulphureufe
comme toutes les plantes de la mer, fur-tout celles
qui croiffent dans fes eaux dormantes; car celles
qui croiffeftt dans fes eaux vives font plus falées,
& ont une odeur de mer plus marquée. Ses tiges
& fes branches tracent fous les fables, & produi-
ferit une fi grande quantité de bourgeons ou de faif-
ceaiix de feuilles, qu’elles forment une efpece de
prairie fur le fond de la mer.
B A. M
V f âges. Les fruits, c’eft-à-dire, les amandes de
cette plante , fe mangent crus , & ' encore mieux
rôties fous lès cendres chaudes, ou bouillies dans
l’eau. On en ■ •rejette- la peau charnue, vifqueufe,
& un peu amere qui les en-veloppe ; elles ont un
goût de châtaignes cuites, ou dès amandes du
tsjampadaha. Les fibres qui reftent après la putré-
faftion de fes feuilles fervent aux habitans des îles
Ceram, Bonoa & Manipa, à faire des filets qui ré-
liftent long-tems dans l’eau de la mer, & qui n’ont
pas befoin d’être teints en jaune , parce qu’ils en
ont la couleur.
Remarque. Le bama fait donc un genre particulier
de plante qui doit être rangé dans la fécondé
feftion de là famille des ariftoloches, près du ftra-
tiote & du jonc fleuri butomus. Voye^ nos Familles
des plantes imprimées en t j j$ , volume II. page y 6.
(M . A DANS ON. )
B A MB AN , f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) plante v ivace
des îles Moluques, ainfi nommée par les habitans
de Ternate & du Malabar, & dont Rumphe
a donné une bonne defeription & une figure très-
e x a â e , quoiqu’incomplette , fous le nom à'arun-
daflrum , dans fon Herbarium Amboinicum, vol. IV .
page 22 , planche VII. Les habitans de Java l’appellent
bambang; ceux d’Hitoe nini; ceux d’Amboine
tinat & nitu-atoay ; ceux de Baleya kelangijfan ; les
Malays l’appellent tonckat-feytan, c’eft-à-dire., racine
de Satan ; les Ethiopiens d’Amboine, moa &
moar ; les Macaffares, buron & une-bine.
C’eft un arbriffeau haut de fept à huit pieds, com-
pofé d’un faifeeau de cinq à fix tiges qui fortent d’une
efpece de tige ou de fouche écailleufe , traçante horizontalement
fous terre,, comme celle du galanga
ou du gingembre, & garnie de racines capillaires.
Chaque tige forme un jet de rofeau cylindrique,
compofé de noeuds de quatre ou cinq pieds dé longueur,
de l’ëpaifleur du doigt, verd fiffe', plein de
moelle blanche , foiïgueufe, feche & fibrëufe,
comme celle du jonc. Leur fommeteft couronné de
trois' à cinq branches rayonnantes, c’eft-à-dire,
partantes du même noeud, écartées fous un angle
de vingt à trente degrés, de même forme & fub-
ftance, mais une à deux fois plus petites, encore
divifées & fubdivifées en d’autres branches plus
petites qui toutes font accompagnées des gaines
feches perfiftentes des feuilles de l’aiffelle defquelles
elles font forties.
Il n’y a que ces jeunes branches qui foient garnies
de feuilles qui y font difpofées alternativement &
affez rapprochées fur deux plans paralleles, de forte
que le feuillage eft applati ; elles imitent affez celles
du galanga fleuri, galanga florida, ou du balilier,
cannacorus, étant elliptiques, pointues aux deux
extrémités, fur-tout à l’antérieure , longues de fept
pouceS, une fois moins larges, liffes, d’un verd-gai,
entières, relevées en-deffous d’une eôte*& de nombre
de petites nervures alternes très-ferrées, marquées
en creux en-deffous & relevées en-deffus,
portées fur un pédicule cylindrique, deux à fix fois
plus court qu’elles, articulé ou relevé .d’un noeud
dont la bafe forme une gaîne fendue d’un côté enw
vironnant la tige, & couronné à fon extrémité d’une
membrane comme certains gramens. Avant leur développement
, elles font roulées en cornet en-dedans
fur un feul côté, de maniéré que l’extérieure enveloppe
les autres.
De l’extrémité de chacune des branches fort une
panicule ramifiée de cinq à fix fleurs hermaphrodites
blane-fales, portées fur un péduncule de leur longueur.
Elles confiftent en un calice de trois feuilles
fort petites, perfiftentes, po fées fur l’ovaire d’une
corolle monopétale, à tube fort court, caduc, à fix
divifions, affez égales, elliptiques, étroites, ûnueufes,
B A M
qui porte une étamine très-courte. Lfovaire êiî
murifiànt devient une baie ovoïde, noire, longue de
fix à fept lignes, d’un tiers moins large, à fomrnet
couronné d’un ombilic blanchâtre, recouverte d’une
peau très-fine, enveloppant une chair molle, blanche,
feche, à une löge qui ne s’ouvre point & qui contient
unoffelet ovoïde, noirâtre extérieurement, &fillonné
comme la noix mufeade, blanc an-dedans, fec &
dur comme une vieille noix d’arec.
Qualités. Le bamban n’a qu’une faveur fade &
graminée il croît naturellement dans les forêts des
plaines & des vallons à Amboine, mais particuliére-
ment a Cérane & Célebe où il eft des plus communs.
On le ferne auffi pour le cultiver dans les jardins,
mais il y prend moins de hauteur, parce qu’il pré-
féreTés terreins ombragés & plus humides.
Vfages. L’écorce extérieure & verte de fes tiges
fe fend aifément en lanières fort fines, que plufieurs
nations Indiennes , fur-tout lès Macaffares ^emploient
pour'eôudre ieur'atap, c’eft-à-dire, pour
faire des corbeilles & des liens qui font infiniment
, fupérieurs à Ceux qui fe font dans d’autres lieux
avec le leleba qui eft une efpécè de bambou. Ses
feuilles font plus folides & fe fendent moins aifément
que celles du bananier appellé pijfarig, & plus
propres à envelopper nombre de chofes ; auffi les
Macaffares les emploient-ils à envelopper des fruits,
du poiffon & d’autres provifions de bouché, fur-tout
l’efpece de mets qu’ils appellent bobato. Les pédicules
tendres de fes jeunes feuilles fe mâchentavec
un peu de gingembre & du laurier appellé culit-lawan,
pour l’appliquer en topique fur les démangeaifons
de la peau. • . -, ^
Les Malays prétendent qu’il fublïfte une antipathie
mortelle entre cette plante & le crocodile, de forte
qu’ils en portent une baguette à la main toutes les
fois qu’ils vont lui faire la chaffe, ou bien ils s’en
font une ceinture , ou partent fon fruit fur eux, per-
fuadés qu’un crocodile n’oferoit attaquer un homme
qui en feroii ainfi pourvu. Une autre fuperftition a
introduit chez eux la coutume de piquer des branches
vertes de cette plante autour de leurs poules, pendant
qu’elles couvent, & autour de leurs champs de
r iz .
Remarques. Le bamban eft, comme l’on peut en
juger par fa defeription, une plante du genre de
Celle que Plumier a appellée du nom de maranta &
qui fe range naturellement dans la famille des °in-
gembres , 0ù nous l’avons placée. Voye{ nôs Familles
des plantes, volume I I , page. 66. ( M. A D A N SON . )
§ BAMBOU , f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) Plante
des tropiques , la plus grande de toutes celles de la
famille des graminées, nommée auffi bambouc, vrai-
femblablement par confufion, à càufe de lareffem-
blancë qu’ont fes petitçs branches avec une efpècë
de rofeau Ou de canne légère , qui vient du pays de
Bamboùc, au Sénégal, & à laquelle nos tabletiers
donnent par cette raifon le nom de bambouches &
bamboches. 7
Il y a plus detrente efpeces de bambou, auxquelles
les François donnent indiftinflement ce nom générique.
Les Portugais les appellent bamboes, bàmbos
oc bambus ; les Hollandois bamboefen ; les Indiens
monibu, félon Garzias ; les Macaffares bnlo, & les
Malays bùlu, a caufede la dilpofition de fes feuilles
comme les plumes des aîles des oifeaux ; les Java--
nois wulu & b ambu ; les Madagafcares voulou, félon
Flacourt; les Chinois tick ; les habitans d’Amboine
uttet & ceux de Ternate tabatico. M. Linné regarde
toutes ces efpeces- comme autant de variétés», dont
îl ne fait qu une feqle efpece, qu’il placé dans Jé-
genre du rofeau,' qu’il défigne fous le nom d'arundo,
1 bambos, calycibus multflons^jpicis ternis fefilibus
dans fon Syflerna natura, édition in- ig imprimée
BAM 7 6 7
en 1767 ; page ioo. On vèrra ci-après; par la defeription
de chacune de fes efpeces, combien cette
dénomination renfermé d’erréurs ; & que tous les
bambous, bien loin d’être une feule & même efnece
du genre- du rofeau, pourroient faire plufieurs gen-*
tes ae bambou. 1 : . 6
: Avant que d'entrer dans le détail de ces efpeces i
fanons remarquer ici les caractères qui leur font
Communs-; i . Tous les bambous ont une tige 3c des
feuilles qui imitent en quelque forte l'appirence du
rofeau commun ; mais avec des différences qui ca
ratlcnfenr chaque efpece. z». Tous pouffent tous
les mois, vers la nouvelle lune, félon les obfer-
JaIï . nl , .Rump? e > “ » î« on bourgeon conique.'
femblable a une longue pique, qui, dans quelques
efpeces , fe mange & fe ramifie infenfiblemenr.
3 -Tous outre les racines fibrëufes, fans nombre .
hgneufes & tortillées, ont une efpece de tige traçante
horizontalement fous terre , noueufe ou arri-
culee comme dans le gingembre ou le rofeau qui
prodmt pres-à-près dés bourgeons Coniques , fem-
1 B des monticules étages, d’où fortent les
jets dont nous venons de parler! 4°. Tous les W
iou? ’. exÇepte 1 efpece appelléeUkba, queRumphe
a obfervee dans des vallons humides, & celui que
I ai obfervé au bord méridional du fleuve Gambie
crorflent dans les lieux fecs & pierreux , ad contraire
de nqs roleaux d’Europe qui préfèrent les lieux humides.
5 ». Leurs jeunes liges ou les bourgeons font
plus épais que les tiges qui en proviennent, quoique
celles-ci reftent polies fans fe rider comme ces
bourgeons.' 6°. Les articulations de ces jeunes bourgeons
fout pleines d’abord d’une eau claire . potable
qui s'évanouir à Amboine , & qui , dans d’autres
beux, Ce feche en une fubftance blanchâtre calcaire
app’ëlleë idbdxtr. ' < 9
Les bourgeons ou commencemens des tiges que
pouffent les bambous , s’appellent robong. chez les
Malays, comme qui diroit le mufcle .du bambou, ce
que les Holiandois rendent par le mot rabocrien, qui
répond à ce que nous appelions .;/>ergc. Les mêmes
Malays appellent chaque articulation de fes tiges
roàs‘Si rdwas. , • -, - •
^Rumphe qui a plus travaillé que perfôflne , Sc
meme plus que tous les autres botaniftes enfemble.
à définir toutes les efpeces de bambou , les dïftingiie
d’abord en trois claffes ; favoir : i° . Ceux qui ont
la tige pleine & folide, c’eft-à-dire, entièrement
hgnéufe, comme le rofeaü appellé far'eta, dont
il a reconnu deux genres. z°. Ceux donr la tige a air
centre une cavité, mais fort petite ; & il en fait un
gérirè. j°. Enfin ceux ;dônt la cavité intérieure ,eft
plus confidérable que la partie ligneufe, lui fournif-
fenthuit claffes, dont la premiefe comprend le leleba
qu’il appelle arùndo arbor tenais ; la fécondé le;
tallam ou buîu-fera, qu’il appellé àrund’arbor crathtm -
la troifieme , le bulu-tü-ÿ , qu’il appelle arund’arbor
fpkulomm ; la quatrième, leterin où bulu-jara, qu’il
appelle arundlarbor y àfaria ; la cinquième , le potong
©u bulu potong , qu’il appelle aruncCàrbor àfpera ; la
fixieme, le fammat-ou bulü-fammet, qu’il-appelle
arund’àrbor maxima ; la feptieme , le. teba-teba on
bulu-baduri, qu’il appelle arund’arborfpinoff; enfin
la huitième, l’ampàl' ou lé buTus\va'ngi, qu’il nomme
aruncC àrbor fera. * •'*
■ Nous•éphferveroris Ces trois principales divifiôns ’
en fuivant un ordre plus commode pour la diftinc-
tion des efpeces , dont nous allons indiquer les
principales différences, en ne regardant comme vrais
bambous, que ctùx dont les tiges ont une cavité à
leur centre.
Première efpece. Il Y.
Voicila^remiere U une des plus grandes efpeces