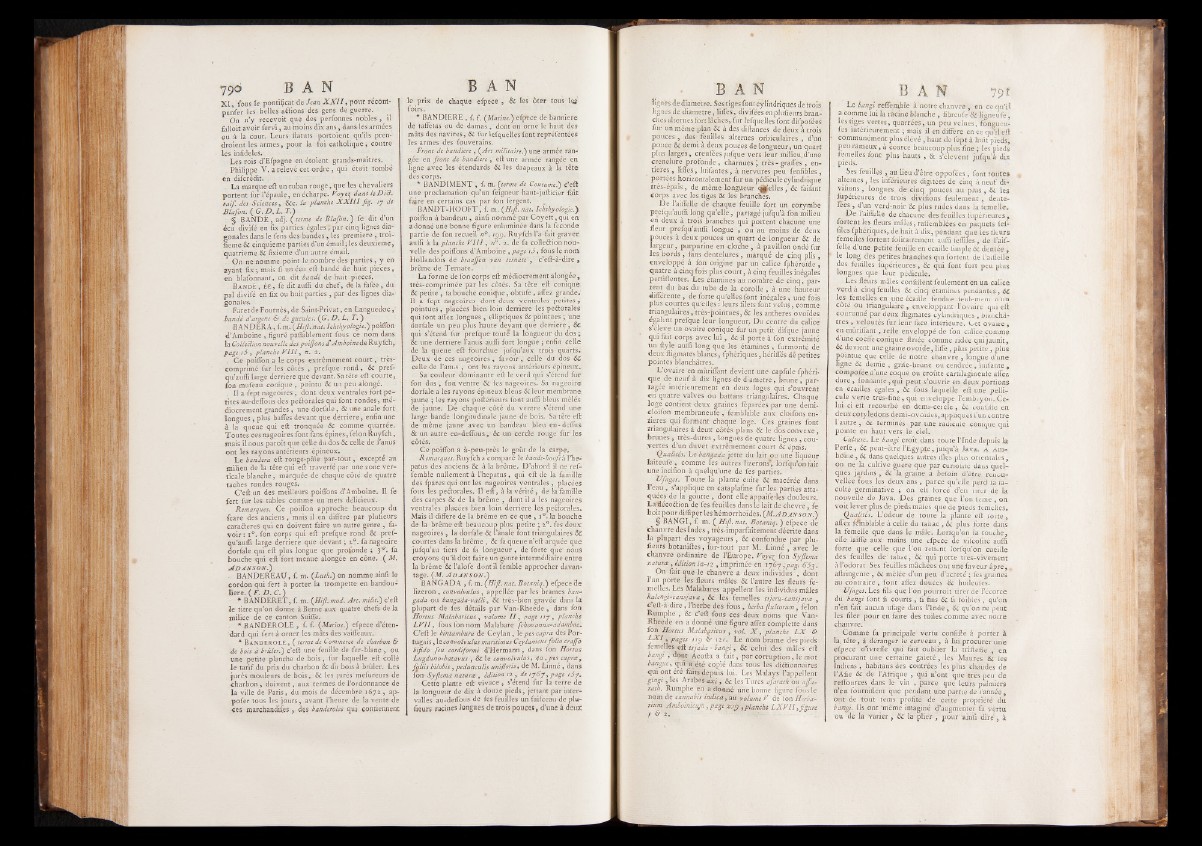
7 0 B A N
X I , fous le pontiÇcat de Jean X X I I , pour récom-
penfer les belles avions des gens de guerre.
On n’y recevoit que des perfonnes nobles , il
falloit avoir fervi, au moins dix ans, dans les armées
ou à la cour. Leurs ftatuts portoient qu’ils pren-
droient les armes, pour la foi catholique, contre
les infidèles.
Les rois d’Efpagne en étoient grands-maîtres.
Philippe V. a relevé cet ordre, qui étoit tombé
en difcredit. - v •' ■ "
. La marqué eft un ruban rouge, que les chevaliers
portent fur l’épaule, en écharpe. Voye\ dans leDict.
raif. des Sciences , &c. la. planche XX.ILI fig. i j de
Blafon. ( G .D .L .T .)
: § BANDÉ adj. ( terme de Blafon.) fe dit d’un
écu divifé en lix parties égales, par cinq lignes diagonales
dans le fens des bandes, les première , troisième
& cinquième parties d’un émail; les deuxieme,
quatrième & fixieme d’un autre émail.
. On ne nomme point le nombre des parties, y en
ayant fix ; mais fi un écu eft bandé de huit pièces,
en blafonnant, on dit bandé de huit pièces.
Bandé ,. é e , fe dit aufli du chef, de la fafce, du
pal divifé en fix ou huit parties , par des lignes diagonales.
Faret de-Foufnés, de Saint-Privat, en Languedoc,
bandé d?argent & de gueules. (G. D. L. T. )
BANDERA-, f.m. (Hijl.nat. lchthyologie.) poiffon
d’Amboine , figuré paffablement fous ce nom dans
la Collection nouvelle des poijjons £ Amboine de Ruyfch,
pdgerb, planche V I I I , n. z.
, Ce poiffon a le corps extrêmement court, très-
comprimé fur les côtés , prefque rond, 6c pref-
qu’auffi large derrière que devant. Sa tête eft courte,
ion mufeau conique , pointu & un peu alonge.
, Il a fept nageoires, dont deux ventrales fort petites
-au-deflous des pe&orales qui font rondes, médiocrement
grandes , une dorfale, & une anale fort
longues , plus baffes devant qiie dërriere, enfin une
à la queue qui eft tronquée & comme quarrée.
Toutes ces nageoires font fans épines, félon Ruyfch,
mais il nous paroît que celle du dos & celle de i ’anus
ont les rayons antérieurs épineux.
Le bandera eft rouge-pâle par-tout, excepté au
milieu de la tête qui eft trâverfé par une zone verticale
blanche, marquée de chaque côté de quatre
taches rondes rouges.
C’eft un des meilleurs poiffons d’Amboine. Il fe
fert fur les tables comme un 'mets' délicieux.
Remarques. Ce poiffon approche beaucoup du
fcare des anciens, mais il en différé par plufieurs
cara&eres qui en doivent faire un autre genre , fa-
voir: i° . fon corps qui eft prefque rond & pref-
qu’aufli large derrière que devant ; z ° . fa nageoire
dorfale qui eft plus longue que profonde ; y 9. fa
bouche -qui eft fort menue alongée en cône. ( M.
A d a n s o n .)
BANDEREAU, f. m. (Luth.) on nomme ainfi le
cordon qui fert à porter la trompette en bandoulière.
( F. D. C.)
* BANDERET, f. m. (Hijl. mod. Art. milit.j c’eft
le titre qifon donne à Berne aux quatre chefs de la
milice de ce canton Suiffe.
* BANDEROLE , f. f. (Marine.) efpece d’étendard
qui fert à orner les mats des vaiffeaux.
* BANDEROLE, ( terme de Commerce de charbon &
de bois d brûler.) c’eft une feuille de fer-blanc , ou
«ne petite planche de bois , fur laquelle eft collé
le tarif du prix du charbon & du bois à brûler. Les
jurés mouleurs de bois ; 6ç les jurés mefureurs de
charbon, doivent, aux termes.de l’ordonnance de
la ville de Paris, du mois de décembre 167 z , ap-
pofer tous les jours, avant l’heure de la vente de
ces njarchandifes , dçs banderoles qui contiennent
B A N
le prix de chaque efpece , & les ôter tous les
foirs.
* BANDIERE , fi f . (Marine.) efpece de bannière
de taffetas ou de damas, dont on orne le haut des
mâts des navires, 6c fur lefquelles font repréfëntées
les armes des fôuvèrains.
Front de bandiere , (Art militaire.) tmè armée rangée
en front de bandiere , eft une armée rangée en
ligne avec les étendards & les drapeaux à la tête
des.corps.
* BANDIMENT , f. ni. (terme de Coutume!) C’eft
une proclamation qu’un feignéur haut-juftiCier fait
faire en certains cas par fon fergent. £
BANDT-HOOFT, f. m. (Hijl. nati lchthyologie.)
poiffon à bandeau, ainfi nommé par Côyëtt, qui en
adonné une bonne figure enluminée dans la fécondé
partie de fon recueil nç . rcjg. Ruyfch l’a fait graver
aufli à la planche V I I I , n°. z. de fa colleftion nouvelle
des poiffons d’Amboine ,page 16 $ fous le nom
Hollandois de braaffen vdn ternâte , c’eft-à-dire ,
brème'de Ternate.
La forme de fon cprps eft médiocrement alongée ,
très-comprimée par les côtés. Sa tête eft conique
6c petite , la bouche conique, obtufe, affez grande.'
Il a fept nageoires dont deux ventrales petites,
pointues, placées bien loin derrière lës peôorales
qui font affez longues , elliptiques & pointues ; une
dorfale Un pèu plus haute devant que derrière, ÔC
qui s’étend fur prefque toute la longueur du dos;
6c une derrière l’anus aufli fort longue ; enfin celle
de la queue eft fourchue jufqu’aux trois quarts.
Deux de ces nageoires, fàvoir, celle du dos 6c
celle de l’anus , ont les rayons antérieurs épineux.
Sa couleur dominante eft le v e rd qui s’étend fur
fon dos , fon ventre & fes nageoires.- Sa nageoire
dorfale a les rayons épineux bleus 6c leur membrane
jaune ; les rayons poftérieurs font aufli bleus mêlés
de jaune; De chaque côté du ventre s’étend une
large bande longitudinale jaune dé bois. Sa tête eft
de même jaune avec un bandeau bleu en-deffus
& un autre en-deffous,: 6c un cercle rouge fur les
côtés.
Ce poiffon a à-peu-près le goût de la carpe.
Remarques. Ruyfch a comparé le bandt-kooftà. l’he-'
patus des anciens & à la brème* D’abord il ne ref-
femble nullement à l’hepatus, qui eft de la famille
des fpares qui ont les nageoires ventrales, placées
fous les pe&orales. Il eft, à la vérité., de la famille
des carpes 6c de la. brème , dont il a les nageoires
ventrales placées bien loin 'derrière les pectorales.
Mais il différé de la brème en ce que , i° . la bouche
de la brème eft beaucoup plus petite ; z°. fes deux
nageoires , la dorfale 6c l’anale font triangulaires 6c
courtes dans la brème , & fa queue n’eft arquée que
I jufqu’au tiers de fa longueur , de forte que- nous
croyons qu’il doit faire un genre intermédiaire entre
la brème & l’a lofe dont il fëmble approcher davantage.
(M. A d a n so n .)
BANGADA , f. m. (Hijl. nat. Botaniq.) efpece de
lizeron , convolvulus, appellée par les brames ban-
gada ou bangada-valli, 6c très-bien gravée dans la
plupart de fes détails par Van-Rheede , dans fon
Hortus Malabaricus, volume /ƒ, page n y , planche
L V I I , fous fon nom Malabare fchovanna-adamboe.
C’eft le binlamburu de Ceylan, le pes capra des Portugais
, 1e convolv ulus maritirnus Ceylanicus folio craffo
bifido feu cordiformi d’Hermann, dans fon Hortus
Lugduno-batavus , & le convolvulus, 40, pes capra ,
foliis bilobis, pedunculis unifions, de M. Linné , dans
fon* Syjlemd hatura , édition iZ , de tyCy, page <5j .
Cette plante eft vivace ; s’étend fur la terre de
la longueur de dix à douze pieds, jettant par intervalles
au-deffous de fes feuilles un faifceau de plu-
fieurs racines longues de trois pouces, d’une à deux
BAN
lignes de diamètre. Ses tiges font cylindriques de trois
lignes de diamètre, Mes, divifées en plufieurs branches
alternes fort lâches, fur lefquelles font difpofées
fur un même plan & à des diftances de deux à trois
pouces , des feuilles alternes orbieulaires., d’un
pouce 6c demi à deux pouces de longueur, un quart
plus larges, creufées jufque vers leur milieu.d’une
crenelure profonde , charnues ; très - graffes , entières
, liffes, luifantes, à nervures peu fenfibles,
portées horizontalement fur un pédicule cylindrique
très-épais, de même longueur quelles, 6c failant
corps avec les tiges & les branches.
De l’aiffelle de chaque feuille fort un eorymbe
prefqu’aufli long qu’elle, partagé jufqu’à fon milieu
en deux à trois branches qui portent chacune une
fleur prefqu’auflï longue , ou au moins de deux
pouces à deux pouces un quart de longueur 6c de
largeur, purpurine en cloche , à pavillon ondé fur
les .bords , fans dentelures, marqué de cinq plis ,
enveloppé à fon origine par un calice fphéroïde ,
quatre à cinq fois plus court, à cinq feuilles inégales
perfiftentes. Les étamines au nombre de cinq, partent
du bas du tube de la corolle , à une hauteur
différente, de forte qu’elles font inégales ; une fois
plus courtes qu’elles : leurs filets font velus, comme
triangulaires, très-pointues, 6c les anthères ovoïdes
égalent prefque leur longueur. Du centre du calice
S’élève un ovaire conique fur un petit difque jaune
qui fait corps avec lu i, 6c il porte à fon extrémité
un ftyle aulfi long que les étamines , furmonté de
deux ftigmate's blancs, fphériques, hériffés dé petites
pointes blanchâtres.
L’ovaire en mûriffant devient une capfule fphéri-
que de neuf à dix lignes de diamètre, brune , partagée
intérieurement en deux loges, qui. s’ouvrent
en quatre valves ou battàns triangulaires. Chaque
loge contient deux graines féparées par une demi-
cloifon membraneufe, femblable aux cloifons entières
qui forment chaque loge. Ces graines font
triangulaires à deux côtés plans & le dos convexe,
brunes , très-dures , longues de quatre lignes , couvertes
d’un duvet extrêmement court & épais.
Qualités. Le bangada jette du lait ou une liqueur
laiteufe , comme lés autres lizerons", lorfqu’on fait
une incifion à quelqu’une de fes parties.
C f âges. Toute la plante cuite 6c macérée dans
l ’eau , s’applique en cataplafme furies parties atta-
quées de la goutte , dont elle appaife-les douleurs.
La léeoélion de fes feuilles dans le lait de chevre, fe
boitpour difliper les hémorrhoïdes. ( M . A d a n s o n . )
§ BANGI, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) efpece de
chanvre des Indes , très-imparfaitement décrite dans
la plupart des voyageurs, & confondue par plufieurs
botaniftes, fur-tout par M. Linné , avec le
chanvre ordinaire de l’Europe. Voye^ fon Syfiema
natura, édition in-iz , imprimée en 1767 ÿpagt 65$.
On fait que le chanvre a deux individus , dont
l ’un porte les fleurs mâles 6c l’autre les fleurs femelles.
Lès Malabares appellent les individus mâles
kalengi-cansjava, & les femelles tsjeru-cansjava ,
c eft-à-dire, l’herbe des fous , herb a fiultorum, félon
Rumphe , 6c c’eft fous ces’deux noms que Van-
Rheede en a donné une figure affez complette dans
fon Hortus Malabpricus , vol. X , planche L X &
L X l , pages t ïcf & 1 z i. Le nom brame des pieds
femelles eft tsjada - bangi, 6c celui des mâles êft
bangi , dont Acofta a fait, par corruption, le mot
banguè, qui été copié dans tous les diérionnaires
qui ont été faits depuis lui. Les Malays l’appellent
gingi, les Arabes a x i, 6c les Turcs afarath ou ajfa-
rath. Rumphe en adonné une bonne figure fous le
nom de cannabis indien, au volume fi de l'on Herbarium
Amboiniciÿh, page zo$ , planche L X V I I , figure
l & •?.
B A N 791
Le bangi reffeiijble à notre chanvre , en ce qu’il
a comme lui la racine blanche , fifireufe 6c ligneufe,
les tiges vertes, quarrées, un peu velues, fongueu-
fes intérieurement ; mais il en diffère en ce qu’il eft
communément plus élévé , haut de fept à huit pieds,
peu laineux, a ecorce beaucoup plus fine ; les pieds
femelles font plus- hauts , & s’élèvent jufqu’à dix
pieds.
Ses feuilles * au lieu d’être oppofées , font toutes
alternes, les inférieures digitées de cinq à neuf di-
vifions , longués de cinq pouces au plus , 6c les
fuperieures de trois divifions feulement , dente-
lees , d’unjverd-noir 6c plus rudes dans la femelle.
D e Taiffelle de chacune des feuilles fupérieures ,
fortent les fleurs mâles, rafl'emblées en paquets lef-
files fpheriques, de huit à dix, pendant que les fleurs
femelles fortent folitairement aufli leflifes, de l’aif-
felle d’une petite feuijle en écaille Ample 6c dentée ,
le long des petites branches qui fortent de l’aiflelle
des feuilles fupérieures , & qui font fort peu plus
longues que leur pédicule.
Les fleurs mâles confiftent feulement en un calice
verd a cinq feuilles 6c cinq étamines pendantes, ÔC
leAs femelles en une écaille fendue leulcment ü'un
cote ou triangulaire, enveloppant l’ovaire qui eft
couronné par deux ftigmates cylindriques , blanchâtres
, veloutés fur leur face intérieure. Get ovaire,
en mûriffant, refte enveloppé de fon calice comme
dune coëffe conique ftriée comme ridée qui jaunit,
6c devient une graine ovoïde, liffe , plus petite, plus
pointue que celle de notre chanvre , longue d’une
ligne 6c demie , grile-brune ou cendrée, lutfante ,
compofée d’une coqué ou croûte cartilagineule affez
dure , fonnante, qui peut s’ouvrir en deux portions
en écailles égalés , 6c fous laquelle eft une pellir-
cule verte très-fine, qui enveloppe l’embryon. Celui
ci elt recourbé en demi-cercle , 6c conlifte en
deux cotylédons demi-ovoïdes, appliqués l’un contre
l ’autre , ôi terminés par une radicule conique qui
pointe en haut vers le ciel.
Culture. Le bangi croît dans toute l’Inde depuis la
Perfé , 6c peut-être l’Egypte, jufqu’à Java. A Am-
bo'ine, & dans quelques.autres ifles plus orientales ,
on ne la cultive guere que par curiolite dans quelques
jardins , 6c la graine a beloin d’être renou-
vellée tous les deux ans , parce qu’elle perd la faculté
germinative ; on elt forcé d’en tirer de la
nouvelle de Java. Des graines que l’on leme, on
voit lever plus de pieds males que de pieds femelles.
Qualités. L’odeur de toute la plante eft forte,
affez flhabiable à celle du tabac , 6c plus forte dans
la femelle que dans le mâle. Lorlqu’on la touche,
elle laiffe aux mains une efpece de vilcofité aufli
forte que celle que l ’on relient lorfqu’on cueille
des feuilles de' tabac, 6c qui porte très-vivement
à l’odorat. Ses feuilles mâchées ont une faveur âp re ,.
aftringente , 6c mêlée d’un peu d’acreté ; fes graines
au contraire , font affez douces &. huileules.
Ufages. Les fils que l’on pourroit tirer de l’écorce
du bangi font fi courts , fi fins & fi foibies , qu’on
n’én fait aucun ulage dans l’Inde, 6c qu’on ne peut
les filer pour en faire des toiles comme avec notre
chanvre.
Comme fa principale vertu conlifte à porter à
la. tête, à déranger le cerveau , à lui.procurer une
efpece' d’ivrefle qui fait oublier la triftefîe , en
procurant une certaine gaieté, les Maures & les
Indiens , habitans des contrées les plus chaudes de
l ’Afie 6c de l’Afrique , qui n’ont que très peu de
reffourcès dans le vin , parce que leurs palmiers
n’en foùrniffent que pendant une partie de l’année,
ont de tout tems profité de cette propriété du
bangi. Ils ont ’même imaginé d’augmenter fa vertu
ou de la varier, 6c la plier , pour ainfi dire , à