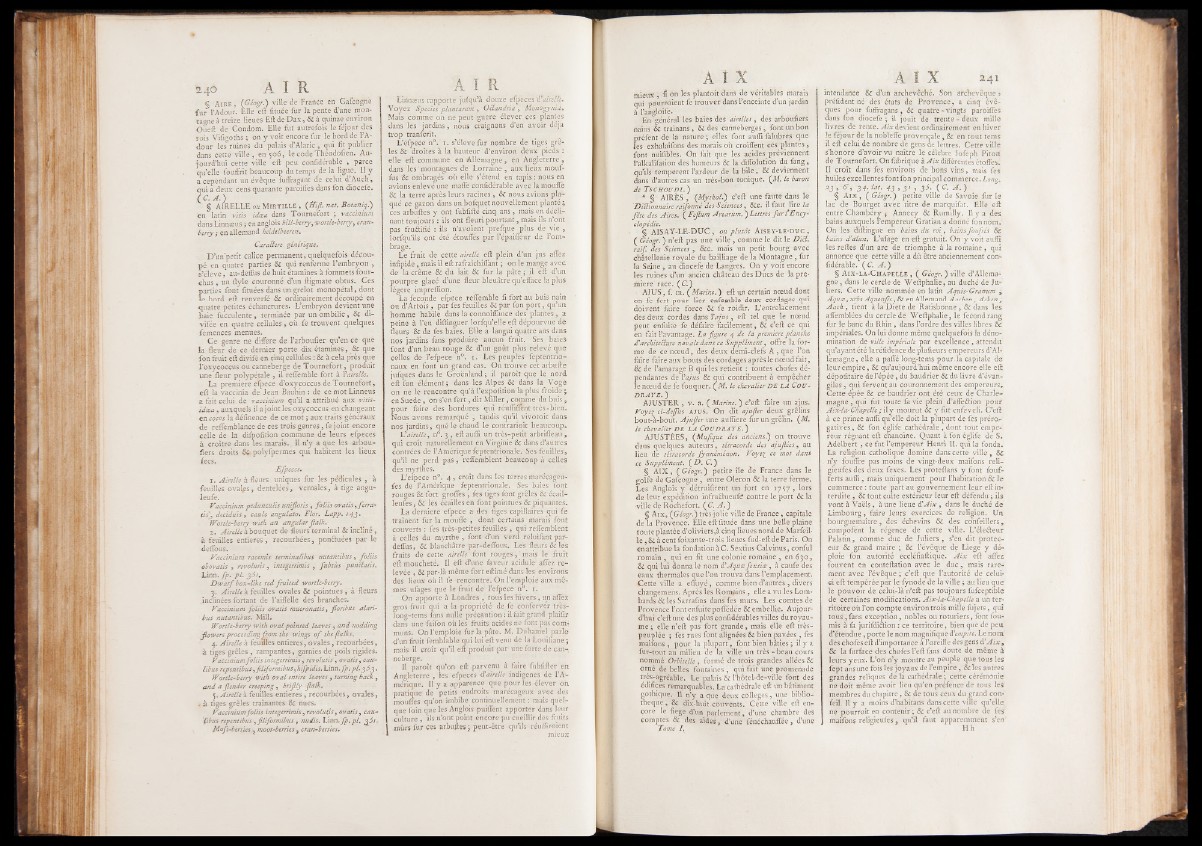
§ Aire , (Géogr.) ville de France en Gafeognè
fur l’Adour. Elle eft fituée fur la pente d’une montagne
à treize lieues Eft de D a x , & à quinze environ
Oueft de Condom. Elle fut autrefois le féjour des
rois Vifigoths ; on y voit encore fur le bord de l’A-
dour les ruines du palais d’Alaric , qui fit publier
dans cette v ille , en 506, le code Théodofien. Aujourd’hui
cette ville eft peu confidérable , parce
qu’elle fouffrit beaucoup du temps de la ligue. 11 y
a cependant un évêque fuffragant de celui d’Auch,
qui a deux cens quarante paroilfes dans fon diocefe.
( C . A . )
§ AIRELLE ou Mirtille , fffifi. nat. Botaniq.)
en latin vitis idem dans Tournefort ; vaccinium
dans Linnæus ; en anglois bill-berry, wortle-berry, cran*
berry; en allemand heidelbeeren.
Caractère, générique.
D ’un'petit calice permanent, quelquefois découpé
en quatre parties & qui renferme l ’embryon ,
s’élève, au-deffus de huit étamines à fommets fourchus
, un ftyle couronné d’un ftigmate obtus. Ces
parties font fituées dans un grelot monopétal, dont
le bord eft renverfé & ordinairement découpé en
quatre petites échancrures. L’embryon devient une
baie fucculente, terminée par un ombilic, &C di-
vifée en quatre cellules, oit fe trouvent quelques
femences menues.
Ce genre ne différé de l’arboufier qu’en ce que
la fleur de ce dernier porte dix étamines, ÔC que
fon fruit eft divifé en cinq cellules : & à cela près que
l’oxycoccus ou canneberge de Tournefort, produit
une fleur polypétale , il reffemble fort à Y airelle.
La première efpece d’oxycoccus de Tournefort,
eft la vaccinia de Jean Bauhin : de ce mot Linneus
a fait celui de vaccinium qu’il a attribué aux vids-
idoea, auxquels il a joint les oxycoccus en changeant
en cocos la définence de ce mot ; aux traits généraux
de reffemblance de ces trois genres, fe joint encore
celle de la difpofition commune de leurs efpeces
à croître dans les marais., Il n’y a que les arbousiers
droits Ô4 polyfpermes qui habitent les lieux
fecs.
jEfpeces.
1. Airelle à fleurs uniques fur les pédicules , à
feuilles, ovales, dentelées, vernales, à tige angu-
leufe.
Vaccinium pedunculis unifions , folïis ovatis, ferra-
tis\ décidais, caule angulato. Flor. Lapp. 143.
Wortle-berry with an angular fialk.
2. Airelle àbouquet de fleurs terminal & incliné,
à feuilles entières, recourbées, ponctuées par le
deffous.
Vaccinium racemis terminalibus nutanûbus, foliis
obovatis , revolutis, integernmis , fubtiis punctads.
U n n .fp .p l.3 S 1 . \
Dwarf box-like red fruited wortle-berry.
y. Airelle à feuilles ovales & pointues , à fleurs
.inclinées fortant de l’aiffelle des branches.
Vaccinium foliis ovatis mucronads, fioribus alari-
bus nutanûbus. Mill.
Wortle-berry with oval pointed leàves, and nodding
JLowers proceeding from the wings o f the (lalks.
4. Airelle à feuilles entières, o vales, recourbées,
à tiges grêles , rampantes, garnies de poils rigides.
Vaccinium foliis integerrïmis, revolutis, ovatis, eau-
lïbus repentibus9filiformibus,hifpidis. lAnn.fp.pl.3S3.
Wortle-berry with oval endre leaves , turning back ,
and a fiender creeping, brifily fialk.
5, Airelle à feuilles entières, recourbées, ovales,
. à tiges grêles traînantes & nues.
Vaccinium foliis integernmis, revolutis, ovatis, cau-
fibus repentibus, filiformibus, nudis. \J\nn. fp .pl, 3SI0
Mofs-berries * moor-berries, cran-bernes*
Linnæus rapporte jufqu’à douze efpeces d\airelti.
Voyez Species plantarum , Octandria , Monogynid.
Mais comme on ne peut guere élever ces plantes
dans les jardins, nous craignons d’en avoir déjà
trop tranferit.
L’efpece n V i . s’élève fur nombre de tiges grêles
& droites à la hauteur d’environ deux pieds :
elle eft commune en Allemagne, en Angleterre ,
dans les ' montagnes de Lorraine , aux lieux mouf-
fus & ombragés où elle s’étend en tapis : nous eil
avions enleve une maffe confidérable avec la moufle
& la terre après leurs racines , & nous avions plaqué
ce gazon dans un bofejuetnouvellement planté;
ces arbuftes y ont fubfifte cinq ans, mais en déclinant
toujours : ils ont fleuri pourtant, mais ils n’ont
pas fru&ifié : ils n’avoient prefque plus de vie ,
lorfqu’ils ont été étouffés par l’épaiffeur de l’ombrage.
Le fruit de cette airelle eft plein d’un jus affez
infipide, mais il eft rafraîchiflànt ; on le mange avec
de la crème & du lait & fur la pâte ; il eft d’un
pourpre glacé d’une fleur bleuâtre qu’efface la plus
légère impreflion.
La fécondé efpece reffemble fi fort au buis nain
ou d’Artois , par fes feuilles & par fon port, qu’un
homme habile dans la connoiffance des plantes, a
peine à l’en diftinguer lorfqu’elle eft dépourvue dè
fleurs & de fes baies. Elle a langui quatre ans dans
nos jardins fans produire aucun fruit. Ses baies
font d’un beau rouge & d’un goût plus relevé que
celles de l’efpece n°. 1. Les peuples feptentrio-
naux en font un grand cas. On trouve cet arbufte
jufques dans le Groenland ; il paroît que le nord
eft fon élément ; dans les Alpes & dans la Vogè
on ne le rencontre qu’à l’expofition la plus froide ;
en Suede , on s’en fert, dit Miller, comme du buis,
pour faire des bordures qui réufliflent très-bien'.
Nous avons remarqué , tandis qu’il vivotoit dans
nos jardins, que le chaud le Contrarioit beaücoupi
L'airelle, n°. 3 , eft aufli un très-petit arbrifleau,
qui croît naturellement en Virginie & dans d’autres
contrées de l’Amérique feptentrionale. Ses feuilles9
qu’il ne perd pa s, reffemblent beaucoup à celles
des myrthes.
L’efpece n°. 4 , croît dans les terres marécageu*
fes de l’Amérique feptentrionale. Ses baies font
rouges & fort groffes , fiés' tiges font grêles & écail-
leufes, & les écailles en font pointués & piquantes.
La derniere efpece a des tiges capillaires qui fe
traînent fur la moufle , dont certains marais font
couverts : fes très-petites feuilles , qui reffemblent
à celles du myrthe , font d’un verd rëluifant par-
deffus, & blanchâtre par-deffous. Les fleurs & les
fruits de cette airelle font rouges, mais le fruit
eft moucheté. Il eft d’une faveur acidulé affez relevée
, & par-là même fort eftimé dans les environs
des lieux où il fe rencontre. On l’emploie aux mêmes
ufages que le fruit de l’efpece n°. 1.
On apporte à Londres , tous les hivers, un affez
gros fruit qui a la propriété de fe eonférver très-
long-tems fans nulle précaution : il fait grand plaifir
: dans une faifon où les fruits acides ne font pas corn-
1 muns. On l’emploie fur la pâte. M. Duhamel parle
d’un fruit femblable qui lui eft venu de la Loiiifiane.;
mais il croît qu’il eft produit par une forte de canneberge.
:
Il paroît qu’on eft parvenu à faire fubfifter en
Angleterre , les efpeces d'airelle indigènes de l’Amérique.
11 y a apparence que pour les élever on
pratique de petits endroits marécageux avec des
moufles qu’on imbibe continuellement : mais quelque
foin que les Anglois puiffent apporter dans leur
culture , ils n’ont point encore pu cueillir des fruits
mûrs fur ces arbuftes ) peut-être qu’ils réuflirqient
t mieux
mieux , è on les plantoit dans de véritables marais
qui pourraient fe trouver dans l’enceinte d’un jardin
à l’angloife.
En général les baies des airelles , des arboufietS
nains & traînans, & des canneberges, font un bon
préfent de la nature; elles font aufli falubres que
les exhalaifons des marais où croiffent ces plantes ;
font nuifibles. On fait que les acides préviennent
l’alkalifation des humeurs & la diffolution du fang,
qu’ils temperent l’ardeur de la b i l e & deviennent
dans d’autres cas un très-bon tonique. (M. le baron
de Ts c h o v d i .')
* § AIRÈS , (Mythol.) c’ eft une faute dans le
Dictionnaire raifonné des Sciences, &c. il faut lire la
fête des Aires. ( Fefium Arearum. ) Lettres fur tEncyclopédie.
§ AISAY-LE-DUC, ou plutôt A isey-le-d u c ,
( Géogr. ) n’eft pas une ville , comme le dit le Dict.
raif. des Sciences , &c. mais un petit bourg avec
châtellenie royale du bailliage de la Montagne , fur
la Sejne , au diocefe de Langres. On y voit encore
les ruines d’un ancien château des Ducs de la première
race. (C .)
AJUS, f. m. ( Marine. ) eft un certain noeud dont
on fe fert pour lier enfemble deux cordages qui
doivent faire force & fe roidir. L’entrelacement
des deux cordes dans Yajus, eft tel que le noeud
peut enfuite fe défaire facilement, & c’eft ce qui
en fait l'avantage. La figure 4 de la première planche
d'architecture navale dans ce Supplément, offre la forme
de ce noeud, des deux demi-clefs A , que l’on
faire faire aux bouts des cordages après le noeud fait,
& de l’amarage B qui les retient : toutes chofes dépendantes
de Vajus & qui contribuent à empêcher
îe noeud de fe fouquer. ÇM. le chevalier d e l a Co u de.
a y e . )
AJUSTER , v. a. ( Marine. ) c’eft faire un ajus.
Voy ei ci-diffus AJUS. On dit ajufier deux grêlins
bout-à-boùt. Ajufier une aufliere fur un grêlin. (M.
le chevalier DE LA CoUDRATE.')
AJUSTÉES, ( Mufique des anciens.) on trouve
dans quelques auteurs, tètrdcorde des ajufiées.^ au
lieu de tétracorde fynnéménon. Voye£ ce mot dans
ce Supplément. (D . C. )
§ A IX , (£<?ogr.) petite île de France dans le
«rolfe de Gafcogne, entre Oleron & la terre ferme.
Les Anglois y détruifirent un fort en 1757» lors
de leur expédition infru&ueufé contre le port & la
•ville de Rochefort. ( C. A . )
§ A ix , (Géogr.') très-jolie ville de France, capitale
de la Provence. Elle eft fituée dans une belle plaine
toute plantée d’oliviers,à cinq lieues nord de Marfeil-
l e , & à cent foixante-trois lieues fud-eft de Paris. On
en attribue la fondation à C. Sextius Calvinus, conful
romain , qui en fit une colonie romaine , en 630,
& qui lui donna le nom ÜAquce fexdce , à caufe des
eaux thermales que l’on trouva dans l’emplacement.
Cette ville a effuyé, comme bien d’âiitrês , divers
changemens. Après les Romains, elle a vu les Lombards
& les Sarrafins dans fes murs. Les comtes de
Provence l’ont enfuite poffédée & embellie., Aujourd’hui
c’eft une des plus confidérables villes du royaume
; elle n’ eft pas fort grande, mais elle eft très-
peuplée ; fes rues font alignées & bien pavées , fes
maifons , pour la plupart, font bien bâties ; il y a
fur-tout au milieu de la ville un très - beau cours
nommé Orbitelle, formé de trois grandes allées &
orné de belles fontaines , qui fait une promenade
très-agréable. Le palais & l’hôtel-de-ville font des
édifices remarquables. La cathédrale eft un bâtiment
gothique. Il n’y a que deux colleges, une bibliothèque
, & dix-huit couvents. Cette ville eft encore
le fiege d’un parlement, d’une chambre des
comptes & des aides, d’une fénéchauffée, d’une
Tome I,
intendance & d’un archevêché. Son archevêque »
préfident né des états de Provence, a cinq evê-
ques pour fuffragans , & quatre-vingts paroiffes
dans fon diocefe ; il jouit de trente - deux mille
livres de rente. A ix devient ordinairement en hiver
le féjour de la nobleffe provençale, & en tout tems
il èft celui de nombre de gens de lettres. Cette ville
s’honore d’avoir vu naître le célébré Jofeph Pitort
de Tournefort. On fabrique à A ix différentes étoffes.
Il croît dans fes environs de bons vins, mais fes
huiles excellentes font fon principal commerce. Long„
*3 » ;‘f j 34* 43 >3 ' ? 3 $: C C. A . )
§ A i x , ( Géogr.) petite ville de Savoie fu r ie
lac de Bourget avec titre de marquifat. Elle eft
entre Chambéry j Annecy & Rumilly. Il y a des
bains auxquels l’empereur Gratian a donné fon nom.
On les diftingue én bains du roi, bains foufrés &
bains d’alun. L’ufage en eft gratuit. On y voit auflï
les reftes d’un arc de triomphe à la romaine , qui
annonce que cette ville a dû être anciennement con-,
fidérable. (C. A . )
§ Aix-la-Chapelle , ( Géogr. ) ville d’Allemagne
, dans le cercle dè Weftphalie, au duché de Ju-
liers. Cette ville nommée en latin Aquis-Granum ,
Aquce ,urbs Aquenfis, & en Allemand Aachen, Acken 9
Aach, tient à la Diete de Ratisbonne , & dans les
affemblées du cercle dé 'Weftphalie, le fécond rang
fur le banc du Rhin, dans l’ordre des villes libres &
impériales. On lui donne même quelquefois la dénomination
de ville impériale par excellence , attendu
qu’ayant été laréfidence de piufieurs empereurs d’Allemagne,
elle a paffé long-tems pour.îa capitale de
leur empire, & qu’aujourd’hui même encore elle eft
dépofitaire de l’épée, du baudrier & du livre d’évangiles,
qui fervent au couronnement des empereurs^
Cette épée & ce baudrier ont été ceux de Charlemagne
, qui fut toute fa vie plein d’affeélion pouf
Aix-la-Chapelle ; il y mourut & y fut enfeveli. C’eft
à ce prince aufli qu’elle doit la plupart de fes préro^
gatives, & fon églife cathédrale , dont tout empereur
régnant eft chanoine. Quant à fon églife de S.
Adelbert , ce fut l’empereur Henri II. qui la fonda.
La religion catholique domine dans cette ville , &
. n’y fouffre pas moins de vingt-deux maifons reli—
gieufes des deux fexes. Les proteftans y font fouf-
ferts aufli, mais uniquement pour l’habitation & le
commerce : toute part au gouvernement leur eft interdite
, & tout culte extérieur leur eft défendu ; ils
vont à Vaëls, à une lieue d’A ix , dans le duché de
Limbourg, faire leurs exercices de religion. Un
bourguemaître, des échevins & des co’nfeillers,
compofent la régence de ‘ cette ville. L’éle&eur
Palatin, comme duc de Juliers , s’en dit protec-
eur & grand maire ; & l’évêque de Liege y déploie
fon autorité eccléfiaftique. A ix eft affez
fouvent en conteftation avec le du c, mais rarement
avec l’évêque ; c’eft que l’autorité de celui-
ci eft tempérée par le fynode de la ville ; au lieu que
le pouvoir de celui-là n’eft pas toujours fufceptible
de certaines modifications. Aix-la-Chapelle a un territoire
où l’on compte environ trois mille fujets, qui
tou s, fans exception, nobles ou roturiers, font fournis
à fa jurifdiûion : ce territoire, bien que de peu
d’étendue, porte le nom magnifique d’empire. Le nom
des chofes eft d’importance à l’oreille des gens d’A ix 9
& la furface des chofes l’eft fans doute de même à
leurs yeux. L’on n’y montre au peuple que tous les
fept ans une fois les joyaux de l’empire, & le s autres
grandes reliques de la cathédrale ; cette cérémonie
ne doit même avoir lieu qu’en préfence de tous les
1 membres du chapitre, & de tous ceux du grand cou-
- feil. Il y a moins d’habitans dans cette ville qu’elle
ne pourroit en contenir; & c’eft ait nombre de fes
maifons religieufes, qu’il faut apparemment s’en