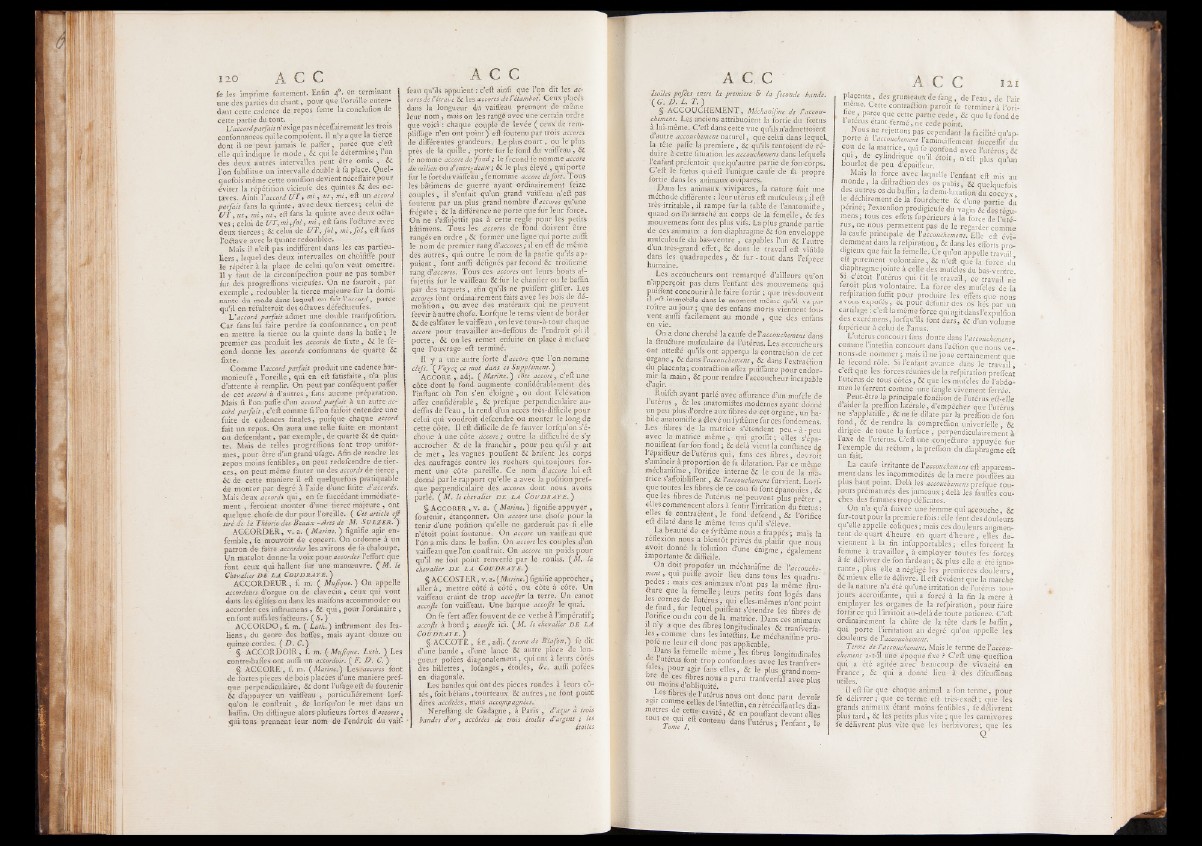
fe .les imprime fortement. Enfin 4“. en terminant
«ne des parties du chant, pour que l’oreille entendant
cette cadence de,repos fente la condufion de ,
cette partie du tout. _ ■ . ■
L’accordparfait n’exige pas néceffairement lés- trois
confonnances qui le compofent. Il n’y a que la tiercé
dont il ne peut jamais le paffer, parce que cfeft
elle qui indique le mode , ol qui le ^déterminé; lun
des deux autrés intervalles peut être omis , &
l ’on fubftitue un intervalle double à fa place. Quelquefois
même cette omilïion devient neceffaire pour
■ éviter la répétition viçieufe des quintes & des octaves.
Ainfi Y accord Ü T , m i, ut, mi, eft un accord
parfait fans la quinte, avec deux tierces; celui de
U T ut, mi, ut, eft fans la quinte avec deux oéta-
ves ; celui de UT, m i,fo l, mi, eft fans l’o&ave avec
deux tierces; & c e lu i de UT, fo l, mi, f o l , eft fans
l’oitave avec la quinte redoublée.
Mais il n’eft pas indifférent dans les cas particuliers
, lequel des deux intervalles on choififte pour
le répéter à la place de celui qu’on veut omettre.
Il y faut de la circonfpe&ion pour ne pas tomber
fur dés progreffions vicieufes. On ne fauroit, par
exemple , redoubler la tierce majeure fur la dominante
du mode dans lequel ou fait Y accord, parce
qu’il en réfulteroit des oftaves défe&ueufes. '
Vaccord parfait admet une double t ra n fp o fit io n .
Car fans lui faire perdre fa confonnance, on peut
en mettre la tierce ou la quinte dans la baffe ; le
premier cas produit les accords de fixte, & le fécond
donne les accords confonnans de quarté &
fixte.
Comme Y accord parfait produit une cadence har-
monieufé , l’oreille, qui en eft fatisfaite n’a plus
d’attente à remplir. On peut par conféquent paffer
de cet accord à d’autres , fans aucune préparation.
Mais fi l’on, paffe d’un accorfl parfait à un autre- accord
parfait, c’eft comme fi l ’o n fa i fo it entendre une
fuite de cadences finales, puifque chaque accord
fait un repos. On aura une- telle fuite en montant
©u defcendant, par exemple, de quarte & de quinte.
Mais de telles progreffions font trop uniformes
, pour être d’un grand ufage. Afin de rendre les
repos moins fenfibles, on peut rede-feendre de tierce
s, on peut même fauter un des accords de tierce ,
& de cette maniéré il eft quelquefois pratiquable
de monter par degré à l’aide d’une fu ite 1 d accords.
Mais deux accords q ui, en fe fuecédant immédiatement
feroient monter d’un.e tierce majeure , ont
quelque ehofe de dur pour l’Oreille. ( Cet article ejë
tiré dt. La Théorie des Beaux -Arts de M. Sü L Z E R . )
ACCORDER, v . a. ( Marine. ) fignifie agir en-
femble, fe mouvoir de concert. On ordonne à un
patron de faire accorder les avirons de fa- c h a lo u p e ;
Un matelot donne la voix pour accorder l’effort- que
f o n t ceux qui hallent- fur une manoeuvre. ( M. le
Chevalier DE LA COUDRAYE. )
ACCORD EU R , f. m . (' Mufique. ) On appelle
accordeurs d’orgue ou de clavecin, ceux- qui vont
dans les: églifes ou dans: les maifons accommoder ou
accorder ces inftramens , & qui, pour l’ordinaire ,
eixfont auffi les faveurs. ( S. )
A C C O R D O , f. m. ( Luth.') infiniment des Italiens,
du genre des baffes;, mais ayant douze ou
quinze cordes. ( D . C.)
§ ACCORD O IR , f. m. (- Mufique. Luth. ) Les
contre-baffes ont auffi un accordoir. ( F. D. C. )
§ A C C O R E , f . m. (Marine.) Les>a6cores font
de fortes pièces de'bois placées d’une maniéré pref-
que perpendiculaire, & dont l’ufageeft de fbutenir
& dlappuyer un vaifféau , particuliérement lorf-
qu-’on. le conftruit , & lorfqu’on le met dans un
baffin. On difljiïgue alors plufieurs fortes d’accores,
qui tous, prennent leur nom- de- l'endroit du vaiffeau
qu’ils appuient : c’eft ainfi que l’on dit les accores
de C étrave Sc les accores d e lè tam b o t. Ceux placés
dans la longueur du vaifféau prennent de même
leur nom , mais on’ les rangé avec une certain ordre
que voici : chaque couple de levée ( ceux1 de rem-
pliffagé n’en ont point) eft foutenu par trois accores
de différentes grandeurs. Le plus cou rt, ou le plus
près de là quille, porte fur le fond du vaifféau , &
fe nomme dccore d e f o n d ; le fécond le nommé décote
du m ilieu ôu d ’entre-deux ; & le plus élevé , qui porte
fur le fort du vaifféau , f e nomme accore de fo r t . Tous
les bekimeris de guerre ayant ordinairement feize
couples, il s’enfuit qu’un grand vaifféau n’eft pas
foutenu par un plus grand nombre <Y accores qu’une
frégate ; & la différénee ne porte que fur leur force.
On ne s’affujettit pas à cette réglé pour les petits
bâtimens. Tous les accores de Fond doivent être
rangés en ordre , & former une ligne qui porte auffi
le nom de premier rang d’ accores; il en eft de même
dés autres, qui outre le nom de la partie qu’ils appuient
, font auffi défignés par fécond & trbifiemé
rang $ accores. Tous ces accores ont leurs bouts af-
fujettis fur le vaifféau & fur le chantier ou le baffin
par des taquets', afin qu’ils ne puiffent gliffer. Les
accores font ordinairement faits avec les bois de démolition,
ou avec des matérairx qui ne peuvent
fervir à-autre ch ©fe. Lorfque le tems vient de border
& dé calfater le vaifféau , ori leve tour-à-tour chaque
accore pour travailler au-deffous de l’endroit où il
porte, & on les remet enfuite en place à mefuré
que l’ouvrage eft terminé; ;
Il y a une autre forte <Y accore que l ’on nomme
clefs . ( V o y e { ce mot d a n s ce S u p p lém en t.)
ACCORE ,. adj. (M a r in e .) côte a cco re, c’eft une
côte dont le fond augmente confidérabiement dès
l’inftant où l’on s’en éloigne , ou dont l’élévation
affez confidérablé , & prefque perpendiculaire au-
deffüs de l’eau , la rend d’un accès très-difficile pour
celui qui vôudroit defeendre ou monter le long de
cette côte. Il eft difficile de fe fauver lorfqu’on s’échoue
à une côte accore outre la difficulté de s’y
accrocher & dé la franchir, pour peu qu’il y ait
de mer , les vagues pouffent & briîent les corps
des naufragés contre les rochers qui.toujours forment
une côte pareille. Ce nom d’accore lui eft
donné parle rapport qu’elle a a y ec la pofitionprefque
perpéndiculairè des accores dont nous avons
parlé. ( M . le chevalier D E L A C o U D R A Y E . )
§. A cgo rer , v. a. ( Marine. ) fignifie appuyer ,
’ fbutenir, étançonner. On accore une, ehofe pour la
tenir d’une pofition qu’elle ne garderoit pas fi elle
n’étoit point fbutenue. On accore un vaifféau que
l’on a mis dans le baffin. On a c c o r d e s . couples d’un
vaifféau que l’on conftruit.. On accore un-poids pour
qu’il ne loit point renverfé par le roulis. (M . le
chevalier D E L A C o U D R A Y E . )
§ A CCOSTER, v. a. (M a r in e .) fignifie approcher ,
aller à , mettre côté à cô té , ou côte à côte. Un
vaifféau craint de trop accojler la terre. Un canot
accojie fon vaifféau. Une barque accojle le quai.
On fe fert affez fouvent de ce verbe à l’impératif ;
accojie à bord; accojle ici. (M . le chevalier D E L A
C o U D R A Y E . )
§ ACCOTÉ , ÉE , adj. (te rm e de B la fo n . ) fe dit
d?üne bande , d’une lance & autre piece de lon-
' gueur pofées diagonalement, qui ont à leurs côtés
des biliettes , lofanges, étoiles, & c . auffi pofées
I en diagonale.
Les bandes qui ont des pièces rondes à leurs cô-
; tés , foit béfans, tourteaux & autres, ne font point
dites a ccâ té cs , mais accompagnées-.
Nerefliâng. d‘e Gadàgne , à Paris , d'azur d trois
■ bandes d o r , accotées de trois étoiles chargent ; les
étoiles
étoiles pofées entre la première & la fécondé bande.
( G .D . L . T . )
§ ACCOUCHEMENT, Méchanifme de l'accouchement.
Les anciens attribuoient la fortie du foetus
à lui-même. C’eft dans cette vue qu’ils n’admettoient
d’autre accouchement naturel, que celui dans lequel^
la tête paffe la p remière, & qu’ils tentaient de réduire
à cette fituation les accouchemeiis dans lefquels
l’ènfant préfentoit quelqu’autre partie de fon corps.
C ’eft le foetus qui eft l’unique caufe de fa propre
fortie dans les animaux ovipares.
Dans les animaux vivipares, la nature fuit une
méthode différente : leur utérus eft mufculeux ; il eft
très-irritable, il rampe fur la table de l’anatomifte,
quand on l’a’arraché au corps de la femelle, & fes
mouvemens font des plus vifs. La plus grande partie
de ces animaux a fon diaphragme & fon enveloppe
mufculeufe du bas-ventre , capables l’un & l’autre
d’un très-grand effet, & dont le travail eft vifiblé
dans les quadrupèdes, & fu r -to u t dans l’efpece
humaine.
^ Les accôucheurs ont remarqué d’ailleurs qu’on
n’apperçoit -pas dans l’enfant dès mouvemens qui
puiffent concourir à le faire fortir ; que très-fouvent
il eft immobile dans le moment même qu’il va pa-
roître au jour ; que des enfans morts viennent fou-
vent auffi facilement au mondé , que dés enfans
en vie.
On a donc cherché la caufe dCYaccouchement dans
la ftruôure mufculaire de l’utérus. Les accoucheurs
ont attefté qu’ils ont apperçu la contraction de cet
organe , & dans Y accouchement, & dans l’extraction
du placenta; contraction affez puiffante pour endormir
la main, & pour rendre l’accoucheur incapable
d’agir. •; . •
Rtdfch ayant parlé avec affurance d’un mufclè de
rutérus , & les anàtomiftes modernes ayant donné
un peu plusff’Ordre aux fibres de cet organe, un habile
anatomifte a élevé un fyftême fur ces fondemens.
Les fibres'de la matrice-s’ étendent p e u -à -p e u
avec la matrice même, qui grolfit ; elles s’epa-
nouiffent fur fon fond; & delà vient la confiancede
l’épaiffeur de l’utérus qui, fans ces fibres, devroit
s?amincir à proportion de fa dilatation. Par ce même
méchanifme , l’orifice interne & le coii de la motrice
s’affoibliffent, & Y accouchement furvient. Lorfque
toutes les fibres de ce cou fe font épanouies, &
que les fibres de l’utérus ne'peuvent plus prêter ,
elles commencent alors à fentir l’irritation du foetus:
elles fe contractent, le fond defeend, & l’orifice
eft dilaté dans le même tems qu’il s’élève.
La beauté de ce fyftême nous a frappés ; mais la
réflexion nous a bientôt privés du plaifir que nous
avoit donné la folution d’une énigme, également
importante & difficile.
On doit propofer un méchanifme de Y accouchez
ment, qui puiffe avoir lieu dans tous les quadrupèdes
: mais ces animaux n’ont pas la même ftru-
, ^e ^ue la femelle-; leurs petits font logés dans
les cornes de lhiterus, qui elles-mêmes n’ont point
de fond, fur lequel puiffent s’étendre les fibres <fè
1 orifice ou du cou de la matrice. Dans ces animaux
ï n y a que des fibres longitudinales & tranfverfa-
les , comme dans les inteffins. Le méchanifme pro-
pôle ne leur eft donc pas applicable.
Dans la femelle même , les fibres longitudinales
f . 1 ll,erus ' “ ut trop confondues avec les tranfver-
ales pour agir fans elles, & le plus grand nomde
ces fibres nous a paru tranfverfal avec plus
ttu moins d’obliquité, v c pms
Les fibres de l’utérus nous ont donc para devoir
Z Z T " CdleS enrétréciffantles diatout
ce d - a cavité ’ & en pouffant devant elles
2 W V * COntenu dans l’utérus; I’enfent, le
placenta, des grumeaux de fang, de l’eau, de l’air
meme. Cette contraflion paroît fe terminer à l’ori-
» Par,ce clue cette partie cede, & que le fond de
1 utérus étant -fermé, ne cede point.
• *SJ0l\s “ e rej ett°ns pas cependant la facilité qu’apporte
a 1 accouchement l’aminciffement fucceffif du
cou de la matrice, qui fe confond avec l’utérus ; &
qui de cylindrique qii'il étoit, n’eft plus qu’un
Dourlet de peu depaiffeur. ■ 1 ^
Mais la force avec laquelle l’enfant eft mis au
monde , la difti-aflion des os pubis, & quelquefois
des autres os du baffin ; la demi-luxation du coccyx ,
le déchirement de la fourchette & d’une partie dû
penne; l’extenfion prodigieufe du vagin & des tégù-
mens ; tous ces effets fupérieurs à la force de l’utérus,
ne nous permettent pas de le regarder comme
la caufe principale de Y accouchement. Elle eft évidemment
dans la refpiration, & dans les efforts pro-
/ digieux que fait la femelle. Ce qu’on appelle travail
eft purement volontaire, & n’eft que la force du
diaphragme jointe à celle des mufcles du bas-ventre.
Si c’étoit l’ utérus qui fît le travail, ce travail ne
feroit plus volontaire. La force des mufcles de la
refpiration fuffit pour produire les effets que nous
avons expofés, & pour défunir des os liés par un
cartilage : c’eft la même force qui agitdans l’expulfion
des excrémens, lorfqu’ils font durs, & d’un volume
fupérieur à celui de l’anus.
L’utérus concourt fans doute dans l’accouchement,
comme l’inteftin concourt dans l’aêtion que nous v e - ,
nons-de nommer ; mais il ne joue certainement que
le fécond rôle. Si l’enfant avance dans le travail,
c’eft que les forces réunies de la refpiration preffent
l’utérus de tous côtés, & que les mufcles de l’abdomen
le ferrent comme une fangle vivement ferrée.
Peut-être la principale fonction de l’utérus eft-elle
d’aider la preffion latérale, d’empêcher que l’utérus
ne s’applatiffe, & ne fe dilate par la preffion de fon
fond, & de rendre la compreffion univerfelle &
dirigée de toute la furface , perpendiculairement à
l’axe de l’utérus. C’ eft une conjeêture appuyée fur
l’exemple du rectum , la preffion du diaphragme eft
un fait. °
La caufe irritante de Y accouchement eft apparemment
dans les incommodités de la mere pouffées au
plus haut point. Delà les accouckemens prefque toujours
prématurés des jumeaux; delà les fauffes couches
des femmes trop délicates.
On n’a qu’à fuivre une femme qui accouche, &
fur-tout pour la première fois : elle fent des douleurs
qu’elle appelle coliques ; mais ces douleurs augmentent
de quart d’heure en quart d’heure , elles deviennent
à la fin infupportables ; elles forcent la
femme à travailler, à employer toutes fes forces
à fe délivrer de fon fardeau ; & plus elle a été ignorante,
plus elle a négligé les premières douleurs,
&: mieux elle fe délivre. Il eft évident que la marche
de la nature n’a été qu’une irritation de l’utérus toujours
accroiflante, qui a forcé à la fin la mere à
employer les organes de la refpiration, pour faire
fortir ce qui 1 irritoit au-delà de toute patience. C’eft
ordinairement la chute de la tête dans le baffin,
qui porte l’irritation au degré qu’on appelle les
douleurs de Y accouchement.
Terme de l’accouchement. Mais le terme de Y accouchement
a-t-il une époque fixe ? C’eft une queftion
qui a été agitée avec beaucoup de’ vivacité en
France, & qui à donné lieu à dès difcuffiôns
utiles.
Il eft fur que chaque animal a fon terme, pour
fe délivrer ; que ce terme eft très-exact ; que -les
grands animaux étant moins fenfibles' , fe délivrent
plus tard, & les petits plus vîte ; que les carnivores
1e délivrent plus vite que les herbivores; que les
Q