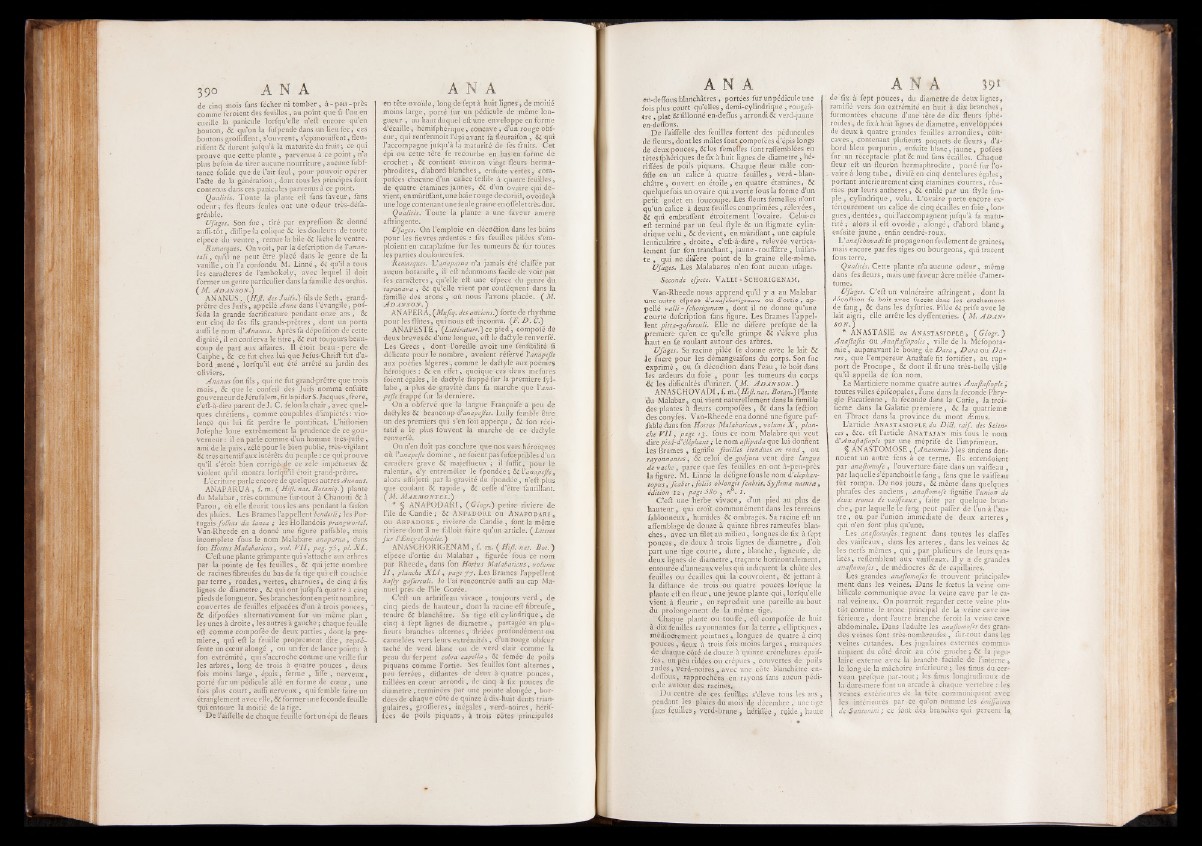
de cinq mois fans'féeher ni tomber, à - peu - près
comme feroient des feuilles, au point que fi l’on en
cueille la panicule lorfqu’elle n’eft encore qu’en
bouton, & qu’on la fufpende dans un lieu fec , ces
boutons grofliffent, s’ouvrent, s’épanouiflent, fleu-
riffent & durent jufqu’à la maturité du fruit ; ce qui
prouve que cette plante, parvenue à ce point, n’a
plus befoin de tirer aucune nourriture , aucune fubf-
tance folide que de l’air feul, pour pouvoir operer
l’afte de la génération, dont tous les principes font
contenus dans ces panicules parvenus à ce point.
Qualités. Toute la plante eft fans faveur, fans
odeur ; fes fleurs feules ont une odeur très-défa-
gréable.
V f âges. Son fuc , tiré par expreflion & donné
aufli-tôt, diffipe la colique & les douleurs de toute
efpece du ventre , remue la bile & lâche le ventre.
Remarques. On voit, par ladefcription de Yanan-
tali, qu’il ne peut être placé dans le genre de la
vanille, où l’a confondu M. Linné, & qu’il a tous
les carafteres de l’ambokely, avec lequel il doit
former un genre particulier dans la famille des orchis.
( M . A d a n s o n .)
AN ANUS, {Hiß. des Juifs.) fils de Seth, grand-
prêtre des Juifs, appellé Anne dans l’évangile, pof-
îeda la grande facrificature pendant onze ans, &
eut cinq de fes fils grands-prêtres , dont un porta
aufîi le nom dû Ananus. Après fa dépofition dé cette
dignité, il en conferva le titre, & eut toujours beaucoup
de part aux affaires. Il étoit beau - pere de
Caïphe, & ce fut chez lui que Jefus-Chrift fut d’abord
,mené, lorfqu’il eut été arrêté au jardin des
oliviers.
Ananus fon fils, qui lie fut grand-prêtre que trois
mois , & que le confeil des Juifs nomma enfuite
gouverneur de Jérufalem, fit lapider S. Jacques, frere,
c’eft-à-dire parent de J. C. félon la chair, avec quelques
chrétiens, comme coupables d’impiétés: violence
qui lui fit perdre le pontificat. L’hiftorien
Jofephe loue extrêmement la prudence de ce gouverneur:
il en parle comme d’un homme très-jufte,
ami de la paix, zélé pour le bien public, très-vigilant
& très-attentif aux intérêts du peuple : ce qui prouve
qu’il s’étoit- bien corrigé.de ce zele impétueux &
violent qu’il montra lorfqu’il étoit grand-prêtre.
L’écriture parle encore de quelques autres Ananus.
ANAPARUA , f. m. ( Hifi.nat. Botaniq.) plante
du Malabar, très-commune fur-tout à Chanotti & à
Parou, où elle fleurit tous les ans pendant la faifon
des pluies. Les Brames l’appellent benderli; les Portugais
folhas da lanea ; les Hollandois prangwortel.
Van-Rheede en a donné une figure paffable, niais
incomplète fous le nom Malabare anaparua, dans
fon Hortus Malabaricus, vol. V i l , pag. y5 , p l.X L .
C’eft une plante grimpante qui s’attache aux arbres
par la pointe de fes feuilles, & qui jette nombre
de racines fibreufes du bas de fa tige qui eft couchée
parterre , rondes, vertes, charnues, de cinq à fix
lignes de diamètre, & qui ont jufqu’à quatre à cinq
pieds de longueur. Ses branches fonten petit nombre,
couvertes de feuilles efpacées d’un à trois pouces,
& difpofées alternativement fur un même plan,
les unes à droite, les autres à gauche ; chaque feuille
eft comme compofée de deux parties, dont la première,
qui eft la feuille proprement dite, repréfente
un coeur alongé , ou un fer de lance pointu à
fon extrémité, qui s’accroche comme une vrille fur
les arbres, long de trois à quatre pouces , deux
fois moins large , épais, ferme , lifte , nerveux,
porté fur un pédicule aîlé en forme de coeur, une
fois plus court, aufli nerveux , qui femble faire un
étranglement avec elle, & former une fécondé feuille
qui entoure la moitié de la tige.
De l’aiffelle de chaque feuille fort un épi de fleurs
en tête ovoïde, long de fept à huit lignes, de moitié
moins large, porté fur un pédicule de même longueur
, au haut duquel eft une enveloppe en forme
d’écaille, hémifphérique, concave , d’un rouge obf-
cur, qui renfermoit l’épi avant fa fleuraifon , & qui
l’accompagne jufqu’à la maturité de fes fruits. Cet
épi ou cette tête fe recourbe en bas en forme de
crochet , & contient environ vingt fleurs hermaphrodites
, d’abord blanches , enfuite vertes, com-
pofées chacune d’un calice fefîile à quatre feuilles,
de quatre étamines jaunes, & d’un ovaire qui devient,
en mûriflant, une baie rouge de corail,-ovoïde,à
une loge contenant une feule graine en ofielet très-dur.
Qualités. Toute la plante a une faveur amere
aftringente.
U J âges. On l ’emploie en décoâion dans les bains
pour les fievres ardentes : fes feuilles pilées s’emploient
en cataplafme fur les tumeurs & fur toutes
les parties douloureüfes.
Remarques. L’anaparua n’a jamais été claffée par
aucun bötanifte, il eft néanmoins facile de voir par
fes cara&eres, qu’elle eft une efpece du genre du
tapanava , & qu’elle vient par conféquent dans la
famille des aroôs -, où nous l’avons placée. ( M.
A d a n so n . )
ANAPERA, {Mufiq. des anciens.) forte de rhythme
pour les flûtes, qui nous eft inconnu. {F. D . C.)
AN APESTE, {Littérature.) ce pied , compolé de
deux brèves & d’une longue, eft le daflyle renverfé.
Les Grecs , dont l’oreille avoit une fenfibilité fi
délicate pour le nombre, avoient réfervé Yanapeße
aux poéfies légères -, comme le daftÿle aux poèmes
héroïques : & en effet, quoique ces deux mefures
foient égales, le daftyle frappé fur la première fyl-
labe, a plus de gravité dans fa marche que Yanapeße
frappé fur la derniere.
On a obfervé que la langue Françoife a peu de
dactyles & beaucoup d’dnapeßes. Lully femble être
un des premiers qui s’en foit apperçu, &c-fon récitatif
a le plus fouvent la marche de ce daétyle
renverfé.
On n’en doit pas conclure que nos vers-héroïques
où Yanapeße domine , ne foient pas fufcéptibles d’un
caractère grave & majeftueux ; il fuffit, pour le
ralentir, d’y entremêler le fpondée ; & Yanapeße-,
alors afiùjetti par la'gravité du fpondée, n’eft plus
que coulant & rapide , & ceflè d’être fautillant.
{M . M a r m o n t e l .)
* § ANAPODARI, {Géogr.J petite riviere de
l’île de Candie ; & Anpadore ou Anapodari ,
ou Arpadore, riviere de Candie, font la même
riviere dont il ne falloir faire qu’un article. {Lettres
fur C Encyclopédie.)
AN ASCHOR1GEN A M , f. m. ( Hiß. hat. Bot. )
efpece d’ortie du Malabar , figurée fous ce -nom
par Rheede, dans fon Horlus Malabaricus, volume
I I , planche X L I , page y y. Les Brames l’appellent
haßy gafurculi. Je l’ai rencontrée aufîi au cap Manuel
près de l’île Gorée.
C’eft un arbriffeau vivace , toujours v erd , de
cinq pieds de hauteur, dont la racine eft fibreufe,
tendre & blanchâtre. Sa tige eft cylindrique, de
cinq à fept lignes de diamètre, partagée en plu-
fieurs branches alternes , ftriées profondément ou
cannelées vers leurs extrémités, d’un rouge obfcur
taché de verd blanc ou de verd clair comme la
peau du ferpent cobra capella, & femée de poils
piquans comme l’ortie. Ses feuilles font alternes,
peu ferrées, diftantes de deux à quatre pouces,
taillées en coeur arrondi, de cinq à fix pouces de
diamètre , terminées par une pointe alongée , bordées
de chaque côté de quinze à dix-huit dents triangulaires
, groflieres, inégales , verd-noires, hérif-
fées de poils piquans, à trois côtes principales
eri-de flous blanchâtres, portées fur uft pédicule Une
fois plus court qu’elles, dêmi-cylindrique, rougeâtre
, plat & fillonné en-deffus , arrondi & verd-jaune
en-deffous.
De raiffelle des feuilles fortent des péduneules
de fleurs, dont les mâles font çompofées d’épis longs
de deux pouces, &lès femelles font raffemblées en
têtes fpheriques de fix à huit lignes de diamètre , he-
riffées de poils piquans. Chaque fleur mâle Con-
fifte en uh calice à quatre feuilles, verd - blanchâtre
, ouvert en étoile, en quatre étamines, &
quelquefois un ovaire qui avorte fous la forme d’un
petit godet en foucoupe. Les fleurs femelles n’ont
qu’un calice à deux feuilles comprimées, rélevées,
& qui embraffent étroitement l’ovaire. Celui-ci
e ft terminé par un feul ftyle & un ftigmate cylindrique
v e lu , & devient, en mûriflant, une capfule
lenticulaire , droite, c’eft-à-dire, relevée verticalement
fur fon tranchant, jaune-rouffâtre , luifart-
te , qui ne différé point de* la graine elle-même.
Ufages. Les Malabares n’en font aucun yfage.
Seconde efpece. V a l u - S C h o r i g e n a m .
Van-Rheede nous apprend qu’il y a au Malabar
Une autre efpece d’anafchorigenam ou d’ortie , appellé
valli - fchorigenam, dont il ne donne qu’une
courte defcription fans figure. Les Brames l’appellent
pitta-gafurculi. Elle ne diffère prefque de la
remiere qu’en ce qu’elle grimpe & s’élève plus
aut en fe roulant autour des arbres.
Ufages. Sa racine pilée fe donne avec le lait &
le fucre pour les démangeaifons du corps. Son fuc
exprimé , ou fa décoâion dans l’eau, fe boit dans
les ardeurs du foie , pour les tumeurs du corps
les difficultés d’uriner. ( M . A d a n so n . )
ANASCHOVADI, f. m. {Hifi.nat. Botan.)Plante
du Malabar, qui vient naturellement dans la famille
des plantes à fleurs çompofées , & dans la feâion
des conyfës. Van-Rheede enadonné une figure paffable
dans fon Hortus Malabaricus , volume X , plan^
che V i l , page i j . fous ce nom Malabre qui veut
dire pied-d’éléphant ; le nom ajlipada que lui donnent
lés Brames , lignifie feuilles étendues en rond , ou
rayonnantes, & celui de godjura veut dire langue
de vache , parce que fes feuilles en ont à-peu-près
la figure. M. Linné la défigne fous le nom à’elephan-
topus, fcaber, foliis oblongis f cabris. Syjlema naturce,
édition z2-, page 58o > n°. I.
C ’eft une herbe vivace, d’un pied au plus de
hauteur, qui croît communément dans les terreins
fablonneux, humides & ombragés. Sa racine eft un
affemblage de douze à quinze fibres rameufes blanches
, avec un filet au milieu, longues de fix à fept
pouces , de deux à trois lignes de diamètre , d’où
part une tige courte, dure, blanche, ligneufe, de
deux lignes de diamètre, traçante horizontalement,
entourée d’anneaux velus qui indiquent la chûte des
feuilles ou écailles qui la couvroient, & jettant à
la diftance de trois ou quatre pouces lorfque la
plante eft en fleur, une jeune plante qui, lorfqu’elle
vient à fleurir , en reproduit une pareille au bout
du prolongement de la même tige.
Chaque plante ou touffe, eft compofée de huit
à dix feuilles rayonnantes fur la terre, elliptiques ,
médiocrement pointues .^ longues de quatre à cinq
pouces, deux à trois fois moins larges, marquées
dé chaque côté de douze à quinze créneiures épaif-
fes,, un peu ridées ou crépues , couvertes de poils
rudes , verd-noires , avec une côte blanchâtre en-
deffous, rapprochées en rayons fans aucun pédicule
autour des racines*
Du centre de ces feuilles s’élève tous les ans ,
pendant les pluies du mois de décembre , une tige
W s feuilles, vçrd-brune , hé rifle e , roide ? haute
de fix à fept pouces, du diàmètfé dé delix ligfiès j
ramifié vers fon extrémité en huit à dix branches,
furmontées chacune d’une tête de dix fleurs fphé-
roïdes, de fixàhuit lignes de diamètre, enveloppées
de deux à quatre grandes feuilles arrondies, concaves,
contenant plufieurs paquets de fleurs, d’abord
bleu purpurin , enfuite blanc, jaune, pofées
fur un réceptacle plat & nud fans écailles. Chaduô
fleur eft un fleuron hermaphrodite, porté fur l’ovaire
à long tube, divifé en cinq dentelures égales,
portant intérieurement cinq étamines Courtes, réunies
par leurs anthères, & enfilé par un ftyle Ample
, cylindrique, velu. L’ovaire porte encore extérieurement
un calice de cinq écailles en foie , ion-
, gués , dentées, qui l’accompagnent jufqu’à fa maturité;
alors il eft ovoïde , alongé, d’abord blanc,
enfuite jaune, enfin cendré-roux.
L’anafehovadi fe propage non feulement de graines,
mais encore par fes tiges ou bourgeons, qui tracent
fous terre.
Qualités. Cette plante n’a aucune odeur, même
dans fes fleurs, mais une faveur âcre mêlée d’amertume.
Ufages, C ’eft un vulnéraire âftrlngent, dont la
déco&ion fe boit avec fuccès dans les crachemens
de fang, & dans les dyfuries. Pilée & prife avec le
lait aigri, elle arrête les dyffenteries. ( M. A d a n *
s o n . )
* ANASTASIË ou Anastasioplé, ( GéogrJ)
Anaflafia ou Anaftafiopolis, ville de la Méfopota-
mie , auparavant le bourg de Dara, Darce ou Da+
rds, que l’empereur Anaftafe fit fortifier, au rapport
de Procope, & dont il fit une très-belle ville
qu’il appella de fon nom.
La Martiniere nomme quatre autres Anafiafiople
toutes villes épifcopales, l’une dans la fécondé Phry-
gie Pacatienne , la fécondé dans la Carie, la troi-
fieme dans la Galatie prèmiere, & la quatrième
en Thrace dans la province du mont Æmus.
L’article A n a s t a s i o p l e du DicL raif. des Scieh*
ces -, &c. eft l’article A n atajan mis fous le norij-
d’Anafiafiople par une méprife de l’imprimeur.
§ ANASTOMOSE , {Anatomie.) les anciens dotï-
noient un autre fens à ce terme. Ils entendoient
par anaflomofe , l’ouverture faite dans un vaiffeâü ,
pâr laquelle s’épanchoitle fang, fans que le vaiffeau
fût rompu. De nos jours, & même dans quelques
phrafes des anciens 3 anaflomofe fignifie Y union dé
deux troncs de vaiffeaux, faite par quelque branche,
par laquelle le fang peut paffer de l’un à l’autre
, ou par l’union immédiate dé deux arteres ,
qui n’en font plus qu’une.
Leà âiiajloviofes. régnent dans toutes les claffes
des vaiffeaux, dans les arteres , dans les veines &c
les nerfs mêmes, q u i, par plufieurs de leurs qualités
, reffemblent aux vaiffeaux. Il y a de grandes
anaflomofes , de médiocres & de capillaires.
Les grandes anaflomofes fe trouvent principale*
ment dans les veines. Dans le foetus la veine ombilicale
communique avec la veine cave par le canal
veineux. On pourroit regarder cette veine plutôt
comme le tronc principal de la veine cave inférieure
, dont l’autre branche feroit la veine Cave
abdominale. Dans l’adulte les anaflomofes^des grandes
veines font très-nombreufes , fur-tout dans les
veines cutanées. Les jugulaires externes communiquent
du côté droit au côté gauche ; & la jugulaire
externe avec la branche faciale de l’interne ,
le long de la mâchoire inférieure ; les finus du,cerveau
prefque par-tout; les finus longitudinaux de
la dure-mere font un arcade à chaque vertebre :• les.
veines extérieures de la tête communiquent avec
les intérieures par ce. qu’on nomme les émiffaires
I de Santonini ; ce font des branches qui percent 1$