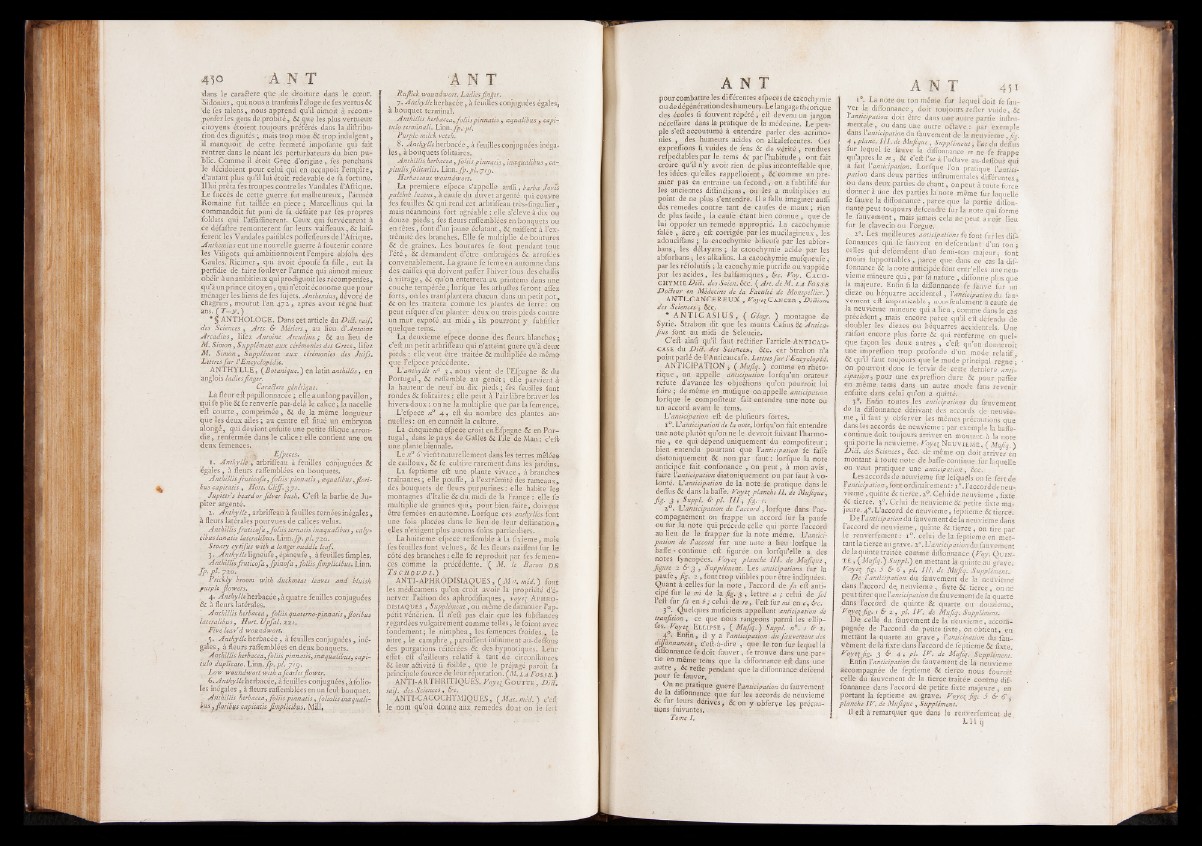
'dans le cara&ere qüe de droiture dans le coeùf.
‘Sidonîus,. qui nous a tranfmis l’éloge de les vertus 6ç
d e fes talens, nous apprend qu’il aimoit à récomr
]:p enfer les, gens deprobité, &.que les plus vertueux
citoyens étqient toujours préférés dans la diftribu-
jtion des dignités ;. mais trop mou & trop indulgent,
il manquoit de cette fermeté impofante qui fait
rentrer dans le néant les perturbateurs du bien public.
Comme il.étoit Grec d’origine, fes penchans
le décidoient pour celui qui en occupoit l’empire,
d ’autant plus qu’il lui étoit redevable.de fà fortune.
11 lui prêta fes.troupes contre.les Vandales d’Afrique,.
Le fuccès de cette guerre rut malheureux, l’armée
Romaine fut taillée en piece ; Marcellinus qui la
commandoit fut puni de fa défaite par fes propres
ïbldats q u i. l’affaifinerent. Ceux, qui furyéçurent à
.ce défaftre remontèrent fur leurs vaiffeaux, 6c laif-
fererif les Vandales pailibles poffeffeurs de l ’Afrique.
Anthemius eut Une nouvelle guerre à foutenir contre
les Vifigots qui ambitionnoient l’empire abfolu des
'Gaules. Ricimer;,. qui âvoit époufé fa fille, eut la
perfidie de faire foulever l’armée qui aimoit mieux
obéir à un ambitieux qui prodiguoit les récompenses,
qu’à un prince citoyen, qui n’étoit économe que pou.r
'ménageries Biens de fes fujets. Anthcmius, dévoré de
chagrins, mourut l’an 472 , après avoir régné huit
àns. ( T—n . )
* § ANTHOLOGË. Dans cet article du Dict. raif.
des Sciences ,. Arts & Métiers , . au lieu d’Antoine
Arcadius, liiez Antoine Arcudius ; & au lieu de
M. Simon,Supplément aux cérémonies des Grecs, lifez
M. Simon, Supplément aux cérémonies des Juifs.,
Lettres fur P Encyclopédie.
ANTHYLLE, {Botanique.) en latin anthillis, en
anglôis ladiesfinger.
Caractère générique.
Là fleur eft papillonnacée ; elle.a unîong pavillon,
qui fe plie & fe renverfe par-delà le calice ; la nacelle
eft courte, comprimée, & de,la même longueur
'que les deux ailes ; au centre eft fitué un embryon
alongé, qui devient enfuite une petite filique.arrondie,
renfermée dans le calice : elle contient une ou
deux femences. :
Efpeces.
1 . Anthylte 'é arbriffeau à feuilles conjuguées &
égalés, à fleurs raflemblées en bouquets.
Anthillis fruticofa, foliis'pinnatis , oequalibus,fiori-
^ lus capitatis, Hort. Cliff. 37.1.
Jupiter*s b tard or filvtr bush, C’eft la barbe de Jupiter
argenté.
2. Anthylle, arbriffeau à feuilles ternées inégales,
à fleurs latérales pourvues de calices velus.
Anthillis fruticofa., foliis ternatis inczqualibus, caly-
çibus lanatis lateralibus.lÀirn.fp. pl.^20. i
Stoary cytifus with a longermiddle leaf
3. Anthylle ligneufe, épineufe, à feuilles Amples,
Anthillis fruticofa ,fpinofa , foliis fimplicibus; Linn.
fp .p l. 7Z0.
Prickly broom with duckmeat leaves and bluish
purple fiowtrs.
. 4. Anthylle herbacée, à quatre feuilles conjuguées
6c à fleurs l a t é r a l e s . . ’ 'f/f
Anthillis herbacia, foliis quatemo-pmnatis ,fioribus
lateralibus, Hort. Upfal. 2.21.
Five leav’d woundwort. . ..
5* Anthylle herbacée , à feuilles conjuguées, inégales,
à fleurs raflemblées en deux bouquets.
Anthillis herbacea,foliis pinnatis, incequalibus, capitulé
düplicato. Linri.fp. pl. y 19. .. . *
Low woundwort with a fçarletflowtr.
(i.Anthylle herbacée, àfeuilles conjuguées, à folioles
inégâles , à fleurs raflemblées en un.leul bouquet.
. • Anthillis herbacea, foliis pinnatis, foliolis incequq.li-
hus. fioriby-s capitatis fimpliçibits, Mill«
7. Anthylle herbacée, à feuilles conjuguées égales;,
à bouquet terminal.
.Anthillis .herbacea, foliis pinnatis, oequalibus , capitula
terminais Linn•fpl'pl.
Purple milck vetch.
8. Anthylle herbacée ,.à feuilles conjuguées inégales
, à bouquets folitaires.
Anthillis. herbacea, foliis pinnatis, incequalibus, ca-
pitulisfolitariis. Linn. fp.pl. y ig. . é :
Herbaceous woundwort. .
, La première efpece s’appelle aufli, barba Jovis
pulthrè lucens, à caufe du duvet..argenté qui couvre
fes feuilles &,q.ui rend cet arbriffeau très-fingulier.,
mais néanmoins fort agréable : .elle s’élève à dix ou
douze pieds ; fes fleurs raflemblées en bouquets ou
en têtes, font d’un jaune éclatant, & naiffent à l’extrémité
des branches. Elle fe multiplie de boutures
6c de graines*. Les boutures fe font pendant tout
l’été, & .demandent d’être ombragées 6c arrofées
convenablement. La graine fe ferne, en automne dans
dés. caiffes qui doivent paffer l’hiver fous dès chaflis
à vitrage, 6c qu’on enterrera.au printems dans une
couche tempérée.; lorfque les arbpftes feront affez
forts, oh les tranfplantera chacun, dans un petit pot.,
.& on les traitera comme les.plantes de ferre: on
peut rifquer.d’en planter deux ou trois pieds contre
un mur expofé. au midi, ils pourront y fubfifter
quelque tems.
La deuxieme efpece donne des fleurs blanches ;
c’eft un petit arbriffeau qui n’atteint guere qu’à deux
pieds : elle veut être traitée 6c multipliée de même
que l’efpece précédente.
L’anthylle n° 3 , nous vient de l’Efpagne & du
Portugal, 6c reffemble au genêt ; elle parvient à
la hauteur de neuf ou dix pieds.; fes feuilles.font
róndes & folitaires.: elle peut à l’air libre braver les
hivers doux : oh ne la multiplie que par la femence*
L’efpece n° 4 , eft du nombre des plantes annuelles
: on en connoît la culture.,
La cinquième efpece croît enEfpagtie 6c en Portugal
, dans le pays de Galles 6c l’île de Mam: c’eft
une plante biennale.
Le n° G viefft naturellement dans les terres mêlée»
de cailloux, 6c fe. cultive rarement dans les jardins.
La feptieme eft. une plante vivace, à branches
tramantes ; elle pouffe, à l’extrémité des rameaux,
des bouquets de fleurs purpurines : elle' habite le»
montagnes d’Italie & du,midi de là France: elle fe
multiplie de graines qui., pour bien faire, doivent
être femées en automne. Lorfque ces anthylles font
une fois- placées dans le lieu- de 'leur deftination,
elles n’exigent plus aucuns foins. particuliers.
La huitième efpece reffemble à la fixieme, mais
fes feuilles font velues, 6c les fleurs naiffent fur le
côté des branches : elle fe reproduit par fes femences
comme la précédente. ( M.. le Baron d e
T s c h o u d i .) ,
: ÀNTI-APHRODISIAQUES, ( M a. méd. ) font
les médicamens qu’on croit avoir la propriété d’énerver
l’aûion des aphrpdifiacjiies, voye^ A p h r o d
i s i a q u e s , Supplément, oit meme de diminuer l’appétit
vénérien. Il n’eft pas clair que les fubftances
regardées vulgairement comme telles, le foient avec
fondement ; le nimphea, les femences froides le
nitre, le camphre , paroiffent infiniment, aù-deffqûs
des purgations réitérées 6c des hypnotiques. Leur
effet- eft d’ailleurs relatif- à tant de circonftances
6c. leur activité fi foible , que le préjugé pardît la
principale fourcé de leur réputation. (M . l a F o s s e . )
ANTI-ARTHRITIQUES. Voye^ G o u t t e , D ié .
rail, des Sciences,, &c.
ANTI-CACOCHYMIQUES, {Mat. méd.) c’eft
le ; nom qu’oii donne aux remedés dont on fe fert
pour Combattre les différentes efpeces de cacochymie
ou de dégénération des humeurs; Le langage théorique
des écoles fi fouvent répété ; eft devenu un jargon
néceffaire dans la pratique de la médecine. Le peuple
s’eft accoutumé à entendre parler des acrimonies
, des humeurs acides on alkalefeentes. Ces
expreflions fi vuides de fens & de vérité , rendues
refpe&ables par le tems & par l’habitude * ont fait
croire qu’il n’y avoit rien de plus inconteftablê que,
les idées qu’elles rappelloient ; & 'comme un premier
pas en entraîne un fécond , on a fubtilifé fur
les anciennes diftinétions, on les a multipliées au
point de ne plus- s’entendre, il a fallu imaginer aufli
des remedes contre tant de eaufes de maux; rien
de plus facile, la caufe étant bien connue , que de
lui oppofer un remede approprié. La cacochymie
faléê , âcre 5 eft corrigée par les mucilagineux, les
adouciffans ; la cacochymie bilieufe par les abfor-
bans, les délayans ; la cacochymie acide par les
abforbans ; les alkalins. La cacochymie mufqueufe ÿ
par les réfolutifs ; la cacochymie putride ou vappide
par les acides, les balfamiques, &c. Voy. C a c o c
h y m i e Dict. des Scien. 6 c c . ( Art. de M. l a F o s s e
Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier. )
, ANTI-CANCEREUX, Foyei C a n c e r , Diction,
des Sciences $ 6cc.
* A N T I C A S IU S , ( Géogr. ) montagne dé
Syrie. Strabon dit que ies monts Cafius 6c Antica-
fius font au midi de Seleueie.
C’eft ainfi qu’il faut rectifier l’article An t iCAUCASE
du Dict. des Sciences», ,&c. car Strabon n’a
point parlé de l’Anticaucafe. Lettres fur VEncyclopéd.
ANTICIPATION ; ( Mufiq. ) comme en rhétorique
, on appelle anticipation lorfqu’un orateur
réfute d’avance les objeâions qu’on pôurroit lui
faire ; de même en mufique on, appelle anticipation
lorfque lè compofiteur fait entendre une note Ou
un accord avant le tems.
U anticipation eft de plufieurs fortes.
i° . L’anticipation de la note, lorfqu’on fait entendre
une note plutôt qu’on ne le devroit fuivant l’harmonie
, ce qui dépend uniquement du compofiteur ;
bien entendu pourtant que l’anticipation fe faffe
diatoniquement & non par faut : lorfque la note
anticipée fait confonance , on peut, à mon avis,
faire l’anticipation diatoniquement ,ou par faut à volonté;
L’anticipation de la note fe pratique dans le
deflus 6c dans la baffe. Voye{ planche II. de Mufique,
fig• 3 * Suppl. & pl. I I I , fig. 11 .
2°. L’anticipation de Vaccord, lorfcjue dans l’aé-
compagnèment on frappe un accord fur la paufe
ou fur ,1a note qui précédé Celle qui porte l’accord
au lieu de le frapper fur la note même. L’anticipation
de Caccord fur une note a lieu lorfque la
baffe - continue eft figurée ou lorfqu’elle a des
notes fyncopées. Voyeç planche III. de Mufique,
figure 2 & 3 , Supplément. Les anticipations fur' la
paufe, fig. 2 , font trop vifibles pour être indiquées;
Quant à celles fur la note , l’accord de fa eft anticipé
fur le mi de la fig. 3 , lettre a ; celui de fol
l’eft fur fa en b ; celui de re, i ’eft fur mi en e, &c.
3°. Quelques muficiens appellent anticipation de
tranfition, ce que nous rangeons parmi les ellip-
fes. Voy es E l l i p s e , ( Mufiq. ) Suppl. n°. 1 & 2.
4 . Enfin, il y a l’anticipation du fauvement des
dijfànnances, c’eft-à-dire , que le ton fur lequel là
diffonnance fe doit fauver, fe trouve dans une partie
en même tems que la diffonnance eft dans une
autre , & refte pendant que la diffonnance dèfcend
pour fe fauver.
1 nj - ^ rat^ Ue guere Xanticipation du fauvement
de la diffonnance que fur les accords de neuvième
. *ur. . urs dérivés, & on y obferve les précautions
luivantes,, v ; ; : c ; . . .
Tome L
i®. La note ou ton même fur lequel doit fe fauver
la diflbnnànce, doit toujours refter vuide, 6c
I anticipation doit être dans une autre partie inftru-
ment^le, Ou dans une autre oélave : par, exemple
dans l’anticipation du fauvement de la neuvième ,fig.
4 , plane. III. de Mufique , Supplément, Y Ut du deflus
iur lequel fe fauve la diffonnance rc ne fe frappe
qu après le re , 6c e’eft Y ut à l’o&ave au-deffous qui
a tait 1 anticipation. Lorfcjue l’on pratique {’anticipation
dans deux parties inftrumentales différentes •
Ou dans deux parties de chant, on peut à toute force
donner à Une des parties la note même fur laquelle
fe fauve la diffonnance , parce que ia partie diffon-
nanté peut toujours defcehdré fur la note qui forme
le faüvemeht, mais jamais cela rie peut avoir lieu
fur le claveciri ou l’Orgue.
2°. Les meilleures anticipations fe font fur les dif-
fontiances qui fe fauvent en dçfcendant d’un ton 5
celles qui deféendent d’un femi-ton majeur; font
moins fuppoftables, parce que dans ce cas la dif-
fonnance 6c la note anticipée fdnt entr’eljes une neuvième
mineure qui, par fa nature , diffonne plus qué
la majeure. Enfin fi la , diffonnance fe fauve fur un
dieze ou béquarre accidentel, Y anticipation du fau-
vement eft impraticable , non-feulement à caufe de
la neuvième mineure qui a lieu , comme dans le cas
précédent, mais encore patee qu’il eft défendu de
doubler les diezes Ou béquarrèS accidentels. Une
raifon encore plus forte 6c qui renferme en quelque
façon les • deux autres , c’eft qu’on donneroit
une imprefliori trop profonde d’un mode relatif
6c qu’il faut toujours, que le mode principal régné ; •
on pourroit donc fe fervir de cette derniere anticipation
i pour une expreflion dure & pour paffer
en même tems dans un autre mode fans revenir
enfuite dans celui qu’on a quitté;
3°. Enfin toutes .les anticipations du fauvement
de la .diflbnnarice dérivant des accords de neuvième
, il faut y obferver les mêmes précautioris qüe
dans les accords de neuvième : par exemple là baffe-
continue doit toujours arriver en montant à la note
qui porte la neuvième. Voye{ Neüviemë, ( Mufiq. )
Dict. des Sciences, 6cc. de même on doit.arriver en
montant à toute note de baffe-continue, fur laquelle,
on veut pratiquer une anticipation, &c.
Les accords de neuvième fur lefquels on fe fert de
Y anticipation, font ordinairement : i° . l’accord de neuvième
, quinte 6c tierce. a9. Celui de neuyieme , fixte
6c tierce. 30. Celui de neuvième & petite fixte majeure.
40. L’accord de neuvième, feptieme & tiercé;
De l’anticipation du fauvement de la neuvième dans
l’accord de rieuvieme, quinte & tierce , on tire par
le renverfe ment : i° . celui de la feptieme eri mettant
la tierce au grave. 20. L’anticipation du fauvement
de la quinte traitée comme diffonnance {Voy. Q u in t
e , { Mufiq.) Suppl.) en mettant la-quinte au grave;
k^oyé£ figi b & G , pl, 111. de Mufiq. Supplément.
, De C anticipation, du fauvement de la neuvième
dans l’accord de, neuvième , fixte & tierce , on né
peut tirer que Y anticipation du fauvement.de la quarté
dans l’accord de quinte & quarte ou douzième.
Foyeifig. i& 2 , pl. IV. de Mufiq. Supplément.
De celle du fauvement de la rieuvieme, accompagnée
de l’accord de petite fixte, on obtient, en
mettant la quarte au grave, l’anticipation du fau-
vèment de la fixtè dans l’accord de feptieme & fixte.
Voye{ fig. 3 & 4 ,- pl. IV. de Mufiq.-Supplément:
Erifin Y anticipation du fauveriient de la neuvième
accompagnée de feptieme & tierce nous fournit
celle du fauvement de la tierce traitée Confine diffonnance
dans l’accord de petite fixte majeure ,• en
portant la feptieme au grave'; Voyeç. fig. 5 & G >
planche IV; de Mufique , Supplément,
II eft à remarquer que dans le reriverfem'erit de
L l ï i j