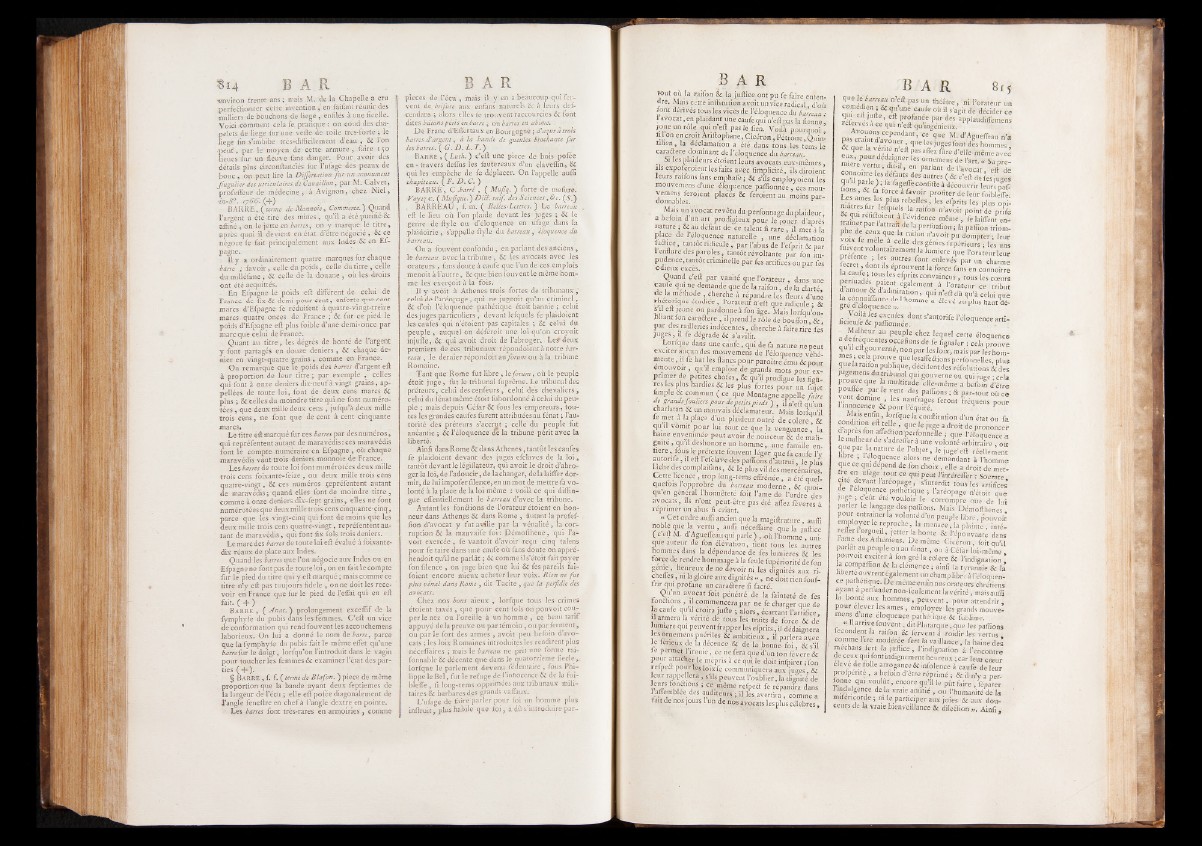
S8i4 B A R
■environ trente ans ; mais M. de;la Chapelle a cru
5>_erfeâionner cette invention gj en fàifant réunir des
■milliers de bouchons d e liege ,, enfilés Jhune ficelle.
Voici comment cela fe pratique : on coud des chapelets
de liege fur une vefte de toile très-forte ; le
liege fin s’imbibe très-difficilement d’eau , & l’on
p e u t', p a r le moyen de cette a rm u re , faire 150
lieues 'fur. un fleuve fans danger. Pour avoir des
détails plus circonftanciés fur l ’ufage dès peaux de
b o u c , ,on .peut lire la Differtation fur un monument
JîuguTur des utriculairesde Cavaillon, par M. Calyet,
profefleur de méde cine, à Avignon, chez N ie l,
ân-8°,. ri,y&&<(^r) ^
B A R R E ,( terme de Monnaie, Commerce.) Quand
l’argent a été tiré des mines , qu’il a ete purifie &
affiné , on le jette en barres, on y marque le titre ,
-après quoi il devient en état d’être négocié , & ce
négoce fe fait principalement aux Indes & en Ef-
pagne. • ■ ■ ■
Il y a ordinairement quatre marques fur chaque
barre ; fa v o ir, celle du poids,- celle du titr e , celle
d u milléfime , & celle de la douane , oit les droits
o n t été acquittés. . : ; ' • .
- En Elpagne le poids eft différent de celui d e
France de fix & demi po u r c e n t, enforteque cent
marcs d’Efpagne fe réduifent à quatre-vingt-treize
marcs, quatre onces de France ; & fur ce pied le
poids d’Efpagne eft plus foible d’une demi-once par
marc que celui de France.-
> Quant a u titr e , les degrés de bonté de l’argent
y font partagés en douze deniers , & chaque den
ier en vingt-quatre grains , comme en France.
On remarque que le poids des barres d’argent eft
à proportion de leu r titre ; par exemple , celles
qui font à onze deniers dix-neuf à vingt grains, app
e lle s de toute lo i, font de deux cens marcs &
plus ; & celles du m oindre titre qui ne font numérotées
, que deux mille deux cens , jufqu’à .deux mille
tro is cens, ne font que de cent a cent cinquante
marcs. . . . . ^
Le titre eft marqué fur ces barres par des numéros,
qui repréfentent autant de maravédis : ces maravédis
font le compte numéraire en Efpagne , où chaque
maravédis v au t trois deniers monnoie de France.
Les barres de toute loi font numérotées deux mille
trois cens foixante-feize , ou deux mille trois cens
quatre-vingt, & ces numéros Repréfentent autant
d e maravédis ; quand elles font de moindre titre ,
■comme à onze deniers dix-fept grains, elles ne font
numérotées que deux mille trois cens cinquante-cinq,
p arce que les vingt-cinq qui font de moins que les
deux mille trois cens quatre -vingt, repréfentent autan
t de m aravédis, qui font fix fols trois deniers.
Le marc des barres de toute loi eft évalué àfoixante-
dix réaux de plate aux Indes.
Quand les barres que l’on négocie aux Indes ou en
Efpagne ne font pas de toute lo i, on en fait le compte
fur le pied du titre qui y eft marqué ; mais comme ce
titre n’y eft pas toujours fideie , on ne doit les recev
o ir en France que fur le pied de I’eflai qui en eft
fait. ( + ).
B a r r e , ( Anat. ) prolongement exceffif de la
fymphyfe du pubis dans les femmes. C’eft un vice
de conformation qui rend fouvent les accouchemens
laborieux. On lui a donné le nom de barre, parce
■que là fymphyfe du pubis fait le même effet qu’une
barre fur le d oigt, lorfqu’on l’introduit dans le vagin
p our toucher les femmes & examiner l’état des p arties
( + ) .
§ B a r r e , f. f. ( terme de Blafon. ) piece de même
proportion que la bande ayant deux feptiemes de
la largeur de l’écti ; elle eft pofée diagonalement de
l ’angle fëneftre en chef à l’angle dextre en pointe.
Les barres fo n t très-rares en armoirie s, comme
pièces de l’écu , mais il y en a beaucoup qui fervent
de brifure aux enfans naturels & à leurs def-
cendans ; alors elles fe trouvent raccourcies & font
dites bâtons péris en barre OU barres en abîme. .
D e Franc d’Efl'ertaux en Bourgogne ; d’azur à trois
barres d'argent, à la bande de gueules brochante fur ies
barres. ( G. D . L .T . )
B a r r e , ( Luth. ) c’eft une piece de bois pofée
e n - tr a v e rs defîiis les fautereaux d’un ela v'effin, &
qui les empêche de fe déplacer. On l’appelle auffi
.chapiteau. ( F . D . C. )
BARRÉ, C .barré , ( Mujiq. ) forte de mefure.
Voyesr c. ( Mujiqut. ) DiÈl. raif. des-Sciences ,& c . ( S . )
, BARREAU , f. m. ( B elles‘ Lettres. ) L e barreau
eft le lieu où l’on plaide devant les ' juges ; & le
genre de ftyle. ou d’éloquence en ufage dans la
plaidoirie , s’appelle ftyle du barreau, éloquence dü.
barreau.
On a fouvent confondu, en parlant des anciens,
le barreau avec la trib u n e , & les avocats avec les
orateurs , fans doute à caufe que l’un de-ces emplois
menoit à l’a u tre , & que bien fouvent le même homme
les' exerçoit à la fois.
Il y avôit à Athènes trois fortes de tribunaux,-
celui de l’aréopage, qui ne jugeoit qu’au criminel,
& d’où, l’éloquence pathétique étoit bannie ; celui
des juges particuliers , devant lefquels fe plaidoient
les caufes qui n ’étoient pas capitales, ; & celui du
peuple , auquel on déféroit une. loi qu’on croyoit
injufte, & qui avoit droit de l’abroger» L e^ deux
premiers de ces tribunaux répondoient à notre barreau
, le : dernier répondoit au forum ou à la tribune
Romaine.
Tan t que Rome fut libre , 1 q forum, où le peuple
étoit ju g e , fut le tribunal fuprême. Le tribunal des
pré teurs, celui d esc en ieu rs, celui des chevaliers,
celui du fénat même étoit fubordonné à celui du peuple
; mais depuis Céfar & fous les empereurs, toutes
les grandes caufes furent attribuées au fénat ; l’autorité
des préteurs s’accrut ; celle du peuple fut
anéantie ; & l’éloquence de la tribune périt avec la
liberté.
Ainfi dans Rome & dans Athènes-, tantôt les caufes
fe plaidoient devant des jugés efclaves de la lo i,
tantôt devant le légiflateur, qui avoit le droit d’abror
ger la loi, de l’adoucir, de la changer, de la laifler dormir,
de lui impofer filence, en un mot de mettre fa volonté
à la place de la loi même : voilà ce qui diftin-
gue effentiellement le barreau d’avec la tribune.
Autant les fondions de l’orateur étoient en honneur
dans Athen.es & dans Rome , âutant la profef-
fion d’avocat y . fut avilie par la v én a lité , la corruption
& la mauvaife foi : Démqfthene, qui l’a-
voit exercée , fe vantoit d’a v o ir're ç u cinq talens
pour fe taire dans une caufe où fans doute on appré-
hendoit qu’il ne parlât ; & comme il s’étoit fait payer
fon filence , on juge bien que lui & fes pareils rai-
foient encore mieux acheter leur voix. Rien ne fu t
plus vénal dans Rome, dit Tacite , que la perfidie des
avocats.
Chez nos bons aïeux , lorfque tous les crimes
étoient ta x é s , que po u r cent fols ori pouvoit cou^
p e r le nez ou l’oreille à un homme , ce beau ta rif
appuyé delà preuve ou p ar tém o in , ou par ferment-,
ou p a r le fort des armes , avoit peu befoin d’avocats
; les.loix Romaines introduites les rendirent plus
néceflaires ; mais le barreau ne prit une forme rai-
fonnable & décente que dans le quatorzième fiecle-,.
lorfque le parlement devenu fédentaire , fous Philippe
le Bel, fut le refuge de l’innocence & de la foi-
bfeffe , fi long-tems opprimées aux tribunaux militaires
& barbares des grands vaffaux. .
L’ufage de faire;parler pour foi un homme plus
in ftru it, plus habile que fo i, a dû s’introduire par-
BAR
tout OLi Ia raifon &Ma juftice ont pu fe faire enten-
dre .M a ia c e tte inftitution avoit un vice radical d’où
io iif dérivés tous les vices de, l’éloquence du barreau ■
1 avoc at, en plaidant une caufe qui n’eft pas la fienne,
joue un rôle qui n’eft pas le lien. V o ilà, p o u rq u o i,
fa.1 on en croit Ariftophane, C ic éron, Pétrone ,Quin-
ttlien, la déclamation a été dans tous lies, teins le
caractère dominant de l ’éloquence du barreau.
: plaideurs etoient leurs avocats eux-mêmes,
ils expoleroient les faits avec {implicite , ilsdiroient
leurs raifons fans emphafe ; & s’ils employoient les
mouvemens d’une éloquence pafîionnée, 'cés mou-
vemens feroient placés & feroient au moins pardonnables.
■ é ■ ' *■
Mais un avocat revêtu du-perfonnage du plaideur,
a befoin d Un art prodigieux pour le jouer, d ’après
nature ; & au defaut de ce talent fi rare , il met à la
p h e e de l’éloquence naturelle , une déclamation
xacticé, tantôt ridicule, par l’abus de l’efprit & par
1 enflure des p arole s, tantôt révoltante par fon impudence,
tantôt criminelle p a r fes artifices ou par fes
odieux exces. r
Quand ç’eft par vanité que l’orateur , dans une
caufe qui ne demande que de la ra ifon, de la clarté!
d e là methode . cherche à répandre.les, fleurs d’une
rhétorique etudiee , l’orateur n’eft que ridicule ; &
s il eft jeune on pardonne à fon âge. Mais lorfqn’ou-
DJiant fon caraftére , il prend le rôle de bouffon, & ,
p a r des railleries indécentes, cherche à faire rire fés
ju g e s, il.fe dégrade & s ’avilit.
Lorfque dans une caufq „qui de fa nature ne peut
exciter aucun des mouvemens de l’éloquence véhémente
, il fé bat les flancs p our paroître ému & pour
ém o u v o ir, qu’il emploie,de grands mots pour ex-
primer de petites chofes, & qu’il prodigue les figft-
res les pins hardies & les plus fortes pour un furet
fimple & commun ( c e que Montagne appelle faire
de grands fouïiers pour de petits pieds ) , il n’eft qu’un
charlatan & un mauvais déclamateur. Mais lorfqu’il
“îe t.^ ,a P^ace d’un plaideur outré de colere &
qu il vomit pour lui tout ce que la vengeance la
haine envenimée peut avoir de noirceur & de malig
n ité , qu il deshonore un homme, une famille entière
, fous le p rétexte fouvent léger que fa caufe l’y
a u to n fe , il eft l’efclave dés paffions d’a u tru i, le plus
lâche des complaifans, & le plus vil des mercénaires.
Cette licence, trop long-tems effrénée, a été q u e lquefois
l’opprobre du barreau moderne , & quoi-
qu’en général l’honnêteté foit l’ame de l’ordre des
avoc ats, ils n’ont peut-être pas été affez féveres à
réprimer un abus fi criant.
« Cet ordre aufli ancien que la magiftrature, auffi
noble que la v e r tu , auffi néceffaire que la juftice
( c ’eft M. d’Agueffeauqui parle) ,..o ù l’homme, unique
auteur de fon élévation, tient tous les autres
nommes dans la dépendance de fes lumières & les
force de rendre hommage à la feule fupériorité de fon
genie, heureux de ne devoir ni les dignités aux ri-
chefles, ni la gloire aux dignités » , ne doit rien fouf-
in r qui profane un caraftere fi facré.
Qu’un avocat foit pénétré de la fainteté de fes
fonctions , 1 commencera par ne fe charger que de
la caufe qu d croira jufte ; alo rs, écartant l’arrifice,
il armera la v en te de tous les traits de force & de
lumière qui peuvent frapper les efprits, il dédaignera
les oi nemens puériles & ambitieux , il parlera avec
le lerieux de la décence .& de la bonne- f o i, & s’il
fe permet l’ironie, ce ne fera que d’un ton févere &
pour attacher le mépris’ à ce qqi le doit infpirer ; fon
lelpect pour les Ioixle communiquera aux juges &
eur rappellera , s’ils peuvent l’oublier, la dignité de
J f jj? M?10,1“ ’ ce.. mcme refpeCt fe répandra dans
1 affemblee des auditeurs ; il les avertira , comme a
fait de nos jours 1 un de nos avocats les plus célébrés,
’ f e I eWn n eft pas un théâtre, ni l’orateur un
m û l a V i V Un%cau,fe oil a “'agit de décider ce
S f e r v é s f c e ’ ^ P™fan?e P ," e erves a ce qui n eft qu ingem eduexs. a■pplaudiffemens
Avouons cependant , 'ce que M. d’Agueffeau n’a
pas craint d’avouer , .que les juges font dés hoinmes*
& que la verné „ ’eft pas affez ff,re d’ellé-mêm
mierePO“r, dedr S".er omeme" s l’art.-« Sa première
v e rtu s dit-il, en parlant de l’avocat -eft de
connoitre les defauts des autres ( & c’eft de fes iuaeS
fioni" M Vfa fa8,ef confl(le à découvrir leurl p§afî
Les am « i fori“ à ft Vn 'r Profiter de leur foibkffe.
les plus reb elles, les efprits les plus opi-
. . • ur lefquels la raifon n ’avoit point dé prife
& qu. refittcnent à l’évidence même , fe laiffent en !
Pal 1 attraI? de laperfuafion ; la paffion triom-
^ r cet^ Bl,e la raifon n’avoit pu dompter • leur
,VP.X fe mêle à celle des génies fu p é rie iT fïe ’s uns
fiuven volontairement la lumière que l’orateur leur
I liB B— B H enlev“ Par un charme
l ü i H M éprouvent la force fans en connoîrre
la caule, tous les efprits convaincus , tous les coeurs
perfuades patent également à l’omteur ce ,ribüt
d amour & d admiration, qui n’eft dû qu’à celui que
“ é,Wé 31 PluS ^
S’aUt0rife
Malheur au peuple chez lequel cette éloquence
an ’il c ? "™ “ ? f Cafions de fe fignaler ; cela prouve
qu I eftgouverne, non par leslofx, m aispar leshom-
mes cela prouve que lesaffeaions pcrfonnelles, plus
9,“ ’la:raif° n Pudique, décident desréfolütions & des
J gemens du tribunal qui gouverneou qui juge • cela
prouve que la multitude elle-même a L fo in d’être
pouffee. par le vent des paffions ; & p ar-tout où ce
vent domine les naufrages feront fréquens pour
1 innocence & pour l’équité.’■ . ! -, ^
H E m B m B t B m Ê M état ou fa
condition eft telle , que le juge a droit de prononcer
d aptes fon affeaioirperfonnelle ; que-l'éloquence a
Je malheur de s adreffer à une Volonté arbitraire , o u
lHibbroee a, r1r 1éMlonqautUenrecde ea l!’o°rbs |enet’ dlee mil,aSned-eafntt ràé el’lhleommemnet
que ce qui dépend de fon ch o ix , elle a droit de met!
tre en ufage: to u t ce qui peut I’intéreffer : Socrate
cite devant 1 aréopage J s’interdit tous les artifices
de leloquence p athé tique ; l’aréopage n’étoit que
juge , c e n t ete vouloir le corrompre que de lui
parler le langage des-paffions. Mais Démofthenes
p our entraîner la volonté d’un peuple lib re, pouvoit
employer le reproche, la menace, la plainte, in té-
refler 1 orgueil, jetter la honte & l’épouvante dans
l ame des Athéniens. Dé m ême Cicéron , foit qu’il
parlât au peuple ou au fénat,, ou à Céfar lui-même
pouvoit exciter à fon gré la colere & l’indignation !
a compaffion & la clémence ; ainfi la tyrannie & la
liberté ouvrent egalement un champlibre à Iléloquen-
ce pathétique. D e même enfin nos orateurs chrétiens
ayant a perluader non-feulement la v é rité , maisauflï
la bonté aux hommes , p e u v e n t, pour attendrir ,
pour eleyer les âmes , employer les grands mouvemens
d u n e éloquence patliéiique & fublime.
« 11 arrive fouvent, dit Plutarque, que les paffions
fécondent la raifon & fervent a raidir les vertus
comme l’ire modérée fert la vaillance, lah a in e des
mechans fert la jûftice , l’indignation à l’encontre
de ceux qui font indignement heureux ; car leur coe u r
eleve de folle arrogance & infolence à caufe dé leur
prolpente , a befoin d’être réprimé ; & il n’y a personne
qui vo u lû t, encore qu’U le pût faire , fépafer
1 indulgence, d e là vraie amitié , ou l’humanité de la ï
mifencorde; ni le. participer aux joies & aux douceurs
de la vraie bienveillance & dileûion ». Ainfi