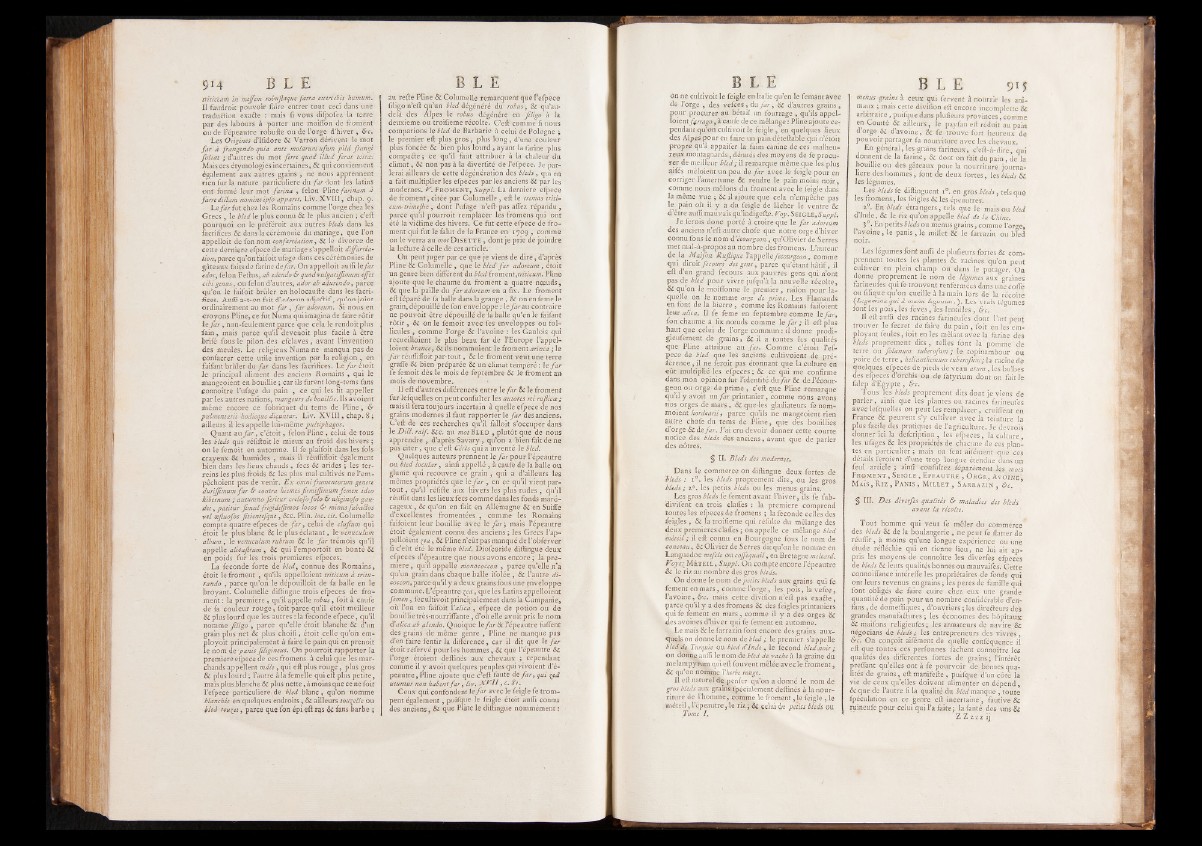
tnticearil in'mejfem robuflaque farr a exercelis hiimum.
Il faudroit pouvoir faire entrer tout ceci dans une
trad'uftion exa&e : mais fi vous difpofez la terre
par des labours à porter une moiffon de froment
©u de l’épeautre robufte ou de l’orge d’hiver , &c.
Les 'Origines d’Ifidore 8c Varron dérivent le mot
far à frangendb quia ante molarum uftun pila frangi
foleat ; d’autres du mot ferre quod illiid ferat terra*
Mais ces étymologies in c e r ta in e s ,q u i conviennent
également aux autres grains -, ne nous apprennent
rien fur la nature particulière du far dont les latins
ont formé leur mot farina , félon Plinefarinam a
farre dirham nomineipfo apparet. Liv.XVIII, chap. 9.
Le fàr fut chez les Romains comme l’orge chez les
Grecs , le bled le plus connu 8c le plus ancien ; c’eft
pourquoi on le préféroit aux autres bleds dans les
facrifices & dans la cérémonie du mariage, que l’on
appelloit de fon nom cohfarréation, 8c le divorce de
cette derniere efpece de mariage s’appelloit diffarria-
tion, parce qu’on faifoit ufage dans ces cérémonies de
gâteaux faits de farine de far. On appelloit auffi le far
edor, félon Félins, db edendo & quodvulgatiffimum effet
cibi gênas, ou félon d’autres, adorab adurcndo, parce
qu’on le faifoit briller en holocaufte dans les facri-
fices. Auffi a-t-on fait dWorun adjectif, qu’on joint
ordinairement au mot fa r , far adoreum. Si nous en
croyons Pline, ce fut Numa qui imagina de faire rôtir
le fa r , non-feulement parce que cela le rendoitplus
fa in , mais parce qu’il devenoit plus facile à être
brifé fous le pilon, des efclaves, avant l’invention
des meules. Le religieux Numa ne manqua pas de
confacrer cette utile invention par la religion, en
faifant brûler du far dans les facrifices. Le far étoit
le principal aliment des anciens Romains , qui le
mangeoient en bouillie ; car ils furent long-tems fans
connoître l’ufage du pain , ce qui les fit appeller
par les autres nations, mangeurs de bouillie. Ils avoient
même encore ce fobriquet du tems de Pline, 6*
pulmentarii hodieque dicuntur. Liv. XVIII , chap. 8 ;
ailleurs il les appelle lui-même pultiphagos.
Quant au fa r , c’étoit, félon Pline , celui, de tous
les bleds qui réfiftoit lé mieux au froid des hivers ;
on le femoit en automne. Il fe plaifoit dans les fols
crayeux 8c humides , mais il réuffiffoit également
bien dans les lieux chauds-, fecs 8c arides ; les ter-
reins les plus froids 8c les plus mal-cultivés ne l’em-
pêchoient pas de venir. E x omni frumentorum genere
durifjîmum far & contra hiemes firmifjimum femen ideo
hibetnum ; autumno feritur crelofo folo & uliginofo gau-
det, patitûr Jimul frigidifjimos locos 6* minus fubaclos
yel cefluofos Jîtientefqüe , &C. Plin. loc.cit. Columelle
compte quatre efpeces de fa r , celui de clufium qui
étoit le plus blanc 8c le plus éclatant, le venuculum
album, le venuculum rubrum 8c le far trémois qu’il
appelle alicafirum , 8c qui l’emportoit en bonté 8c
en poids fur les trois premières efpeces.
La fécondé forte de bled, contaue des Romains,
étoit le froment , qu’ils appelloient triticum à tritu-
rando , parce qu’on le dépouilloit de fa balle en le
broyant. Columelle diffingue trois efpeces de froment:
la première , qu’il appelle robus, foit à caufe
de fa couleur rouge, foit parce qu’il étoit meilleur
8c plus lourd que les autres : là fécondé efpece, qu’il
nomme Jiligo , parce qu’elle étoit blanche 8c d’un
grain plus net 8c plus' choifi, étoit celle qu’on em-
ployoit principalement à faire le pain qui en prenoit
îe nom de -panis flligineus. On pourroit rapporter la
première efpece de ces fromens à celui que les marchands
appellent mâle, qui eft plus rouge, plus gros
8c plus lourd ; l’autre à la femelle qui ell plus petite,
mais plus blanche 8c plus nette, à moins que ce ne foit
l’efpece particulière^ de bled blanc, qu’on nomme
blanchie en quelques endroits, 8c ailleurs tourelle ou
fled toupet, parce que fon épi eft ras 8c fans barbe ;
âu refté Pline 8c Columelle remarquent qtiê Pefpece
filigon’eft qu’un bled dégénéré du robus, 8c qu’au-
delà des Alpes le robus dégénéré en jiligo à la
deuxieme.ou troifieme récolte. C’eft' comme fi nous
comparions lé bled de Barbarie à celui de Pologne ;
le premier eft plus gros, plus long, d’une couleur
plus foncée 8c bien plus lourd, ayant la farine plus
compa&e ; te, qu’il faut attribuer à la chaleur du
climat, 8c non pas à la diverlité de l’efpece. Je parlerai
ailleurs de cette dégénération des bleds, qui en
a fait multiplier les efpeces par les anciens 8c par les
modernes. E. F r om e n t , Suppl. La derniere efpece
de froment, citée par Columelle , eft le trémas triti-
cum-trime (Ire, dont l’ufage n’eft-pas affez répandu,
parce qu’il pourroit remplacer les fromens qui ont
été la viClime des hivers. Ce fut cette efpece de froment
qui fut le falut de la France en 1709 , comme
on le verra au mot D is e t t e , dont je prie de joindre
la lefture à celle de cet article. ’
On peut juger par ce que je viens de dire, d’après
Pline 8c Columelle , que le bled' far adoreum, étoit
un genre bien différent du bled,frornent,triticum. Pline
ajoute que le chaume du froment a quatre noeuds,
8c que la paille du far adoreum en a fix. Le froment
eft féparé de fa balle dans la grange , 8c on en feme le
grain, dépouillé de fon enveloppe : le far au contraire
ne pouvoit être dépouillé de fa balle qu’en le faifant
rôtir , 8c on le femoit avec fes enveloppes ou follicules
, comme l’orge 8c l’avoine : les Gaulois qui
recueilloient le plus beau far de l’Europe l’appel-
loient brance, 8cils nommôient le froment arinca ; le
far réuffiffoit par-tout, 8c le froment veut une terre
graffe 8c bien préparée 8c un climat tempéré : le far
fe femoit dès le mois de feptembre 8c le froment ai*
mois de novembre.
11 eft d’autres différences entre le far 8c le froment
fur lefquelles on peut confulter les autores rei ruflicce;
mais il fera toujours incertain à quelle efpece de nos
grains modernes il faut rapporter le far des anciens.
C’eft de ces recherches qu’il falloit s’occuper dans
le Dict. raif. Sec. au oto^Ble d , plutôt que de nous
apprendre , d’après Savary, qu’on a bien fait de ne
pas citer, que c’eft Cirés qui a inventé le bled.
'Quelques auteurs prennent le far p,our I’épeautre
ou bled locular, ainfi appellé , à caufe de la balle ou
glunié qui recouvre ce grain, qui a d’ailleurs les
mêmes propriétés que le far , en ce qu’il vient partout
, qu’il réfifte aux hivers les plus rudes , qu’il
réuffit dans les lieux fecs comme dans les fonds marécageux
, 8c qu’on en fait en Allemagne 8c en Suiffe
d’excellentes fromentées., comme les Romains
faîfoient leur bouillie avec le far ; mais l’épeâutre
étoit également connu des anciens ; les Grecs l’ap-
pelloient %ea, 8c Pline n’eût pas manqué de l’obferver
fi c’eut été le même bled. Diofcoride diftingue deux
efpeces d’épeautre que nous avons encore ; la première
, qu’il appelle monococcon , parce qu’elle n’a
qu’un grain dans chaque balle ifolée , 8c l’autre di-
coccon, parce qu’il y a deux grains fous une enveloppe
commune. L’epeautre \ea, queles Latins appelloient
femen, fècultivoit principalement dans la Campanie,
oit l’on en faifoit Y alica, efpece de potion ou de
bouillie très-nourriffante, d’où elle avoitpris le non*
d'alica ab alendo. Quoique le far 8c i’épeautre fuffent
des grains de même genre , Pline ne manque pas-
d’en faire fentir la différence, car il dit que le far
étoit réfervé pour les hommes, 8c que l’épeautre 8c
l’orge étoient deftinés aux chevaux ; cependant
comme il y avoit quelques peuples qui vivoient d’épeautre
, Pline ajoute que c’eft faute de far, qui %eâ
utuntur non habent far, liv. \XEII ,c . 81.
Ceux qui confondent le far avec le feigl'e fe trompent
également, puifque le feigle étoit auffi connu
des anciens, & que Pline le diftingue nommément :
ôn ne cultivoit le feigle en Italie qu’en le femant avec
de 1! orge , des vefees, du fa r , 8c d’autres grains ,
pour procurer au bétail un fourrage , qu’ils appelloient
fe.rrago ,à caufe de ce mélange : Pline ajoute cependant
qu’on cultivoit le feigle , en quelques lieux
des Alpes pour en faire un pain déteftable qui n’étoit
propre qu’à appaifer la faim canine de ces malheureux
montagnards, dénués des.moyens de fe procurer
de meilleur bled ; il remarque même que les plus
«jifes. mêloient un peu de far avec le feigle pour en
corriger l’amertume 8c rendre le pain moins noir,
comme, mous mêlons du, froment avec le feigle dans
la même vue ; 8c il ajoute que cela n’empêche pas
le pain où il y a du feigle de lâcher le ventre 8c
d’être auffi mauvais qu’indigefte. Voy. S e ig l e , Suppl.
Je ferois donc porté à croire que 1 e far adoreum
des anciens n’eft autre chofe que notre orge d’hiver
connu fous le nom d’écourgeon, qu’Olivier de Serres
met mal-à-propos au nombre des fromens. L’auteur
de là Maifon Ruflique l’appellefecourgeon, comme
qui diroit fecours des gens, parce qu’étant hâtif, il
e ft d’un grand fecours aux pauvres gens qui n’ont
pas de bled pour vivre jufqu’à la nouvelle récolte,
8c qu’on le moiffonnele premier, raifon pour laquelle
on le homme orge de prime. Les Flamands
en font de la bierre , comme les Romains faifoient
leur alica. Il fe feme en feptembre comme le far,
fon chaume a fix noeuds comme le far ; il eft plus
haut que celui de l’orge commun : il donne prodi-
gieufement de grains, 8c il a toutes les qualités
que Pline attribue au far. .Comme c’étoit l’efpece
de bled que les anciens culti voient de préférence,
il ne feroit pas étonnant que la culture en
eût multiplié les efpeces; 8c ce qui me confirme
dans mon opinion fur l’identité du far 8c de l ’écaur-
geon ou orge de prime , c’eft que Pline remarque
qu’il y avoit un far printanier, comme nous avons
nos orges de mars, 8c que les gladiateurs fe nom-
moient hordearii, parce qu’ils ne mangeoient rien
autre chofe du tems de Pline, que des bouillies
d’orgé 8c d,e far. J’ai cru devoir donner cette courte
notice des bleds des anciens, avant que de parler
des nôtres.
§ II. Bleds des modernes.
Dans le commerce on diftingue deux fortes de
bleds : i° . les bleds proprement dits, ou les gros
bleds ; 20. les petits bleds ou les menus grains.
Les gros bleds fe fement avant l’hiver, ils fe fub-
divifént en trois daffes : la première comprend
toutes les efpeces de fromens ; la fécondé celles des
feigles , 8c la troifieme qui réfulte du mélange des
deux premières claffes ; on appelle ce mélange bled
méteil ; il eft connu en Bourgogne fous le nom de
conceau, 8c Olivier de Serres dit qu’on le nomme en
Languedoc mefcle ou coffequail, en Bretagne meleard.
Vioyei M é t e il , Suppl. On coihpte encore l’épeautre
8c le riz au nombre des gros bleds.
On donne le nom de petits bleds aux grains qui fe
fement en mars, comme l’orge, les pois, la vefee,
l’avoine, &c. mais cette divifion n’eft pas exaéle
parce qu’il y a des fromens 8c des feigles printaniers
qui fe fement en mars , comme il y a des orges 8c ,
des avoines d’hiver qui fe fement en automne.
Le maïs 8c le farrazin font encore des grains auxquels
on donne le nom de bled; le premier s’appelle
bled dp Turquie ou bled d'Inde , le fécond bled,noir ;
on donne auffi le nom de bled de- vache à là graine du
melampyrum qui eft fouvent mêlée avec le froment,
8c qu’on nomme l'herbe rouge.
Il eft naturel de penfer qu’on a donné le nom de
gros bleds aux grains-fpécialement deftinés à la nourriture
de l’homme, comme le froment ,1e feigle , le
méteil, l’épeautre, le riz ; 8c celui 4e petits bleds ou
Tome /*
hiehus grains à ceux qui fervent à nourrir les animaux
; mais cette divifion eft encore incomplette 8c
arbitraire, puifque dans plufieurs provinces, comme
en Comté 8c ailleurs, le payfan eft réduit au pain
d orge 8c d’avoine, 8c fe trouve fort heureux de
pouvoir partager fa nourriture avec les chevaux.
En général, les grains farineux, c’eft-à-dire, qui
donnent de la farine, 8c dont on fait du pain , de la
bouillie ou des gâteaux pour la nourriture journalière
des hommes, font de deux fortes, les bleds 8c
les- légpmès.
Les bleds fe diftinguent i°. en gros bleds, tels que
■ les fromens, les feigles 8c les épeautres.
5 2°- En bleds étrangers, tels que le maïs ou bled
d’Inde, 8c le riz qu’on appelle bled de la Chine.
3 °; En petits bleds ou menus grains, comme l’orge;
l’avoine, le panis, le millet 8c le farrazin ou bled
noir.
Les légumes font auffi de plufieurs fortes 8c comprennent
toutes les plantes 8c racines qu’on peut
cultiver en plein champ oit dans le potager. On
donne proprement le nom de 'légumes aux graines
farineufes qui fe trou vent renfermées dans une Coffe
ou filique qu’on cueille à la main lors de la récolte
(Legumina qui à manu leguntur. ). Les vrais légumes
font les pois, les feves, les lentilles , &c.
Il eft auffi des racines farineufes dont l’art peut
trouver le fecret de faire du pain , foit en les employant
feules, foit. en les mêlant avec la farine dès
bleds proprement dits, telles font la pomme de
terre ou folanum tuberofum ; le topinambour ou
poire de terre , helianthemum tuberofum; la racine de
quelques efpecès de pieds de veau arum , les bulbes
des efpeces d’ôrchis ou de fatyrium dont on fait le
falep d’Egypte, &c.
Tous les bleds proprement dits dont je viens de
parler, ainfi que les plantes ou racines farineufes
avec lefquelles on peut les remplacer, croiffent en
France 8c peuvent s’y cultiver avec la teinture la
plus facile des pratiques de l’agriculture. Je devrois
donner ici la defeription, les efpeces, la culture,
les ûfages 8c les propriétés de chacune de ces plantes
en particulier ; mais on fent aifément que ces
détails, ferqient d’une trop longue étendue clans un
feul article ; ainfi confultez féparément les mots
Fr o m e n t , Se ig l e , Ep e a u t r e , O r g e , Av o in e -
M a ï s , R i z , Pa n i s , Mi l l e t , Sa r r a z in , &c. *
§ III. Des diverfes qualités & maladies des bleds
avant la récolte.
Tout homme qui veut fe mêler du commerce
des bleds 8c de la boulangerie, ne peut fe flatter de
réuffir, à moins qu’une longue expérience ou une
étude réfléchie qui en tiènne lieu, ne lui ait appris
les moyens de connoître les diverfes efpeces
de bleds 8c leurs qualités bonnes ou mauvaifes. Cette
connoiffance intéreflè les propriétaires de fonds qui
ont leurs revenus en grains ; les peres de famille qui
font obligés de faire cuire chez eux une grande
quantité de pain pour un nombre eonfidérablê d’en-
fans, de domeftiques, d’ouvriers ; les direfleurs des
grandes manufactures ; les économes des hôpitaux
8c maifons religieufes; les armateurs de navire 8c
négocians de bleds; les entrepreneurs des vivres,
&c. On conçoit aifément de quelle conféquence il
eft que toutes ces perfonnes fâchent connoître les
qualités des différentes fortes de grains; '(’intérêt
preffant qu’elles ont à fe pourvoir de bonnes qualités'de
grains, eftmanifefte, puifque d’un côté la
vie de ceux qu’elles doivent alimenter en dépend ,
8c que de l’autre fi la qualité du bled manque , toute
fpéculation en ce genre eft incertaine , fautive 8c
ruineufe pour celui qui l’a faite; la fanté des uns 8c
Z l z z z ij