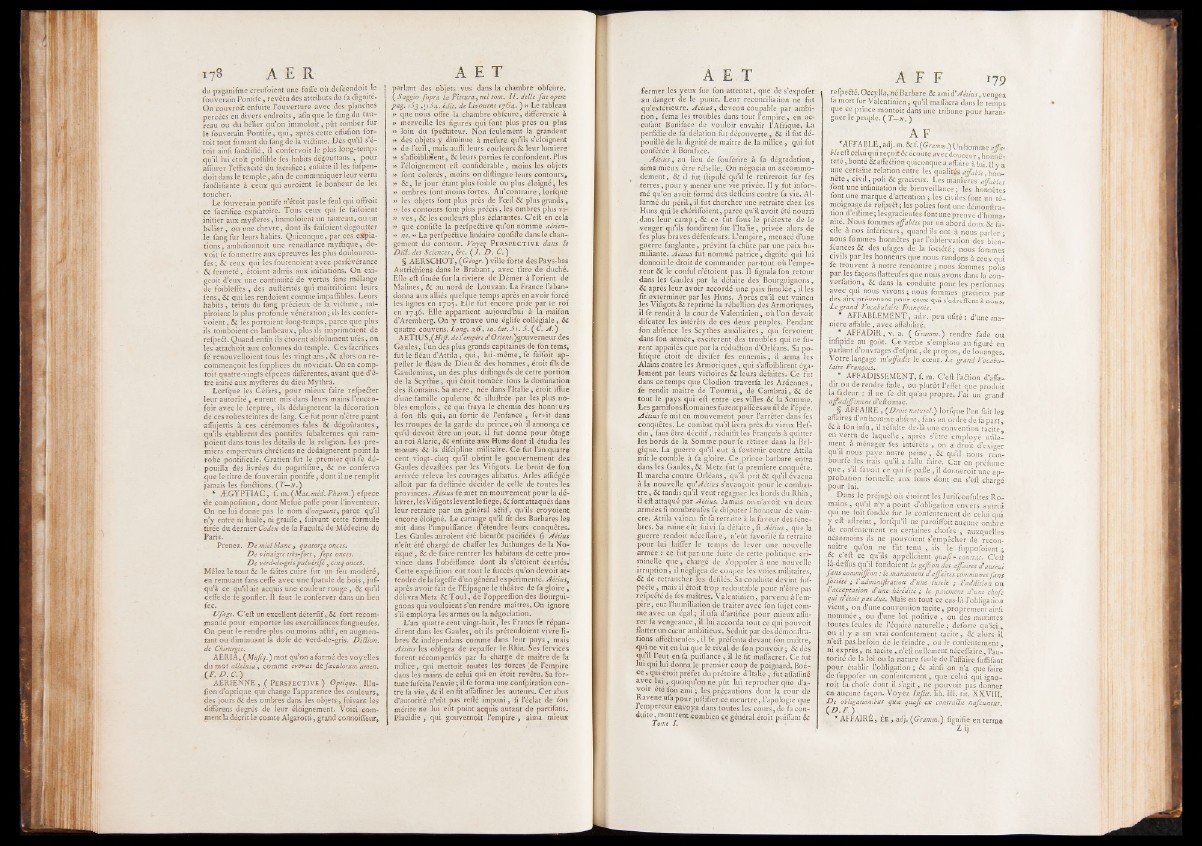
1
178 A E R
du pa'ganifme creufoient une foffe où defcendoit le
fouverain Pontife, revêtu des attributs de fa dignité.
On couvroit ënfuite l’ouverture avec des planches
percées en divers endroits, afin que le fang du taureau
ou du bélier qu’on imxnoloit, pût tomber fur
le fouverain Pontife, qui, après cette effufion for-
toit tout fumant du fang de la viâime. Dès qu’il s e -
toit ainfi fanâifié, il confervoit le plus long-temps
qu’il lui étoit poflible fes habits dégouttans , pour
affurer l’efficacité du facrifice; enfuite il les fufpen-
doit dans le temple, afin de communiquer leur vertu
fanâifiante à ceux qui auroient le bonheur de les
toucher. .
Le fouverain pontife n’etoit pas le feul qui offroit
ce facrifice expiatoire. Tous ceux qui fe faifoient
initier aux myfteres, immoloient un taureau, ou un
bélie r, ou une chevre, dont ils faifoient dégoutter
le fang fur leurs habits. Quiconque, par ces expiations,
ambitionnoit une renaiffance myftique, de-
voit fe foumettre aux épreuves les plus douloureu-
fes ; & ceux qui les foutenoient avec perfévérance
& fermeté, étoient admis aux initiations. On exi-
geoit d’eux une continuité de vertus fans mélange
de foibleflès , des aùftérités qui maîtrifoient leurs
fens, & qui les rendoient comme impaffibles. Leurs
habits, teints du fang. précieux de la viâime ., inf-
piroient la plus profonde vénération ; ils les confer-
voient-, & les portaient long-temps, parce que plus
ils tomboient én lambeaux, plus ils imprimoient de
refpeâ. Quand enfin ils étoient abfolument ufés, on
les attachoit aux colonnes du temple. Ces façrifices
fe renouvelloient tous les vingt ans, & alors on re-
commençoit les fupplices du noviciat. On en comp-
toit quatre-vingts efpeces différentes, avant que d’être
initié aux myfteres du dieu Mythra.
Lorfque les Céfars, pour mieux faire refpeâer
leur autorité, eurent mis dans leurs mains l’eucen-
foir avec le fceptre, ils dédaignèrent la décoration
de ces robes teintes de fang. Ce fut pour n’être point
-afluiettis à ces cérémonies fales & dégoûtantes,
qu’ils établirent des pontifes fubalternes qui ram-
poient dans tous les détails de la religion. Les premiers
empereurs chrétiens ne dédaignèrent point la
robe pontificale. Gratien' fut le premier qui fe dépouilla
des livrées du paganifme, & ne conferva
que le titre de fouverain pontife, dont il ne remplit
jamais les fonâibns.
* Æ G YPT IA C, f. m. {Mat.mcd. Pharm.) efpece
•de compofition, dont Mefué paffe pour l ’inventeur.
On ne lui donne pas le nom d’onguent, par ce qu’il
n’y entre ni huile, ni graiffe , fuivant cette formule
tirée du dernier ffWe* de la Faculté de Médecine de
Paris.
Prenez. De miel blanc , quatorze onces.
De vinaigre tris-fort, fept onces.
De verd-de-gris pulvéafé, cinq onces.
Mêlez le tout & le faites cuire fur un feu modéré,
en remuant fans ceffe avec une fpatule de bois, juf-
qu’à ce qu’il ait acquis une couleur rouge , & qu’il
ceffe de fe gonfler. 11 faut le conferver dans un lieu
fec. v
Ufage. C ’eft un excellent déterfif, & fort recommandé
pour emporter les excroiffarices fongueufes.
On peut le rendre plus ou moins a â i f , en augmentant
ou diminuant la dofe de verd-de-gris. Diction,
de Chirurgie.
AÉRIA, (Mujîq.) mot qu’on a formé des voyelles
du mot alléluia, comme evovac de ftzculorum amen.
f F . D . C . )
AÉRIENNE , ( Perspective ) Optique. Illusion
d’optique, qui change l’apparence des couleurs,
des jours & des ombres dans les objets, fuivant les
différens degrés de leur éloignement. Voici comment
la décrit le comte Algarotti, grand connoiffeur,
A E T
parlant des objets vus dans la chambre obfcùre.
( Saggio fopra la Pittura, ntl tom. I I . délit fue opéré
pag. 163 ,1/^4. édit, de Livourne 1764. ) « Le tableau
» que nous offre la chambre obfcure, différencie à
» merveille les figures qui font plus près ou plus
»»■ ■ loin du fpeâateur. Non feulement la grandeur
» des objets y diminue à mefure qu’ils s’éloignent
» de l’oe il, mais aufli leurs couleurs & leur lumière
» s’affoibliffent, & leurs parties fe confondent. Plus
» l’éloignement eft confidérable, moins les objets
» font colorés, moins on diftingue leurs contours,
» & , le jour étant plus foible ou plus éloigné, les
» ombres font moins fortes. Au'contraire, lorfque
» les objets font plus près de l’oeil & plus grands ,
» les contours font plus précis, les ombres plus vi-
» v e s , & les couleurs plus éclatantes. C’eft en cela
» que confifte la perfpeâive qu’on nomme aérien-
» ne. » La perfpeâive linéaire confifte dans le changement
du contour. Voye£ Perspective dans lé
Dict. des Sciences, &c. {J. D . C. )
§ AERSCHOT, (Géogr. ) ville forte des Pays-bas
Autrichiens dans le Brabant , avec titre de duché.
Elle eft fituée fur la riviere de Démer à l’orient de
Malines, & au nord de Louvain. La France l’abandonna
aux alliés quelque temps après en avoir forcé
les lignes en 1705. Elle fut encore prife par le roi
en 1746. Elle appartient aujourd’hui à la maifon
d’Aremberg. On y trouve une églife collégiale, &
quatre couvens. Long. x 6 . to.la t.S i. S. (C. A .)
AÉTIU S,{HiJl. d.e C empire d O rient.')gouverneur des
Gaules, l’un des plus grands capitaines de fon tems,
fut le fléau d’Attila, qui, lui-même, fe faifoit ap-
peller le fléau de Dieu & des hommes, étoit fils de
Gaudentius, un des plus diftingués de cette portion
de la Scythie, qui étoit tombée fous la domination
des Romains. Sa mere, née dans l’Italie, étoit iffue
d’une famille opulente & illuftrée par les plus nobles
emplois, ce qui fraya le chemin des honneurs
à fon fils qui, au fortir de l’enfance , fervit dans
les troupes de la garde du prince, où il annonça ce
qu’il de voit être un jour, lî fut donné pour otage
au roi A lafic, & enfuite aux Huns -dont il étudia les
moeurs & la difcipline militaire. Ce fut l’an quatre
çent vingt-cinq qu’il obtint le gouvernement des
Gaules dévaftées par les Vifigots. Le bruit de fon
arrivée releva les courages ab batus. Arles afliégëe
alloit par fa deftinée décider de celle de toutes les
provinces. Aétius fe met en mouvement pour la délivrer,
lesVifigots lèvent le fiege, & font attaqués dans
leur retraite ,par un général a â if , qu’ils croÿoient
encore éloigné. Le carnage qu’il fit des Barbares les
mit dans l’impuiffance d’étendre leurs conquêtes.
Les Gaules auroient été bientôt pacifiées fi Aétius
n’eût été chargé de chaffer les Juthunges de la No-
rique, & de faire rentrer les habitans de cette province
dans l’ctbéiffance dont ils s’étoient écartés.'
Cette expédition eut tout le fuccès qu’on devoit attendre
de la fageffe d’un général expérimenté. Aétiusy
après avoir fait de l’Efpagne le théâtre de fa gloire,
délivra Metz & T o u t , de l’oppreflion des Bourguignons
qui vouloient s’en rendre maîtres. On ignore
s’il employa les armes ou la négociation.
L’an quatre cent vingt-huit, les Francs fe répandirent
dans les Gaules, où ils prétendoient vivre libres
& indépendans comme dans leur p a y s , mais
Aétius les obligea de repaffer le Rhin. Ses fervices
furent récompenfés par la charge de maître de la
milice, qui mettoit toutes les forces 'de l’empire
dans les mains de celui qui en étoit revêtu. Sa fortune
fufcita l’envie ; il fe forma une confpiration contre
fa v ie , & il en fit affafliner les auteurs. Cet abus
d’autorité n’eût pas refté impuni, fi l’éclat de fon
mérite ne lui eût point acquis autant de partifans.
Placidie , qui gouyernoit l’empire > aima mieux
A E T
fermer les yeux fur fon attentat, que de s’expofer
au danger de le punir. Leur réconciliation ne fut
qu’extérieure. Aétius, devenu coupable par ambition
, fema les troubles dans tout l’empire, eh ac-
-cufant Boniface de vouloir envahir l’Afrique. La
perfidie de fa délation fut déçouverte , & il fut dépouillé
de la dignité de maître de la milice, qui fut
conférée à Boniface.
Aétius, au lieu de foufcrire à fa dégradation,
aima mieux être rébelle. On négocia un accommodement,
& il fut ftipulé qu’il fe retireroit fur fes
terres, pour y mener une vie privée. Il y fut infor-.
mé qu’on avoit formé des deffeins contre fa vie. Al-
larmé du péril, il fut chercher une retraite chez les
Huns qui le chériflbient, parce qu’il avoit été nourri
.dans leur camp ;•& ce fut fous le prétexte de le
venger qu’ils fondirent fur l’Italie, privée alors de
fes plus braves défenfeurs. L’empire, menacé d’une
. guerre fanglante, prévint fa chûte par. une paix humiliante.
Aétius fut nommé patrice, dignité qui lui
donnoit le droit de commander par-tout où l’empereur
& le conful n’étoient pas. Il fignala fon retour
dans les Gaules par la défaite des Bourguignons,
& après leur avoir accordé une paix fimulée, il les
fit exterminer par les Huns. Après qu’il eut vaincu
les Vifigots & reprimé la rébellion des Armoriques,
il fe rendit à la cour de Valentinien, où l’on devoit
difçuter les intérêts de ces deux peuples. Pendant
fon abfence les Scythes auxiliaires, qui fervoient
dans fon armée, excitèrent des troubles qui ne furent
appaifés que parla réduâion d’Orléans. Sa politique
étoit de divifef fes ennemis ; il arma les
AlainsContre les Armoriques, qui s’affoiblirent également
par leurs viâoires & leurs défaites. Ce fut
dans ce temps que Glodion traverfa les Ardennes,
fe rendit maître de Tournai, de Cambrai, & de
tout le pays qui eft entre ces villes & la Somme.
Les garnifons Romaines furentpaffées au fil de l’épée.
Aétius fe mit en mouvement pour l’arrêter dans fes
conquêtes. Le combat qu’il livra près du vieux Hef-
din, fans être décifif, réduifitles François à .quitter
les bords de la Somme pour fe rètirer dans la Belgique.
La guerre qu’il eut à foutenir contre Attila
mit le comble à fa gloire. Ce prince barbare entra
dans les Gaules, & Metz fut fa première conquête.
Il marcha contre Orléans, qu’il prit & qu’il évacua
à la nouvelle qx'Aétius s’avançoit pour le combattre
, & tandis qu’il veut regagner les bords du Rhin ,
i l eftattaqué par Aétius. Jamais on n’avoit vu deux
armées fi nombreufes fe difputer 1 honneur de vaincre.
Attila vaincu fit fâ retraite à la.faveur des téne-
bres. Sa ruine eût fuivi fa défaite , fi Aétius, que la
guerre rendoit néceflaire, n’eût favorifé fa retraite
pour lui laifler le temps de lever une nouvelle
armée : ce fut par. une fuite de cette politique criminelle
q u e , chargé de s’oppofer à une nouvelle
irruption, il négligea de couper les voies militaires,
& de retrancher les défilés! Sa conduite devint fuf-
peéte , mais il étoit trop redoutable pour n’être pas
relpè&éde fes maîtres. Valentinien, parvenu à l’empire,
eut l’humiliation de traiter avec fon fujet comme
avec un égal; il ufa d’artifice pour mieux afîù-
rer fa vengeance, il lui accorda tout ce qui pouvoit
flatter un coeur ambitieux. Séduit par des démonftra-
tioris affe&ueufes , il fe préfenta devant fon maître,
qui ne vit en lui que le rival de fon pouvoir ; & dès
qu’il l’eut en fa puiflance, il le fit maflacrer. Ce fut
lui qui lui donna le premier coup de poignard. Boé-
c e , qui étoit préfet du prétoire d’Italie , fut aflafliné
avec lu i, quoiqu’on ne pût lui reprocher que da -
voxr été fon ami ; les précautions dont la cour de
Ravene ufa pour juftifier ce meurtre, l’apologie que
l’empereur envoya dans toutes les cours, de fa conduite,
montrent combien ce général étoit puiflant &
Tome I.
A F F 179
refpefté. Occylla, né Barbare & ami d’Aétius, vengea
) mort ftir Valentinien, qu’il maflacra dans le temps
que ce prince montoit dans une tribune pour haranguer
le peuple. ( T - n . )
AF
* A F F ABLE, adj. m. & f. (Gramm.) Un homme affa
ble eft celui qui reçoit & écouté avec douceur, honnêteté
, bonté & affeûion quiconque a affaire à lui 11 y a
une certaine relation entre les qualités affable] honnête,
civil, poli & gracieux. Les maniérés affables
font une infinuation de bienveillance ; les honnêtes
font une marque d’attention ; les civiles font un témoignage
de refpeâ: ; lés polies font une dérfionftra-
tion d’eftime ; les gracieuîes font une preuve d’humanité.
Nous fommes affables par un abord doux & facile
à nos inférieurs, quand ils ont à nous parler ;
nous fommes honnêtes par l’obfervation des bien-
féances & des ufages de la fociété; nous fommes
civils par les honneurs que nous rendons à ceux qui
fe trouvent à notre rencontre ; nous fommes polis
par les façons flatteufes que nous avons dans la con-
verfation , & dans la conduite pour les perfonnes
avec qui nous vivons; nous fommes gracieux par
des airs prévenans pour ceux qui s’adreffent à nous.
Le grand Vocabulaire François.
* AFFABLEMENT, adv. peu ufité: d’une maniéré
affable, avec affabilité.
* AFFADIR, v .'a . ( Gramm.') rendre fade ou
infipide au goût. Çe verbe s’emploie au figuré en
parlant d’ouvrages d’efprit, de propos, de louanges.
Votre langage m'affadit le coeur. Le grand Vocabulaire
François..
* AFFADISSEMENT, f. m. C ’eft I’aâion d’affadir
ou de rendre fade, ou plutôt l’effet que produit
Ja fadeur : il ne fe dit qu’au propre. J’ai un grand
aff ïdiffement d’eftomac.
§ AFFAIRE , {Droit naturel.') lorfque l’on fait les
affaires d’un homme abfent, fans un ordre de fa part,
& à fon infu, il réfulte de-là une convention tacite*
en vertu de laquelle , après s’être employé utilement
à ménager fes intérêts , on a droit d’exiger
qu’il nous paye notre peine , & qu’il nous rem-
boiirfe -les frais qu’il a fallu faire. Car on préfume
que, s’il favoit ce qui fe paffe, il donneroit une approbation
formelle aux foins dont on s’eft chargé
pour lui.
Dans le préjugé où étoient les Jurifconfultes Romains
, qu’il n’y a point d’obligation envers autrui
qui ne foit fondée fur le confentement de celui qui
y eft afireint, lorfqu’il ne paroiffoit aucune ombre
de confentement en certaines chofes , auxquelles
néanmoins ils ne pouvoient s’empêcher de recon-
noître qu’on ne fût tenu , ils le; fuppofoient -
& c’eft ce qu’ils appeiloient quaji- contrat. C’eft
là-deffus qu’il fondoient la gejlion des affaires £ autrui
fans commiffion : le maniement (T affaires communes fans
fociété ■; Vadminijlration d'une tutele ; l'addition ou
l'acceptation d'une hérédité ; le paiement d'une chofe
qui n'étoit pas due. Mais en tout ce cas-là l’obligation
vient, ou d’une convention tacite, proprement ainfi
nommée, ou d’une loi pofitive , ou des maximes
toutes feules de l’équité naturelle ; deforte qu’ici ,
.ou il y a un vrai confentement tacite, & alors il
n’eft pas befoin de le feindre , ou le confentement,
ni exprès, ni tacite, n’eft nullement néceflaire, l’autorité
de la loi.ou la nature feule de l’affaire fiiffifant
pour établir ^obligation ; & ainfi on n’a que faire
de fuppofer un confentement, que celui qui igno-
roit la chofe dont il s’ag it, ne pouvoit pas donner
en aucune façon. Voyez Inftit. lib. III. tit. XXVIII.
De obligationibus quce quan. ex contraclu nafcuntur
c - 0 - * ) A * u H H
* AFFAIRE, EE, adj. {Gramm.) fignifie en terme
Z i j