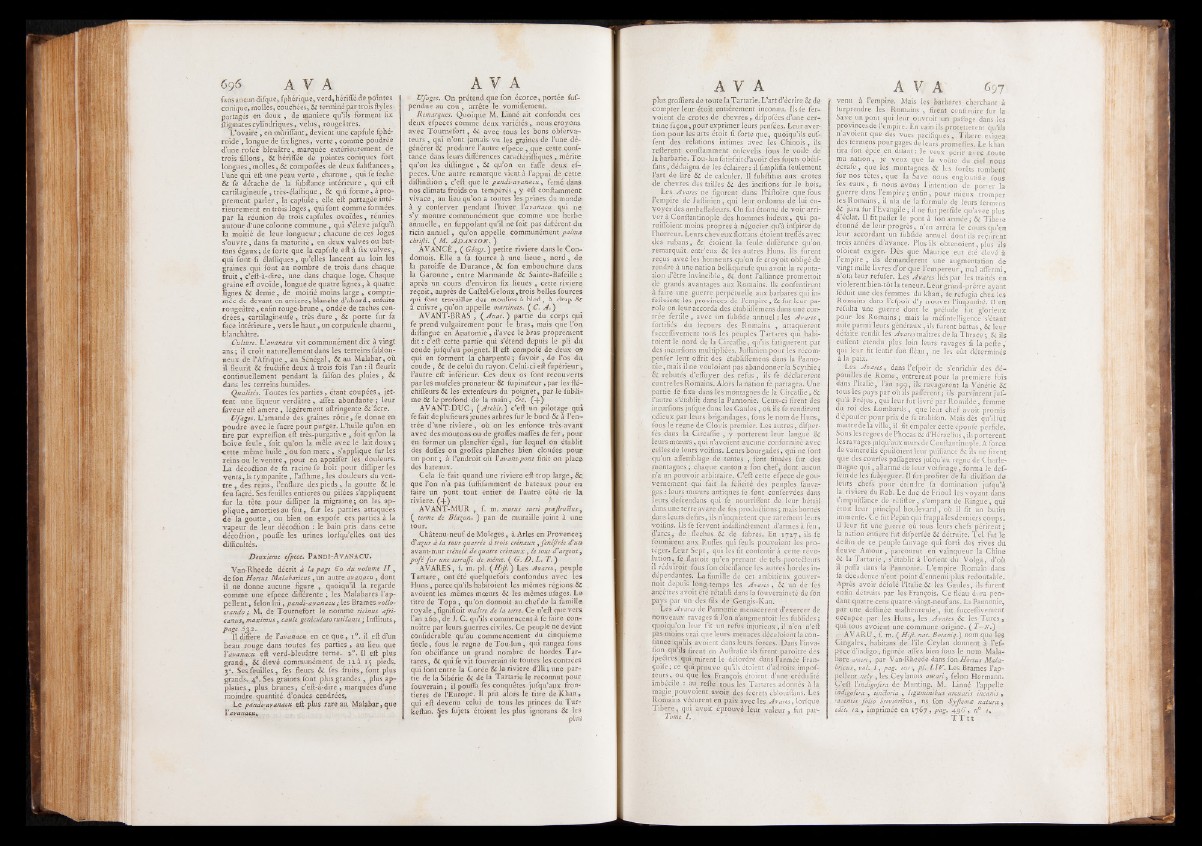
fans aucun difque, fphérique, verd, hériffé de pointes
conique, molles, couchées, & terminé par trois ftyles
partagés en deux , de maniéré qu’ils forment fix
ftigmates cylindriques , velus', rougeâtres.
L’ovaire , en mûriffant,.devient une capfule fphe-
roïde , longue de fix lignes , verte , comme poudrée
d’une rofée bleuâtre, marquée extérieurement de
trois filions, & hériffée de pointes coniques fort
longues, molles, & compofées de deux fubftances,
l ’une qui eil une peau verte, charnue , qui fe feche
& fe détache de la fubftance intérieure , qui eft
cartilagineufe, très-élaftique , & qui forme, à proprement
parler, la capfule ; elle eft partagée intérieurement
en trois loges, qui font comme formées
par la réunion de trois capfules ovoïdes, réunies
autour d’une colonne commune, qui s’élève jufqu’à
la moitié de leur longueur ; chacune de ces loges
s’ouvre , dans fa maturité, en deux valves ou bat-
tans égaux; de forte que la capfule eft à fix valves,
qui font fi élaftiques, qu’elles lancent au loin les
graines qui fönt au nombre de trois dans chaque
f ru it , c’eft-à-dire, une dans chaque loge. Chaque
graine eft ovoïde, longue de quatre lignes, à quatre
lignes & demie, de moitié moins large, comprimée
de devant en arriéré, blanche d’abord, enfuite
rougeâtre, enfin rouge-brune , ondée de taches cendrées
, cartilagineufe, très dure , & porte fur fa
face intérieure, vers le h aut, un corpulcule charnu r
blanchâtre.
Culture. Vavanacu vit communément dix à vingt
ans ; il croît naturellement dans les terreins fablon-
neux de l’Afrique, au Sénégal, & au Malabar, où
il fleurit & fruftifie deux à trois fois l’an : il fleurit
continuellement pendant la faifon des pluies , &
dans les terreins humides.
Qualités. Toutes fes parties, étant coupées , jettent
une liqueur verdâtre , allez abondante ; leur
faveur eft amere , légèrement aftringente & ’âcre.
Ufages. L’amande des graines rôtie, fe donne en
poudre avec le fucre pour purger. L’huile qu’on en
tire par expreffion eft très-purgative , foit qu’on la
boive feule , foit qu’on la mêle avec le lait doux ;
■ cette même huile , ou fon marc » s’applique fur les
reins ou le ventre , pour en appaifër les; douleurs.
La décoûion de fa racine fe boit pour diffiper les
vents, la tympanite , l’afthme, les douleurs du ventre
, des. reins, l’enflure des pieds , la goutte & le
feu facré. Ses feuilles entières ou pilées s’appliquent
fur la tête pour diffiper la migraine; on les applique
, amorties au feu, fur les parties attaquées
de“ la goutte, ou bien on expofe ces parties à la
vapeur de leur déco&ion : le bain pris dans cette
décoâion , pouffe les urines lorfqu’elles ont des
difficultés.
Deuxieme efpece. Pandi-Avanacu.
Van-Rheede décrit à la page Go du volume I I ,
de fon Hortus Malabaricus , un autre avanacu, dont
il ne donne aucune figure , quoiqu’il la regarde
comme une efpece différente ; les Malabares l ’appellent,
félon lui, pandi-avanacu ; les Brames vollo-
erando ; M. de Toürnefort le nomme ricinus afri-
canttSymaximus, caule geniculato rutilante ; Inftituts,
page 532.
Il différé de Vavanacu en ce que, i° . il eft d’un
beau rouge dans toutes fes parties , au lieu que
Vavanacu eft verd-bleuâtre terne. 20. Il eft plus
grand, & élevé communément de 12 à 15 pieds.
30. Se&feuilles, fes fleurs & fes fruits, font plus
grands.. 40. Ses graines font plus grandes , plus ap-
platies , plus brunes, c’eft-à-dire , marquées d’une
moindre quantité d’oncles cendrées.
Le pandi-avanacu eft plus rare au Malabar, que
l'avanacu»
Ufages. On prétend que fon écorce, portée fuf-
pendue au c o u , arrêté le vomiffement.
Remarques. Quoique M. Linné ait confondu çes
deux éfpeces comme deux variétés » nous.croyons
avec Toürnefort, & avec tous les bons obferva-
teurs , qui n’ont jamais vu les graines de l’unè dégénérer
& produire l’autre efpece , que cette,confiance
dans, leurs différences cara&ériftiques , mérite
qii’on les diftingue , & qu’on en faffe deux ef-
peces. Une autre remarque vient à l’appui de cette
diftin&ion ; c’eft que le pandi-avanacu, femé dans
nos climats froids ou tempérés , y eft conftamment
vivace, au lieu qu’on a toutes les peines du monde
à y conferver pendant l’hivef Vavanacu qui ne
s’y montre communément que comme une herbe
annuelle, en fuppofant qu’il ne foit pas diftérent du
ricin annuel, qu’on appelle communément palma
chrijli. ( M. A d a n s o n . )
AVANCÉ , ( Géogr. ) petite riviere dans le Con-
domois. Elle a fa fource à une lieue , nord, de
la paroiffe de Durance, & fon embouchure dans
la Garonne , entre Marmande & Sainte-Bafeille :
après un cours d’environ fix lieues , cette riviere
reçoit, auprès de Caftel-Geloux,trois belles fources
qui font travailler des moulins à bled, à drap &
à cuivre, qu’on appelle martinets. ( C. A . )
AVANT-BRAS , ( Anat. ) partie du corps qui
fe prend vulgairement pour le bras, mais que l’on
diftingue en Anatomie , d’avec le bras proprement
dit : c’eft cette partie qui s’étend depuis le pli du
coude jufqu’au poignet. Il eft compofé de deux 09
qui en forment la charpente ; favoir , de l’os du
coude , & de celui du rayon. Celui-ci eft fupérieur ,
l’autre eft inférieur. Ces deux os font recouverts
par les mufcles pronateur & fupinateur, par les fié—
chiffeurs & les extenfeurs du poignet, par lefubli-
me & le profond de la main, &c. (+ )
AVANT-DUC, ( Archit.) c’eft un pilotage qui
fe fait de plufieurs jeunes arbres fur le bord & à l’entrée
d’une riviere, où on les enfonce très-avant
avec des moutons ou de groffes maffes de fer, pour
en former un plancher égal, fur lequel on établit
des doffes ou groffes planches bien clouées pour
un pont ; à l’endroit où Vavant-pont finit on placo
des bateaux.
Cela fe fait quand une riviere eft trop large, 8c
que l’on n’a pas fuffifamment de bateaux pour en
faire un pont tout entier de l’autre côté de la
riviere. (+ )
AVANT-MUR , f. m. murus turri pmflructus,
( terme de Blason. ) pan de muraille joint à une
tour.
Château-neuf de Moleges, à Arles en Provence ;
d’û£«r à la tour quarrée a trois crénaux, fenéjirée (Cuti
avant-mur crénelé de. quatre crénaux, le tout d'argent,
pofé fur une terrajfe de même. ( G. D. L. T. )
AVARES, f. m. pl. ( Hifl. ) Les A v a re s , peuple
Tartare, ont été quelquefois confondus avec les
Huns , parce qu’ils habitoient les mêmes régions &
avoient les memes moeurs, & les mêmes ufages. Le
titre de Topa , qu’on donnoit au chef de la famille
royale, fignifioit maître de la terre. Ce n’eft que vers
l’an 260, de J. C. qu’ils commencent à fe faire con-
noître par leurs guerres civiles. Çe peuple ne devint
confidérable qu’au commencement du cinquième
fiecle, fous le régné deTou-lun, qui rangea fous
fon obéiffance un grand nombre de hordes Tar-
tares, & quife vit fouverain de toutes les contrées
qui font entre la Corée & la riviere d’Ili ; une partie
de la Sibérie & de la Tartarie le reconnut pour
fouverain; il pouffa fes conquêtes jufqu’aux frontières
de l’Europe. Il prit alors le titre de Khan,
qui eft devenu celui de tous les princes du Tur-
keftan. Ses fujets étoient les plus ignorans 8c les
* plus
A V A
plus greffiers de toute la Tartarie. L’art d’écrire & de
compter leur étoit entièrement inconnu. Ils fe fer-
voient de crotes de chevrès, difpofées d’une certaine
façon,pour exprimer leurs penfées. Leuraver-
fion pour les arts étôit fi forte que, quoiqu’ils euf-,
fent des relations intimes avec les Chinois, ils
refterent conftamment enfevelis fous le voile de'
la barbarie. Tou-lunfatisfait d’avoir des fujets obéif-
fans» dédaigna de les éclairer: il Amplifia feulement
l’art de lire & de calculer. Il fubftitua aux crotes
de chevres des tailles & des, incifions fur le bqis.
Les Avares’ ne figurent dans l’hiftoire que fous
l’empire de Juftinien, qui leur ordonna de lui envoyer
des ambaffadeurs. On fut étonné de voir arriver
à Conftantinople dés hommes hideux, qui pa-
roifloient moins propres à négocier qu’à infpirer de
l’horreur. Leurs cheveux flottans étoient treffés avec
des rubans, & étoient la feule différence qu’on
remarquât, entr’eux & les autres Huns. Ils furënt
reçus avec les honneurs qu’on fe croyoit obligé de
rendre à une nation belliqueufe qui avoit la réputation
d’être invincible, & dont l’alliance promettoit
de grands avantages aux Romains. Ils confentirent
à faire une guerre perpétuelle aux barbares qui in-
feftoient les provinces de l’empire, & fiir leur parole
on leur accorda des établiffémens dans une contrée
fertile, avec un fubfide annuel : les Avares,
fortifiés du fecours des Romains , attaquèrent
fuccëffivement tous les peuples Tartares qui habitoient
le nord de la Circaffie „ qu’iis fatiguèrent par
des incurfions multipliées. Juftinien pour les récom-
penfer leur offrit des établiffemens dans la Pannonie
, mais il ne vouloient pas abandonner la Scy thie ;
& rebutés d’efluyer des refus , ils fe déclarèrent
contre les Romains. Alors la nation fe partagea. Une
partie fe fixa dans les montagnes de la Circaffie, &
l’autre s’établit dans la Pannonie. Ceux-ci firent des
incurfions jufquedans les Gaules, où ils fe rendirent
odieux par leurs brigandages, fous le nom de Huns,
fous le régné de Clovis premier. Les autres , difper-
fés dans la Circaffie , y portèrent leur langue &
leùrsmoeurs, qui n’a voient aucune conformité avec
.celles de leurs voifins. Leurs bourgades, qui ne font
qu’un affemblage de tentes , font fituées fur des
montagnes ; chaque canton a fon chef, dont aucun
n’a un pouvoir arbitraire. C’eft cette efpece de gouvernement
qui fait la félicité des peuples fauva-
ges : leurs moeurs antiques fe font confervées dans
leurs defeendans qui fe nourriffent de leur bétail
flans une terre avare de fes produirions ; mais bornés
dans leurs defirs, ils n’inquietent que rarement leurs
voifins. Ils fe fervent indiftinttement d’armes à feu,
d’ares, de fléchés & de fabres. En 1727, ils fe
fournirent aux Ruffes qui fe;uls pouvoient les protéger.
Leur Sept, qui les'fit conlèntir à cette révolution,
fe.flattoit qu’en prenant de tels protecteurs
il réduiroit fous fon obéiflànce les autres hordes indépendantes.
La famille de cet ambitieux gouver-
noit depiiis long-temps les Avares , & un de fes
ancêtres avoit été rétabli dans la fouveraineté de fon
pays par un des fils de .Gengis-Kan.
■ Les Avares de Pannonie menacèrent d’exercer de
nouveaux ravages fi l’on n’augmentoit les fubfides;
quoiqu’on leur fît un refus injurieux, il n’en n’eft
pas moins vrai que leurs menaces déceloiènt la confiance
qu’ils avoient dans leurs forces. Dans l’inva-:
fion qu ils firent en Auftrafie ils firent paroître des
fpeCtrës qui.mirent le défordre dans l’armée Fran-
çoife; ce qui prouve qu’ils étoient d’adrOits impof-.
leurs, ou que les François étoient d’une crédulité
imbécile : au^ refte tous les Tartares adonnés à la
magie pouvoient avoir des fecrets éblouiffans. Les
Romains vécurent en paix avec les Avares, lorfque
Tibère, qui avoit éprouvé leur valeur, fut par-
' Tome I . ' ' ' • ' ' " * '
A V A 697
venu à l’empire. Mais les barbares cherchant à
furprendre les Romains , firent conftruire fur la
; Save un pont qui leur onvroit un paftâge dans les
provinces de l’empire. En vain ils protelterem qu’ils
n avoient que des vues pacifiques, Tibere exigea
des fermens^ pour gages de leurs promeft'es. Le khan
tira fon epee en dilant: Je veux périr avec -toute
pia nation, je veux que la voûte du ciel nous
éçrafë, que les montagnes. & les forêts tombent
fur nos têtes, que la Save nous engloutifi'e fous
fes eaux, fi nous avons l'intention de porter la
guerre dans l’empire; enfin, pour mieux tromper
les Romains, il ula de la formule de leurs fermens
jura fur l’Evangile ; il ne fur perfide qu’avec plus
d eclat. Il fit paffer le pont à fon armée; & Tibere
étonné de leur progrès, n’en arrêta le cours qu’en
leur accordant un fubfide annuel dont ils reçurent
. trois années d’avance. Plus ils obtenoient, plus ils
ofoient exiger. Dès que Maurice eut été élevé à
l’empire , ils demandèrent une augmentation de
vingt mille livres d’or que l’empereur, mal affermi,
n’ofa leur refufer. Les Avares liés par les traités ea
violèrent bien-tôt la teneur. Leur grand-prêtre ayant
-féduit une des femmes du khan, fe réfugia chez les
Romains dans l’efpoir d’y trouver l’impunité. Il en
refulta une guerre dont le prélude fut glorieux
pour les Romains; mais laméfintelligehce‘s’étant
mile parmi leurs généraux, ils furent battus, & leur
défaitë rendit les Avares maîtres de la Thrace ; & ils
euffenV étendu plus, loin leurs ravages fi la pefte ,
qui leur fit fentir fon fléau, ne lès eût déterminés
à la paix.
Lps Avares, dans l’efpoir de s’enrichir des dépouilles
de Rome, entrèrent pour la première fois
dans l’Italie,' l’an 1 9 9 , ils ravagèrent la Vénétie &
tous les pays par où ils pafferent ; ils parvinrent jufi-
qu à Fréjus, qui leur fut livré par Romilde, femme
du roi des Lombards , que leur chef avoit promis
d’époufer pour prix de fatrahifon. Mais dès qu’ilfut
maitrede la ville, il fit empaler cette époufe perfide.
Sous les régnés de Phocas ôi d’Héraclius, ils portèrent
tes rayages jufqu’aux murs'dé Conftantinople. A force
de vaincre’ils épuiloient leur püifiance & ils ne firent
que des courfés paffageres jufqu’au regne de Charlemagne
qui, allarmé de leur voifinage, forma le def-
fèin de les fubjùguer. Il fut profiter de la divifion de
leurs chefs pour étendre fa domination jufqu’à
la. riviere du R ab. Le duc de Frioul les voyant dans
i’jmpuiflance de réfifter, s’empara de Ringue, qui
étoit leur principal boulevard, où il fit un butin
immenfe. Ce fut Pépin qui frappâtes derniers coups.
■ il leur fit une guerre où toits leurs chefs périrent ;
la nation entière fut difperfée & détruite. T el fut le
deftin.de ce peuple fauvage qui forti dès rives dit
fleuve Amour, parcourut en vainqueur la Chine
& la Tartarie, s’établit à l’orient du Volga , d’où
il paffa dans la Pannonie. L’empire Romain dans
fa décadence n’eut point d’ennemi plus redoutable.
Après avoir défolé l’Italie & les Gaules, ils furent
enfin détruits par les François. Ce fléau dura pendant
quatre cens quatre-vingt-neuf ans. La Pannonie,
par une deftinée malheureufe , fut fuceeffiveinent
occupée par leSi Huns, les Avares 8c les Turcs ,
qui tous avoient une commune origine. ( T—n .')
AV A RU, f. m. ( Hiß. nat. Botaniq.') nom que les
Cingales, habitans de l’île Ceylan donnent à ,1’ef-
p;ece'd’indigo, figurée affez bien fous le nom Mala-
bare atneripar Van-Rheede dans fon -Hortus Mala-
bricus, vol. I , pagi 101 », pl.. LIF. Les Brames l’appellent
nefy , les. Ceyianois awari, félon Hermann.
Ç’eft Vindigofera de Munting. M. Linné l’appelle
indigo fer a , tincloria , leguminibus arcuatis incanis ,
racentis folio brevioribus, ns fon Syßemce natura,
edit. tu , imprimée en 176 7 , pag. 49G, n° /,
; T T t t