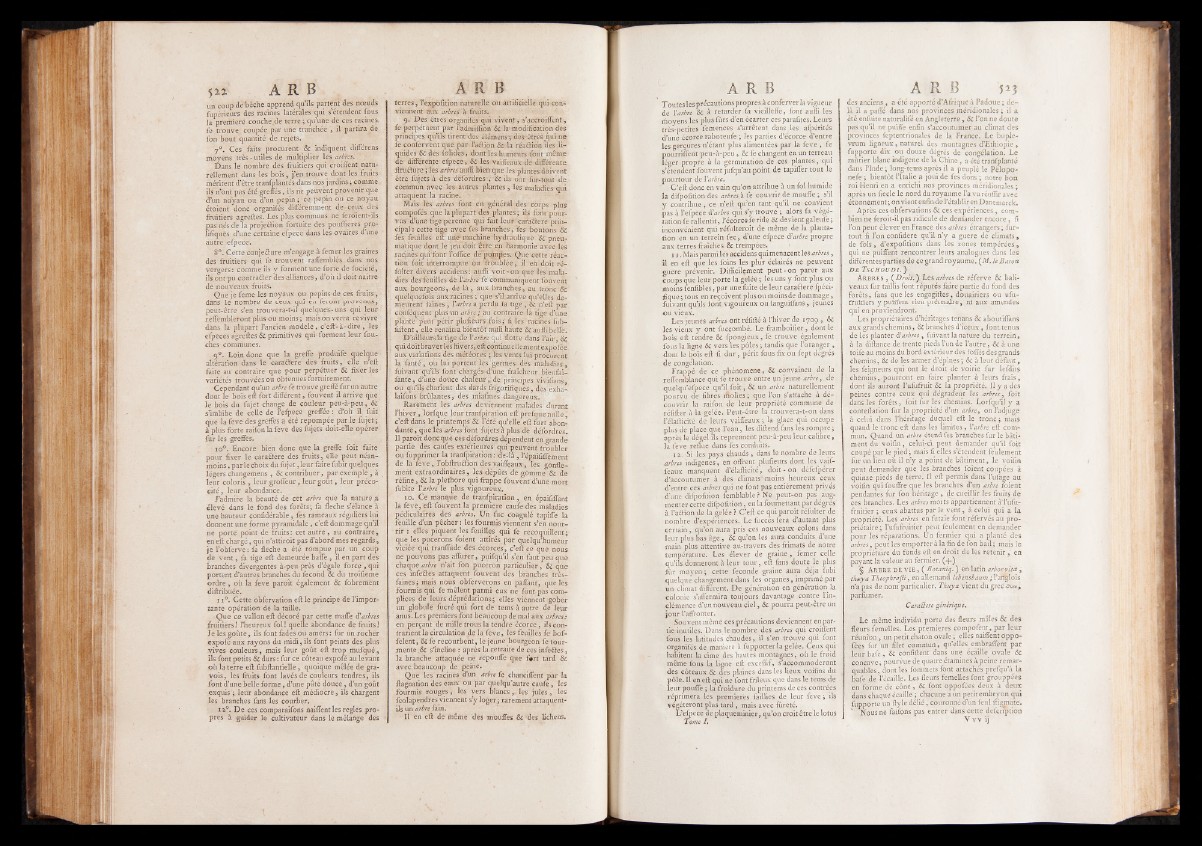
un coup de bêche apprend qu’ils partent des noeuds
fupérieurs des racines latérales qui s'étendent fous
la première couche.de terre; qu’une dé ces racines,
fe trouve coupée par une tranchée , il partira de
fon bout quantité de remets.
7°. Ces faits procurent & indiquent différens
moyens très - utiles de multiplier les arbres.
Dans le nombre des fruitiers qui croiffent naturellement
dans les bois, jlen .trouve dont les,fruits
méritent d’être tranfplantés dans nos jardins ; comme
ils n’ont pas été greffés, ils ne peuvent provenir que
d’un noyau ou d’un pépin ; ce pépin ou ce noyait
étoient donc organifés différemment de- ceux des
fruitiers agreftes. Les plus communs ne feroient-ils
pas nés de là projefrion fortuite des pouffieres prolifiques
d’une certaine efpeee dans les ovaires d’une
autre efpeee. . '
8°: Cette conjecture m’engage à femer les graines
des fruitiers qui fe trouvent raffemblés dans nos
vergers : comme ils y forment une forte de fociété,
ils ont pu contracter des' alliances, d’où il doit naître
dè nouveaux friiitSi 1 *•/
Que je feme les noyaux ou pépins de ces fruits:,-
dans le nombre de ceux qui en feront provenus,
peut-être s’en trouvera-t-il quelques-uns qui leur
reffembleront plus ou moins ; mais on verra revivre
dâns la plupart l’ancien modelé, c-’èft-à-dire, les
efpeces agreftes & primitives qui-forment leur fou-
ches- communes.
9°. Loin donc que la greffe produife quelque
altération dans le caraCtere des fruits, elle n’eft
faite au" contraire que pour perpétuer & fixer lès
variétés trouvées ou obtenues fortuitement.
Cependant qu’un arbre fe trouve greffé fur un autre
dont le bois eft fort différent, fouvent il arrive quej
le bois du fujet change de couleur peu-à-peu, &
s’imbibe de celle de l’efpece greffée : d’où il fuit
que la feve des greffes a été repompée par le fujet;
à plus forte raifon la feve des fujets doit-elle opérer
fur les greffés.
io ° . Encore bien donc que la greffe foit faite
pour fixer le caractère des fruits, elle peut néanmoins
, par lé choix du fujet, leur faire fubir quelques
légers changemens , & contribuer, par exemple , à
leur coloris , leur groffeur, leur goût, leur précocité,
leur abondance.
J’admire la beauté de cet arbre que la nature ,a
élevé dans le fond des forêts; fa fléché s’élance à
une hauteur confidérable, fes rameaux réguliers lui
donnent une forme pyramidale, c’eft dommage qu’il
ne porté point de fruits: cet autre, au contraire,
en eff chargé, qui n’attiroit pas d’abord mes regards,
je l’obferve: fa fléché a été rompue par un coup
de vent, fa tige eff demeurée baffe , il en part des
branches divergentes à-peu-près d’égale force , qui
portent d’autres branches du fécond & du troifieme
ordre, où la feve paroît également & fobrement
diftribuée.
11°. Cette obfervation eff le principe de l’importante
opération dé la taille.
Que ce vallon eff décoré par cette maffe ÿarbres
fruitiers ! l’heureux fol ! quelle abondance de fruits !
Je les goûte, ils font fades ou amers: fur un rocher
expofe aux rayons du midi, ils font peints des plus
vives cpuleurs, mais leur goût eff trop mufqué,
ils font petits & durs : fur ce coteau expofé au levant
oii la terre eff fubftantielle, quoique mêlée de gra-
vo is , les fruits font lavés de couleurs tendres, ils
font d’une belle forme, d’une pâte douce , d’un goût
exquis ; leur abondance eff médiocre, ils chargent
lès branches fans les courber.
i i ° . De ces comparaifons naiffent les réglés propres
à guider le cultivateur dans le mélange des
terres, l’expofition naturelle ou artificielle qui conviennent
aux 'arbres à fruits.
9. Des: êtres, organifés qui vivent1, Vaccroiflcnt,
fe perpétuent par l’admiffion & la; modification des
principes ■ qu’ils" tirent-des élëmens ; des'êtrei^ui ne
fè confervént que par l’a&ion & la réa&ioh'cles'liquides
■ &: des folides, dont les humeurs font même
de différente efpeee, & les vaiffeàüx de différente
ffru&ure ;les arbres'zaiü bien que: les plàntës:dôivent
être fujétS à des d é fo rd r e s& ils onr fur-tout de
commun avec les antres plantes, les maladies qui
attaquent la racine.
Mais les arbres font en général des corps plus
Gompofés que la plupart des plantes ; ils font pourvus
d ’une tige pérenne qui fait leur carafrere principal:
cette tige avec fes branches, fes boutons &
fes feuilles eff une machine hydraulique ÔT pneumatique
dont le jeu dôitHêtre en Harmonie"avec les
raejnes qui‘font l’office dè: pompas. Que cette réaction
foit interrompue" ou "troublée ; il eù doit rë-
fùlter divers accidens: auffi voit-on que lés .maladies"
des feuilles dè Yarbre"fè' communiquenrfoU vent
aux bourgeons, de là , aux branches, au tronc &
quelquefois aux racines ; q.uers’il arrive qu’elles demeurent
faines, Yarbre a perdu fa tige, & h’eff par
cqnféqiient'plus un arbre ; àu contraire là tige d’dne
plante périt" périr plufiéurs fois;1 ii les ratinesTub-
fiftent, elle renaîtra biénfot auffi hàute & auffi.belie.
D ’ailleurs la tige d!e l’flrôr^qui flotte dansTâir, <8c
qui doit Braver les hivers,;èff continuellement expoféè
aux Variations des météores'; lès vents lui procurent,
là fànte, ou lui portent les germes des maladies,
fuivant qù’ilS' font chargésidune fraîcheur bienfai-
fânte, d’une doiice dfislèüf;; de. principes vivifians,
ou qu’ils chariënt des dards frigprifiques, dés ëxhà-
laifons Brûlantes, des miafrîies" dange'reux.
Rareménr les arbres deviennent malades durant
l’h iver, lorfque leur tranfpiration eff prefqtiè mille |
c’eft dans le printemps & f ete qu’elle eff fort abondante
, qùe'les arbres font fujets à plus de défordres.
Il paroît donc que ces défor.dres dépendent en grande
partie dés caufes extérieures qui peuvent troubler
ou fiipprimer la tranfpifatiôn : dè-là , l’épaififfement
dé la f è v e l ’obftru&ion des vaiffeaux, lés gonflement
extraordinaires, les dépôts de gomme & de
réfine, & la pléthore qui frappe fouvent d’une mort
fiihite Yarbre le plus vigoureux.
10. Ce manque de tranfpiration, en épaififfant
la fève, eff fouvent la première caufe des maladies
pédiculaires des arbres. Un fuc coagulé tapiffe la
feuille d’un pêcher : les fourmis viennent s’en nourrir
: elles'piquent les feuilles qui fe recoquillent;
que les pucerons foient attirés par quelqu’humeur
viciée qui tranffüde dès écorces, c’eft cé que nous
ne pouvons pas affurer, puifqu’il s’en faut peu que
chaque arbre n’ait fon puceron particulier , & qùe
ces inféfrés attaquent fouvent des branches ires-
faines; mais nous obferverons en paffant , que les
fourmis qui fe mêlent parmi eux ne font pas complices
de leurs déprédations.; elles viennent gober
un globule fucré qui fort de tems à autre de leur
anus. Les premiers font beaucoup de mal aux arbres:
en perçant de mille trous la tendre ëcorce, ils contrarient
la circulation de la feve, lés feuilles fe bof-
felent, & fe recourbent, le jeune bourgéon fe tourmente
& s’incline : après la-retraite de ces infe&es,
la branche attaquée ne repouffe que fort tard &
avec beaucoup de peiné.
Que les racines d’un arbre fe chanciffent par la
ftagnation des eaux ou par quelqu’autre caufe, les
fourmis rouges, les vers blancs, les jules, les
fcolapendres viennent s’y loger; rarement attaquent-
ils un arbre fain.'
11 en eff de même des mouffes 6c des lichens.
Toutes les précautions propres à conferver la vigueur j
de Yarbre 6c à retarder fa vieilleffe, font auffi les
moyens les plus fûrs d’en écarter ces parafites. Leurs
très-petites femences s’arrêtent dans .les afpérités
d’une écorce raboteufe ; les parties d’écorce d’entre
les gerçures n’étant plus alimentées par la feve , fe
pourfiffent peu-à-peu, & fe changent en un terreau
léger propre à la germination de ces plantes, qui
s’étendent fouvent jufqu’au point de tapiffertout le
pourtour de Yarbre.
C ’eft donc en vain qu’on attribue à un fol humide
la difpofition des arbres à fe couvrir de moufle ; s’il
y contribue, ce n’eft qu’en tant qu’il ne convient
pas à l’efpece 6? arbre qui s’y trouve ; alors fa végétation
fe rallentit, l’écorce fe ride & devient galeufe ;
inconvénient qui réfulteroit de même de la plantation
en un terrein fec, d’une efpeee d'arbre propre
aux terres fraîches & trempées.
11. Mais parmi lés accidens qui menacent les arbres,
il en eff que les foins les plus éclairés ne peuvent
guere prévenir. Difficilçment peut- on parer aux
coups que leur porte la gelée ; les uns y font plus ou
moins fenfibles, par une fuite de leur cara&ere fpéci-
fique ; tous en reçoivent plus ou moins de dommage,.
fuivant qu’ils font vigoureux ou languiffans, jeunes
ou vieux. ? - .'y ■ . •
Les jeunes arbres ont réfifté à l’hiver de 1709 , &
les vieux y ont fuccombé. Le framboifier, dont le
bois eff tendre & fpongieux, fe trouve également
fous la ligne & vers les pôles ; tandis que l’oranger ,
dont le bois eff fi dur, périt fous fix ou fept degrés
de congélation.
Frappé de ce phénomène , & convaincu de la
reffemblance qui fe trouve entre un jeune arbre, de
quelqu’efpece. qu’il foit, & un arbre naturellement
pourvu de fibres ffiolles ; que l’on s’attache à découvrir
la raifon do leur propriété commune de
réfifter à la gelée. Peut-être la trouvera-t-on dans
î’élafticité de leurs vaiffeaux; la glace qui occupe
plus de place que l’eàu, les diftend fans les rompre ;
après le dégel ils reprennent pe.u-à-peu leur calibre,
la feve reflue dans' fes conduits.
12. Si les pays chauds , dans le nombre de leurs
arbres indigènes, en offrent plufiéurs dont les vaiffeaux
manquent d’élafticite, doit-on defelperer
d’accoutumer à des climats* moins heureux ceux
d’entre ces arbres qui ne font pas entièrement priyés
d’une difpofition lemblable ? Ne peut-on pas augmenter
cette difpofition, en la foumettant par degrés
à l’afrion de la gelée ? C’eft ce qui paroît réfulter de
nombre d’expériences. Le fuccès fera d’autant plus
certain , qu’on aura pris ces nouveaux colons dans
leur plus bas âge, & qu’on les aura conduits d’une
main plus attentive au-travers des frimats de notre
température. Les élever de graine, femer celle
, qu’ils,donneront à leur tour, eft fans doute le plus
fur moyen ; cette fécondé graine aura déjà fubi
quelque changement dans les organes, imprimé par
un climat différent. De génération en génération la
colonie s’affermira toujours davantage contre l’inclémence
d’un nouveau c iel, & pourra peut-être un
jour l’affronter. ■
Souvent même ces précautions deviennent en partie
inutiles. Dans le nombre des arbres qui croiflent
fous les latitudes chaudes, il s’en trouve qui font
organifés de maniéré à fupporter la gelée. Ceux qui
habitent la cime des hautes montagnes, où le froid
même fous la ligne eft exceffif, s’accommoderont
des coteaux & des plaines dans les lieux voifins du
pôle. Il en eft qui ne font frileux que dans le tems de
leur pouffe ; la froidure du printems de ces contrées
réprimera les premières faillies de leur feve ; ils
végéteront plus tard, mais avec fureté.
L’efpece de plaqueminier, qu’on croit être le lotus
Tome ƒ,
des anciens , a été apporté d’Afrique à Padoue ; delà
il a paffé dans nos provinces méridionales ; il a
été enfuite naturalife en Angleterre, & l’on ne doute
pas qu’il ne puifîe enfin s’accoutumer au climat des
provinces feptentrionales de la France. Le buple-
vrum ligneux, naturel des montagnes d’Ethiopie,
fupporte dix ou douze dégrés de congélation. Le
mûrier blanc indigène de la Chine, a été tranfplanté
dans l’Inde ; long-tems après il a peuplé le Pèlopo-
nefe ; bientôt l’Italie a joui de fes dons ; notre boa
roi Henri en a enrichi nos provinces méridionales ;
après un fiècle le nord du royaume l’a vuréuffir avec
étonnement ; on vient enfin de l’établir en Danemarck.
Après ces obfervations & ces expériences , combien
ne feroit-il pas ridicule de demander encore , fi
l’on peut élèver en France des arbres étrangers ; fur-
tout fi l’on confidere qu’il n’y a guere de climats,
de fols, d’expofitions dans les zones tempérées,
qui ne puiffent rencontrer leurs analogues dans les
différentes parties de ce grand royaume. (AL le Baron
d e T s c h o u d i .')
A r b r e s , (Droit. ) Les arbres de réferve & baliveaux
fur taillis font réputés faire partie du fond des
forêts, fans que les engagiftes, douaniers ou usufruitiers
y puiffent rien prétendre, ni aux amendes
qui en proviendront.
Les propriétaires d’héritages tenans & aboutiffans
aux grands chemins, & branches d’iceux, font tenus
de les planter arbres , fuivant la nature du terrein,
à la diftance de trente pieds l’un de l’autre, & à une
toife au moins du bord extérieur des foffés des grands
chemins, & de les armer d’épines ; & à leur défaut,
les feigneurs qui ont le droit de voirie fur lefdits
chemins, pourront en faire planter à leurs frais,
dont ils auront l’ufufruit & la propriété. Il y a des
peines contre ceux qui dégradent les arbres, foit
dans les forêts, foit fur les chemins. Lorfqu’il y a
conteftation fur la propriété d’un arbre, on l’adjuge
à celui dans l’héritage duquel eft le tronc ; mais
quand le tronc eft dans les limites, Yarbre eft commun.
Quand un’ arbre étend fes branches fur le bâtiment
du" voifin, celui-ci peut demander qu’il foit
coupé par le pied ; mais fi elles s’étendent feulement
fur un lieu oïi il n’y a point de bâtiment, le voifin
peut demander que les branches foient coupées à
quinze' pieds de terre. Il eft permis dans l’ufage au
voifin qui fouffre que les branches d’un arbre foient
pendantes fur fon héritage , çlecueillir les fruits de
ces branches. Les arbres morts appartiennent à i’ufu-
fruitier ; ceux abattus par le vent, à celui qui a la
propriété. Les arbres en futaie font réferves au propriétaire
; l’ufufruitier peut feulement en demander
pour les réparations. Un fermier qui a planté des
arbres, peut les emporter à la fin de fon bail ; mais le
propriétaire du fonds eft en droit de les retenir , en
payant la valeur au fermier. (+ )
§ A r b r e de V IE , ( Botaniq. ) en latin arbonyitee ,
thuya Theophrajli, en allemand lebtnsbaum /l’an'glois
n’a pas de nom particulier. Thuya vient du grec-3-w»,
parfumer.
Caractère générique.
Le même individu porte des fleurs mâles & des
fleurs femelles. Les premières compofent, par leur
réunion, un petit chaton ovale ; elles naiffent oppo-
fêes fur un filet commun, qu’elles embraffent par
leur bafe., & confident dans une écaille ovale 6c
concave, pourvue de quatre étamines à peine remarquables,
dont les fommets font attachés prefqu’à la
bafe de l’écaille. Les fleurs femelles font grouppées
en forme dé cône, & font oppofées deux à deux
dans chaqué écaille; chacune a un petit embryon qui
fupporte un ftyle délié, couronné d’un feul ftigmate.
' Nous ne faifons pas entrer dans cette deferiptiors
y w îj
j