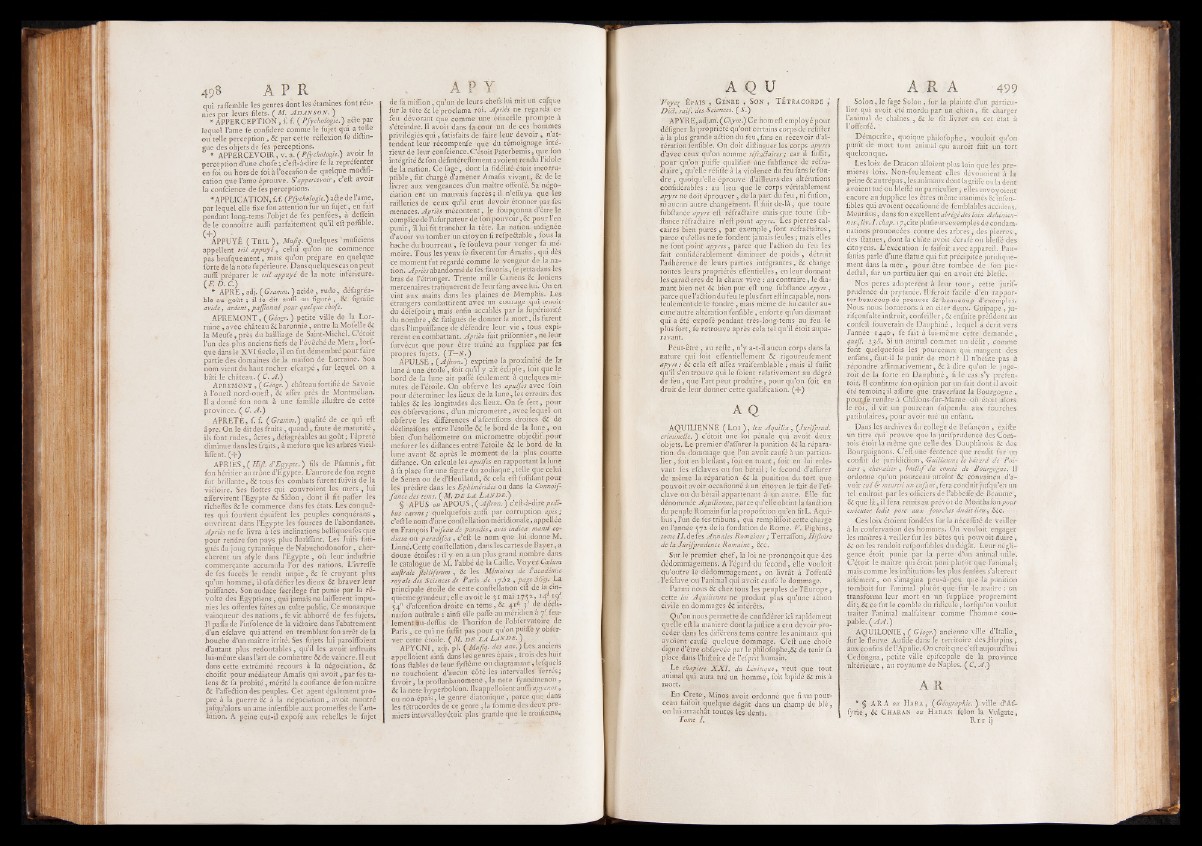
qui raffemble les genres dont les étamines font reunies
par leurs filets. (M . A d a n s o n . )
* APPERCEPTION, f. f. ( Pfychologie.) afte par
lequel l’ame fe confidere comme le fujet qui a telle
ou telle perception , 8c par cette reflexion fe diftin-
gue des objets de fes perceptions.
* APPERCEVOIR, v. a. ( Pfychologie.) avoir la
perception d’une chofe ; c’eft-à-dire fe la reprefenter
en foi ou hors de foi à l’occafion de quelque modification
que l’ame éprouve. S1 appercevoir, ce ft avoir
la confcience de fes perceptions.
^APPLICATION, f.f. (Pfychologie.) afte de l’ame,
par lequel elle fixe fon attention fur un fujet, en fait
pendant long-tems l’objet de fes penfées, à deflein
de le connoître aufli parfaitement qu’il eft poflible.
^APPUYÉ ( T r i l ) , Mufiq. Quelques 'mufieiens
appellent tril appuyé, celui qu’on nè commence
pas brufquement, mais qu’o'n prépare en quelque
forte de la note fupérieure. Dans quelques cas on peut
aufli préparer le tril'appuyé de la note inferieure.
(F .D .C .) > V ' -
* APRE, adj. ( Gramm. ) acide , rude, défagrea-
ble au goût ; il fe dit aufli au figuré , 8c lignifie
avide., ardent, pajjionné pour quelque chofe.
APREMONT, ( Gèogr. ) petite ville de la Lorraine
, avec château & baronnie, entre la Mofelle 8c
la Meufe j près du bailliage de Saint-Michel. C’étoit
l’un des plus anciens fiefs de l’évêché de Metz, lorf-
que dans le X V I fiecle, il en fut démembre pour faire
partie des domaines de la maifon de Lorraine. Son
nom vient,dû haut rocher efcarpé , fur lequel on a
bâti le château. ( C. A.)
A p r em o n t , ( Gèogr. ) château fortifié de Savoie
à l’oueft nord-oueft, 8c allez près, de Montmelian.
Il a donné fon nom à une famille illuftre de cette
province.- ( 6. A.)
ÂPRETÉ, f. f. ( Gramm.) qualité de ce qui eft
âpre. On le dit des fruits , quand, faute de maturité,
ils font rudes, âcres, défagréables au goût ; l’âpreté
diminue dans les fruits, à mefure que les arbres vieil-
liffent. (+)
A PRIES, ( Hijî. d’Egypte.') fils de Pfamnis,fut
fon héritier au trône d’Egypte. L’aurore de fon régné
fut brillante, 8c tous fes combats forent fuivis de la
viéfoire. Ses flottes qui couvroient les mers , lui
affervirent l’Egypte 8c Sidon , dont il fit paffer les
richeffes 8c le commercé dans fes états. Les conquêtes
qui foulent épuifent les peuples conquérans',
ouvrirent dans l’Egypte les fources de l’abondance.
A priés ne fe livra à fes inclinations belliqueufes que
pour rendre fon pays, plus floriflant. Les Juifs fati-
. gués du joug tyrannique de Nabuchodonofor, cherchèrent
un afyle dans l’Egypte, où leur .industrie
commerçante accumula l’or des nations. L’ivreffe
de fes fuccès le rendit impie, 8c fé croyant plus
qu’un homme, il ofa défier les dieux 8c braver leur
puiffance. Son audace facrilege fut punie par la révolte
des Egyptiens , qui jamais ne laifferent impunies
les offenfes faites au culte public. Ce monarque
vainqueur des nations-, fe vit abhorré de fes fujets. '
Il pafla de l’infolence de la viftoire dans l’abattement
. d’un efclave qui attend en tremblant fon arrêt de la
bouche d’un maître irrité. Ses fujets lui paroifloient
d’autant plus redoutables, qu’il les avoit inftruits
lui-même dans l’art de combattre 8c de vaincre. Il eut
dans cette extrémité recours à la négociation, 8c
choifit pour médiateur Amafis qui avoit, par fes ta-
lens 8c fa probité, mérité la confiance de fon maître
8c l’affe&ion des peuples. Cet agent également propre
à la guerre 8c à la négociation , avoit montré
jufqu’alors un ame infenfible aux promeffes de l’ambition.
A peine eut-il expofé aux rebelles le fujet
de fa million, qu’un de leurs chefs lui mit un cajque
fur la tête 8c lé proclama roi. Apriès ne regarda ce
feu dévorant que comme une étincelle prompte à
s’éteindre. Il avoit dans fa-cour un de ces hommes
privilégiés q ui, fatisfaits de faire leur devoir , n’attendent
leur récompenfe que du témoignage intérieur
de leur confcience. C’e.toit Paterbemis, que fon
intégrité 8cfon défintéreffement avoient rendu l’idole
de la nation. Ce fage, dont la fidélité étoit incorruptible
, fut chargé d’amener Amafis vivant , 8c de le
livrer aux vengeances d’un maître oftenfé. Sa négociation
eut un mauvais fuccès ; il n’effuya que les
railleries de ceux qu’il crut devoir étonner par fes
menaces. Apriès mécontént, le foupçonna d’être le
complice de l’ufurpateur de fon pouvoir ,8c pour l’en
punir, il lui fit trancher la tête. La nation, indignée
d’avoir vu tomber.un citoyen fi refpeftable , fous la
hache du bourreau , fe fouleva pour venger fa mémoire.
Tous les yeux fe fixèrent fur Amafis, qui des
ce moment fut regardé comme le vengeur de la nation^
Apriès abandonné de fes favoris, fe jetta dans les
bras de l’étranger. Trente mille Cariens 8c Ioniens
mercenaires trafiquèrent de leurfang avec lui. On en
vint aux mains dans les plaines de Memphis. Les
étrangers combattirent avec un courage qui tenoit'
du défefpoir ; mais enfin accablés par la fupériorité
du nombre, 8c fatigués de donner la mort, ils furent
dans l’impuiffance de défendre leur, vie , tous expirèrent
en combattant. Apriès fait prifonnier, ne leur
furvécut que pour être traîné au fupplice par fes
propres fujets. (T—^ .)
À PULSE , ( Afiron.) exprime la proximité de la
lune à une étoile, foit qu’il y ait éclipfe, foit que le
bord de la lune ait paffé feulement à quelques minutes
de l’étoile. On obferve lés apulfes avec foin
pour déterminer les lieux de la lune , les erreurs des
tables 8c les longitudes des lieux. On fe fert, pour
ces ôbfervations, d’un micromètre, avec lequel on
obferve les différences d’afcenfions droites 8c de
déclinaifons entre l’étoile 8c le bord de la lune > ou
bien d’un héliometre ou micromètre objeûif, pour
mefurer les diftances entre l’étoile 8c~le bord de la
lune avant 8c. après le moment de la plus courte
diftance. On calcule les apulfes en rapportant la lune
à fa place fur une figure du zodiaque, telle que celui
de Senen ou de d’Heulland, 8c cela efl fuflifant pour
les prédire dans les Ephémérides ou dans la Connoif-
fance des tems. ( M. DE LA L a n d e .)
§ APUS ou A P O U S ,fAfiroju) c’eft-à-dire pedi-
bus carens; quelquefois aufli par corruption apis.;
c’efl le nom d’une conftellation méridionale, appellée
en François Voifeau de paradis, avis indica manié co-
diata où paradifea, c’efl; le nom que lui donne M.
Linné. Cette conftellation, dans les cartes de Bayer, a
douze étoifes : il y én a un plus grand nombre dans
le catalogue de M. l’abbé de la Caille. Voyez: Ctzlum
aujlrale jtelliferum , 8c les Mémoires de l academie
royale des Sciences de Paris de lyâz , page 5joÿ. La
principale étoile de cette' conftellation eft de la cinquième
grandeur; elle avoit le 31 mai 1752, 14“ I9/-
54" d’afcenfion droite en tems, 8c 41^ f de deçli-
naifon auftrale : ainfi elle pafle au méridien a 7' fett-
■ lementfiu-deffus de l’horifon de l’obfervatoire de
Paris, ce qui ne fuffit pas pour qu’on puiffe y obfër-
ver cette etoile. (M. d e l a L a n d e . )
APYCNI, adj. pl. ( JMuftq. des anc.) Les anciens
appelloient ainfi dans les genres épais, trois des huit
fons fiables de leur fyftême ou diagramme, lefquels
ne touchoient d’aucun côté les intervalles* ferres;
fàvoir, la proflanbanomene , la nete fynnémeno'n ,
8c la nete hyperboléon. Ils appelloient aufli apycnos,
ou non-épais, le genre diatonique , parce que dans
les tétracordes de ce genre ; la lômme des deux premiers
intefvalles étoit plus grande que le troiûeme^
'Foyei Ép a is , G enre -, S o n ; T é t r a c o r d e ",
Dict. raif.'des Sciences. (S .)
APYRE, adj.m'. ( Chym.) Ce nom eft employé pour
défigner la propriété qu’ont certains corps de réfifter
à la plus grande a c tion du feu,fans en recevoir d’altération
fenfible. On doit diftingüer les corps dpyres
d’avec ceux qu’on nomme réfractaires ; car il fuffit,
pour qu’on puiffe qualifier-fine fübftance de réfra-
étaire, qu’elle réfifte à la violence du feu fans fe fondre
, quoiqu’elle éprouve d’ailleurs des altérations
confidérablës : au lieu que le corps véritablement
apyre ne-doit éprouver, de la part du feu, ni fufion,
ni aucun autre changement. Il fuit de-là, que toute
fubftance apyre eft réfr a c ta ir e mais que toute fub-
ftance réfra&aire n’eft point àpyre. Les pierres calcaires
bien pures , par exemple , font réfraftaites,
parce qu’elles ne fe fondent jamais feules ; mais elles
ne font point apyres, parce que l’aâion du feu les
fait confidérablement diminuer de poids , détruit
l’adhérence de leurs parties intégrantes, 8c change
toutes leurs'propriétés effentielles, en leur donnant
les caraéteres de la chaux vive : au contraire, le diamant
bien net 8c bien pur eft une fubftance apyre ,
parce que l’a c tion du feu le plus fort eftincapable, non-
leulement de le fondre, mais même de luicaufer au - .
cune autre altération fenfible , enforte qu’un diamant
qui a été expofé pendant très-long-tems au feu le
plus fort, fe retrouve après cela tel qu’il étoit auparavant.
Peut-être , au refte,. n’y a-t-il aucun corps dans la
nature qui foit effentiellement 8c rigoureufement
apyre: 8c cela eft affez vraifemblable ; mais il fuffit
qu’il s’en trouve qui le foient relativement au dégré
de feu, que l’art peut produire , pour qu’on foit en
droit de leur donner cette qualification. (+)
A Q
AQUILIENNE ( L o i ) , lex Aqutlia , ( Jurifprud.
criminelle. ) c’étoit une loi pénale qui avoit deux
objets. Le premier d’àffurer la punition 8c la réparation
du dommage que l’on avoit caufé à un particulier
, foit en bleflânt, fo;t en tuant, foit en lui enlevant
fes efclaves ou fon bétail ; le fécond d’affurer
de même la réparation 8c la punition du tort que
pouvoit avoir, occafionné à un citoyen le fait de l’ef-
clave ou du bétail appartenant à lin autre. Elle fut
dénommée Aquilienne, parce qu’elle obtint la fanftion
du peuple Romain fur la propofition qu’en fitL. Aqui-
lius, l’un de fes tribuns, qui rempliffoit cette charge
en l’année 572 delà fondation de Rome. V. Pighius,
tome IL de fes Annales Romaines ; Terraffon, Hijloire
de la Jurifprudence Romaine, 8fC.
Sur le premier chef, la loi ne prononçoit que des
dédommagemens. A l’égard du fécond, elle vouloit
qu’outre le dédommagement, on livrât à Poffenfé
,• l ’efclave ou l’animal qui avoit caufé le dommage.
Parmi nous 8c chez tous les peuples de l’Europe,
cette loi Aquilienne ne produit plus qu’une a&ion
civilë en dommages 8c intérêts.
Qu’on nous permette de confidérer ici rapidement
quelle eft la maniéré dont la juftice a cru devoir procéder
dans les différens tems contre les animaux qui
avoient caufé quelque dommage. C ’eft une chc>fe
digne d’être obfervée par le philofophe,8c de tenir fa
place dans l’hiftoire de l’efprit humain.
Le chapitre X X I . du Lèvitique, veut que tout,
animal qui. aura tué un homme, foit lapidé 8c mis à
mort. ,.A;
En Crete, Minos avoit ordonné que fi un pourceau
faifoit quelque dégât dans un champ de b lé ,
on lui arrachât toutes les dents.
Tome, /.
Solon , le fage Solon, fur la plainte d’un particulier
qui avoit été mordu par un chien, fit charger
l’animal de chaînes , 8c le fit livrer en cet état à
l ’offenfé. y
Dempcrite, quoique philofophe, vouloit qu’on
punit de mort tout animal qui auroit fait un tort
quelconque.
Les loi-x de Dracon alloient plus loin que les premières
loix. Non-feulement elles dévouoient à la
peine 8c ali trépas, les animaux dont la griffe ou la dent
avoient tué ou bleffé un particulier, elles envoyoient'
encore au fupplice les êtres même inanimés 8c infen-
fibles qui avoient occafionné de femblables accidens.
Me,urfius, dans fon excellent abrégé des loix Athéniennes,
liv. I. chap. ly, cite plufieurs exemples de condamnations
prononcées contre des arbres; des pierres,
des ftatués, dont la chute avoit écrafé ou bleffé des
citoyens. L’exécution fe faifoit avec appareil. Pau--
fanias parle d’une fia tue qui fut précipitée juridiquement
dans la mer , pour, être tombée de fon pie-
deftal, fur un particulier qui en avoit été bleffé.
Nos peres adopterént âAJeur tour, cette jurif-
prudence du prytanée. Il feroit facile d’en rapporter
beaucoup de preuves 8c beaucoup d’exemples.
Nous nous bornerons à en citer deux. Guipape , ju-
rifçonfulte inftruit, confeiller, 8c enfuite préfident au
confeil fouverain de Dauphiné , lequel a écrit vers
Fannée 1440, fe fait à lui-même cette : demande ,
quejl. 238. Si un animal commet un délit, .comme
font quelquefois les pourceaux qui mangent des
enfans, faut-il le punir, de mort ? Il n’héfite pas à
répondre affirmativement, 8c à dire qu’on le juge-
roit de la forte en Dauphiné , fi le cas s’y préfen-
toit. Il confirme fon opinion par un fait dont il avoit
été témoin; il affure que traverfant la Bourgogne ,
pouiüé rendre à Châlôns-fur-Marne où étoit alors
le roi, il vit un pourceau fufpendu aux fourches
patibulaires,- pour avoir tué un enfant.-
Dans les archives du collège de Befançon , exifte
un titre qui prouve que la jurifprudencè des Comtois
étoit la même que Celle des Dauphinois 8c des
Bourguignons. C’eft une fëntence que rendit fur un
conflit de jurifdi&ion-, Guillaume le bâtard de Poitiers
, chevalier , baillif du comté de Bourgogne. Il
ordonne qu’un pourceaii atteint 8c convaincu d’avoir
tué & meurtri un enfant, fera conduit jufqu’en un
tel endroit par les officiers de l’abbefle de Beaume,
8c que là , il fera remisait prévôt de Montbafonpour
exécuter, ledit porc aux fourches dudit lieu, &CC.
Ces loix étoient fondées fur la néceflité de veiller
à la confervation des hommes. On vouloit engager
les maîtres à veiller fur les bêtes qui pouvoit .nuire,
8c on les rendoit refponfables du dégât. Leur négligence
étoit punie par la perte d’un animal utile.
C’étoit le maître1 qui étoit puni plutôt'que l’animal;
mais comme lès inftitutions les plus fenfées s’altèrent
aisément, on s’imagina peu-à-péu que-là punition
tomboit fur l’animal plutôt que- fur -le maître : on
transforma leur mort en un fupplice proprement
dit; 8c ce fut le .comble du ridicule, lorfqu’on voulut
traiter l’animal malfaiteur comme l’homme coupable.
fA A .')
■ AQUILONIE, ( Gèogr.') ancienne ville d’Italie ,
fur le fleuve Aufide dans le territoire desjiirpins,
aux confins de l’Apulie. On croit que c’eft aujourd’hui
Cedongna, petite ville épifcopale de la province
ultérieure , au royaume de Naples. ( C. A.)
A R
* § ARA ou Ha r a , ( Géographie. ), ville d’Af-
fyrie, 8c C haran ou Haran félon la Vulgate,
R r r ij