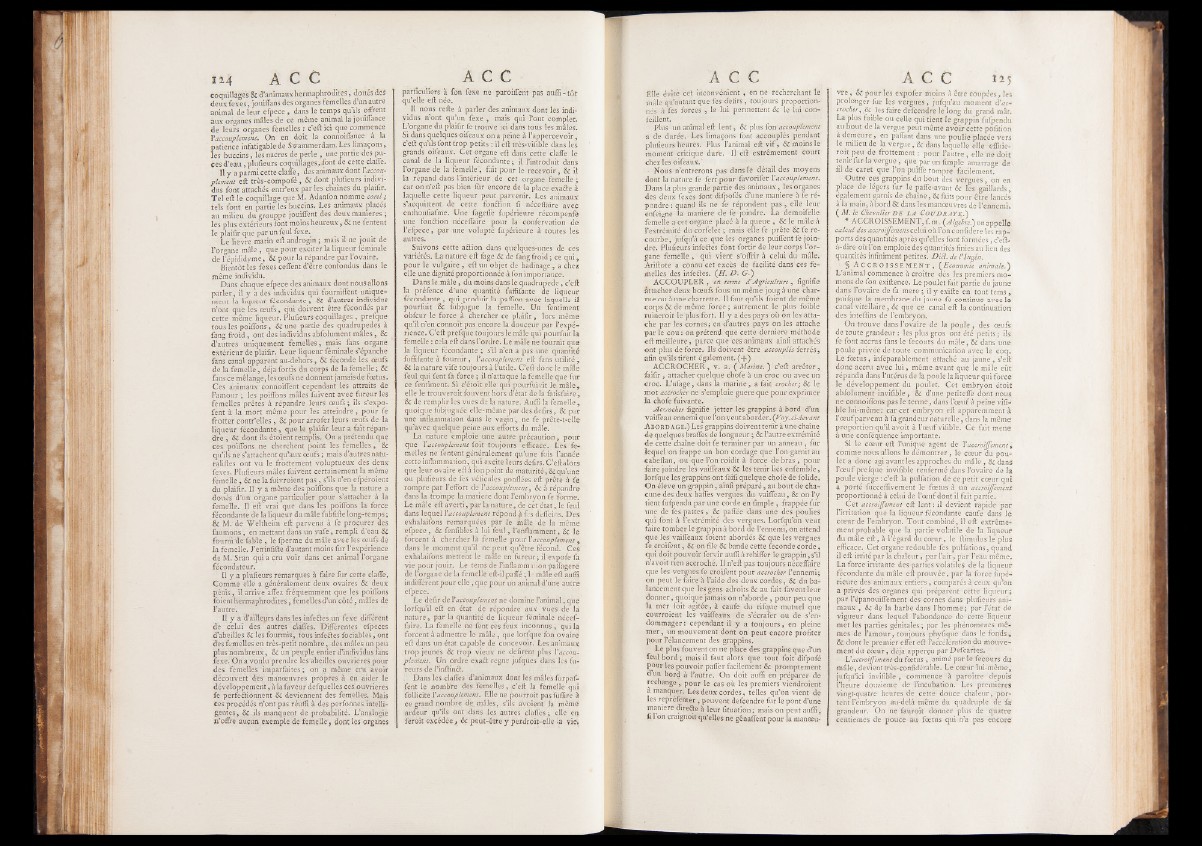
coquillages 8c d’animaux hermaphrodites, doues des
deux fexes, jouiffans des organes femelles d un autre
animal de leur efpece , dans le temps qu’ils offrent
aux organes mâles de ce même animal la jouiffance
de leurs organes femelles : c’eft ici que commence
Y accouplement. On en doit la connoiffance à la
patience infatigable de Swammerdam. Les limaçons,
les buccins, les nacres de perle , une partie des puces
d’eau , plu heurs coquillages,-font de cette^claffe.
Il y a parmi cette claffe, des animaux dont Y accouplement
eft très-compofé , & dont plufieurs individus
font attachés entr’ettx par les chaînes du plaifir.
T e l eft le coquillage que M. Adanfon nomme core{;
tels font en partie les buccins. Les animaux places
au milieu du grouppe jouiffent des deux maniérés ;
les plus extérieurs font moins heureux, & ne fentent
le plaifir que par un feul fexe.
Le lievre marin eft androgin ; mais il ne jouit de
l’organe mâle , que pour exciter la liqueur féminale
de l’épididyme, & pour la répandre par l’ovaire.
Bientôt les fexes ceflent d’être confondus dans le
même individu.
Dans chaque efpece des animaux dont nous allons
parler, il y a des individus qui fourniffent uniquement
la liqueur fécondante , & d’autres individus
n’ont que lés oeufs, qui doivent être fécondes par
cette même liqueur. Plufieurs-coquillages , prefque
tous les poiffons, & une partie des quadrupèdes à
fang froid , ont des individus abfolument m âles, &
d’autres uniquement femelles, mais fans organe
extérieur de plaifir. Leur liqueur féminale s’épanche
fans canal apparent au-dehors^ & féconde les oeufs
de la femelle, déjà fortis du corps de la femelle ; &
fans ce mélange, les oeufs ne donnent jamais de foetus.
Ces animaux connoiffent cependant les attraits de
l’amour ; les poiffons mâles fuivent avec fureur les
femelles prêtes à répandre leurs oeufs ; ils s’expo-
fent à la mort même pour les atteindre, pour fe
frotter contr’elles , & pour arrofer leurs oeufs de la
liqueur fécondante, que lé plaifir leur a fait répandre
, & dont ils étoient remplis. On a prétendu que
ces poiffons. ne cherchent point les femelles , &
qu’ils ne s’attachent qu’aux oeufs ; mais d’autres natu-
raliftes ont vu le frottement voluptueux des deux
fexes. Plufieurs mâles fuiv'ent certainement la même
femelle, & ne la fuivroient pas, s’ils n’en efpéroient
du plaifir. Il y a même des poiffons que la nature a
doues d’un organe particulier pour s’attacher à la
femelle. Il eft vrai que dans les poiffons la force
fécondante de la liqueur du mâle fubfifte long-temps ;
& M. de "Weltheim eft parvenu à fe procurer des
faumons , en mettant dans un v a fe , rempli d’eau &
fournrde fable , le fperme du mâle avec les oeufs de
la femelle. J’enrinfifte d’autant moins fur l’èxpérience
de M . Sran qui a cru voir dans cet animal l’organe
fécondateur.
Il y a plufieurs remarques à faire fur cette claffe.
Comme elle a généralement deux ovaires & deux
pénis, il arrive affez fréquemment que les poiffons
foient hermaphrodites, femellesd’un côté, mâles de
l ’autre.'
Il y a d’ailleurs dans les infe&ès.un fexe différent
de celui des autres claffes. Différentes efpeces
d’abeilles & les fourmis, tous infe&es fociables, ont
des femelles en très-petit nombre, dés mâles un peu
plus nombreux, &c un peuple entier d’individus fans
fexë. On a voulu prendre les abeilles ouvrières pour
des fèmelles imparfaites ; on a même Cru avoir
découvert des manoeuvres propres à en aider le
développement, à la faveur defquelles ces! ouvrières
fe perfectionnent & deviennent des femelles. Mais
ces procédés n’ont pas réuffi à des perfonnes intelligentes,
&-ils manquent de probabilité. L’analogie
»’offre aucun exemple de femelle ? dont les 'organes
particuliers à fon fexe ne paroiffent pas aufïi-tôt
qu’elle eft née.
Il nous refte à parler des animaux dont les individus
n’ont qu’un fexe , mais qui l’ont complet.
L’organe du plaifir fe trouve ici dans tous les mâles.
Si dans quelques oifeaux on a peine à l’appercevoir,
c’eft qu’ils font trop petits : il eft très-vifible dans les
grands oifeaux. Cet organe eft dans cette claffe le
canal de la liqueur fécondante ; il l’introduit dans
l’organe de. là femelle fait pour le recevoir & il
la répand dans l’intérieur de cet organe femelle ;
car on n’eft pas bien fur encore de la place exafte à
laquelle cette liqueur peut parvenir. Les animaux
s’acquittent de cette fonction fi néceffaire avec
enthoufiafme. Une fagefl'e fupérieure récompenfe
une fonftion néceffaire pour la confervation de
l’efpece, par une volupté fupérieure à toutes les
autres.
Suivons cette aûion dans quelques-unes de ces
variétés. La nature eft fage & de fang froid; ce qui,
pour le vulgairé , eft un objet de badinage , a chez
elle une dignité proportionnée à fon importance.
Dans le mâle, du moins dans le quadrupède, c’eft
la préfence d’une quantité fuffifante de liqueur
fécondante , qui produit la paffion avec laquelle il
pourfuit & lubjugue la femelle. Un fentiment
obfcur le force à chercher ce plaifir, lors même
qu’il n’en connoît pas encore la douceur par l’expérience.
C’eft prefque toujours le mâle qui pourfuit la
femelle : cela eft dans l’ordre. Le mâle ne fournit que
la liqueur fécondante ; s’il n’en a pas une quantité
fuffifante à fournir, Y accouplement eft fans utilité ,
& la nature vife toujours à l’utile. C ’eft donc le mâle
feul qui fent fa force ; il n’attaque la femelle que fur
ce fentiment-. Si c’étoit elle qui pourfuivît le mâle,
elle le trouveroit fouventhors d’état de la fatïsfaire,
& de remplir les vues de la nature. Auffi la femelle ,
quoique fubjuguée elle-même par des defirs, & par
une inflammation dans le vagin, ne fe prête-t-elle
qu’avec quelque peine aux efforts du mâle.
La nature emploie une autre précaution, pour
que Y accouplement foit toujours efficace. Les femelles
ne fentent généralement qu’une fois l’année
cette inflammation, qui excite leurs defirs, C’eftalors
que leur ovaire eft à ion point de maturité, & qu’une
ou plufieurs de fes véficules gonflées eft prête à fe
rompre par l’effort de Y accouplement, & à répandre
dans la trompe la matière dont l’embryon fe forme.
Le mâle eft averti, parla nature, de cet état, le feul
dans lequel Y accouplement répOnd à fes dèffein's. Des
exhalaifons remarquées par le mâle de la même
efpece, & fenfiblés à lui feu l, l’enflamment, & le
forcent à chercher la' femelle pour l’accouplement,
dans le moment qu’il ne peut qu’être fécond. Ces
exhalaifons mettent le male en fureur; il expofe fa
vie pour jouir. Le tems de l’inflamm ition paflàgeré
de l’organe de la femelle eft-il paffé ;1 - mâle eft auffi
indifférent pour e lle, que pour un animal d’une autre
efpece.
Le defir de Y accouplement ne domine l’animal, que
lorfqu’il ëft en état de répondre aux Vues de la
nature, par la quantité de liqueur féminale néceffaire.
La femelle ne fent ces feux inconnus , qui la
forcent à admettre le mâle , que lorfque fon ovaire
eft dans un état capable de concevoir. Les animaux
trop jeunes & trop vieux ne défirent plus Y accouplement.
Un ordre exaft régné jufqiies dans lès fureurs
de Pinftinâ:.
Dans les claffes d’animaux,dont les mâles furpaf-
fent le nombre des femelles, c ’eft la femelle qui
follicite Y accouplement. Elle ne pourroit pasfuffire à
ce grand nombre de mâles, s’ils avoiërit la même
ardeur qu’ils Ont dans les autres claflès ; elle en
feroit excédée , & peut-être y perdroit-ellç la vie*
Elle évité cet inconvénient , en rie recherchant le
mâle qu’autant que fes defirs, toujours proportionnés
à fes forces -, le lui permettent & le lui cori-
feillent.
Plus un animal eft lent, & plus fon accouplement
a de durée. Les limaçons font accouplés pendant
plufieurs heures. Plus l’animal eft v i f , & moins le
moment critique dure. Il eft extrêmement court
chez les oifeaux.’
- Nous n’entrerons pas dans le détail des moyens
dont la nature fe fert pour faVorifer Y accouplement.
Dans la plus grande partie des animaux, les organes
des deux fexes font difpofés d’une maniéré à fe répondre
: quand ils ne fe répondent p a s, elle leur
énfeigne la maniéré de fe joindre.- La demoifelle
femelle a cet organe placé à la queue , & le mâle à
l’extrémité du corfelet ; mais elle fe prête & fe recourbe,
jufqu’à ce que les organes puiffentfe joindre.
Plufieurs infeftes font fortir de leur corps l’organe
femelle , qui vient s’offrir à celui du mâle.
Ariftote a connu cet excès de facilité dans' ces femelles
des infe&es. {H. D. G-)
ACCOU PLER, enterme d? Agriculture, fignifîe
attacher deux boeufs fous un même joug à une charrue
ou à une charrette. Il faut qu’ils foient de même
corps & de même force ; autrement le plus foible
ruineroit le plus fort. Il y a des pays où on les attache
par les cornes; en d’autres pays on les attache
par le cou : on prétend que cette derniere méthode
eft meilleure , parce que ces animaux ainfi attachés
ont plus de force.- Ils doivent être accouplés ferrés,
afin qu’ils.tirent également. (+ )
A CCROCH ER, v. a. ( Marine. ) c’eft arrêter,
faifir , attacher quelque chofe à un croc ou avec un
croc. L’ufage, dans la marine, a fait crocher; & le
mot accrocher ne s’emploie guère que pour exprimer
la chofe fuivante.
Accrocher fignifîe jetter les grappins à-bord d’un
vaiffeau ennemi que l’on veut aborder. {V>y .ci-devant
Abordage.) Les grappins doivent tenir à une chaîne
de quelques braffes de longueur ; & l’autre extrémité
de cette chaîne doit fe terminer par un anneau , fur
lequel'on frappe un bon cordage que l’on garnit au
cabeftan, ou que l’on roidit à force de bras , pour
faire joindre les vaiffeaux & les tenir liés enfemble,
lorfque les grappins ont fàifi quelque chofe de folide.
On eleve un grappin, ainfi préparé, au bout de chacune
des deux baffes vergues du vaiffeau, & on l’y
tient fufpendu par une corde en fimple , frappée fur
tïne de fes' pattes, & paffée dans une des poulies
qui font à l’extrémité des vergues. Lorfqu’on veut
faire tomber le grappin à bord de l’ennemi, on attend
que les vaiffeaux foient abordés & que les vergues
fe croifent, & on file & bande cette fécondé corde,
qui doit pouvoir fervir auffi à rehiffer le grappin, s’il
n’avoit rien accroché. Il n’eft pas toujours néceffaire
que les vergues fe croifent pour accrocher l’ennemi;
on peut le faire à l’aide des deux cordes, & du balancement
que les gens adroits & au fait faventleur
donner, quoique jamais on n’aborde , pour peu que
la mer foit agitée, à caufe du rifque mutuel que
courroient les vaiffeaux de s’écrafer ou de s’endommager
: cependant il y a toujours, en pleine
mer, un mouvement dont on peut encore profiter
pour l’élancement des grappins.
Le plus fouvent on ne place des grappins que d’un
feul bord ; mais il faut alors que tout foit difpofé
pour les pouvoir paffer facilement & promptement
d’un bord à l’autre. On doit auffi en préparer de
rechange , pour le cas oîi les premiers vieridroient
à manquer. Lés deux cordes, telles qu’on vient de
les reprefénter, peuvent defeendre fur le pont d’une
maniéré direôe à leur fituation; mais on peut auffi,
fi 1 on craignoit qu’elles ne gênaffent pour la manoeuv
r e , & pour les expofer moins à être coupées, les
prolonger fur les vergues, jufqu’au moment d’*c-
crocher, v& les faire defeendre le long du grand mât.
La plus foible ou celle qui tient le grappin fufpendu
au bout de la vergue peut même avoir cette pofition
à demeure, en paffant dans une poulie placée vers
le milieu de la vergue, & dans laquelle elle effuie-
roit peu de frottement : pour l’autre , elle ne doit
tenir fur la v ergue, que par un fimple amarrage de
fil de caret que l’on puiffe rompre facilement.
Outre ces grappins du bout des vergues, on en
place de légers fur le paffe-avant & les gaillards,
également garnis de chaîne, & faits pour être lancés
à la main, à bord & dans les manoeuvres de l ’ennemi.
( M. le Chevalier DE LA Cou D RAYE.')
* ACCROISSEMENT, f.m. {Algèbre.) on appelle
calcul des accroijfemens celui où l’on confidere les rapports
des quantités après qu’elles font formées , c’eft-
à-dire où l’on emploie des quantités finies au lieu des
quantités infiniment petites. Dict. de Clngén.
§ A c c r o i s s e m e n t , {Economie animale.)
L’animal commence à croître dès les premiers mo-
mens de fon exiftence. Le poulet fait partie du jaune
dans l ’ovaire de fa mere ; il y exifte en tout tems ,
puifque la membrane du jaune fe continue avec le
canal vitellaire, & que ce canal eft la continuation
des inteftins de l’embryon.
On trouve dans l’ovaire de la pou le , des oeufs
de toute grandeur : les plus gros ont été petits; ils
fe font accrus fans le fecôurs du mâle, & dans' une
poule privée de toute communication avec le coq.
Le foetus, inféparablement attaché au jaune , s’eft
donc accru avec lu i, même avant que le mâle eût
répandu dans l’utérus de l'a poule la liqueur qui force
le développement du poulet. Cet embryon étoit
abfolument invifible , & d’une petiteffe dont nous
ne connoiffons pas le terme, dans l’oe uf à peine vifi-
ble lui-même: car cet embryon eft apparemment à
l’oeuf parvenu à fa grandeur naturelle, dans la même
proportion qu’il avoit à l’oeuf vifîble. Ce fait mené
à une conféquence importante.
Si le coeur eft l’ùriique agent de Yaccroijfement,
comme nous allons le démontrer, le coeur du poulet
a donc agi avant les approches du mâle , & dans
l’oeuf prefque invifible renfermé dans l’ovaire de la
poule vierge : c’eft la pulfation de ce petit coeur qui
a porté fucceflivement le foetus à un accroijfement
proportionné à celui de l’oeuf dont il fait partie.
Cet accroijfement eft lent : il devient rapide par
l’irritation que la liqueur fécondante caufe dans le
coeur de l’embryon. Tout combiné , il eft extrêmement
probable que la partie volatile de la liqueur
du mâle eft, à l’égard du coeu r, le ftimulus le plus
efficace. Cet organe redouble fes pulfations, quand
il eft irrité par la chaleur, par l’air, par l’eau même.
La force irritante des-parties volatiles de là liqueur
fécondante du mâle eft prouvée, par là force fupérieure
des animaux entiers, Comparés à ceux qu’on
a privés des organes qui préparent cette liqueur;
par l’épanouiffement des cornes dans plufieurs animaux
, & de la barbé dans l'homme ; par l’état de
vigueur dans lequel l’abondance'de cette liqueur
met les parties génitales ; par les phénomènes mêmes
de l’amour, toujours phyfique dans le fonds,
& dont le premier effet eft l’accélération du mouvement
du coeur, déjà apperçu par Defcartes.
IYaccroijfement du foetus , animé par le fecours du
mâle , devienttrès-confidérable. Le coeur lui-même,
jufqu’ici invifible, commence à paroître depuis
l’heure douzième de l’incubation. Les premières
vingt-quatre heures de cette douce chaleur, portent
l’embryon au-delà même du quadruple de fa
grandeur. On ne fauroit donner plus de quatre
centièmes de pouce au foetus qui n’a pas encore