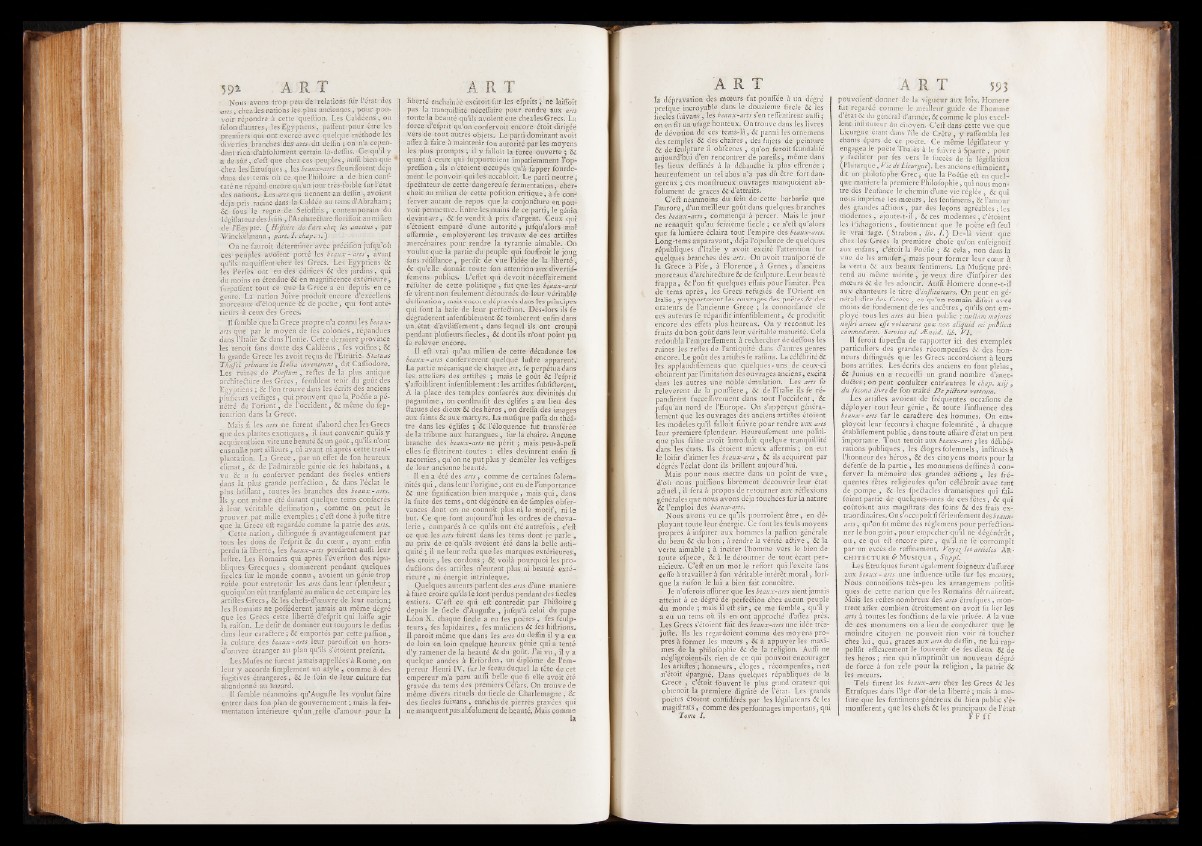
Nous avons, 'trop:1 peit id«* relations -fur l*étât des j
u ns, .chezies nations les>plus anciennes, po\tr- po#- ;
voir répondre à cette qu’eftion. Les Caldéens;, ou :
ielomdteutres, les Egyptiens', paffent1 pour-être les !
premiers tqur ont exercé avec quelque méthode les ]
-idivecfes branches des1 arts. du deffin ; on n’a cepen- 1
•dant rien rd’abfohimént certain là-deffus. • Ge-qu’il y
a de- sûr, o?eft que chez ces peuples j’suffi bien que ^
-chez les! Et-rufques , lés beaux-ares fleuriffoiènt déjà
flans. des-, te ms o.ii ce. que Khiftoire a de bien constaté
ne répand encore-qu’un jour très-fbible fur l’etat
des nations.- Le-swm qui tiennent au- deffin, avoient
déjà pris. racine dans la-;Galdee au tems d’Abraham ;
de fous! le régné: !de !;Sefoftris, contemporain du
légiflateur des Juifs-, l’Architefture florifloit au milieu
de l’Egypte. ( Hijltiire deslxirt cke£ les .anciens y par
AVinckélmann, part. I. chap..i. ) .
On ne fauroit déterminer avec précifibn jufqü’oii
Ces1 peuples avoieiit pófte 1 es beaux - arts', avant
qu’ils naquiffentthez' les'Grecs. Les Egyptiens &
-léS Pèrfés Ont eu des-édifiées & des jardins, qui
du moins en étendue & en magnificence éxtérieurë,
iurpaffent tout ce que- la Grece a èu depuis en ce
genre.' La nation Juive produit encore d’excellens
morceaux d’éloquence & de poéfie, qui font antérieurs
-à ceux des Grecs;
Il femble que la Grece propre n’a connu lés beaux- -
arts que par le moyen de fès colonies, répandues
dans l’Italie & dans l’Ionie. Cette dernière province
les ténoit fans doute dqs Caldéens ,fe s voilins ; &
la grande Grecé les avoir reçus de l’Etrüriè. Statuas
'Thiifci prïmufn in Italia invenerunt, dit Càfliodore.
Les ruines de Poeflum, rèftes d e la plus antique
architeéhire des Grecs , femblent tenir du goût des
Egyptiens ; & l’on trouve dans les écrits dés anciens
plufieurs veftigès, qui prouvent que la. Poéfie a pénétré
de l’orient, de l’occident, & même du fep-
tentrion dans la Grece.
Mais fi les arts ne furent d’abord chez les Grecs,
que des plantes exotiques, il faut convenir qu’ils y
acquirent bien vîte.une beauté & un goût, qu’ils n’ont
eus nulle part ailleurs , ni avant ni après cette tranf-
plantation. La Grece , par tin effet de fon heureux
climat, & de l’admirable génie de. fes habitans, a
vu & a fu conferver pendant des fieçles entiers
dans la plus grande perfection, & dans l’éclat le
plus brillant, toutes-les branches des beaux-arts..
Ils .y. ont même été durant quelque tems confacrés
à leur véritable d.eftination , comme on peut le
prouver par. mille exemples..; c’eft donc à jufte titre
que la,Grece eft regardée comme la patrie des arts.
Cette nation,, diftinguée fi avantageufement par
tous les dons de l’efprit & du coeur, ayant enfin
perdu fa liberté , lés beaux-arts perdirent aufli leur
luflre. Les Romains qui après l’éverfion des républiques
Grecques , dominèrent pendant quelques
ïiecles fur le monde connu, avoient un genie trop
roide pour entretenir les arts dans leur fplendeur ;
quoiqu’on eût tranfplanté au milieu de cet empire les
artiftes Grecs, & les chefs-d’oeuvre de leur nation;
les Romains ne pofîederent jamais au même dégré
que les Grecs cette liberté d’efprit qui laiffe agir
la raifon. Le défit de dominer eut toujours le deflùs
dans leur caraftere ; & emportés par cette paffion,
la culture des beaux-arts leur paroifloit un hors-
d’oeuvre étranger au plan qu’ils s’étoient preferit.,
LesMufes ne furent jamais appellées'à Rome, on
leur y accorda Amplement un afyle , comme à des
fugitives étrangères, & le-foin de leur culture fut
abandonné au hazard.
. Il femble néanmoins qu’Augufte les vpulut faire
entrer dans fon plan de gouvernement ; mais la fermentation
intérieure qu’un, refte d’amour pour la
liberté enchaînée excitoit fur- les éfpnfô ; ne laifloît
pas la tranquillité néceffaire polir rendre aux arts
toute la béauté q u’ils avoient eue chez les Grecs. La
force, d’efprit qu’on confervoit encore étoit dirigé ë
vers de tout autres objets.- Le parti dominant avoit
allez à faire à maintenir fon autorité par les moyens
les plus prompts ; il yfalloit la force ouverte ;
quant à -ceux qui fupportoient impatiemment l’op-
pr.effion, ils n’étôient occupés qu’à fapper fourde-
mént-le pouvoir quilei accabloit. Le parti neutre,’
fpeftateur de cette dangereufe fermentation, cher-,
choit au milieu de cette pofition critique ; à-fe conJ
ferver autant de repos que la conjoncture en pou-
voit permettre. Entre les mains de ce parti, le génie
devint art, & fe vendit à prix d’argent. Ceux qui
■ s’étoient emparé , d’une autorité , Jufqu’alors : mal
affermie, employèrent les travaux de ces artiftes
mercénaires pour rendre la tyrannie aimable* On
voulût que la partie du peuple qui fouffroit le joug
-fans réfiftance , perdît de vue l’idée de la-liberté,
& qu’elle donnât toute fon attention-aux divertifi-
femens publics. L’effet qui devoit néceflairement
réfulter de cette politique , fut que les beaux-arts
fe virent non feulement détournés de leur véritable
deftination, mais encore dépravés dans les principes
qui font la bafe de leur perfeCfion. Dès-lors ils fe
dégradèrent infenfiblement & tombèrent enfin dans
un.état d’àviliffement, dans lequel ils ont croupi
pendant plufieurs Ïiecles, & dont ils n’ont point pu
fe relever encore.
Il eft vrai qu’au milieu de cette décadence les
beaux-arts conferverent quelque luftre apparent.'
La partie mécanique de chaque <zr/, fe perpétua dans
les atteliers des artiftes ; mais le goût & ■ l’efprit
q’aftbiblirent infenfiblement : les artiftes fubfifterent.
A la place des temples confacrés aux divinités du
paganifme , on conftruifit deséglifes ; au lieu des
ftatues des dieux & des héros , on dreffa des images
aux faints & aux martyrs. La mulique paffa du théâtre
dans les églifes ; & l’éloquence fut transférée
de la tribune aux harangues , fur la chaire* Aucune
branche des beaux-arts ne périt ; mais peurà-peft
elles fe flétrirent toutes : elles devinrent enfin Ji
racornies, qu’on ne put plus y de.mêler les veftiges
de leur ancienne beauté.
Il en a été des arts, comme de certaines folem-
nités qui, dans leur l’origine, ont eu de l’importance
& une lignification bien marquée , mais qui, dans
la fuite des tems, ont dégénéré en de limples obfer-
vances dont on ne connoît plus ni le motif, ni le
but. Ce que, font aujourd’hui les ordres de chevalerie,
comparés à ce qu’ils ont été.autrefois, ç’efl;
ce que les arts furent dans les tems dont je parle ,
au prix de ce qu’ils avoient été dans la belle antiquité
; il ne leur refta que les marques extérieures,
les croix, les cordons.; &. voilà pourquoi les productions
des artiftes n’eurent plus ni be.auté extérieure
, ni énergie intrinfeque.
. Quelques auteurs parlent des arts d’une maniéré
à faire croire qu’ils fe font'perdus pendant des Ïiecles
entiers. C ’eft ce qui eft contredit par l’hiftoire ;
depuis le. fiecle d’Augufte , jufqu’à celui du pape
Léon X. chaque fiecle a eu fes poètes , fes fculp-
teurs, fes lapidaires , fes muficiens & fés hiftrions.
Il paroît même que dans les arts du deffin il y a eu
de loin en loin quelque heureux genie qui a tenté
d’y ramener de la. beauté & du goût. J’ai vu , il y a
quelque années à Erforden, un diplôme de l’empereur
Henri IV. fur le fceàu duquel la tête de cet
empereur m’a paru auffi belle que fi elle avoit été
gravée du tems des premiers Cefars. On trouve de
même divers rituels du fiecle de Charlemagne ; &
des Ïiecles fuivans , enrichis de pierres gravées qui
ne manquent,pas.abfolument de beauté.,. Mais comme
la dépravation des moeurs fut pouflee à un dégré
prefque incroyable dans le dolizieme fiecle & les
Ïiecles fuivans, les beaux-arts s’en reffentirent auffi;
on en fit un ufage honteux. On trouve dans les livres
de dévotion de ces tems-là, & parmi les ornemens
des temples & des chaires, des fujets de peinture
& de fculpture fi obfcenes , qu’on feroit fcandalifé
aujourd’hui d’en rencontrer de pareils, même dans
les lieux deftihés à la débauche la plus effrenée ;
heureulement un tel abus n’a pas dû être fort dangereux
; ces monftruéux .ouvrages manquoient ab-
folument de grâces & d’attraits;
C’eft néanmoins du fein de cette barbarie que
l’aurore, d’un meilleur goût dans quelques branches
des beaux-arts, commença à- percer. Mais le jour
ne renaquit qu’au feizieme fiecle ; ce n’eft qu’alors
que fa lumière éclaira tout l’empire des beaux-arts.
Long-tems auparavant , déjà l’opulence de quelques
républiques d’Italie y avoit excité l’attention fur
quelques branches des arts. On avoit tranfporté de
la Grece à Pife, à Florence, à Genes, d’anciens
morceaux d’ârchiteâure & de fculpture. Leur beauté
frappa, & l’on fit quelques effais pour l’imiter. Peu
de tems après, les Grecs réfugiés de l’Orient en
Italie, y apportèrent les ouvrages des poètes & des
orateurs de l’ancienne Grece ;.la connpiffance de
ces auteurs fe répandit infenfiblement, & produifit
encore des effets plus heureux. On y reconnut les
fruits du bon goût dans leur véritable maturité. Cela
redoubla l’empreffement à rechercher de deffous les
ruines les reftes de l’antiquité dans d’autres genres
encore. Le goût des artiftes fe raffina. La célébrité &
les applaudiffemens que quelques-uns de ceux-ci
obtinrent par l’imitation des ouvrages anciens, excita
dans les autres une noble émulation. Les arts fe
relevèrent de la pouffiere, & de l’Italie ils fe répandirent
fucceffivement dans tout l’occident, &
jufqu’au nord de l’Europe. On s’apperçut généralement
que les ouvrages des anciens artiftes étoient
les modèles qu’il falloit fuivre pour rendre aux arts
leur première fplendeur. Heureufement une politique
plus faine avoit introduit quelque tranquillité
dans les états. Ils étoient mieux affermis ; on eut
le loifir d’aimer les beaux-arts, & ils acquirent par
dégrés l’éclat dont ils brillent, aujourd’hui.
Mais pour nous mettre dans un point de vu e ,
d’oîi nous puiffions librement découvrir leur état
aftuel, il fera à propos de retourner aux réflexions
générales que nous avons déjà touchées fur la nature
& l’emploi des beaux-arts.
Nous avons vu ce qu’ils pourroient ê tre, en déployant
toute lèur énergie. Ce font les feuls moyens
propres à infpirer aux hommes la paffion générale
du beau & du bon ; à rendre la vérité aftive , & la
vertu aimable ; à inciter l’homme vers le bien de
toute efpece, & à le détourner de tout écart pernicieux.
C ’eft en un mot le reffort qui l’excite fans
ceffe à travailler à fon véritable intérêt moral, lorl-
que la raifon le lui a bien fait connoître.
■ Je n’oferois affurer que les beaux-arts aient jamais
atteint à ce dégré de perfection chez aucun peuple
du monde ; mais il eft sûr, ce me femble , qu’il y
a eu un tems oti ils en ont approché d’affez près.
Les Grecs s’étoient fait des beaux-arts une idée très-
jufte. Ils les regardoiént comme des moyens propres
à former les moeurs , & à appuyer les maximes
de la philofophie & de la religion. Auffi ne
négligeoient-ils rien de ce qui pou voit eneourager
les artiftes ; honneurs, éloges , récompenfes, rien-
n’étoit épargné. Dans quelques républiques de la
Grece , c’étoit fouvent le plus grand orateur qui
obtenoit la première dignité de l’état. Les grands'
poètes étoient cônfidérés par les légiflateurs & les
magiftrats, comme des perfonnages importans, qui
Tome I.
poli voient donner de la vigueur aux lôîx. Homere
fut: regardé comme le meilleur guide de l’homme
d’état & du général d’armée, & comme le plus excellent:
inftituteur du citoyen. C’eft dans cette vue que
Licurgue étant dans l’île de Crête , y raffembla les
chants epars de ce poète. Ce même légiflateur y
engagea le poète Thaïes à le fuivre à Sparte , pour
y . faciliter par fes vers le fuccès de fa légiflation
(Plutarque, Vie de Licurgue). Les anciens eftimoient,
dit un philofophe Grec, que la Poéfie eft en quelque
maniéré la première Pnilofophie, qui nous montre
dès l’enfance le chemin d’une vie réglée , & qui
nous imprime les moeurs, les fentimens, & l’amour
dés grandes aftions, par des leçons agréables ; les
modernes , ajoute-t-il, & ces modernes , c’étoient
les Pithagoriens , foutiennent que le poète eft feul
ie vrai lage. (Strabon, fiv. J.) De-là vient que
chê^ lès Grecs la première chofe qu’on enfeignoit
aux enfans, c’étoit la Poéfie ; & cela, non dans la
vue de les amufer , mais pour former leur coeur à
la vertu &■ aux beaux fentimens. La Mufîque prétend
au même mérite , je veux dire d’infpirer des
moeurs & de les adoucir. Auffi Homere donne-t-il
aux- chanteurs, le titre à*injlituteurs. On peut en général
dire des Grecs , ce qu’un romain difoit avec
moins de fondement de fes ancêtres, qu’ils ont employé
tous les arts au bien public : nullam majores
nojlri artern ejfe voluerunt quoe non aliquid rei puBliccs
commodaret. Servius ad Æneid. lib. VI.
Il feroit fuperflu de rapporter ici des exemples
particuliers des grandes récompenfes & des honneurs
diftingués que les Grecs accordoient à leurs
bons artiftes. Les écrits des anciens en font pleins,
& Junius en a recueilli un grand nombre d’anec-
do&es ; on peut conlulter entr’autres le chap. x i i j ,
du fécond livre de fon traité De piclura veterum.
Les artiftes avoient de fréquentes occafions de
déployer tout leur génie, & toute l’influence des
beaux-arts fur le caraôere des hommes. On employât
leur fecours à chaque folemnité , à chaque
établiffement public, dans toute affaire d’état un peu
importante. Tout tenoit aux beaux-arts ; les délibérations
publiques , les éloges folemnels, inftituésà
l’honneur des héros, & des citoyens morts pour la
défenfe de la partie , les monumens deflinés à conferver
la mémoire des grandes actions , les fréquentes
fêtes religieufes qu’on célébroit avec tant
de pompe , & les fpeftacles dramatiques qui fai-
foie nt partie de quelques-unes de ces fêtes, & qui
coûtoient aux magiftrats des foins- & des frais extraordinaires.
On s’occupoit fi férieufement des beaux-
arts , qu’on fit même des réglemens pour perfeétion-
ner le bon goût, pour empecher qu’il ne dégénérât,
o u , ce qui eft encore pire, qu’il ne fe corrompît
par un excès de raffinement. Voyelles articles A r c
h i t e c t u r e & M u s iq u e , Suppl.
Les Etrufques furent également foigneux d’affurer
.aux beaux-arts une influence utile fur les moeurs.
Nous connoiffons très-peu les arrangemens politiques
de cette nation que les Romains détruifirent.
Mais les reftes nombreux des arts étrufques , montrent
affez combien étroitement on avoit fit lier les
arts à toutes les fondions de la vie privée. A la vue
de ces monumens on a lieu de conje&urer que le
moindre citoyen ne pouvoir rien voir ni toucher
chez lui, qui, grâces aux arts du deffin, ne lui rap-
pellât efficacement le fouvenir de fes dieux & de
les héros ; rien qui n’imprimât un nouveau dégré
de force à fon zele pour la religion , la patrie &
les moeurs. . ,
Tels furent les beaux-arts chez les Grecs & les
Etrufques dans l’âge d’or delà liberté ; mais à me-
fure que les fentimens généreux du bien public s’é-
moufferent, que les chefs & les principaux de l’état
F F f f