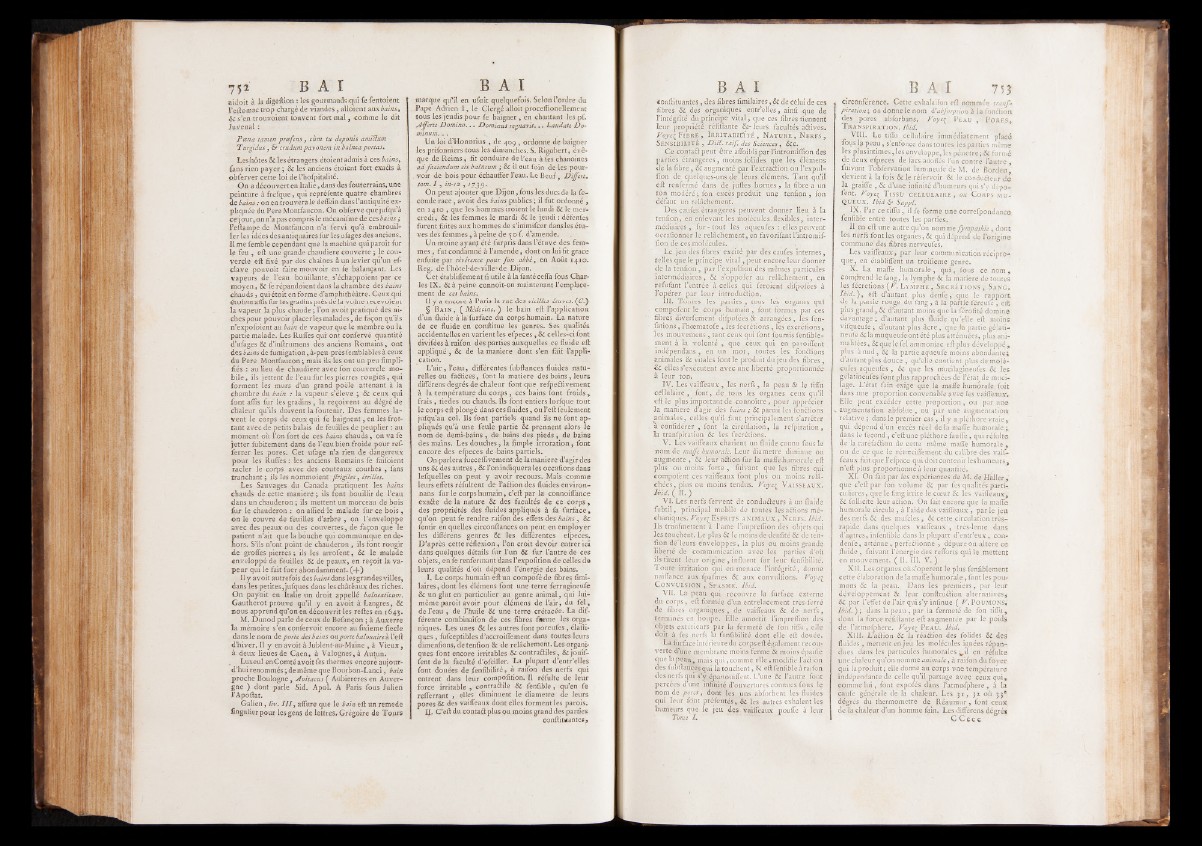
aidoit à la digeftion : les gourmands qui fe fentoient
l’eftomactrop chargé.de viandes, alloient aux bains,
& s’en trouvoient iotivent fort mal, corfime le dit
Juvenal :
Pana tamen prcefens ? ,cùm tu deponis amictum
•Turgidus, & crudum pavanent in balnea portas.
Les hôtes & les étrangers étoient admis à ces bains,
fans rien payer ; & les anciens étoient fort exa&s à
pbferyer cette loi de l’hofpitalité.
On a découvert en Italie, dans des fouterrains, une
peinture à frefque, qui repréfente quatre chambres
de bains : on en trouvera le deffein dans l’antiquité expliquée
du Pere Montfaueon. On obferve que jufqu’à
Ce-jour, on n’a pas compris le mécanifme de ces bains ;
i’ eftampe de Montfaueon n’a fervi qu’à embrouiller
les idées des antiquaires fur les ufages des anciens.
Il me femble cependant que la machine quiparoît fur
le feu , eft une grande chaudière couverte ; le couvercle
eft fixé, par des chaînes à un levier qu’un ef-
çlave pouvoir faire mouvoir en fe balançant. Les
vapeurs de l ’eau bouillante, s’échappoient par ce
moyen, & fe répandoient dans la chambre des bains
chauds, qui étoit en forme d’amphithéâtre. Ceux qui
étoient affis fur les gradins près de la voûte rece voient
la vapeur la plus chaude ; l’on avoit pratiqué des niches
pour pouvoir placer lqs malades, de façon qu’ils
n’expofoient au bain de vapeur que le membre ou la
partie malade. Les Ruffes qui- ont confervé quantité
cl’ufàges & d’inftrumens des anciens Romains, ont
des bains de fumigation, à-peu-près femblables à ceux
du Pere Montfaueon ; mais ils les ont un peu Amplifiés
: au lieu de chaudière avec fon couvercle mobile,
ils jettent de l’eau fur les pierres rougies , qui
forment les murs d’un grand poêle attenant à la
chambre du bain : la vapeur s’élève ; & ceux qui
font affis fur les gradins, la reçoivent au degré de
chaleur qu’ils doivent la foutenir. Des femmes lavent
le corps de ceux qui fe baignent, en les frottant
avec de petits balais de feuilles de peuplier : au
moment oit l’on fort de ces bains chauds,, on va fe
jetter fubitement dans de l’eau bien froide pour ref-
ferrer les pores. Cet ufage n’a rien de dangereux
pour les Ruffes : les anciens Romains fe faifoient
racler le corps avec des couteaux courbes , fans
tranchant ; ils les nommoient (Irigiles, étrilles.
Les Sauvages du Canada pratiquent les bains
chauds de cette maniéré ; ils font bouillir de l’eau
dans un chauderon ; ils mettent un morceau de bois
fur le ch au deronon affiecHe malade fur ce bois ,
on le couvre de feuilles d’arbre , on l ’enveloppe
avec des peaux ou des couvertes, de façon que le
patient n’ait que la bouche qui communique en dehors.
S’ils n’ont point de chauderon, ils font rougir
de groffes pierres ; ils les arrofent, & le malade
enveloppé de feuilles & de peaux, en reçoit la vapeur
qui le fait fuer abondamment. (+ )
Il y avoit autrefois des bains dans les grandes villes,
dans les petites, jufques dans les châteaux des riches.
On pay'oit en Italie un droit appellé balneaiicum.
Gautherot prouve qu’il y en avoit à Langres, &
nous apprend qu’on en découvrit les relies en 1643.
M. Dunod parle de ceux de Befançon ; à Auxerre
la mémoire s’en confervpit encore au fixieme liecle
dans le nom de porte des bains ou porte balouaire à l’eft
d’hiver. Il y en avoit à Jublent-au-Maine , à V ieu x,
à deux lieues de Caen, à Valognes,à Autun.
Luxeul en Comté avoit fes thermes encore aujourd’hui
renommés ; de même que Bourbon-Lanci, bain
proche Boulogne, Avitacus ( Aubiereres en Auvergne
) dont parle Sid. Apol. A Paris fous Julien
l’Apoftat.
Galien, liv. I I I , affure que le bain eft un remede
fingulierpour les gens de lettres, Grégoire de Tour«
marque qu’il en ufoit quelquefois. Selon l’ordre du
Pape Adrien I , le Clergé alloit proceffionellement
tous les jeudis pour fe baigner, en chantant les pf.
Afferte Domino.. . Dominas regnavit.... Laudate Dominant.
. .
Un loi d’Honorius , de 409 , ordonne de baigner
les prifoaniers tous les dimanches. S. Rigobert, évêque
de Reims, fit conduire de l’eau à tes chanoines
ad faciendum eis balneuni ; & il eut foin de les pourvoir
de bois pour échauffer l’eau. Le B eu f, Dijfert.
lom. I , in-12. ,
On peut ajouter que Dijon, fous les ducs de la fécondé
race, avoit des bains publics ; il fut ordonné ,
en 1410 , que les hommes iroient le lundi & le mercredi,
& les femmes le mardi & Je jeudi : détentes
furent faites aux hommes de s’immifcér dans les étuves
des femmes, à peine de 5 0 f. d’amende.
Un moine ayant été furpris dans l’étuve des femmes
, fut condamné à l’amende, dont on lui fit grâce
enfuite par révérence pour J'on abbé, en Août 1410.
Reg. de l’hotèl'-de^ville*de Dijon.
Cet établiffement fi utile à la fantéceffa fous Charles
IX. & à peine connoît-on maintenant l’emplacement
de ces bains.
Il y a encore à Paris la rue des vieilles étuves. (C.)
§ B a in , ( Médecine. ) le bain eft l’application
d’un fluide à la'furface du corps humain. La nature
de ce fluide en conftitue les genres. Ses qualités
accidentelles en varient les efpeces, & celles-ci font
divifées à raifon des parties auxquelles ce fluide eft
appliqué, & de la maniéré dont s’en fait l’application.
L’a ir , l’eau, différentes fubftances fluides naturelles
ou factices, font la matière des bains, leurs
différens degrés de chaleur font que refpeftivement
à la température du corps , ces bains font froids ,
frais , tiedes ou chauds. Ils font entiers lorfque tout
le corps eft plongé dans ces fluides, ou l’eft feulement
jufqu’au col. Ils font partiels quand ils ne font appliqués
qu’à une feule partie & prennent alors le
nom de . demi-bains , de bains des pieds , de bains
des mains. Les douches, la ümple irroratipn, font
encore des efpeces de bains partiels.
On parlera' fucceffivement de la maniéré d’agir des
uns & des autres, & l’on indiquera les occafions dans
lefquelles on peut y avoir recours. Mais comme
leurs effets réfultent de l’àéHon des fluides environ-
nans fur le corps humain, c’eft par la connoiffance
exa&e de la nature & des facultés de ce corps,
des propriétés des fluides appliqués à fa furface,
qu’on peut fe rendre raifon des effets des bains, êc
fentir en quelles circonftances on peut en employer
les différens genres & les différentes efpeces.
D ’après cette réflexion , l’on croit devoir entrer ici
dans quelques détails fur l’un & fur l’autre de ces
objets, en fe renfermant dans l’expofition de celles da
leurs qualités d’oii dépend l’énergie des bains.
I. Le corps humain èft un compofé de fibres, fimi-
laires, dont les élémens font une terre ferrugineufe
& un glut en particulier au genre animal, qui lui-
même paroît avoir pour élémens de l’air, du fe l,
de l’eau , de l’huile & une terre crétacée. La différente
combinaifon de ces fibres forme les organiques.
Les unes & les autres font pôreufes, élafti-
ques , fufceptibles d’accroiffement dans toutes leurs
dimenfions, detenfion & de relâchement. Les organiques
font encore irritables & contra&iles, & jouif-
lent de la faculté d’ofciller. La plupart d’entr’elles
font douées de fenfibilité, a raifon des nerfs qui
entrent dans leur composition. Il réfulte de leur
force irritable , contractile & fenfible, qu’en fe
refferrant , elles diminuent le diamètre de leurs
pores & des vaiffeaux dont elles forment les parois.
IJ. C’eft du conta# plus ou moins grand des parties
conftituantes»
«onftituantes, des fibres fimilaires, & de celui de ces
' fibres & des organiques. eotr elles, ainfi que de
l’intégrité du principe vita l, que ces fibres tiennent
leur propriété féfiftante leurs facultés aftives.
V o y e { F i b r e , I r r i t a b i l i t é , N a t u r e , N e r f s ,
S e n s i b i l i t é , D i c l. raif. des S c ien c e s, &c.
Ce conta# peut être affoibli par l’intromiflion des
parties étrangères, moins folides que les élémens
de la fibre, & augmenté par l’extradion ou l’expul-
fion de quelques-uns de leurs élémens. Tant qu’il
eft renfermé dans de juftes bornes, la fibre a un
ton modéré ; fon excès produit une tenfion , fon
défaut un relâchement.
Des caufés, étrangères peuvent' donner lieu à la
tenfion, en enlevant lès.molécules.flexibles, intermédiaires,
fur - tout les aquéufes : elles peuvent
ôccafionner le relâchement, en favorisantl’intromif-
fion de ces molécules.. ,
Le jeu des fibres- excité par des caufes internes,
telles que le principe v ita l, peut encore leur donner
de la tenfion , par l’expulfion des mêmes particules
intermédiaires, & s’oppofer au relâchement, en
refufant' Centrée à celles qui feroient difpofées à
l’opérer par leur introdudion.
III. Toutes, les parties , tous les organes qui
compofent le Corps humain , font formés par ces
fibres diverfement difpofées & arrangées , les fen-
fatioris, l’hoematofe , les fecrétions , les excrétions,
les mouvemens, tant ceux qui font fournis fenfiblé-
ment.à la volonté , que ceux qui en paroiffent
indépendant,, en un mot, toutes les fondions
animales & vitales font le produit du jeu des fibres,
& elles s’exécutent avec une liberté proportionnée
à leur top.
IV. Les vaiffeaux, les nerfs, la peau & le tiffu
céllulaire , font, de.tous les. organes ceux qu’il
eft le plus important de connoître, pour apprécier
la maniéré d’agir des bains ; & parmi les fondions
anima.les, celles qu’il faut principalement s’arrêter
a confidérer ,\font la circulation, la refpiration,
la tranfpiration & les fecrétions.
V. Les vaiffeaiix charient un fluide connu fous lé
nom de maffe humorale. Leur diamètre diminue ou
augmente , & leur adion fur la maffehumorale eft
plus ou moins forte , fuivant que les fibres qui
-compofent ces vaiffeaux font plus ou moins relâchées,
plus ou moins tendus, Voye^ V a i s s e a u x .
Ib id . ( II. )
VI. Les nerfs fervent de condudeurs à un fluide
fubtil, principal mobile de toutes les adions rrié-
chaniques. Voy e^E s p r i t s a n i m a u x , N e r f s . Ibid.
Ils tranfmettent à l’a me l’impreffion des objets qui
les touchent. Le plus & le moins de denfité & de tenfion
dé^leurs ebveloppes , la plus où moins grande
liberté de communication avee les. parties d’oîi
ils tirent leur origine , influent fur leur fenfibilité.
Toute irritation qui en menace l’intégrité, donne
naiffance aux fpalmes & aux convulfiôns. Voy er
C o n v u l s i o n , S p a s m e . Ibid.
VII. La peau qui recouvre la furface externe
du corps, eft formée d’un entrelacement très-ferré
de fibres organiques, de vaiffeaux & de nerfs,
terminés en houpe. Elle amortit l’impreffion des
objets extérieurs par la fermeté de fon tiffu , elle
dort à fes nerfs la fenfibilité dont elle eft douée.
La furface intérieure du corps eft également recouverte
d’une membrane moins ferme & moins épaiffe
que la peau , mais qui, comme elle, modifie l’adion
des fubftances qui la touchent, & eft fenfible à raifon
des nerfs qui s’y épanouiffent. L’une & l’autre font
percées d’une infinité d’ouvertures connues fous le
nom de pores, dont les uns abforbent les fluides
qui leur font préfentés, & les autres exhalent les
humeurs que le jeu des vaiffeaux pouffe à leur
Tome I .
circonférence. Cette exhalaifon eft nommée tranf-
piraùon ; ôn donne le nom tfabforption îi la fonéfion
des pores abforbans. Foye^. P e a u , P o r e s ,
T r a n s p i r a t i o n . Ibid.
VIII. Le tiffu cellulaire immédiatement ‘ placé
i£>\fs la peau, s’enfonce dans toutes les parties même
les plus intimes., les enveloppe, les pénétré ; & formé
de deux efpeces de facs adoffés l’un contre l’autre ,
fuivant Tobfervâtiori Iumineufe" de M. Je Bordeu,
devient à la fois & le réfervoir & le conducteur de
la graiffe , & d’une infinité d’humeurs qui s’y dépo-
fënt. Foye{ Tissu c e l l u l a i r e , ou C o r p s m u q
u e u x . Ibid & Suppl.
IX. Par ce tiffu, il fe forme une correfpondanca
fenfible entre toutes les parties.
Il en eft une autre qu’on nomme fympaihie, dont
les nerfs font les organes, & qui dépend de l’origine
Commune des fibres nerveufes.
Les vaifleaux, par leur communication récipro-*
que, en établiffent un troifieme genre.
X. La maffe humorale, q ui, . fous. ce nom,
comprend le fang, la lymphe & la matière de toutes
les fécretions ( K L y m p h e , S e c r é t i o n s S a n g .
Ibid. ) , eft d’autant plus denfe, que le rapport
de la partie rouge du fang, à la partie féreufe , eft
plus grand, & d’autant moins que la férofité domine
davantage j d’autaht plus fluide qu’elle eft moins
vifqueulé ; d’autant plus âcre, que la partie gélatineuse
& la muqueufe ont été plus atténuées, plus.ani-
malilées, & que le fel ammoniac eft plus développé,
plus à nud, & la ‘partie aqueufe moins abondante;
d autant plus douce , qu’elle contient plus de molécules
aqueufes , & que les mucilagineufes & les
gélatinèufes font plus rapprochées de l’état de mucilage.
L’état fain exige que Ja maffe humorale, foit
dans une proportion convenable avec les vaiffeaux.
Elle peut excéder cette proportion , ou par une
augmentation abfolue, ou par une augmentation
relative ; dans le premier cas, il y a,pléthore Vraie,
qui dépend d’un excès réel de la maffe humorale ;
dans le fécond, c’eft une pléthore fauffe, qui réfulte
de la raréfaftiôn de cettè même maffe humorale ,
ou de ce que le rétreciffement du calibre des vaiffeaux
fait que l’efpace qui doit contenir les humeurs,
n’eft plus proportionnel leur quantité.
XI. On fait par les expériences de M. de Haller,'
que c’eft par fon volume 6c par fes qualités particulières,
que le fang irrite le coeur & les vaiffeaux,'
& follicite leur action. On fait encore que la maffe
humorale circule, à l’aide des vaiffeaux , par le jeu
des nerfs & des mufcles , & cette .circulation très-
rapide' dans quelques vaiffeaux , très-lente dans
d’autres, in fenfible dans la plupart d’entr’eux, con-
denfe, atténue , perfectionne , dépure ou altéré ce
fluide , fuivant l’énergie des refforts qui le mettent
en mouvement, ( II. III. V. )
XII. Les organes oiis’operent le plus fenfiblement
cette élaboration de la maffe humorale, font les poumons
& la peau. Dans les premiers, par leur
développement & leur conftruéHon alternatives,
& par l’effet de l’air qui s’y infinue ( ^ .P oumons.'
Ibid. ) ; dans la peau, par la fermeté de fon tiffu ,
dont la force réfiftante eft augmentée par le poids
de l’âtmofphere. Voyt^ P e a u . Ibid. .
XIII. L’a&ion & la réaâion des folides & des
fluides , mettent.en jeu les molécules ignées répandues
dans les particulés humorales ^.il en réfulte
une chaleur qu’on nomme animale, à raifon dû foyer
qui la produit ;; elle donne au corps une température
indépendante de celle qu’il partage avec ceux qui,
comme lui, font expofés dans l’atmofphere , à la
cajife générale de la chaleur. Les 3 1 , 31 oit 33e
degrés du thermomètre de Réaumur, font ceux
de la chaleur d’un homme fain. Les différens dégré*
C C c c ç