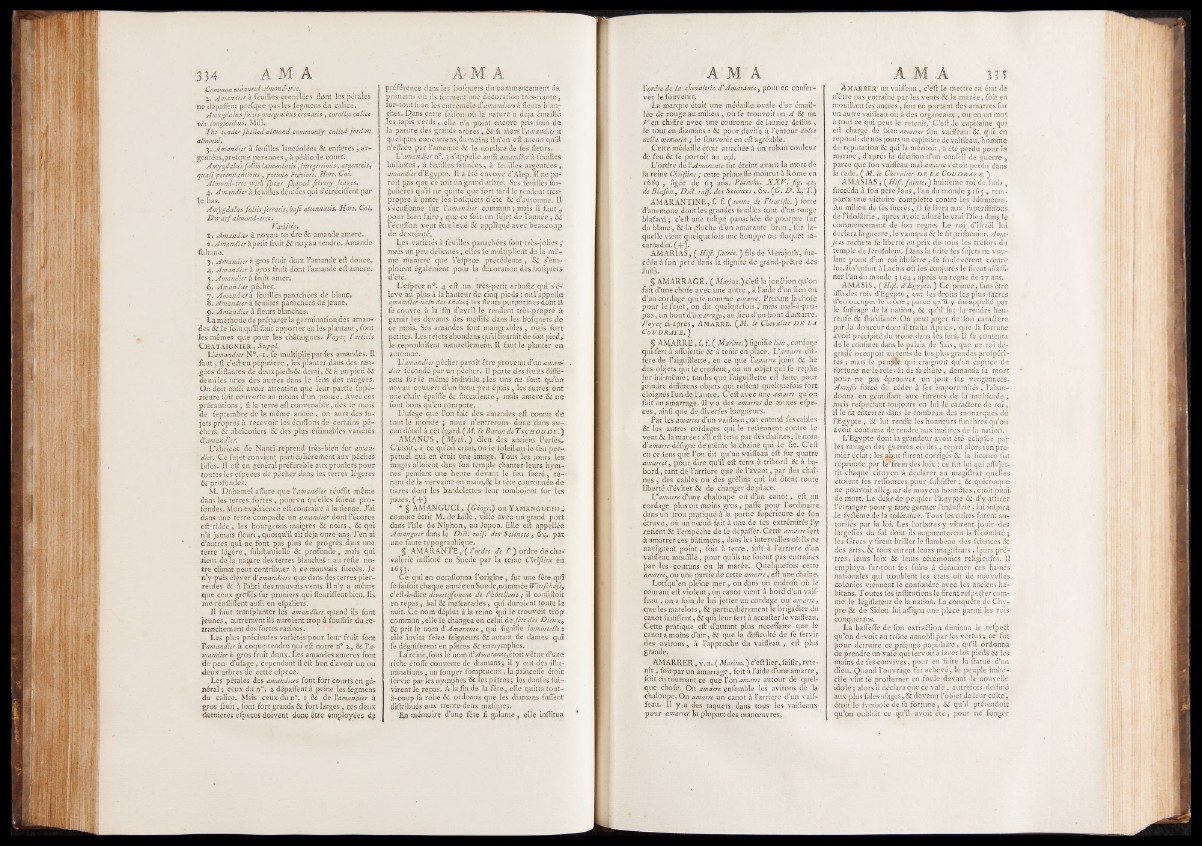
3 3 4 A M A
Common manured almond-tree.
2. Amandier à feuilles crenelées dont les pétales
tie dépafiènt prefque pas les fegmens du calice .. '
Amygdalus foliis marginibus crenatis , corollis calice
yix longioribus. Mill.
The tenderßielled almond commonly called jordan
almond.
3. Amandier à feuilles lancéolées & entières, argentées,
prefque perennes, à pédicule court.
Amygdalus foliis lanceolatis, integerrimis, argenteis,
quafi perennantibûs , petiolo breviore. Hort. Col.
Almond-tree with fpear fhaped Jilvery leaves.
4. Amandier à feuilles dentées qui s’étréciffent par
le bas.
Amygdalus foliis ferratis, baß attenuatis. Hort, Col.
Dwar f almond-tree.
Variétés|
I . Amandier à noyau tendre 8c amande ameré.
a. Amandier à petit fruit 8c noyau tendre. Amande
fulfane.
3. Amandier à gros fruit dont l’amande eft douce.
4. Amandier à gros fruit dont l’amande eft amère.
5. Amandier à fruit amer.
4b. Amandier pêcher.
7. Amandier à feuilles panachées de blanc;
8. Amandier à feuilles panachées de jaune,
9. Amandier à fleurs blanches.
La méthode de préparer la germination des amandes
8c le foin qu’il faut apporter en les plantant, font
les mêmes que pour les châtaignes. Voye1 Varticle
C h â t a ig n ie r , Suppl.
V amandier N°. i . f e multiplie par fes amandes. Il
fau t , fi c’eft en pépinière , les planter dans des rangées
diftantes de deux pieds 8c demi, 8c à un pied &
demi les unes des autres dans le fens des rangées.
On doit aufli avoir attention que leur partie fupé-
rieure foit couverte au moins d’un pouce. Avec ces
précautions, fi la terre eft convenable, dès le mots
de feptembre de la même année , on aura des fu-
jets propres à recevoir les écuflons de certains pêchers
8c abricotiers 8c des plus eftimables variétés
d'amandier.
L’abricot de Nanci reprend très-bien fur aman-
'dier. Ce fujet convient particuliérement aux pêchés
liftes.■ Il eft en général préférable aux pruniers pour
toutes les efpeces de pêcher dans les terres legeres
& profondes,; •
M. Duhamel aflitre que Lamandier réuflit même
dans les terres fortes , pourvu qu’elles foient pro*-
fondes. Mon expérience eft contraire à la fienne. J’ai
dans une terre compacte un amandier dont l’écorce
eft ridée , les bourgeons maigres 8c noirs , 8c qui
n’a jamais fleuri, quoiqu’il ait déjà onze ans. J’en ai
d’autres qui ne. font pas plus de progrès dans une
terre légère, fubftantielle 8c profonde, mais qui
tient de la nature des terres blanches : au refte notre
climat peut contribuer à ce mauvais fuccès. Je
n’y puis élever d'amandiers que dans des terres pier-
reufes 8c à l’abri des,mauvais vents. 11 n’y a même
que ceux greffés fur pruniers qui fleuriffent bien. Ils
me réufliffent aufli en efpaliers.
Il faut tranfplanter les amandiers quand ils font
jeunes, autrement ils auroient trop à fouffrir du retranchement
des fortes racines.
Les plus précieufes variétés pour leur fruit font
¥ amandier à coque tendre qui eft notre n° 2 , & l’amandier
à gros fruit doux. Les amandes ameres font
de peu d’ufage, cependant il eft bon d’avoir un ou
deux arbres de cette efpece.
Les pétales des amandiers font fort courts en général
; ceux du n°. 2 dépaffent à peine les fegmens
du calice. Mais ceux du n°. 1 & de l’amandier à
gros fruit, font fort grands 8c fort larges, ces deux
dernieres efpeçes doivent donc être employées dg
A - M A
préférence dans les bofquets du commencement du
printeroî oit ils forment une décoration très-riante,
lur-toutfion les entremêle d’amandiers à fleurs blanches.
Dans cette faifon ou la nature a déjà émaillé
les tapis verds, elle n’a point encore pris foin de
la parure des grands -arbres, 8c fi alors M amandier a
quelques concurrens,du moins il n’en eft aucun qu’il
n’efface par l’aménité 8c le nombre de fes fleurs.
Vamandier n°. 3 s’appelle aufli amandier à feuilles
luifantes, à feuilles farinées, à feuilles argentées ,
amandier d’Egypte. Il a été envoyé d’Alep. line pa-
roit pas que ce foit un grand arbre. Ses feuilles fin-
gulieres qu’il ne quitte que fort tard le rendent très-
propre à orner les bofquets d’été & d’automne. Il
s’écuffonne fur Vamandier commun ; mais il faut ,
pour bien faire, que ce foit un fujet de l’année , 8c
l’écuffon veut être levé 8c appliqué avec beaucoup
de dextérité.
Les variétés à feuilles panachées font très-jolies £
mais un peu délicates ; elles fe multiplient de la même
maniéré que l’efpece précédente , 8c s’emploient
également pour la décoration des bofquets
d’été,
L’efpeee n°. 4 eft un très-petit arbufte qui s’élève
au plus à la hauteur de cinq pieds : on l’appelle
amandier nain des Indes ; les fleurs purpurines dont il
fe couvre à la fin d’avril le rendent très-propre à
garnir les devants des maflifs dans les bofquets de
ce mois. Ses amandes font mangeables, mais fort
petites. Les rejets abondans qu’il fournit de fon pied,'
le reproduifent naturellement-. Il faut le planter en
automne.
L’amandier pêcher paroît être provenu d’un aman* .
dier fécondé par un pêcher. Il porte des fruits diffé-
rens fur le même individu ; les uns ne font qu’un
noyau couvert d’un brou peu épais , les autres ont
une chair épaiflè 8c fucculente, mais amere 8c ne
font bons qu’en compote.
L’ufage que l’on fait des amandes eft connu de
tout le monde ; nous n’entrerons donc dans aucun
détail à cet égard.(M. le Baron de T s c h o u d y .)
AM ANUS, ( Myth. ) dieu des anciens Perfes.
C’étoit, à ce qu’on croit, ou le foleil ou le feu perpétuel
qui en étoit une image. Tous les jours les
mages alloient dans fon temple chanter leurs hymnes
pendant une heure devant lé feu facré, tenant
de la vervaine en main,8c la tête couronnée de
tiares dont les bandelettes leur tomboient fur les
joues. (+ )
* § AMANGUCI, (Géogr.) ou Y am a n g u ch i ,’
comme écrit M. de Lille, ville avec un grand port
dans l’ifle deNiphon, au Japon. Elle eft appellée
Amanguer dans le DiH. raif. des Sciences, &ct. par,
une faute typographique,
§ AMARANTE, ( Cordre de l ’ ) ordre de chevalerie
inftitué en Suede par la reine Chrijline en
>653- H I . I 1 1 7 ■
Ce qui en occafionna l’origine , fut une fête qui
fe faifoit chaque année en Suede,nommée TVirtfchafty
c’eft-à-dire divertiffement de l ’hôtellerie ; il confiftoit
en repas, bal 8c mafcarades, qui duroient toute la
nuit. Ce nom déplut à la reine qui le trouvoit trop
commun, elle le changea en celui de fête des Dieux,
8c prit le nom à’Amarante , qui lignifie immortelle :
elle invita feize feigneurs 8c autant de dames qui
fe déguiferent en pâtres 8c en nymphes.
La reine,fous le nom ddAmarante,était vêtue d’une
riche étoffe couverte de diamans ; il y eut des illuminations
, un fouper fomptueux, la princeffe étoit
fervie parles nymphes 8c les pâtres; les danfes fui-
virent le repas. A la fin de la fête, elle quitta tout-
à-coup fa robe 8c ordonna que les diamans fuffent
diftribués aux trente-deux mafques.
En mémoire d’une fête fi galante , elle inftituà
A M A
l’ordre de la chevalerie d?Amarante, pour en confer-
ver le fouvenir.
La marque étoit une médaille ovale d’or émaillée
de rouge au milieu , où fe trouvoit un A 8c un
Ven chiffre avec une couronne de laurier deffus ,
le tout en diamans : 8c pour devife à'l’entour dolce
nella memoris. ; le fouvenir en eft agréable.
Cette médaille étoit attachée à un ruban couleur
de feu 8c fe portoit au col. A
L’ordre de l’Amarante fut éteint avant la mort de
la reine Chrijline ; cette pririceffe mourut à Rome en
1689 , âgée de 63 ans. Planche. X X V . fig. 42.
de Blafon-, Dicl. raif. des Sciences, &c. (G. D . L. T.)
AMARÀNTINE, f. f. ( terme de Fleurijle. ) forte
d’anemone dont les grandes feuilles font d’un rouge
blafard; c’eft une tulipe panachée de pourpre fur
du blanc', 8c la plüche d’un amarante brun , fur laquelle
vient quelquefois une houppe ou floquet in-
carnadin. (+ ),
AMARIAS, ( Hijl. facrée. ) fils de Merajoth, fuc-
céda à fon pere dans la dignité de grand-prêtre des
Juifs, ' .
§ AMARRAGE, ( Marine.') c’eft la jonttion qu’on
fait d’une chofe avec une autre , à l’aide d’un lien ou
d’un cordage qui fe nomme amarre. Prenant la chofe
pour le fujet, on dit quelquefois mais mal-à-propos
, un bout dd amarrage, au lieu d’un bout d’amarre.
V o y e i ci-après, Amarre, (df. lé Chevalier d e l a
C o u d r a y e . )
§ AMARRE, f. f. ( Marine.) fignifie lien, cordage
qui fert à aflùjettir 8c à tenir en. place. U amarre différé
de l’aiguillette, en ce que Xamarre joint 8c lie
des objets qui fe croifent, ou un objet qui fe replie
fur lui-même; tandis que l’aiguillette eft faite pour
joindre différens objets qui relient quelquefois fort
éloignés l’un de l’autre. C’eft avec une amarre qu’on
fait un amarrage. Il y a des amarres de toutes elpe-
ces , ainfi que de diverfesTongueurs.
Par les amarres ddun vaiffeau, on entend fes cables
8c les autres cordages qui le retiennent contre le
vent 8c la marée : s’il eft tenu par des chaînes, le nom
d’amarre défigne de même la chaîne qui le lie. C’eft
en ce fens que l’on dit qu’un vaiffeau eft fur quatre
amarres, pour dire qu’il eft tenu à tribord 8c à bâbord,
tant de l’arriere que de l’avant, par des chaînes
, des cables ou des grêlins qui lui ôtent toute
liberté d’éviter 8c de changer de place.
L’amarre d’une chaloupe ou d’un canot, eft un
cordage plus ou moins gros, paffé pour l’ordinaire
dans un trou pratiqué à la partie fupérieure de fon
étrâve, où un noeud fait à une de fes extrémités l’y
.retient 8c l’empêche de fe dépaffer. Cette amarre fert
à amarrer ces bâtimens, dans les intervalles où ils ne
naviguent point, foit à terre, foit à l’arriere d’un
vaiffeau mouillé ; pour qu’ils ne foient pas entraînés
par les courans ou la marée. Quelquefois cette
amarret ou une partie de cette amarre, eft une chaîne.
Lorfqu’en pleine mer, ou dans un endroit où le
courant eft violent, un canot vient à bord d’un vaiffeau
, on a foin de lui jetter un cordage ou amarre,
que les matelots, 8c particuliérement le brigadier du
canot faififfent, 8c qui leur fert à accofter le vaiffeau.
Cette pratique eft d’autant plus néceffaire que le
canot a moins d’air, 8c que la difficulté de fe fervir
des avirons, à l’approche du vaiffeau , eft plus
grande.
AMARRER, v . a. ( Marine. ) c’eft lier, faifir, retenir
, foit par un amarrage, foit à l’aide d’une amarre,
foit en tournant ce que l’on, amarre autour d>e quelque
chofe. On amarre enfemble les avirons de la
chaloupe. On amarre un canot à l’arrie/e d’un vaiffeau.
Il y a des taquets dans tous les vaiffeaux
pouf amarrer la plupart des manoeuvres.
A M A 3 3 î
Amarrer un vaiffeau , c’eft le mettfe en état de
n’être pas entraîné par les vents 8c la marée, foit en
mouillant fes ancres, foit en portant des amarres fur
un autre vaiffeau ou à des organeaux, ou en un mot
à tout ce qui peut le retenir.' C ’eft Je capitaine qui
eft charge de bien am arrer fon vaiffeau ÔC qui en
répond: de nos jours un capitaine de vaiffeau, homme
de réputation 8c qui la méritoit, a été perdu pour la
marine, d’après la décifion d’un confeil de guerre ,
parce que fon vaiffeau mal am a r r é s’étoit perdu dans
la rade. ( M. l e C h e v a l ie r D F . l a C o u d r a y e . )
AMASIAS , ( Hijl. fainte. ) huitième roi de Juda
fuccéda à fon pere Joas, l’an du monde 3165 , remporta
une viéloire complette contre les Idumëens.
Au milieu de fes fuccès, il fe livra aux fuperftitions
de l’idolâtrie , après avoir adoré le vrai Dieu dans le
commencement de fon régné. Le roi d’Ifraël lui
déclara la guerre, le vainquit 8c le fitprifonnier. Ama-
fias racheta fa liberté au prix de tous les tréfors du
temple de Jérufalem. Dans la fuite fes fujets ne voulant
point d’un roi idolâtre , fe fouleverent contre
lui. Il s’enfuit àLachis où les conjurés le firent affaffi-
ner l’an du monde 3194,, après un régné de 27 ans.
AMASIS , ( Hifi. d’Egypte. ) Ce prince, fans être
iffu des rois d’Egypte , eut les droits les plus facrés
d’en occuper le trône, parce qu’il y fut appellé par
le fuffrage de la nation, 8c qu’il fut la rendre heu-
reufe 8c floriffante. On peut juger de fon caraélere
par la douceur dont.il traita Apriès , que la fortune
avoit précipité du trône dans les fers. Il fe contenta
de le confiner dans/le palais de Sais, que ce roi dégradé
occupoit au te ms de fes plus grandes profpéri-
tés ; mais le peujMè qui craignoit qu’un caprice de
fortune ne le relevât de fa chute, demanda fa mort
pour ne pas éprouver un jour fes vengeances.
Amafis forcé de céder à fes importunités, l’abandonna
en gémiffant aux fureurs de la multitude ;
mais refpeclant toujours en lui le caraélere de r o i ,
il le fit enterrer dans- le tombeau des monarques de
l’Egypte , 8c lui rendit les honneurs funèbres qu’on
avoit coutume de rendre aux maîtres de la nation,
L’Egypte dont la grandeur avoit été éclipfée par
les ravages des guerres civiles, reprit alors fon premier
éclat; les abus furent corrigés 8c la licence fut
réprimée par le'frein des loix : ce fut lui qui affujet-
tit chaque citoyen à déclarer au magiftrat quelles
étoient fes reffources pour fubfifter ; 8c quiconque
ne pouvoit alléguer de moyens honnêtes, étoit puni
de mort. Le défir de peupler l’Egypte 8c d’y attirer
l’étranger pour y faire germer l’induftrie, lui infpira
le fyfteme de la tolérance. Tous les cultes furent au-
torifé.s par la loi. Les barbares y vinrent jouir des
largeffes du fol dont ils augmentèrent la fécondité ;
les Grecs y firent briller le flambeau des fciences.8c
des arts, 8c tous eurent leurs magiftrats, leurs prêtres,
leurs loix & leurs cérémonies religieufes. Il
employa fur-tout fes foins à déraciner ces haines
nationales qui troublent les états où de nouvelles
colonies viennent fe confondre avec les. anciens ha-
bitans. Toutes fes inftitutions le firent refpeéler comme
le légiflateur de la nation. La conquête de Chypre
8c de Sidon lui affigna une place parmi les rois
conquérans.
La baffeffe de fon extraction diminua le refpeél
qu’on devoit au trône annobli par fes vertus ; ce fut
pour détruire ce préjugé populaire, quil ordonna
de prendre un vafe qui fervoit à laver les pieds 8c les
mains de fes convives, pour en faire la ftatue d’un
dieu. Quand l’ouvrage fut achevé, le peuple imbécile
vint fe profterner en foule devant la nouvelle
idole ; alors il déclara que ce v a fe, autrefois deftiné
aux plus fales ufages, 8c devenu l’objet de leur culte,
étoit le fymbole de fa fortune , 8c qu’il préte^ndoit
qu’on oubliât ce qu’il avoit é té , pour ne fonger