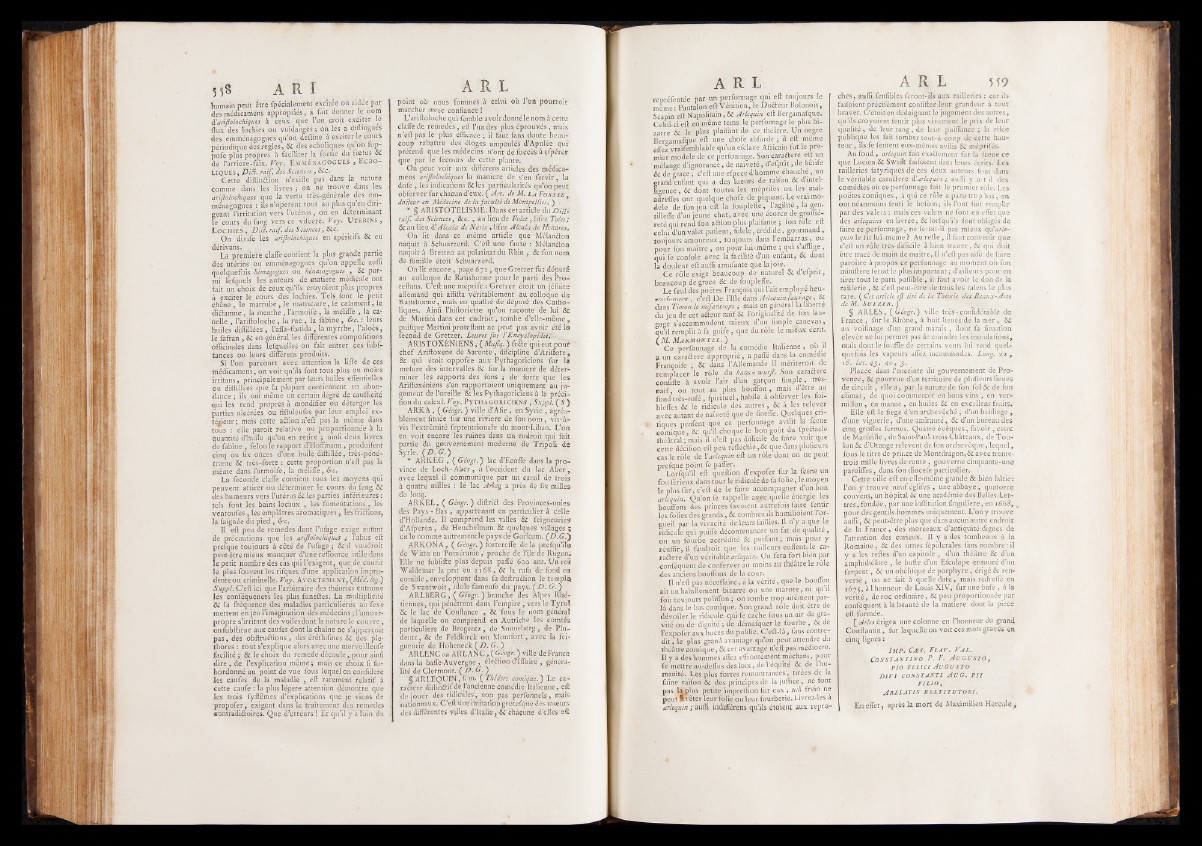
5 A R I
humain peut être fpécialement excitée ou aidée par
des médicamens appropriés, a fait donner lé nom
à’arlflolochiqu e s à ceux que l’on croit exciter lè
flux des lochiés ou vuidarigès ; On les a diftingùés
des emménagogues qu’on deftine à exciter le cours
périodique des réglés, & des ecboliques qu’on fup-
pofe plus propres à faciliter la fortie du foetus &
de l’arriëre-faix. Voy. E m m e n a g o g ü è s , Ecbo-
LIQÜES, Dict. raif. des Sciences , Sic.
Cette diftin&ion n’exifte pas dans la nature
comme dans les livres i on në trouve dans les
àriflolochïques que la vertu ttès-génerale des em-
menagogues : ils n’operent tout au plus ^u’en dirigeant
l’irritation vers l’utérus, où en déterminant
le cours du fang vers ce vifcere. Pôÿ. Ut érin s ,
L o ch ie s , Dicl. raif. des Sciences, Sic.
On divife les arijtolochiques en apéritifs Si en
dérivans. , , . . . f . .
La première clafle contient la plus grande partie
des utérins bu emménagogues qu’on appelle auffi
quelquèfois hètnagogues _ ou kenatogogues , Si parmi
lefquels les auteurs de «natiere médicale ont
fait un choix de ceux qu’ils crbyoient plus propres
à exciter le cours des lochies. Tels, font le petit
chêne , le marrube,le matricaire, le calament,le
diûamne, la menthe , l’armoife , la méliffe , la ca-
nelle , l’ariftoloche ,1 a rue , la fabine , &c. : leurs
huiles diftilléës , l’afla-foetida , la myrrhe, l’aloès,
le fafran , Si en général les différentes compôfitions
officinales dans lefquelles on fait entrer ces fubf-
tances ou leurs différens produits. .
Si l’on parcourt avec attention la lifte de ces
médicamens, on voit qu’ils font tous plus ou moins
irritans, principalement par leurs huiles effentielles
ou diftiilees que la plupart contiennent en abondance
; ils ont même un certain dégré de cauftiçité
qui les rend propres à m'ondifîer bu déterger les
parties ulcérées ou fiftuleufes par leur emploi extérieur
; mais cette a&ion n’eft pas la même dans
tous : elle paroît relative ou proportionnée à la
quantité d’huile qu’on en retire ; ainfi deux livres
de fabine , félonie rapport d’Hoffmann, produifent
cinq bu fix onces d’une huile diftillée, très-pené-
trante & très-forte : cette proportion n’eft pas la
même dans l’ârmoife, la méliffe, &c.
La fécondé clafle contient tous les moyens qui
peuvent attirer ou déterminer le cours du fang &
des humeurs vers l’utérus & les parties inférieures :
tels font les bains locaux , les fomentations , les
ventoufes , les emplâtres aromatiques, lesfriéïions,
la faignée du pied, &ç.
Il eft peu de remedes dont l’iifage exige autant
de précautions que les anftolochiques ; l’abus eft
prefque toujours à côté de Tiifage ; & il vaudroit
peut-être mieux manquer d’une, reffource utile dans
le petit nombre des cas qui l ’exigent, que de courir
le plus fouveùt les rifques d’une application impru-r
dente ou criminelle. Voy. A v o r t em e n t , ÇMéd.leg.)
Suppl. C’eft ici que l’arbitraire des théories entraîne
les conféquences les plus funeftes. La .multiplicité
6 la fréquence des maladies particulières au fexe
mettent enjeu l’imagination dés médecins ^’amour-
propre s’irritant des voiles dont la nature lé couvre,
onfubftitue aux caufes dont la chaîne ne s’apperçoit
pas, des obftruéiions, des eréthifmès & des pléthores
: tout s’explique alors avec une merveilleufe
facilité ; & le choix du remede découle , pour ainfi
dire , de l’explication même ; mais ce choix fi fu-
bordonné au point de vue fous lequel on confidere
les caufes de-la maladie., eft rarement relatif à
cette caufe : la plus légère attention démontre que
les trois fyftêmes d’explications que.je viens de
propofer, exigent dans le traitement des remede.s
«ontràdi&oires. Que d’erreurs ! Et qu’il y a Foin du
point oh nous fomihesà celui oh l’on pourroit
marcher avec confiance !
L’ariftoloche qui femble avoir donné le nom à cette
clafle de remedes, eft l’un des plus éprouvés, mais
n’éft pas le plus efficace ; il faut fans doute beaucoup
rabattre des éloges ampoulés d’Apülée qui'
prétend que les médecins n’ont de fuccès à efpérer
que par le fecours dè cette plante.
On peut voir aux différens articles des médica-
mèns aristolochiques la maniéré de s’en fervir, la
dofe , les indications & le s particularités qu’on peut
obfervér fur chacun d’eux. ( Art. de M. l a Fos s sè ,
docteur en Médecine de la S acuité de Montpellier.') ■
* § ARISTOTELISME. Dans cet article du Dicl»
raif. des Sciences, &c. , au liçu de Folee , lifez Tolet;
& au lieu d' Alcala de Naris , lifez Alcala de Henares.
On lit dans ce même article que Mélanélon
naquit à Schuarzerd. C ’eft une faute : Mélandon
naquit à Bretten au palatinat du Rhin , & fon nom
de famille étoit Schuàr'zerd.
On lit encore , page'671, que Gretzer fut député
au colloque de Ra'tisbonne pour le parti des Pro-
tëftans. C’eft une méprife : Gretzer étoit un jéfuite
allemand qui aflifta véritablement au colloque de
Ratisbonne, mais en qualité de député des Catholiques.
Ainfi l’hiftoriette qu’on raconte de, lui &
de Martini dans cet endroit, tombe d’elle-même ,
puifqué Martini proteftant. ne peut pas avoir été la
fécond de Gretzer. Lettres fur tEncyclopédie^';-
ARISTOXÈNIENS, ( Mufîq. ) fede qui eut pouf
chef Ariftoxene de Sàrënte , discipline d’Ariftote ,
& qui étoit oppoféè aux Pythagoriciens fur là
mefure des intervalles & fur la maniéré de déterminer
les rapports des fons ; 'de* forte 'que les
Àriftoxéhiens s’en rapportoient uniquement au jugement
de l’oreille & les Pythagoriciens à la préci-
fion du.calcul. Voy. Py thagoricien s fSuppl. ( 31)
A R K Â , ( Géogr.) ville d’Afie , en Syrie , agréablement
fituéè fur une riviere de fon nom, vis-à-
vis l’extrémité fepterttrionale du mont-Liban. L’on
en voit encore les ruines dans u'n endroit qui fait
partie du. gouvernement moderne de Tripoli dè
Syrie. ( D. G. )
* ARKEG , ( Géogr. ) lac d’Ecoffe dans la province
de Loch'-Aber, .à l’occident du lac Ab er,
avec lequel il communique par un cariai de trois
à quatre milles : lé lac Arkeg a près de fix milles
dè long.'
ARKEL, ( Géogr.') diftrift des Provirices-unies
des Pays - Bas , appartenant en particulier à celle
d’Hollande. 11 comprend les villes & feigneuries
d’Afperen, de Heucheliium & quelques villages ;
on le nomme autrement le pays de Gorkum. (D .G .)
ARKON A, ( Géogr. ) fortereffe de la prefqu’îla
de "Witto en Poméranie, proche de l’île de Rugen.'
Elle ne fubfifte plus'depuis paffé 600 ans. Un roi
"Valdemâf la prit en 1168 , & la rafa de fond en
comble, enveloppant dans fa deftruâion le temple*
de SVantwoit, idole fameufe du pays. ÇD. G. )
ARLBERG, ( Géogr. ) branche des Alpes Rhé-
tiennes, qui pénètrent dans l’empire, vers le T yroï
& le lac de Confiance , & fous le nom général
'de laquelle on comprend en Autriche les comtés
particuliers de Bregëhtz, de Sorineberg, de Plu-
deritz, ’& de Fëldkirclc ou Montfôrt', avec la fei-
gneurie de Hoheneck(Z?. G .)
ARLENC ou AR.LANC, (Géogr. ) ville de France
dans la baffe-Auvergne , éleélion d’ifloire , généra-,
lité de Clermont. ( p - G. )
§ ARLEQUIN, fm . ( Théâtre comique.) Le caractère
diftinétif de l’ancienne comédie Italienne, eft:
de jouer des ridicules , non pas perfo'rinel^, mais
nationnaux. C’eft: une*imitation grotefqùe des moeurs
des dïfférentes villes d’Italie chàeuhë d’elles eft
reptéfentée par un perfonnage qui eft toujours le
même: Pantalon eft Vénitien, le Dofteur Bolonois,
Scapin eft Napolitain, & Arlequin eft Bergamafque.
Celui-ci eft en même teins le perfonnage le plus bi-
zarre & le plus plaifant de ce théâtre. Un negre
Bergamafque eft une chofe abfurde ; il eft même
aflez vraifemblable qu’un efclave Africain fut le premier
modèle de ce perfonnage. Son cara&ere eft un
'‘mélange d’ignorance, de naïveté, d’efprit, de betife
& de grâce ; c’eft une efpece d’homme ébauché, un
grand enfant qui a des lueurs de raifon & dintel-
Egence, & dont toutes les méprifes ou les mal-
adreffes ont quelque chofe de piquant. Le vrai modèle
de fon jeu eft la foupleffe,( l’agilité, la gen-
tilleffe d’un jeune chat, avec une écorce de groflie-
reté qui rend fon a£tion plus plaifante ; fon rôle eft
celui d’un valët patient, fidele, crédule, gourmand,
toujours amoureux, toujours dans 1 embarras , ou
pour fon maître , ou pour lui-même ; qui s’afflige,
qui fe confole avec la facilité d’un enfant, & dont
la douleur eft auffi amufante que la joie. .
Ce rôle exige beaucoup de naturel & d’efprit,
beaucoup de grâce & de foupleffe.
Le feul des poètes François qui l’ait employé heu-
reufement, c’eft De l’Iflè dans Arlequinf zuvage, &
dans Timon le mifantrope ; mais en général la liberté
du jeu de cet afteur naïf & l’originalité de fon langage
s’accommodent mieux d’un fimple canevas,
qu’il remplit à fa guife , que du rôle le mieux écrit.
TM. Ma rm o n t e l . ) . . I '
Ce perfonnage de la comédie Italienne , ou il
a un cara&ere appropriera paffé dans la comédie
Françoife ; & dans l’Allemande il mériteroit de
remplacer le rôle du hans - wurjl. Son caraûere
' confifte à avoir l’air d’un garçon fimple , très-
naïf, ou tout au plus bouffon, mais detre.au
fond très-rufé, fpirituel, habile à obferver les foi-
bleffes & le ridicule des autres, & à les relever
avec autant de naïveté que de fineffe. Quelques critiques
penfent que ce perfonnage avilit la feene
comique, & qu’il choque le bon goût du fpeaacle
théâtral ; mais il n’eft pas difficile de faire voir que
cette détifion eft peu réfléchie, & que dans plufieurs
cas le rôle de Xarlequin eft un rôle dont on ne peut
prefque point fe paffer.
Lorfqu’il eft queftion d’expofer fur la feene un
fou férieux dans tout le ridicule de fa folie, le moyen
le plus fur, c’eft de le faire accompagner d’un bon
arlequin. Qu’on fe rappelle ay,ec quelle énergie les
bouffons des princes fa voient autrefois faire fentir
les folies des grands, & combien ils humilioient 1 orgueil
par la vivacité deleursfaillies.il n y a que le
ridicule qui puiffe décontenancer un fat de qualité,
ou un fourbe accrédité & puiffant; mais pour y
réuffir, il faudfoit que les railleurs euffent-le ca-
raûere d’un véritable arlequin. On fera fo^rt bien par
conféquent de conferver au moins au théâtre le rôle
des anciens bouffons de la cour.
Il n’eft pas néceflaire, à la vérité, que le bouffon
ait un habillement bizarre ou une marote, ni qu’il
foit toujours poliffon ; on tombe trop ailément par-
là dans le bas comique. Son grand rôle doit être de
dévoiler le ridicule qui lé cache fous un air de gravité
ou de dignité ; de démafquer le fourbe , & de
l’expofer aux huées du public. C’eft-là, fans contredit
, le plus grand avantage qu’on peut attendre du
théâtre comique, & cet avantage n’eft pas médiocre.
Il y a des hommes affez effrontément médians, pour
fe mettre au-deffus des loix, de l'équité de 1 humanité.
Les plus fortes remontrances, tirees de la
faine raifon & des principes de la juftice, ne^ font
pas lajjplus petite impreflion fur eux ; nul frein ne
peut Prêter leur folie ou leur fourberie. Livrez-les à
arlequin ; auffi indïfférens qu’ils étoient aux reprochés,
auffi fenfibles feront-ils aux railleries : car ils
faifoient précifément confifter leur grandeur à tout
braver. C’étoit en dédaignant le jugement des autres,
qu’ils .croyoient fentir plus vivement le prix de leur
qualité, de leur rang, de leur puiffance ; la rifée
publique les fait tomber tout-à-coup de cette hauteur,
ils fe feritent eux-mêmes avilis & méprifés.
Au fond, arlequin fait exactement fur la feene ce
que Lucien & Swifft faifoient dans leurs écrits. Les
railleries fatyriques de ces deux auteurs font dans
le véritable cara&ere d'a r leq u in ; aufli y a-t il des
comédies où ce perfonnage fait le premier rôle. Les
poètes comiques, à qui ce rôle a paru trop bas, en
ont néanmoins fenti le befoin; ils l’ont fait remplir
par des valets : mais ces valets ne font en effet que
des arlequins en livrée, & lorfqu’ils font obligés de
faire ce. perfonnage, ne fe:oit-il pas mieux oy?arlequin
le fît lui-mëme ? Au refte , il faut convenir que
c’eft un rôle très-difficile à bien traiter, & qui doit
être tracé de main de maître, Il n’eft pas aifé de faire
paroître à propos ce perfonnage au moment oh fon
miniftere leroitle plus important ; d’ailleurs pour en
tirer tout le parti pofiible, il faut avoir le don de la
raillerie , & c’eft peut-être' de tous les talens le plus
rare. ( Cet article efi tiré de la Théorie des B e a u x -A r t s
de M . S u 1 z E R . )
§ ARLES, ( Géogr. ) ville très considérable de
France, furie Rhône, à huit lieues de la mer, Sc
au voifinage d’un grand marais , dont fa fituation
élevée né lui permet pas' de craindre tes inondations,
mais dont le fouffie de certains vents lui rend quelquefois
les vapeurs affez. incommodes. Long. 2.2 ,
18. lat.' 43, 40, 3 . _
Placée dans l’enceinte du gouvernement de Provence',
& pourvue d’un territoire de plufieurs lieues
de circuit, elle a , par la nature de fon fol & de fon
climat, de quoi commercer en bons vins , en vermillon
, en manne , en huiles & en excellens fruits.
Elle eft le fiege d’un archevêché, d’un bailliage ,
d’une viguerie, d’une amirauté, & d’un bureau des
cinq groffes fermes. Quatre évêques, favoir, ceux
de Marfeillé , de Saint-Paul-trois-Châteaux, de Toulon
& d’Orange relevent de fon archevêque, lequel,
I fous le titre de prince de Montdragon, & avec trente-
! trois mille livres de rente , gouverne cinquante-une
paroiffes, dans fon diocefe particulier.
Cette ville eft en elle-même grande & bien bâtie:
1 Fon y trouve neuf églifes , une abbaye, quatorze
couvens, un hôpital & une académie des Belles-Lettres
, fondée, par uné inftitution finguliere, en 1668, „
pour-des gentils-hommes uniquement. L’on y trouve
auffi, & peut-être plus que dans aucun autre endroit
de la France, des morceaux d’antiquité dignes de
l’attention des curieux. Il y a des tombeaux à la
Romaine , & des urnes fépulcrales fans nombre : il
y a les reftes d’un capitôle , d’un théâtre & d’un
amphithéâtre , le bufte d’un Efculape entouré d’un
ferpent, & un obélifque de porphyre, érigé & ren-
verfé on ne fait à quelle date, mais redreffé en
1675 , à l'honneur de Louis X IV, fur une bafe , à la
vérité, de roc ordinaire, & peu proportionnée par
conféquent à la beauté de la matière dont la piece
eft.fofmée.
[ Arles érigea une colonne en l’honneur du grand
Conftantin, fur laquelle on voit ces mots gravés en
cinq lignes :
Im p . Cæs. Fl a v . Va l .
. CO N ST AN T IN O P . F . A U G U S T O ,
P IO FE L 1C I A ü G U ST O
D I V I CO N ST AN T I A ü G . P I I
F I L I O ,
A R E L A T IS R E S T IT U T O R I .
| En effet, après la mort de Maximilien Hercule y