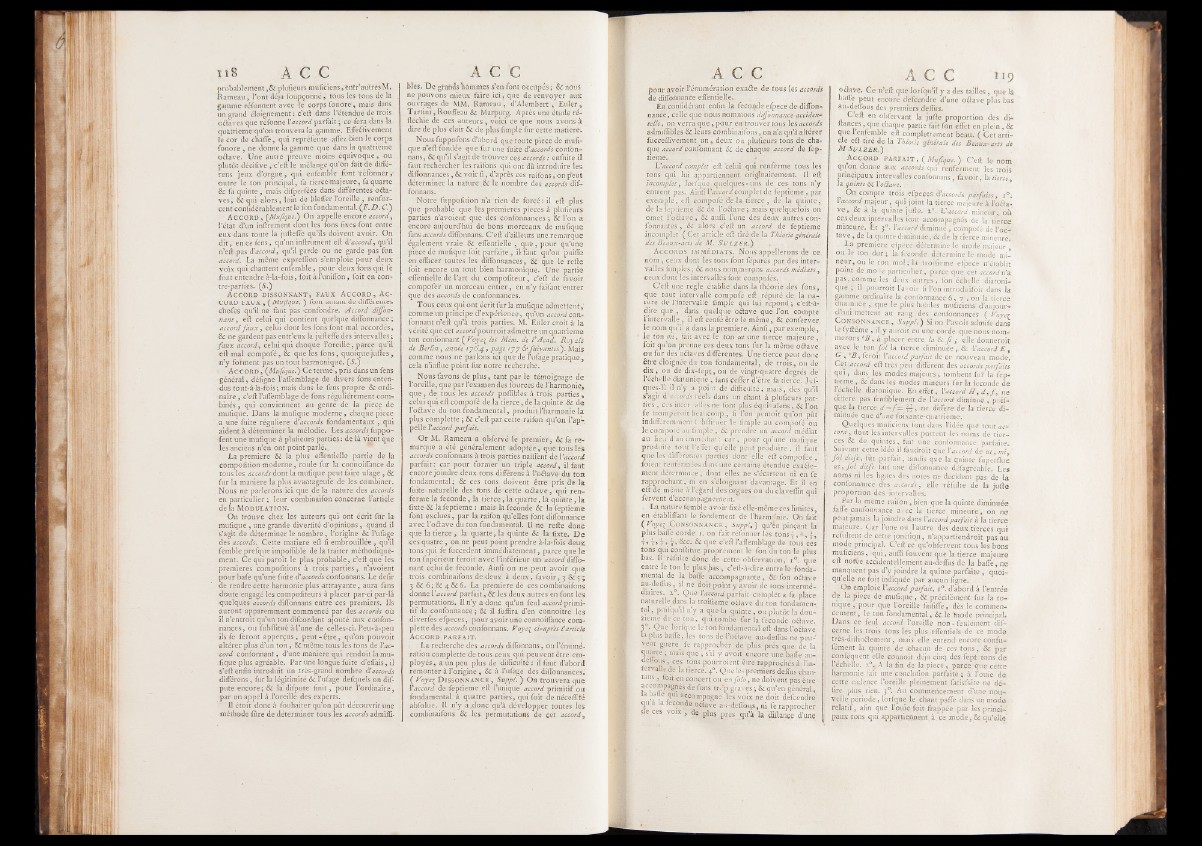
probabletfièft't ,& plufieurs mùficiens, eritr’aûffèsM.
•Rameau, l’ont déjà SoupçonnéI tous les tons de la
gamme réfonnent avec 4e corps fonore, mais dans
un grand éloignement : c’eft -dans T'étendue de trois
odàves que réfonneYaccord parfait ; ce fera dans la
quatrième-qu’on trouvera la gamme. Effectivement
le cor de chàffe, 'qui repréfente -affez bien le corps
fonore , ne donne la gamme que dans la quatrième
oétave. Une autre preuve moins équivoque, ou
plutôt décifîve , 'C’eft le mélange qu’on fait-de différens
jeux d’orgue, qui enfemble font téfonner ,•
outre le ton principal, fa tierce-majeure, fa quarte
& fa quinte, mais difperfées dans différentes o&a-
v e s ; & qui alors, loin de bleffer l’oreille , renforcent
confidérablement le Ion fondamental. -(F.D. C.)
Accord , (Mufique.) On appelle encore accord,
l ’état d’un infiniment dont les fons fixes font entre
eux dans toute la jufteffe qu’ils doivent avoir. On
dit, en ce fens, qu’un infiniment eft d'accord, qu’il
n’efi-pas $ accord, qu’il garde ou ne garde -pas fon
accord. La même expreffion s’emploie pour deux
voix qui chantent enfemble , pour deux fons qui fe
font entendre à-la-fois, foit à l’uniffon, foit en contre
parties. (Si)
A ccord dissonnant, -f a u x Accord, Accord
faux , ( Mujîque-, ) font autant de différentes
•chofes qu’il ne faut pas ‘confondre. Accord difon-
nant, èft Celui qui contient quelque diffonnance ;
accord fa u x , celui dont les fons font mal accordés,
& ne gardent pas entr’eux la juftefie des intervalles ;
faux accord, celui qui choque l’oreille, parce qu’il
eft mal compofé, & que les fons, quoique juftes,
•n’y forment pas un tout harmonique, (é1.)
Accord , ( Mujîque.) Ce terme, pris dans un fens
•général, défigne Taffemblage de divers fons enten-
dus tout-à-la-fois ; mais dans le fens propre & ordinaire
, c’eft Taffemblage de fons régulièrement combinés
, qui conviennent au genre de la piece de
mufique. Dans la mufique moderne, chaque piece
a une fuite régulière d’accords fondamentaux , qui
aident a déterminer la mélodie. Les accords fuppo-
fent une mufique à plufieurs parties: de là vient que
les anciens n’en ont point parlé.»
La première & la plus effentielle partie de la
compofition moderne, roule fur la connoiffance de
tous les accords dont la mufique. peut faire ufage , &
fur la maniéré la plus avantageuse de les combiner.
Nous ne parlerons ici que de la nature des accords
en particulier ; leur eombinaifon concerne l’article
de la Modulation.
On trouve chéi les auteurs qui. ont écrit fur la
mufique , une grande divërfité d’opinions, quand il
s’agit de déterminer le nombre, l’origine & l’ufage
des accords. Cette matière eft fi embrouillée, qu’il
femble prefque impoflible de la traiter méthodiquement.
Ce qui paroît le plus probable, c’ eft que les
premières compofitions à trois parties , n’avoient
pour bafe qu’une fuite d’accords confonnans. Le defir
-de rendre-cette harmonie plus attrayante, aura fans
doute engagé les compofiteurs à placer par-ci par-la
quelques accords diffonnans entre ces premiers. Ils
auront apparemment commencé par des accords où
il n’entroit qu’un ton difcordant ajouté aux corifon-
nances, ou fubftitué à Tune de celles-ci. Peu-à-peu
ils fe feront apperçus , peut - être, qu’on pouvoit
-altérer plus d’un ton , &-même tous les tons de Vaccord
confonnant, d’une maniéré qui rendoit la mufique
plus agréable. Par une longue fuite d’effais, il
s’eft enfin introduit ùn très-grand nombre d'accords
différens, fur la légitimité & l’ufage defquels on dif-
pute encore; & la difpute finit, pour l’ordinaire,
par un appel à l’oreille des experts.
Il étoit donc à fouhaiter qu’on pût découvrir une
méthode fùre de déterminer tous les accords admifiiblés.
De grands liômmes s’en font occupés ; & nous
ne pouvons mieux faire ic i, que de renvoyer aux
ouvrages de MM. Rameau, d’Alembert , Euler,
Tartini, Rouffeau & Marpurg. Après Une étude réfléchie
de -ces auteurs, voici ce qiie nous avons à
dire de plus clair & de plus fimple fur cette matière.
Nous fuppofons d’abord que toute piece de mufique
n’eft fondée que fur une fuite d'accords confonnans,
& qu’il s’agit de trouver ces accords: enfuite il
faut rechercher les raifons qui ont dû introduire les
difïonnances, & voir fi , d’après ces raifons, on peut
déterminer la nature .& le nombre des accords diffonnans.
Notre fiippofition n’a rien de forcé : il eft plus
que probable que les premières pièces à plufieurs
parties n’avoient que des confonnances ; & Ton a
encore aujourd’hui de bons morceaux de mufique
fans accords diffonnans. C ’eft d’ailleurs une remarque
également vraie & effentielle , qu e , pour qu’une
piece de mufique foit parfaite, il faut qu’on puiffe
en effacer toutes les diffonnances, & que le refte
foit encore un tout bien harmonique. Une partie
effentielle de l’art du compofiteur, c’eft de favoir
cbmpofèr un morceau entier, en n’y faifant entrer
que des accords de confonnances.
Tous ceux qui ont écrit fur la mufique admettent,'
Comme un principe d’expérience, qu’un accord confonnant
n’eft qu’à trois parties. M. Euler croit à la
vérité que cet accord pourroit admettre un quatrième
ton confonnant ( Voye^ les Mérn. de l'Acad. Royale
de Berlin, année 1 J 6 4 , page ryy & fulvantes'). Mais
comme nous ne parlons ici que de l’ufage pratique ,
Cela n’influe point fur notre recherche.
Nous favons de plus, tant par le témoignage de
l’oreille, que par l’examen des Sources de,l’harmonie,
que, de.tous,les accords: poffibles'à trois parties ,
celui qui eft compofé ;de la tierce, de la quinte & de
l’o&ave du-ton fondamental, produit Tnarmonie la
plus complette ; & c’eft par cette raifon .qu’on l’ap*-
pelle l’accord parfait.
Or M. Rameau a obfervé le premier, & f a remarque
a été généralement adoptée, que tous les
accords conionnzns à trois parties naiffent dé l ’accord
parfait; car pour former un triple accord, il faut
encore joindre deux-fons différens à Toftave- du ton
fondamental; & ces tons doivent être pris de là
fuite, naturelle des tons dé cette otta v e, qui renferme
la fécondé, la tierce , la quarte, la quinte, là
fixte & la feptieme : mais la fécondé & la Septième
font exclues, par la raifon qu’elles font diffonnance
avec Toftave du ton fondamental. Il né refte donc
que la tierce , la quarte, là quinte & la fixte. D e
ces quatre, on ne peut point prendre à-la-fois deux
tons qui fe fuccedent immédiatement, parce que le
ton fupérieur feroit avec l’inférieur un accord diffo-
nant celui de fécondé. Ainfi on ne peut avoir que
trois combinaifons de deux à deux, favoir, 3 & y-
3 & 6 ;& 4 & 6 . La première de ces combinaifons
donne l ’accord parfait, & les deux autres en font les
permutations. Il n’y a donc qu’un feul accord primitif
de confonnance ; & il fuffira d’en connoître les
diverfes efpeces, pour avoir une connoiffance cora-
plette des accords confonnans. Voye^ ci-après l’article
Accord parfait.
La recherche des accords diffonnans, ou Rémunération
complette de tous ceux qui peuvent être employés,
a un peu plus de difficulté : il faut d’abord
remonter à Torigine , & à l’ufage des diffonnances^
( Voye^ Dissonnance , Suppl. ) On trouvera que
l’accord, de feptieme eft Tunique accord primitif ou
fondamental à quatre parties, qui foit de néceflifé
abfolue. Il n’y a,donc qu’à développer toutes les J combinaifons & les permutations de cet accord,
pour avoir l’énumération exafte de tous les accords
de diffonnance effentielle.
En confidérant enfin la fécondé efpece de diffonnance,
celle que nous nommons diffonnance accidentelle,
on verra qu e , pour en trouver tous les accord
admiffibles & leurs combinaifons, on n’a qu’à altère?
fucceflivement un, deux ou plufieurs tons de chaque
accord confonnant &c de chaque accord de fep-
rieme..
L ’accord complet eft celui qui renferme tous les
tons qui lui appartiennent originairement. Il eft
incomplet, lorfque . quelques - uns de ces tons n’y
entrent pas. Ainfi T^ccor^complet de feptieme;, par
exemple, eft compofé .de la tierce , de la quinte,
de la feptieme & de l’oftave ; mais quelquefois on
omet l’oiftave,' & aufli l’une des deux autres,con-
fonnantés, &c alors c eft un accord de feptieme
incomplet-. ( Cet article eft tiré de la Théorie générale
des Beaux-arts de M. SuL ZERÎ)
Accords immédiats. Nous appellerons de Ce,
nom, ceux dont les tons font féparés par des intervalles
Amples ; & nous nonynerpns accords médiats,
ceux dont les intervalles font compofés.
C’eft: une réglé établie dans.la: théorie des fons,
que tout intervalle compofé .eft réputé de la na-
ture de l’intervalle fimple qui lui répond ; c’eft-à-
dire que , dans quelque oâave que Ton compte
Tinteryalîe , il eft cenfé être le même, & conferver |
le nom qu’il a dans la première. Ainfi, par exemple, 1
le ton mi, fait avec le ,ton ut une tierce majeure , !
foit qu’on prenne ces deux tons fur la même ofrave j
ou fur des oriaves différentes. Une tierce peut donc
être éloignée du ton fondamental, de trois, ou de !
d ix , ou de dix-fept, ou de vingt-quatre degrés de
Téchelle diatonique , fans Ceffér d’être fa tierce: Juf-
ques-là il n’y a point de difficulté; mais, dès qu’il
s’agit d accords réels dans un chant à plufieurs parties
, ces inter. ailes ne font plus équivalens, & Ton
fe trompèroit beaucoup, fi Ton penloit qù’on pût
indifféremment 1 nbftituer le fimple au compofé ou
le compote *au fimple , & prendre un accord médiat
au lieu d’un immédiat": c a r , pôur qu’une mufique
produife tout l’effet qu’elle péut produire , il faut
que les'différentes pàrrie^ don^êlië eft cbrppôfée , ‘ '
foient renfermées dans une cerraine étendué éxaéle-
mènt déterminée, dont elles ne s’écartent ni en fe
rapprochant, ni en s’éloignant davantage. Et il en
eft-de même à l’égard des Orgues ou du clàveflîn qui
fervent d’accômpagnementT- v
■ La nature femble avoir fixé elle-même ces limites,
en établiffant le fondement de Tharmo'nie. On fait
( f^oye^ vC onsonnance , Suppl,') qu?én pinçant la
plus baffe corde 1. on fait réfonner les tons^,-1-, i
f » i t I5 &c. & que c’èft Taffemblage de tous ces
tons qui conftitue proprement le fon du ton le plus
bas. IT refui te-donc de cette obfervation, i° . que
entre le ton le plus\bas , c’eft-à-dire entre le'fondamental
de la baffe accompagnante, &-fon oftave
au-deffus, il ne doit point y avoir de tons-intermédiaires.
z°. Que Taccord parfait complet a fa place
naturelle dans la troifieme oriave.du ton fondamental
, puifqu’il n’y a que la quinte , ou plutôt la dou-
iteme de ce ton, qui tombe fur la fécondé oriave. ,
3 • Q ue lorfque le ton fondamental eft dans l’oétave
la plus baffe, les tons de l’oêiave au-deffus ne peuvent
guere fe rapprocher de plus près que; de la !
qujirte ; mais que , s’il y avoit encore une baffe au- ;i
deffous, ces tons pourroient être rapprochés à' Tin- ,
tervalle de la tierce. 40. Que les premiers déffus chan- :
tans , foit en concert ou en folo, ne doivent pas être !
accompagnés de fons trop graves ; & qu’en général, •
là batte qui accompagne les voix ne doit defcéndre
qu à la fécondé oftave au-deffous, ni fe rapprocher ;
de ces voix , de plus près qu’à la diftanee d’une i
oftaVe. C e m’eft que lorfqu’il y a des taiÜes, que la
baffe peut encore defeendre d’une oftave plus bas
au-deffous des premiers deffus.
C eft en obfervant la jufte proportion des dî^-
ftances, que chaque partie fait fon effet en plein , &
que 1 enfemble eft complettement beau. ( Cetarti-
cle eft tire de la Théorie générale des Beaux-arts de
M Su l z e r .)
Accord parfait, (M u fiq u e .) C’eft le nom
qu on donne aux accords qui renferment les trois
principaux intervalles confonnans j, favoir, la tierce>
la quinte 6c Y octave.
On compte trois efpeces à’accords parfaits, i°i
Y accord majeur, qui joint la tierce majeure à Foâa-
: Vef, & à la quinte jufte.' 20. L'accord, mineur, où.
ces deux intervalles font accompagnés de la tierce
mineure. Et 30. Y accord diminué, compofé de Toc-'
tave, de la quinte diminuée, & de la tierce mineure^
L a première: efpece -.détermine le mode majeur ’
ou le ton dur ; ,1a fécondé, déterminé le mode mineur,
ou le ton mol; la troifieme efpece n’établit
point de mode: particulier, parce que. cet accord n’a
pas, comme les deux, autres , fon échelle diatoni-
. qué ; i l . ppurroit Ta voir fi Ton introduifoit dansla
gamme ordinaire la confonnance 6 , 7 , ou la tierce
: diminuée , que lé plus habiles mùficiens d’au jour-
d. hui mettent au rang des confonnances ( Voye^
C0NS.0NNANCE, Suppl.) Si on Ta voit admife dans
le fyfteme , il y a tiroir eu une corde que nous nommerons
bB , à placer'entre la &c j i ; elle donneroit
avec le ton fol la tierce diminuée ,■• & Y accordé ,
G , bB , feroit Y accord parfait de ce nouveau mode,-
Cet accord eft très peu différent des accords parfaits
q p i, dans les modes majeurs * tombent fur la feptieme
, & dans les modes mineurs fur la fécondé de
Téchelle diatonique. En effet, l’accord H . d , f , ne
différé pas fenfiblement de Yaccord diminué , puif-
que la. tierce d—fx z f|é, ne différé de la tierce diminuée
que d’une foix;ante-quatrieme.
Quelques muficieris font dans l’idée que tout ac-
| dont les intervalles portent les noms de tierces
& de quintes, fait une confonnance parfaite.
Suivant cette idée il faudroit que Yaccord de utA mi ‘
fo l diefe, fut parfait, tandis que la'quinte fuperflue
ut, fo l diefe fait une diffonnance dcfagreable. Les
noms ni les lignes dés notes ne décident pas de la
confonnance des accords, elle Tefulte de la jufte-
proportion des -iritervallesj
: Parla même raifon, bien que la quinte diminuée
faffe confonnance avec la tierce mineure, on ne
peut jamais.la joindre dans Yaccord parfait à là tierce
majeure. Car l’une ou 1 autre des'deux tiercés qui
refultent de cette jonction, n’appartiendroit pas au
mode principah C ’eft ce qù’obfervent fous les bons
mùficiens, qui, aufli fouvent que la tierce majeure
eft notée accidentellement au-deffus de la baffe, ne
manquent pas d’y joindre la quinte parfaite ,- quoiqu’elle
ne foit indiquée par aucun figne.
On emploie l ’accord parfait, i° . d’abord à l’entrée
de la piece de mufique, & précifém^nt fur-là to-
niqu;e » pour que l’oreille faififfe, dès le commencement
, le ton fondamental, & le ïnode principale
Dans ce feul accord l’oreille non - feulement discerne
les trois tons lés plus éflentiels de ce mode
très-diftinftemeht, mais elle entend encore confu-
fément la quinte, de lohacun de ces tons, &: par
conféquent elle connoît déjà cinq des fe.pt tons de
Téchelle. 20. A la fin de la piece, parce que cette
harmonie fait une conclusion parfaite ; à l’ouïe de
cette cadence l’oreille pleinement fatisfaite ne dé-
%é plus rien. 30. Au commencement d’une nouvelle
période , lorfque le chant paffe dans un mode
relatif, afin que l’ouïe foit frappée par les princiA
paux tons qui appartiennent, à ce mode , & qu’elle