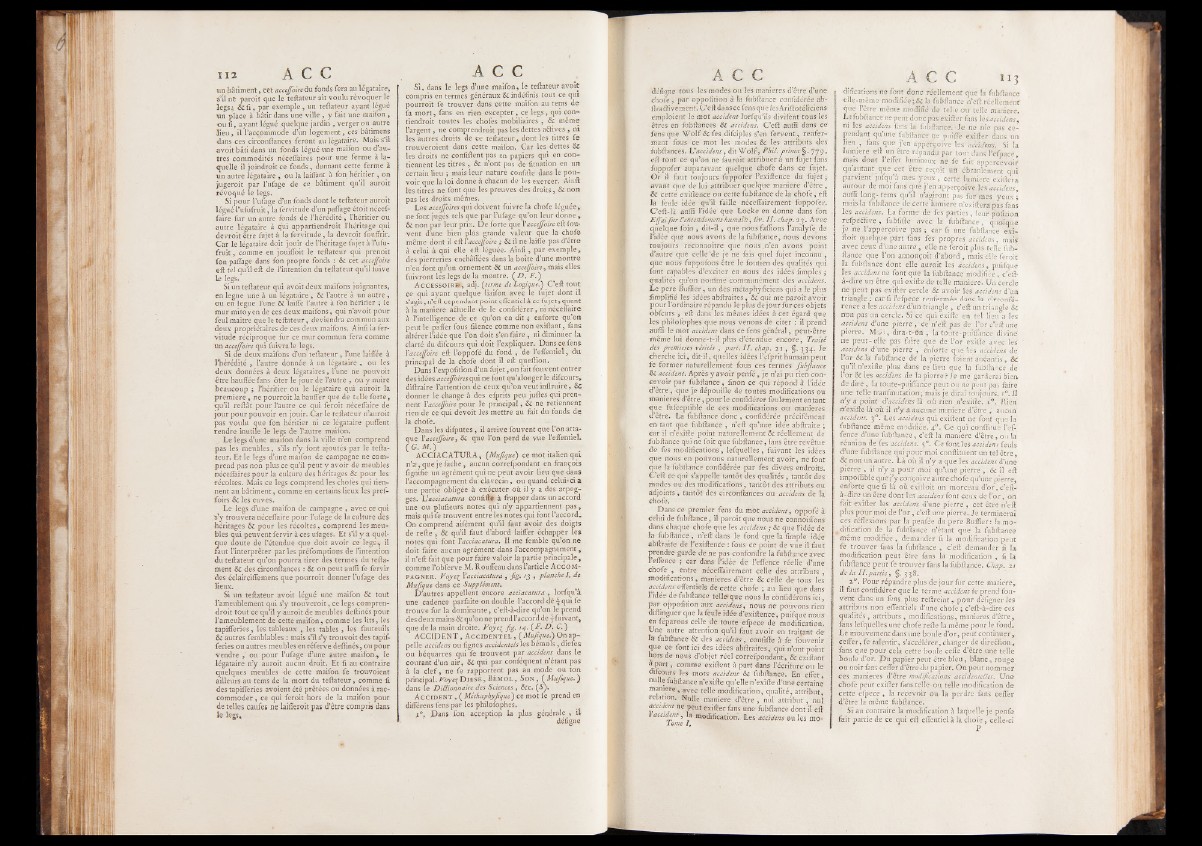
1 1 2
un «bâtiment, cet a c c e jfo ir e du fonds fera au légataire,
s'il ne paroît que le teftateur ait voulu révoquer le
legs} & f i , par exemple, un teftateur ayant légué
Un place à bâtir dans une ville , y fait une maifon ,
ou fi, ayant légué .quelque jardin , verger ou autre
lieu , il raccommode d’un logement, ces bâtimens
dans ces circonftances feront au légataire. Mais s’il
avoit bâti dans un fonds légué une maifon ou d’autres
commodités nécefîaires pour une ferme à laquelle
il ioindroit ce fonds, donnant cette ferme à
un autre légataire , ou la laiflant à fon heritier , on
jugeroit par l’ufage de ce bâtiment qu’il auroit
révoqué le legs.
Si pour l’ufage d’un fonds dont le teftateur auroit
légué l’ufufruit, la fervitude d’un pafiage étoit nécef-
faire fur un autre fonds de l’hérédité , l’héritier ou
autre légataire à qui appartiendroit l’héritage qui
devroit être fujet à la fervitude, la devroit fouffrir.
Car le légataire doit jouir de l’héritage fujet à l’ufufruit
, comme en jouiffoit le teftateur qui prenoit
fon pafiage dans fon propre fonds : & cet accejfoire
eft tel qu’il eft de l’intention du teftateur qu’il luive
le legs.
Si un teftateur qui avoit deux maifons joignantes,
en légué une à un légataire , & l’autre à un autre ,
ou en légué l’une & lailfe l’autre à fon héritier ; le
mur mitoyen de ces deux maifons, qui n’avoit pour
feul maître que le teftateur, deviendra commun aux
deux propriétaires de ces deux maifons. Ainfi la fervitude
réciproque fur ce mur commun fera comme
tin accejfoire qui fuivra le legs.
Si de deux maifons d’un teftateur, l’une laiflee à
l’hérédité , l’autre donnée à un légataire , ou les
deux données à deux légataires, l’une ne pouvoit
être hauffée fans ôter le jour de l’autre , ou y nuire
beaucoup ; l’héritier ou le légataire qui auroit la
première, ne pourroit la haufler que de telle forte,
qu’il reliât pour l’autre ce qui feroit néceflaire de
jour pour pouvoir en jouir. Car le teftateur n’auroit
pas voulu que fon héritier ni ce légataire puflent
rendre inutile le legs de l’autre maifon.
Le legs d’une maifon dans la ville n’en comprend
pas les meubles, s’ils n’y font ajoutés par le teftateur.
Et le legs d’une maifon de campagne ne comprend
pas non plus ce qu’il peut y avoir de meubles
néceflaires pour la culture des héritages & pour les'
récoltes. Mais ce legs comprend les chofes qui tiennent
au bâtiment, comme en certains lieux les pref-
foirs & les cuves.
Le legs d’une maifon de campagne , avec ce qui
s’y trouvera néceflaire pour l’ufage de la culture dés
héritages & pour les récoltes, comprend les meubles
qui peuvent fervir à ces ufages. Et s’il y a quelque
doute de l’ étendue que doit avoir ce legs-, il
faut l’interprêter par les préfomptions de l’intention
du teftateur qu’on pourra tirer des termes du tefta-
ment & des circonftances : & on peut aufli fe fervir
des éclairciflemens que pourroit donner l’ufage des
lieux. .
Si un teftateur avoit légué une maifon & tout
l’ameublement qui s’y trouveroit, ce legs compren-
droit tout ce qu’il y auroit de meubles deftinés pour
l ’ameublement de cette maifon, comme les lits, les
tapifleries, les tableaux , les tables , les fauteuils
& autres femblables : mais s’il s’y trouvoit des tapit
fériés ou autres meubles enréferve deftinés, ou pour
vendre ou pour l’ufage d’une autre maifon,, le
légataire n’y auroit aucun droit. Et fi au contraire
quelques meubles de cette maifon fe trouvoient
ailleurs au tems de la mort du teftateur, comme fi
des tapifleries avoient été prêtées ou données à raccommoder
, ce qui feroit hors de la maifon pour
de telles caufes ne laifferoit pas d’être compris dans
le legs.
S i, dans le legs d’une maifon, le teftateur avoit
compris en termes généraux & indéfinis tout ce qui
pourroit fe trouver dans cette maifon au tems de
la mort, fans en rien excepter , ce legs, qui con-
tiendroit toutes les chofes mobiliaires , & même
l’argent, ne comprendroit pas les dettes aâives , nt
les autres droits de ce teftateur, dont les titres fe
trouveroient dans cette maifon. Car les dettes 8c
les droits ne confiftent pas en papiers qui en contiennent
les titres , 8c n’ont pas de fituation en un
certain lieu ; mais leur nature confifte dans le pouvoir
que la loi donne à chacun de les exercer. Ainfi;
les titres ne font que les preuves des droits, 8c non
pas les droits mêmes.
Les accejfoires qui doivent fuivre la chofe léguée,
ne font jugés tels que par l’ufage qu’on leur donne ,
8c non par leur prix. De forte que Yaccejfoire eft fou-
vent d’une bien plûs grande valeur que la chofe
même dont il eft Yaccejfoire ; 8c il ne laiflé pas d’être
à celui à qui elle eft léguée. Ainfi , par exemple,
des pierreries enchâflees dans la boîte d’une montre
n’en font qu’un ornement 8c un accejfoire, mais elles
fuivront les legs de la montre. (D . F .)
ACCESSOIRE^, adj. {terme, de Logique.') C’eft tout
ce qui ayant quelque liaifon avec le fujet dont il
s’agit, n’ eft cependant point eflentiel à ce fujet, quant
à la maniéré âûuelle ae le confidérer, ni néceflaire
à l’intelligence de ce qu’on en dit ; enforte qu’on
peut le pafler fous filence comme non exiftant, fans
altérer l’idée que l’on doit s’en faire , ni diminuer la
clarté du difeours qui doit l’expliquer. Dans ce fens
Yaccejfoire eft l’oppofé du fond , de l’efîentiel, du
principal de la chofe dont il eft queftion.
Dans l’expofition d’un fujet, on fait fouvent entrer
des idées accejfoires qui ne font qu’alonger le difeours,
diftraire l’attention de ceux qu’on veut inftruire, 8c
donner le change à des efprits peu juftes qui prennent
Yaccejfoire pour le principal, 8c ne retiennent
rien de ce qui devoit les mettre au fait du fonds de
la chofe.
Dans les difputes , il arrive fouvent que l’on attaque
Yaccejfoire, 8c que l’on perd de vue l’eflentiel.
m m » . A CC IA C A TU R A , (Mufique) ce mot italien qui
n’a , que je fâche , aucun eorrefpondant en françois
fignifie un agrément qui ne peut avoir lieu que dans
l’accompagnement du clavecin, ou quand celui-ci a
une partie obligée à exécuter où il y a des arpeg-
ges. L’dcciacatura confifte à frapper dans un accord
une ou plufieurs notes qui n’y appartiennent pas,
mais qui fe trouvent entre les notes qui font l’accord.
On comprend aifément qu’il faut avoir des doigts
de refte , & qu’il faut d’abord laifler échapper les
notes qui font l’dcciacatura. Il me femble qu’on ne
doit faire aucun agrément dans raccompagnement,
il n’eft fait que pour faire valoir la partie principale,
comme l’obferve M. Roufleau dans l’article Accompagner.
Voye£ Yacciacatura , fig. 13 , planche I. de
Mufique dans ce Supplément.
D’autres appellent encore a c c ia c a tu r a , lorfqu’à
une cadence parfaite on double l’accord dé ■£ qui fe
trouve fur la dominante, c’eft-à-dire qu’on le prend
des deux mains 8c qu’on ne prend l’accord de yfuivant,
que de la main droite. Voye^ fig, 14. (F. D . C.)
A CC ID ENT , A cc id ent el , (M u f i q u e . ) On appelle
a c c id e n s ou lignes a c c id e n t e ls les bémols, die fes
ou béquarres qui fe trouvent par a c c id e n t dans le
courant d’un air, & qui par conféquent n’étant pas
à la c le f , ne fe rapportent pas au mode ou ton
principal. Voye^ D ie se , BÉMOL, Son , ( Mufique. )
dans le D i c t io n n a i r e d e s S c i e n c e s , &c, (<£).
Accident , ( Méthaphyfique) ce mot fe prend en
différens fens par les philosophes.
l ° f Dans fon acception la plus générale , il
défigne
A C C
défigne tous les modes ou les maniérés d’être d’une
chofe , par oppofition à la fubftanee confidérée ab-
ftra&ivement. C ’eft dansce fehs qive les Ariftotéliciens
emploient le mot accident lotfqu’iTs divifent tous les
êtres en fubftances & accidens. C’eft aufli dans ce
fens que W olf & fes difciples s’en fervent, renfermant
fous ce mot les modes & les attributs des
fubftances. L’accident, dit W o lf, Phil. prima § . 779»
eft tout' eé qu’on ne fauroit attribuer à un fujet fans
fuppofer auparavant quelque chofe dans ce fujét.
Or il faut toujours fuppofer l’exiftencè du fujet ;
avant que de lui attribuer quelque maniéré d’être ,
& cette exiftence Ou cette fubftanee delà chofe, eft
la feule idée qu’il faille néceflairement fuppofer.
C ’eft-là aufli l’idée' que Locke en donne dans fon
Effaifur C entendement humain, liv. II. chap. 23. Avec
quelque foin , dit-il: , que nous fafîions l’analyfe de
l ’idée que nous avons de la fubftanee, nous devons
toujours reconnoître que nous. n’en avons point
d’autre que celle ‘de je ne fais quel fujet inconnu,
que noti-s fuppofons être le foutien des qualités qui
font capables- d’exciter en nous des idées' Amples ;
qualités qu’on norrîme communément des accidens.
Le pere Buffier, un des métaphyficiens qui a le plus
Amplifié les idées abftraites, & qui me paroît avoir
pour l’ordinaire répandu l:e plus de jour fur ces objets
©Meurs , eft dans les mêmes idées à cet égard que
les philofophes que nous venons de citer : il prend
aufli le mot accident dans ce fens général, peut-être
même lui donne-t-il plus d’étendue encore, Traité
des premières vérités , parti I I . chap. 21 , §.334. Je'
cherche ic i, dit-il, quelles idées l’efprit humain peut
fe former naturellement fous ces termes fubfiance
& accident. Après y avoir penfé,, je n’ai pu rien concevoir
par fubftanee, fînon ce qui'répond à l’idée
d’être , que je dépouille de toutes modifications ou
maniérés d’être, pour le confidérer feulement en tant
«pie fnfeeptible de ces modifications otr maniérés
d’être. La fubftanee donc , confidérée précifément
en tant que fubftanee , n’eft qu’une idée abftraite ;
car il n’éxifte point naturellement & réellement de
fubftanee qui ne foit que fubftanee, fans être revêtue
de fes modifications, lèfquélles , fuivant les idées
que nous en poüvons naturellement avoir, ne font
que la fubllànce confidérée par fes divers endroits.
C ’eft ce qui s’appelle tantôt des qualités', tantôt des'
modes ou des modifications, tantôt des attributs ou
adjoints , tantôt des eirconftances ou accidens de la
chofe.
Dans c e premier fens du mot accident, oppofé à
celui de fubftanee, il paroît que nous ne connoifions
dans chaque chofe que les accidens ; & que l’îdée de
la fubftanee, n’eft dans le fond que la Ample idée
abftraite de Fexiftenée : fous ce point de vue il faut
prendre garde de ne pas confondre la fubftanee avec
rèflfencé ;• car dans Pidée de l’effence réelle d’une
chofe , entre néceflairement celle des attributs ,
modifications, maniérés d’être & celle de tous les
accidens effentiels de cette chofe ; au lieu que dans
l’idée dé fubftanee telle*que nous la cônfidérons ici,
par oppofition aux accidens, nous ne pouvons rien
diftinguer que la feule idée d’exiftence, puifque nous
en féparons celle d’e toute efpece de modification.
Une autre attention qu’il faut avoir en traitant de
la fubftanee & dès accidens, confifte à' fe fouvenir
que ce font ici des idées abftraites , qui n’ont point
hors de nous d’objet réel eorrefpondant, & exiftant
» p a r t, comme exiftent à part dans l’écriture ou. le
difeours les mots accident & fubftanee-. En effet,
nulle fubftanee n’exifte qu’elle n’exifie d’une certaine
maniéré , avec telle modification, qualité, attribut,
relation. Nulle maniéré d’être , nul attribut, nul
accident ne peut exifter fans une fubftanee dont il eft
1 accident, la modification.. Les « c a g o u l e s mo-
1 0111e I ,
A C C 113
dtficatrons ne font donc réellement que la fubftanee
elle-même modifiée ;& la fubftanee n’eft. réellement
^Iue l’être même modifié de telle ou telle maniéré.
La fubftanee ne peut donc pas exifter fans accidens,
ni les accidc/ïs fans la fubftanee. Je ne nie pas cependant
qu’une'fubftanee ne piriflè exifter dans un
lien , fans que j’en âpperçoive les accidens. Si la
lumière eft un être répandu par tout dans l’efpace,
mais dont l’effet lumineux ne fe fait appercevôir
qu autant que cet être reçoit tin ébranlement qui
parvient jufqu’à mes y e u x , cette lumière exiflera
autour de moi fans que j’en âpperçoive les accidens,
auffi long- tems qu’il m’agiront pas fur mes yeux ;
mais-la fubftanee de cette lumière n’exiftera'pas fans
les accidens. La forme de fes parties, leur pofiriori
refpeffive , fubfifte avec la fubftanee, quoique
je ne l’apperçoive pas ; car fi une fubftanee exi-
ftoit quelque part fans fies propres accidens, mais'
avec ceux d’une autre, elle ne feroit plus telle fub-
ftance que l’on annonçoit d’abord , mais elle feroit
la fubftanee dont elle auroit fes àccidens, puifque
lés accidens né font que la fubftanee modifiée, c’eft-
à-dire un être .qui exifte de telle manière. Un cercle
ne peut pas exifter cercle & avoir 1 es. accidens d’un
triangle ; car fi Pefpece renfermée dans la circonférence
a les accidens à\m triangle , c’eft un triangle 8c
lion pas un cerclé. Si ce qui. exifte en tel lieu a les
accidens d’une pierre, ce' rt’eft. pas de l’or c’eft une
pierre. MrJ ; , dira-t-ôn , la toute-puifiance divine
ne peut-elle pas faire que de l’ or' exifte avec les
accidens cf’tme pierre , enlbrté que les accidens de
l’or 8 tla fubftanee de la pierre fo'ient anéantis, 8S
qu’il n’exifte plus dans ce lieu que la fubftanee de
Par & les accidens de fa pierre? Je me garderai bien,
de'dire, la toute-puifiance' peut ou ne peut pas faire
une telle tranfmutafion ; mais je dirai toujours. r°. Il
rfy a point d’accidens là où rien n’exifte. i ° . Rien
n’exifte là où il n’y a- aucune maniéré d’être ,. aucun
accident. 30. Les accidens qui exiftent ne font que la
fubftanee même modifiée. 40. Ce qui conftitue Pef-
fence d’une fubftanee, c’eft la' manière d’être, ou.la
réunion de fes aàcidens. 50. Ce font les accidens feuls
d’une fubftanee qui pour moi conftituent un tel être,
8s nom un autre. Là- où il n’y â que les accidens d’une
pierre , il n’y a pour moi' qu’une pierre , 8s il eft
impoflible que' j’y conçoive autre chofe qu’une pi erre,
enforte que fi là où exiftoit un morceau d’o r , c’eft-
a-dire un être dont l'est accidens font ceux de l’o r , on
fait exifter fes accidens d’une pierre , cet être n’eft
plus pour moi de l’o r , c’ëft une pierre. Je terminerai
ces réflexions par la penfëe du pere Buffier: la rao-
j dificatiom de la fubftanee n’étant que la fubftanee
même modifiée ,. demander fi la modification peut
fe trouver fans la fubftanee , c’eft demander fi la
modification peut être fans la' modification , fi la
fubftanee peut fe trouver fans la fubftâncè. Chap. 21
de la II. partie, §.3 3 8.
2°. Pour répandre plus de jour fur cette matière,
il faut confidérer que le terme accident fe prend fou-
Vënt dans un fens plus reflreint,. pour defigner les
attributs non effentiels d’une chofe ; c’eft-à-dire ces
qualités, attributs , modifications, maniérés d’être,
fans lefqüelles une chofe refte la même pour le. fond.
Le mouvement dans Une boule d’o r, peut, continuer ,
ce fier, fe-ralentir, s’accélérer, changer de direction,
fans que pour cela cette boule cefle d’être une telle
boule d’or. Du papier peut être b leu, blanc , rouge
ou noir fans ceffer d’être du papier. On peut nommer
ces .maniérés d’être modifications accidentelles. Une
chofe peut exifter fans telle ou telle modification de
cette e f p e c é la recevoir ou- la perdre fans ceffer
d’être la même fubftanee.
Si au contraire la modification à laq'uellé je penfe
fait partie de ce qui eft eflentiel à la chofe, celle-ci
P