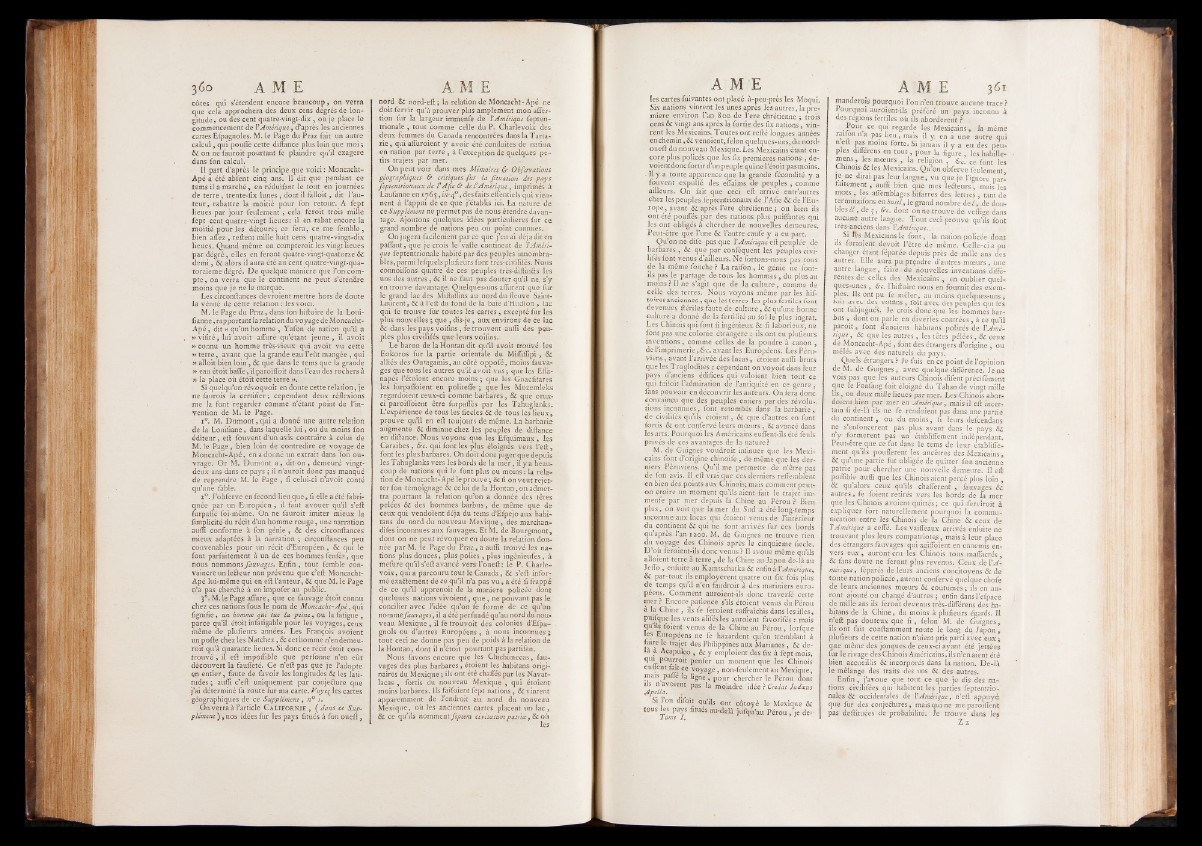
côtes qui s’étendent encore beaucoup, on verra
que cela approchera des deux cens degrés de longitude
, ou des cent quatre-vingt-dix , où je place le
.commencement de Y Amérique, d’après les anciennes
cartes Efpagnoles. M. le Page du Praz fait un autre
calcul, qui pouffe cette diftance plus loin que moi ;
& on ne fauroit pourtant fe plaindre qu’il exagere
dans fon calcul.
11 part d’après le principe que voici : Moncacht-
Apé a été abfent cinq ans. Il dit que pendant ce
tems il a marché, en réduifant le tout en journées
de terre, trente-fix lunes , dont il falloit, dit l ’auteur,
rabattre la moitié pour fon retour. A fept
lieues par jour feulement , cela feroit trois mille
fept cent quatre-vingt lieues : il en rabat encore la
moitié pour les détours; ce fera, ce me femble,
bien affez , relient mille huit cens quatre-vingt-dix
lieues. Quand même on compteroit les vingt lieues
par dégré, elles en feront quatre-vingt-quatorze &
demi, & alors il aura été au cent quatre-vingt-quatorzième
dégré. De quelque maniéré que l’on compte,
on verra que le continent ne peut s’étendre
moins que je ne le marque.
Les circonltances devroient mettre hors de doute
la vérité de cette relation : les voici.
M. le Page du Praz, dans fon hiftoire de la Loui-
fianne, rapportant la relation du voyage de Moncacht-
A p é , dit « qu’un homme , Yafon de nation qu’il a
» v ilité, lui avoit affuré qu’étant jeune, il avoit
» connu un homme très-vieux qui avoit vu cette
» terre, avant que la grande èau l’eût mangée , qui
» alloit bien loin, & que dans le tems que la grande
» eau étoit baffe, ilparoiffoit dans l’eau des rochers à
» la place où étoit cette terre ».
Si quelqu’un révoquoit en doute cette relation, je
ne faurois la certifier ; cependant deux réflexions
me la font regarder comme n’étant point de l’invention
de M. le Page.
i°. M. Dumont, qui a donné une autre relation
de la Louifiane, dans laquelle lu i, ou du moins fon
éditeur, eft fouvent d’un avis contraire à celui de
M. le Page, bien loin de contredire ce voyage de
Moncacht-Apé, en a donné un extrait dans fon ouvrage.
Or M. Dumont a , dit-on , demeuré vingt-
deux1 ans dans ce pays ; il n’auroit donc pas manqué
de reprendre M. le Page , fi celui-ci n’avoit conté
qu’une fable.
2°. J’obferve en fécond lieu que, fi elle a été fabriquée
par un Européen, il faut avouer qu’il s’efl
furpaffé foi-même. On ne fauroit imiter mieux la
fimplicité du récit d’un homme rouge, une narration
auffi conforme à fon génie , & des circonftances
mieux adaptées à la narration ; circonftances peu
convenables pour un récit d’Européen, & qui le
font parfaitement à un de ces hommes fenfés, que
nous nommons fauvages. Enfin, tout femble convaincre
un leCteur non prévenu que c’eft Moncacht-
Apé lui-même qui en eft l’auteur, & que M. le Page
n’a pas cherché à en impofer au public.
3°. M. le Page affure, que ce fauvage étoit connu
chez cès nations fous le nom de Moncacht-Apé, qui
lignifie, un homme qui tue la peine., ou la fatigue ,
parce qu’il étoit infatigable pour les voyages, ceux
même de plufieurs années. Les François avoient
un pofte chez les Natchez, & cet homme n’en demeu-
roit qu’à quarante lieues. Si donc ce récit étoit con-
trouvé , il eft impoflible que perfonne n’en eût
découvert la fauffeté. Ce n’eft pas que je l’adopte
en entier, faute de favoir les longitudes & les latitudes
; auffi c’eft uniquement par conjecture que
j’ai déterminé fa route fur ma carte. Voye% les cartes
géographiques, de ce Supplément, n° i.
On verra à l’article' C a l i f o r n i e , ( dans ce Supplément
) , nos idées fur les pays fitués à fon oueft,
nord & nord-eft ; la relation de Moncacht-Apé ne
doit fervir qu’à prouver plus amplement mon affer-
tion fur la largeur immenfe de l’Amérique fepten-
trionale , tout comme celle du P. Charlevoix des
deux femmes du Canada rencontrées dans la Tarta-
r ie, qui affuroient y avoir ,été conduites de nation
en nation par terre , à l’exception de quelques petits
trajets par mer.
On peut voir dans mes Mémoires & Observations
géographiques & critiques fur la fituation des pays
Septentrionaux de /’ A fie & de C Amérique, imprimés à
Laufanne en 1765,1/2-4°, des faits effentiels qui viennent
à l’appui de ce que j’établis ici. La nature de
ce Supplément ne permet pas de nous étendre davantage.
Ajoutons quelques idées particulières fur ce
•grand nombre de nations peu ou point connues.
On jugera facilement par ce que j’en ai déjà dit en
paffant, que je crois le vafte continent de Y Amérique
feptentrionale habité par des peuples innombrables,
parmi lefquels plufieurs font très-civilifés. Nous
connoiffons’ quatre de ces peuples très-diftin£ls les
uns des autres, & il ne faut pas douter qu’il ne. s’y
en trouve davantage. Quelques-uns affurent que fur
le grand lac des Miftaflîns au nord du fleuve Saint-
Laurent, & à l’eft du fond de la baie d’Hudfon , lac
qui fe trouve fur toutes les cartes, excepté fur les
plus nouvelles ; que , dis-je, aux environs de ce lac
& dans les pays voifins, fe trouvent auffi des peuples
plus civilifés que leurs voifins.
Le baron de la Hontan dit qu’il avoit trouvé les
Eokoros fur la partie orientale du Miffilfipi , &
alliés des Outagamis, au côté oppofé, moins fauva-
ges que tous les autres qu’il avoit vus ; que les Efla-
napés l’étoient encore moins ; que les Gnacfitares
les furpaffoient en politeffe ; que les Mozemleks
regardoient ceux-ci comme barbares, & que ceux-
ci paroiffoient être furpaffés par les Tahuglanks.
L’expérience de tous les fiecles & de tous les lieux,
prouve qu’il en eft toujours de même. La barbarie
augmente & diminue chez les peuples de diftance
en diftance. Nous voyons que les Efquimaux, les
Caraïbes , &c. qui font les plus éloignes vers l’eft,
font les plus barbares. On doit donc juger que depuis
les Tahuglanks vers les bords de la mér, il y a beaucoup
de nations qui le font plus ou moins : la relation
de Moncacht-Apé le prouve ; & fi on veut rejèt-
ter fon témoignage & celui de la Hontan, on admettra
pourtant la relation qu’on a donnée des têtes
pelées & des hommes barbus, de même que de
ceux qui vendoient déjà du tems d’Efpejo aux habi-
tans du nord du nouveau Mexique, des marchan-
difes inconnues aux fauvages. Et M. de Bourgmont,
dont on ne peut révoquer en doute la relation donnée
par M. le Page du Praz, a auffi trouvé les nations
plus douces, plus polies , plus ingénieufes, à
mefure qu’il s’eft avancé vers- l’oueft : le P. Charlevoix
, qui a parcouru tout le Canada, & s’eft informé
exactement de ce qu’il n’a pas v u , a été fi frappé
de ce qu’il apprenoit de la maniéré policée dont
quelques nations vivoient, que, ne pouvant pas le
concilier avec l’idée qu’on fe forme de ce qu’on
nommefauvages, il a été perfuadé qu’au nord du nouveau
Mexique , il fe trouvoit des colonies d’Efpa-
gnols ou d’autres Européens, à nous inconnues 5
tout ceci ne donne pas. peu de poids à la relation de
la Hontan, dont il n’étoit pourtant pas partifan.
Nous favons encore que les Chichimecas, fauvages
des plus barbares, étoient les habitans originaires
du Mexique ; ils ont été chaffés par les Navat-
laças , fortis du nouveau Mexique , qui étoient
moins barbares. Ils faifoient fept nations, & vinrent
apparemment de l’endroit au, nord du nouveau
Mexique, où les anciennes cartes placent un lac ,
&; ce qu’ils nomment feptem civitatumpatria, & où
les cartes fui vantes ont placé à-peu-près les Moqu i.
Six nations vinrent les unes après les autres, la pre-r
miere. environ l ’an, 800 de l’ere chrétienne ; trois
cens & vingt ans après la fortie des fix nations, vinrent
les Mexicains. Toutes ont refté longues années
en chemin, & venoient, félon q u e lq u e s -u n s , du nord-
oueft du nouveau Mexique. Les Mexicains étant encore
plus policés que les fix premières nations , dévoient
donc fortir d’un peuple quine l ’é to i t pas moins.
■ I l y a toute apparence que la. grande fécondité y a
fouvent expulfé des e ffaims de p eu p le s , comme
ailleurs. On fait que ceci eft arrivé entr’autres
chez les peuples feptentrionaux de l’Afie & de l’Europe,
ayant & après l’ere chrétienne; ou bien ils
ont été pouffes par dés nations plus puiffantes qui
les ont obligés à chercher de nouvelles demeures.
Peut-être que l’une & l’autre c a u fe y a eu part.
Qu’on ne dife pas que Y Amérique éft peuplée de
barbares , & que par eonféquent les peuples civilifés
font venus d’ailleurs. Ne fortons-nous pas tous
de la même fouche ? La raifon, le. génie ne font-
ils pas le partage de tous les hommes, du. plus au
moins ? Il ne s’agit que de la culture, comme de
celle des terres. Nous voyons même par les histoires
anciennes , que les terres les plus fertiles font
devenues ftérile s . fa u te de culture, & qu’une honne
culture a d o n n é de la fertilité au fol le plus ingrat..
Les Chinois qui font fi ingénieux & fi laborieux, ne
font pas une colonie ' étrangère : ils ont eu plufieurs
inventions., comme celles de la poudre à canon ,
de l’imprimerie , &c. avant les Européens. Les Péruviens
».avant l’arrivée des Incas, étoient auffi bruts
que les Troglodites : cependant on voyoit dans leur
pays d’anciens édifices qui v a lo ie n t bien tout ce
qui faifoit l’admiration de l’antiquité en ce genre,
fans pouvoir en découvrir les auteurs. On fera donc
convaincu que des peuples entiers par des révolu-,
rions inconnues, fönt re tom b é s dans la barbarie,
de civilifés qu’ils étoient, & que d’autres en font
forfis & ont.confervé leurs moeurs, & avancé dans
les arts. Pourquoi les Américains euffent-ils été feuls
privés de ces avantages de la nature ?
M. de Guignes voudroit infinuer que les Mexicains
font d’origine chinoife, de même que les derniers
Péruviens. Qu’il me permette de n’être pas
de fon avis. Il eft vrai que ces derniers reffemblent
en bien des points aux Chinois; mais comment peut-
on croire un moment qu’ils aient fait le trajet im-
menfepar mer depuis la Chine au Pérou ? Bien
plus, on voit que la mer du Sud a été long-temps
inconnue aux Incas qui étoient venus de l’intérieur
du continent & qui n e font arrivés fur ces bords
qu’après l’an 1200. M. de Guignes ne trouve rien
du voyage des Chinois après le cinquième fiecle.
D ’où fe ro ie n t - ils donc venus ? Il avoue même qu’ils
alloient terre à terre, de la Chine au Japon de-là au
Jeffo , énfuite au Kamtschatka & enfin à l’Amérique,
& par-tout ils employèrent quatre ou fix fois plus
de temps qu’il n’en faudroit à des mariniers européens.
Comment auroient-ils donc traverfé cette
mer ? Encore patience s’ils étoient venus du Pérou
à la Chine , ils fe feroient raffraîchis dans les ifles,
puifque les vents alifés les auroient favorifés : mais
qu’ils foierit venus de la Chine au Pérou, lorfque
les Européens ne fe hazardent qu’en tremblant à
n traîet ^es Philippines a u x Marianes, & delà
à Acapulco , & y emploient des fix à fept mois,
qui pourroit penfer un moment que les Chinois
euffent fa i t ce voyagé, non-feulement au Mexique,
mais^ paffe la ligne , pour chercher le Pérou dont
ils n avoient pas la moindre idée ? Credat Judaus
Apclla.
Si Ion difoit qu’ils ont côtoyé le Mexique &
tous les pays finies au-delà jufqu’au Pérou, je de-
Tome I . - ’
manderois pourquoi l’on n’en trouve aucune trace ?
Pourquoi auroient-ils préféré un pays inconnu à
des.régions fertiles où ils abordèrent ?
..Pour ce qui regarde les Mexicains,, la même
raifon n a pas lieu, mais il y. en à une autre qui
n eft pas moins forte. Si jamais il y a eu des peu-
; pies différons en tou t, pour la figure, les habille-
mens , les moeurs , la religion , &c. ce. font les
Chinois & les Mexicains. Qu’on obferve feulement
je ne dirai pas leur langue, vu que je l’ignore parfaitement
, auffi bien que mes lecteurs, mais les
mots, les affemblages bifarres des lettres , tant de
j:erminaifons en huit/, le grand nombre de/, de doubles//,
de £, &c. dont on ne trouve de. veftige dans
aucune autre langue. Tout ceci prouve qu’ils font
très-anciens dans Y Amérique..
Si lés Mexicains le font, la nation policée dont
us fortoient devoit l ’être de même. Celle-ci a pu
changer étant fié parée depuis près dé mille ans des
autres. Elle aura pu prçndre d’autres moeurs , une
autre langue, faire - de nouvelles inventions différentes
de celles des Mexicains , en oublier quelques
unes , &c. l’hiftoire nous en fournit des exemples.
Us. ont pu fe mêler, au moins quelques-uns ,
loit avec des^ voifins , foit avec des peuples qui les
ont fuhjugues. Je crois donc que les hommes barbus
dont on parle en diverfes contrées , à ce qu’il
paroît, font d’anciens. habitans. policés de. VAmé-
rique, & que les autres , les têtes pelées, & ceux
d‘e^Moncacht-Apé, font dés étrangers d’origine , ou
mêlés avec des naturels du pays.
Quels étrangers ? Je fuis en ce point de. l'opinion
de M. de Guignes , avec quelque différence. Je ne
vois pas que les auteurs Chinois difent précifément
que le Fonfang foit éloigné du Tahande vingt mille
1rs, ou deux mille lieues par mer. Les Chinois abor*
dolent bien par nier en Amérique, mais il eft incertain
fi de-rlà ils ne fe rendoient pas dans une partie
du continent , ou du moins, fi leurs aefeendans
ne s’enfoncèrent pas plus avant dans le pays &
n’y formèrent pas un établiffement indépendant.
Peut-être que ce fut dans le tems de leur établiffement
qu’ils pouffçrent les ancêtres des Mexicains,
& qu’une partie fut obligée de quitter fon ancienne
patrie pour chercher une nouvelle demeure. II eft
poffible auffi que les Chinois aient percé plus loin ,
& qu’alors ceux qu’ils chafferent , fauvages &
autres, fe foient retirés vers les bords de la mer
que les Chinois avoient quittés; ce qui .ferviroit à
expliquer fort naturellement pourquoi la commu-.
nication entre les Chinois de la Chine & ceux de
Y Amérique a ceffé. Les vaiffeaux arrivés enfuite ne
trouvant plus leurs compatriotes, mais à leur place
des étrangers fauvages qui agiffoient.en ennemis envers
eu x , auront cru les Chinois tous maffaçrés,
& fans doute ne feront plus revenus. Ceux de YA-
mèrique, féparés de leurs anciens concitoyens & de
toute nation policée, auront confervé quelque chofe
de leurs anciennes moeurs & coutumes ; ils en auront
ajouté ou changé d’autres ; enfin dans l’efpace
de mille ans ils feront devenus très-différens des habitans
de la Chine, du moins à plufieurs égards. Il
n’eft pas douteux que f i , félon M. de Guignes,
ils ont fait conftamment route le long du Japon ,
plufieurs de cette nation n’aient pris parti avec eux ;
que même des jonques de ceux-ci ayant été jettées
fur le rivage des Chinois Américains, ils n’en aient été
bien accueillis & incorporés dans la nation. De-là
le mélange des traits des uns & des autres.
Enfin, j’avoue que tout ce que je dis des nations
civilifées qui habitent les. parties feptentrio-
nales & occidentales de Y Amérique, n’eft appuyé
que fur des conjectures, mais qui ne me paroiffent
pas deftituées de probabilité. Je trouve dans les
Z z